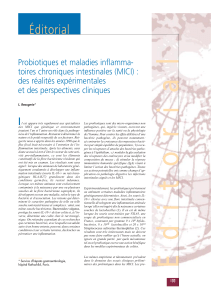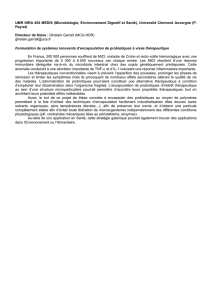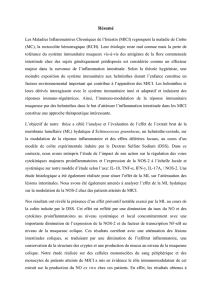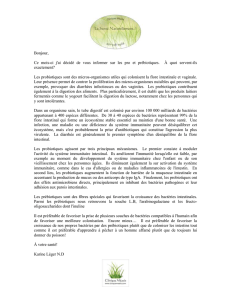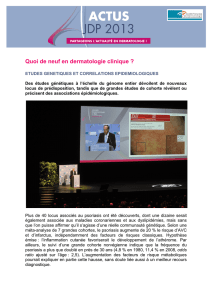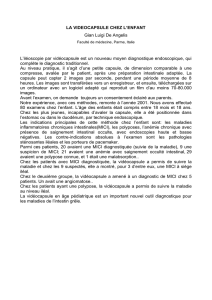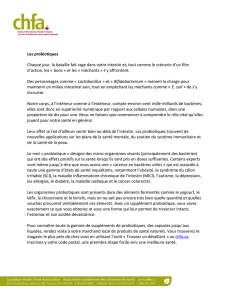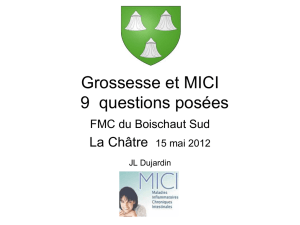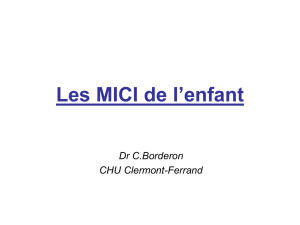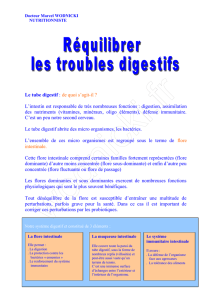Tableau : Résultats des essais contrôlés testant l`efficacité de

1
BACTERIES ET MALADIES INFLAMMATOIRES DE L’INTESTIN
Philippe Seksik
Service d’Hépato-Gastroentérologie Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France
[email protected]paris.fr
L’écosystème du tractus digestif est caractérisé par une importante biodiversité.. En raison des
variations des conditions physico-chimiques, la microflore subit des modulations importantes
qualitatives et quantitatives tout au long du tube digestif. C’est au niveau du côlon que les populations
microbiennes sont les plus abondantes, avec environ 1011 bactéries par gramme de contenu. On
individualise une flore dominante (en nombre supérieur à 108 bactéries par gramme de contenu)
composée d’espèces anaérobies strictes des genres Bacteroides, Eubacterium, Bifidobacterium,
Peptostreptococcus, Ruminococcus et une flore sous-dominante constituée principalement de bactéries
anaérobies facultatives qui sont 100 à 1000 fois moins représentées (Lactobacillus, Streptococcus et
entérobactéries). La microflore associée aux muqueuses a été moins étudiée et représente une niche
écologique de bactéries plus ou moins profondément enchâssées dans le mucus voire adhérentes à la
paroi colique et ainsi à proximité des cellules de l’hôte. Il existe trois difficultés majeures pour l’études
de ces écosystèmes : 1) l’accès à l’écosystème que l’on veut étudier, ce qui nécessite des techniques
d’échantillonnage adaptées, 2) l’impossibilité de cultiver l’ensembles des bactéries intestinales ce qui
requiert des techniques indépendantes de la culture, 3) la variabilité inter-individuelle de la microflore
digestive. Pour palier les difficultés liées à la cultures, une discipline émergeante, l’écologie
moléculaire, a développé des outils basés sur la détection de bio-marqueurs tels que les ARN
ribosomaux 16S. Cette molécule possède des caractéristiques qui ont permis la descritpion
d’écosystèmes complexes et l’avènement d’une nouvelle taxonomie moléculaire complémentaire de la
taxonomie phénotypique classique. A partir d’échantillons (selles et/ou biopsies digestives) plusieurs
techniques telles que la TTGE (Temporal Temperature Gradient-gel Electrophoresis ou électrophorèse
en gradient dénaturant de température) et l’hybridation in situ ou en dot-blot permettent d’analyser la
composition en groupes phylogénétique et la biodiversité d’écosystèmes digestifs. La microflore fécale
a ainsi été étudié et paraît remarquablement stable au cours du temps chez un même sujet. La flore du
caecum diffère de la flore fécale (représentative du côlon distal) ; elle contient moins de bactéries et
une proportion plus importante de bactéries anaérobies facultatifs (entérobacteries).
Le rôle délétère de certains micro-organismes de la flore intestinale et de la réponse
immunitaire intestinale est démontré au cours des (MICI). Les arguments incriminant la microflore
digestive dans les MICI peuvent être énoncés comme suit : a) les lésions surviennent au lieu de
concentration élevée de bactéries (iléo-côlon), b) la microflore est nécessaire au déclenchement des
lésions sur des modèles de colites expérimentales, c) il existe un modèle animal de transfert de colite
par lymphocytes T réactifs vis-à-vis d’antigènes bactériens, d) le rôle du chyme dans la récidive
postopératoire de la maladie de Crohn est clairement démontré, e) il existe une rupture de tolérance
immunitaire au cours des poussées de MICI, f) il existe des anticorps anti-microorganismes chez les
patients atteints de MICI, g) l’efficacité dans certaines conditions (récidive post-opératoire, pochite) de
traitements visant à modifier la microflore digestive (antibiotiques, probiotiques ou prébiotiques).
L’étude de la microflore digestive au cours des MICI peut être envisagées selon deux axes différents :
l’étude d’un micro-organisme candidat ou une stratégie de description globale. La deuxième stratégie a
permis de montrer qu’il existe des différences entre les écosystèmes digestifs des sujets atteints de
MICI et les sujets sains, caractérisées par : a) une grande instabilité de la flore luminale, b) l’émergence
des entérobactéries dans la flore dominante au cours des MICI (en rémission), c) le rôle possible de

2
Bacteroides viulgatus, d) la présence de bactéries (et en premier lieu les entérobactéries) dans le mucus
ou associées au muqueuses en concentration plus importante au cours des MICI que chez des sujets
sains. La modification de l’écosystème digestif par des bactéries non pathogènes apparaît être une
approche thérapeutique séduisante au cours des MICI. Les probiotiques se définissent comme des
micro-organismes non pathogènes qui, ingérés vivants, exercent une influence positive sur la santé ou
la physiologie de l’hôte. Certains de leurs effets peuvent être dus à une modulation de l’écosystème
intestinal mais d’autres sont directs (par des enzymes qu’ils contiennent ou des produits de sécrétion)
ou indirects par leur influence sur le système immunitaire. Des travaux expérimentaux ont montré que
des probiotiques pouvaient aider à prévenir ou améliorer des colites expérimentales chez l’animal.
Chez l’homme, il existe plusieurs essais randomisés et contrôlés utilisant des probiotiques afin de
traiter diverses situations de MICI (cf. tableau ).
En conclusion, la microflore endogène joue probablement un rôle dans le développement de toutes les
colites y compris les MICI. L’hypothèse d’une réaction « anormale » à une microflore endogène ouvre
des voies de recherche intéressantes pour la compréhension des mécanismes physiopathologiques
(relation flore-hôte), et pour le développement de nouvelles cibles thérapeutiques.
Tableau : Résultats des essais contrôlés testant l’efficacité de probiotiques dans diverses
situations de MICI
Situation
Probiotique
Contrôle
n
Durée
Rechutes
probiotique
Rechutes
contrôle
P
Réf
RCH
E. coli Nissle
1917
5-ASA 1,2
g/j
120
4 mois
16 %
11,3 %
NS
Kruis
1997
RCH
E. coli Nissle
1917
5-ASA 1,2
g/j
120
12 mois
67 %
73 %
NS
Rembacken
1999
RCH
E. coli Nissle
1917
5-ASA 1,5
g/j
222
12 mois
36,4 %
33 %
NS
(equ)
Kruis
2001 (abtrs)
RCH
S. boulardii +
5-ASA
5-ASA seul
31
12 mois
30 %
35 %
NS
Copacci
2000 (abstr)
Pochite
réfractaire
VSL #3
placebo
40
9 mois
15 %
100 %
<0,05
Gionchetti
2000
Pochite
réfractaire
VSL #3
placebo
36
12 mois
15 %
94 %
<0,05
Kamm
2002 (abstr)
AIA, prévention
de pochite
VSL #3
placebo
40
12 mois
10 %
40 %
<0,05
Gionchetti
2003
MC, prévention
postopératoire
VSL #3
5-ASA
28
12 mois
20 %
40 %
<0,05
Campieri
2000 (abstr)
MC
E. coli Nissle
1917
placebo
28
12 mois
30 %
70 %
<0,05
Malchow
1995
MC
S. boulardii +
5-ASA
5-ASA seul
28
6 mois
6,3 %
37,5 %
<0,05
Guslandi
2000
MC, prévention
postopératoire
L. rhamnosus
GG
placebo
45
12 mois
60 %
35 %
NS
échec
Prantera
2002
RCH : rectocolite hémorragique
MC : maladie de Crohn
AIA : anastomose iléo-anale
5-ASA : acide 5-aminosalicylique
1
/
2
100%