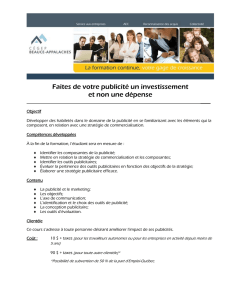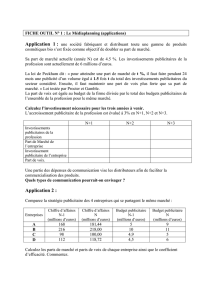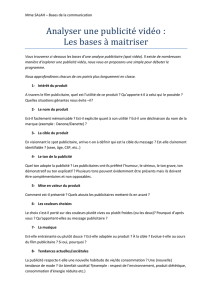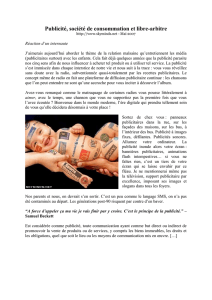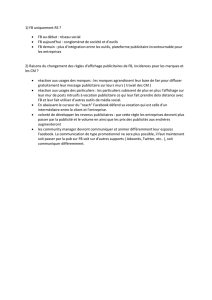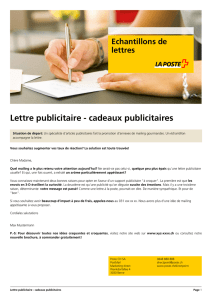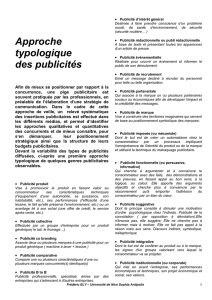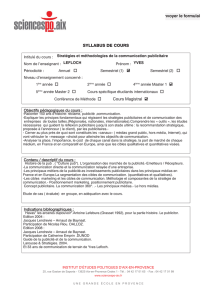Louise Courtemanche Convergence des médias et comportement

Louise Courtemanche
Doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication,
Chercheuse au Centre de Recherche sur les Médias, Université de Metz
FRANCE
Convergence des médias et comportement du consommateur: la
publicité en mutation?
NOTA BENE
_________________________________________________________
L'accès aux textes des colloques panaméricain et 2001 Bogues est exclusivement réservé aux participants.
Vous pouvez les consulter et les citer, en respectant les règles usuelles, mais non les reproduire.
Le contenu des textes n'engage que la responsabilité de leur auteur, auteure.
Access to the Panamerican and 2001 Bugs' conferences' papers is strictly reserved to the participants. You
can read and quote them, according to standard rules, but not reproduce them.
The content of the texts engages the responsability of their authors only.
El acceso a los textos de los encuentros panamericano y 2001 Efectos es exclusivamente reservado a los
participantes. Pueden consultar y citarlos, respetando las pautas usuales, pero no reproducirlos.
El contenido de los textos es unicamente responsabilidad del (de la) autor(a).
O acesso aos textos dos encontros panamericano e 2001 Bugs é exclusivamente reservado aos partici-pantes.
Podem consultar e cita-los, respeitando as regras usuais, mais não reproduzí-los.
O conteudo dos textos e soamente a responsabilidade do (da) autor(a).

Communication
Colloque 2001 Bogues – Globalisme et Pluralisme
Section « Etudes et expériences sectorielles »
Convergence des médias et comportement du consommateur: la publicité en mutation?
Louise Courtemanche, Doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication,
Chercheuse au Centre de Recherche sur les Médias, Université de Metz, France
Le phénomène de globalisation, que préconisait Theodore Levitti de la Harvard Business School
a également touché au monde publicitaire. M. Levitt affirmait que les différences culturelles
disparaissaient, que les goûts et désirs de tous les peuples du monde devenaient remarquablement
semblables et il encourageait les entreprises à ne fabriquer que des produits et services
standardisés, à ne concevoir que des campagnes publicitaires uniques pour tous les marchés du
monde. Les médias de masse, se prêtant bien à la diffusion d’un message unique pour des milliers
de consommateurs, constituaient et constituent toujours la relation privilégiée de communication
entre le producteur et les consommateurs. Pourtant, de nombreux débats sur la
globalisation/segmentation et l’uniformisation des cultures ont rapidement succédé à la thèse de
Théodore Levitt, propulsant le domaine de la publicité au centre de la controverse : fallait-il
adapter le message publicitaire ? Ce débat se poursuit encore aujourd’hui alors qu’on assiste
depuis plusieurs décennies à une montée en puissance très précipitée des « nouvelles technologies
de l’information et de la communication » qui permettent une segmentation extrême du marché,
une relation individuelle et personnalisée avec chaque consommateur. En très peu de temps, les
entreprises, les publicitaires et les consommateurs ont été confrontés à des techniques de
communication radicalement différentes, sous l’augure d’une nouvelle société de la
communication qui allait tout changer à travers la convergence des médias et l’interactivité: la
façon de communiquer, de consommer, de se divertir. Plusieurs définitions de la convergence des
médias circulent: superposition des télécommunications, de la télévision et d’Internet, ce qui
engendre la télévision interactive ou la WebTV ; la combinaison de plusieurs dispositifs
techniques, par exemple le téléphone portable assorti d’un agenda électronique, doublé d’un
lecteur MPEG4 et d’une caméra numérique… ; ou encore l'interaction entre divers supports
médiatiques (par exemple le renvoi à un site Internet dans une émission de télévision)ii. Mais peu

importe la définition à laquelle on adhère, cet engouement pour les nouveaux médias interactifs
suscite de nombreux discours tant au niveau académique que professionnel. Selon Dominique
Wolton, « La mode pour les médias thématiques, puis interactifs, ne constitue pas un
« dépassement » de la problématique des médias de masse, elle constitue plutôt une adaptation à
l’évolution actuelle, vers une individualisation des goûts et des comportements. »iii Les propos de
Vincent Mabillot renforcent cette notion, affirmant que « l’interactivité marque une rupture entre
une culture de masse et une culture de l’individu. »iv
Les professionnels du marketing observent et tentent de comprendre cette culture de l’individu, la
« Net Generation », comprenant les jeunes entre 10 et 19 ans. Ils prétendent que cette tranche de
la population nord-américaine vit Internet et les médias interactifs plutôt qu’elle ne les subit.
Grâce à son accès à Internet, sa participation aux forums de discussion ou aux « chat », cette
génération fait preuve d’un niveau plus élevé de connaissances, d’articulation et d’exigences que
la génération précédente au même âge. Une récente étudev auprès de cette cible a également
signalé quelques différences frappantes entre la génération 25-45 ans et la « Net Generation ».
Alors que les 25-45 ans adoptent entre autres l’ordinateur, Internet, le téléphone mobile, la Net
Generation les internalise. Cette tranche de la population utilise les nouvelles techniques de
communication sans y penser. S’attendant à des produits évolutifs et personnalisables, habitués
au partage de fichiers et de contenus, effectuant systématiquement plusieurs tâches à la fois,
l’attention de cette nouvelle génération devient plus difficile à capter. Exposés à des centaines de
messages publicitaires par jour, le récepteur/consommateur a développé une certaine capacité à
ne pas être influencé. Selon les discours professionnels, la convergence des médias et
l’interactivité bousculent donc non seulement les usages du dispositif médiateur mais également
les comportements des consommateurs face aux informations qui leur sont présentées.
L’émergence de la publicité interactive, sur ordinateur ou à la télévision, donne au récepteur de
nouvelles possibilités d’agir ou de réagir en temps réel.
Comme la technologie progresse toujours plus rapidement que les pratiques sociales et
culturelles, qu’elle incarne auprès de la population le progrès et la modernité, et qu’elle suscite
dans le cas des technologies de la communication une grande polémique, il a semblé opportun de
comparer les discours académiques et professionnels autour des théories de la communication et

des pratiques actuelles de la communication publicitaire. Par le biais d'entretiens, les propos
d’une vingtaine de ces professionnels de la communication ont été recueillisvi.
Les dicours autour de la publicité
Une logique principalement économique
Parmi les porte-parole du champ professionnel de la publicité, on recense principalement les
annonceurs, les publicitaires et les journalistes. Dans ce milieu, la vision économique, la
« logique de communication marchande »vii, domine la façon de penser la communication
publicitaire et influence les moyens de production des connaissances ainsi que les discours. Pour
les annonceurs, les difficultés principales consistent généralement à trouver un moyen efficace
d’atteindre et d’influencer les cibles de prédilection, avec un budget pré-déterminé et à travers
une stratégie de standardisation ou de différenciation selon les caractéristiques socio-culturelles
des segments visés. L’agence de communication, quand à elle, intervient habituellement dans la
conception de la publicité et le média-mix (choix des supports médiatiques, budgétisation, etc.).
Les impératifs d’efficacité de la publicité, le souci d’augmentation des ventes et les études de
comportement du consommateur propulsent une grande partie des discours professionnels. La
Fédération des Professionnels de la Communicationviii du Luxembourg, une association à but non
lucratif, résume bien cette situation à travers la description de sa raison d’être : « faire progresser
les connaissances et l'efficacité des pratiques dans les domaines du marketing, de la publicité et
des relations publiques, ainsi que des communications économiques et sociales en général ». Et
comme l’affirme avec conviction le responsable d’une agence de communication au
Luxembourg : « Tout ce qui est à message utile, et qui crée de l’émotion en faisant grimper le
chiffre d’affaire du client, c’est du bon travail. »
L’organisation du marché de la publicité
Au Luxembourg, les premières agences de publicité sont apparues à la fin des années 50, souvent
issues du monde journalistique, mais ce n’est que depuis la fin des années 80 qu’une réelle
expansion du marché publicitaire a débuté. Aujourd’hui, on recense 214 agences de
communication (les autorités délivrant les autorisations de commerce englobent un éventail très

large de métiers touchant de près ou de loin le monde de la communication, de la vente de pins à
la gestion de la stratégie intégrée de communication). Cependant, dans ce pays de 2586 km carrés
et 441,000 habitants, affichant trois langues officielles ainsi que plus de 37% de population
étrangèreix, seules une vingtaine d’agences sont considérées comme étant « sérieuses ».
Les particularités du marché luxembourgeois et les barrières à l’entrée feront qu’elles
échapperont partiellement à la tendance mondiale des méga-fusions des années 80: on dénombre
une seule fusion de deux agences locales, un partenariat avec une agence mondiale (Publicis) et
une adhésion à un réseau pan-européen. Les agences internationales sont quasi-absentes du
paysage luxembourgeois. Le débat globalisation/segmentation prend néanmoins une dimension
importante puisque d’une part, les puissants annonceurs ayant souvent opté pour la
standardisation de leurs messages conçoivent des campagnes publicitaires en supposant que le
Luxembourg pourra très bien s’intégrer à la Belgique ou à la France, alors que les cibles
luxembourgeoises présentent des particularités culturelles qui nécessitent une adaptation de la
publicité. D’autre part, la diversité des cultures sur un si petit territoire et les budgets restreints
(15 fois moins que les budgets en France pour une campagne similaire) contraignent les agences
à adopter une seule langue véhiculaire, souvent une langue seconde ou même tertiaire pour la
plupart des habitants, ce qui pose des difficultés quant à la réception du message, risquant de
réduire ou même d’anéantir l’impact souhaité.
Des théories et des pratiques
La publicité est une discipline qui se positionne aujourd’hui à l’intersection des sciences de
l’information et de la communication et des sciences de gestion et doit en permanence s’adapter à
de nouvelles situations et contraintes. Mais les pratiques professionnelles puisent-elles dans les
recherches et les théories en sciences de l’information et de la communication ?
Eric Fouquier, un publicitaire de Paris répond partiellement à cette question : « A la différence
des systèmes déterministes (sujet en tant que récepteur passif), les systèmes relativistes (sujet en
tant que récepteur actif) sont presque absents de notre champ professionnel, et ils n’ont donné
presque aucun outil qui compte pour nous… »x A la lumière de ces propos, nous pouvons inférer
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%