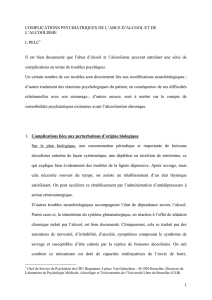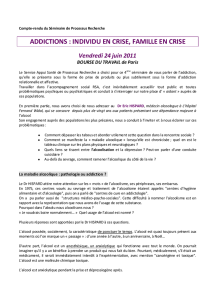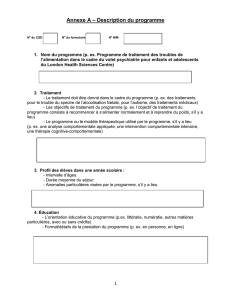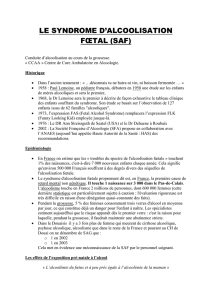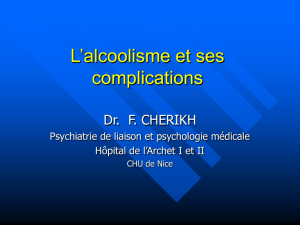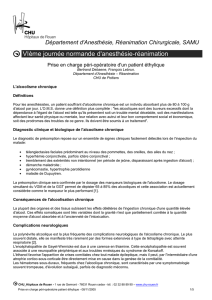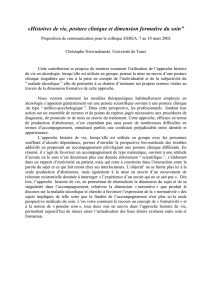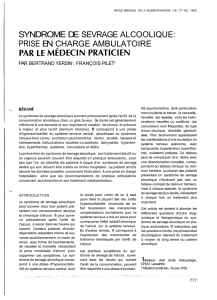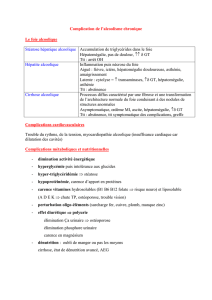Lire l'article complet

111
La dépendance alcoolique peut se définir de
façon simple. Il s’agit de la perte de liberté
vis-à-vis d’un produit, l’alcool. Avec cette
perte de liberté, le sujet ne peut plus consom-
mer de façon maîtrisée, il a du mal à limiter sa
consommation, consommer sans consé-
quences néfastes devient difficile.
Cette perte de liberté est au cœur de la pro-
blématique alcoolique. Paradoxalement,
c’est pourtant à la liberté qu’il faut faire
appel pour traiter le problème alcoolique.
Une fois la dépendance installée, seule la
mobilisation de cette liberté pourra appor-
ter au sujet une solution.
Il n’existe pas une dépendance physique et
une dépendance psychologique. La dépendan-
ce est un comportement lié à cette perte de
liberté. Un comportement n’est ni physique ni
psychologique, il résulte plutôt d’une façon
d’être globale et complexe qui ne permet pas
de distinguer le physique du psychologique.
Ce comportement met en question le corps
considéré dans sa globalité, aussi bien dans
son aspect physiologique que dans son propre
vécu. Si l’on définit ainsi la dépendance, tout
au plus peut-on distinguer des signes phy-
siques de dépendance (comme les tremble-
ments ou autres signes qui résultent du sevra-
ge) et des signes psychologiques (comme le
désir de boire). Ces signes ne disent rien sur le
degré de dépendance face au produit. Pour
apprécier ce degré, il faudrait apprécier la
capacité de liberté face au produit. Ces signes
n’ont qu’une valeur relative, car il est néces-
saire de faire la part des signes dus au sevrage
de ceux dus à l’intoxication proprement dite.
Ces signes sont physiques mais aussi cogni-
tifs, intellectuels, comportementaux.
Si l’on se réfère à la liberté, il n’y a pourtant
pas de dépendance sans dépendance “psycho-
logique” mais celle-ci est étroitement liée à
l’action proprement physique et biologique du
produit sur le cerveau.
Dans les addictions sans produit, il n’existe
pas davantage de clivage entre le psycholo-
gique et le biologique. Là aussi, la perte de
liberté résulte d’une modification du fonction-
nement du cerveau, même si l’origine en est
interne et non plus extérieure à l’organisme.
La distinction entre intérieur et extérieur elle-
même est relative puisque nous savons que le
cerveau produit lui-même des substances
opiacées.
Cette modalité de l’action directe de l’alcool
sur le cerveau distingue la dépendance alcoo-
lique des autres addictions ne relevant pas de
l’action directe d’un produit. Pourtant les deux
formes d’addiction ont des points communs
dont celui qui compte le plus reste la perte de
liberté liée à un objet. Dans l’alcoolisme
s’ajoute la toxicité directe du produit sur les
cellules.
La dépendance alcoolique serait irréversible
une fois installée. Cela est une règle assez
générale sur laquelle s’appuie le traitement de
cette dépendance. Cette irréversibilité devrait
s’expliquer par des modifications biologiques,
elles-mêmes irréversibles. Pourtant, il arrive
de rencontrer de vieux alcooliques qui, après
une très longue période d’abstinence, pour-
raient se remettre à boire sans conséquence
néfaste et qui pourraient contrôler leur
consommation. Cette irréversibilité existe-t-
elle dans les autres addictions sans produit ?
La réversibilité, dans ces cas qui restent assez
rares, sous-entendrait une certaine plasticité
du fonctionnement cérébral.
La cause, c’est l’effet !
L’alcoolique tient un certain discours pour
expliquer son alcoolisation. Le discours de
l’alcoologue ne doit pas se calquer sur le
sien ! On rencontre là un type de raisonne-
ment métaphysique, celui des causes et des
effets : “Une cause produit un effet” et “Un
effet a une cause”. En matière d’alcoolisation,
nous avons seulement des facteurs d’alcooli-
sation et non des “causes”. Il est indispensable
de distinguer les deux : c’est ce que ne peut
pas faire l’alcoolique sous l’influence du pro-
duit car son raisonnement est troublé, son
jugement perturbé au point qu’il prend les
effets de son alcoolisation pour des causes.
Son jugement est d’ailleurs si troublé qu’il est
parfois incapable de s’appréhender lui-même
comme un buveur qui boit pour obtenir les
effets de l’alcool, car ce sont bien ces effets
qui sont la véritable “cause” de son alcoolisa-
tion. Cette position a souvent été qualifiée de
“déni”, terme emprunté à la psychologie ou à
la psychanalyse, dont l’inconvénient est qu’il
évacue la compréhension simple de ce qui se
passe, en réalité, pour le sujet alcoolo-dépen-
dant : l’alcool perturbe ses fonctions cogni-
tives au point qu’il est incapable de se voir, de
prendre du recul par rapport à lui-même, tout
simplement de “penser” sa position. Ce travail
de réflexion est rendu impossible par le pro-
duit. Cette incapacité est à mettre sur le même
plan que les autres troubles cognitifs induits
par l’alcool : troubles du jugement, de la
mémoire, de l’attention etc. D’ailleurs, ces
troubles cognitifs disparaissent plus ou
moins rapidement (souvent rapidement),
lorsque cesse l’intoxication. Le patient est
alors tout à fait en mesure d’appréhender la
Alcool, paradoxes
Alain Fournier*
Dans ce texte, nous allons faire référence à notre expérience de
psychiatrie menée depuis quelques années dans le cadre d’un
CCAA. Il s’agit d’une réflexion de terrain qui ne prétend pas à
l’exhaustivité ni à une théorisation approfondie. La pratique de
l’alcoologie dans ce cadre ne peut pas ouvrir sur une vue globa-
le du problème de l’alcool : elle reste limitée, ne serait-ce qu’en
raison de la sélection des patients qui viennent nous consulter.
Nous aborderons essentiellement le problème de la dépendance
plus que celui des consommations à risques. Nous croyons en
réalité que les deux problématiques sont assez proches et que
l’approche de prise en charge qu’elles demandent ne diffèrent
que de quelques nuances.
* CCAA (centre de cure ambulatoire en alcoo-
logie), 17, avenue du Maréchal-Juin, 77000
Melun.
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s

112
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
Le Courrier des addictions (4), n° 3, juillet/août/septembre 2002
situation dans laquelle il se trouvait quelque
temps auparavant.
Pour ces raisons, le discours sur les causes
est un discours sous l’influence de l’alcool.
Toutefois, il existe des facteurs spécifiques
d’alcoolisation (voir l’article “Le patient
alcoolisé”). La différence entre facteurs et
causes est très grande. Les “causes” seraient
déterminantes alors que dans la prise du pro-
duit, en aucun cas les facteurs ne le sont. À la
limite, un sujet peut présenter tous les fac-
teurs de risque d’alcoolisation et ne pas
boire. Cette situation se rencontre assez fré-
quemment chez les alcooliques sevrés et abs-
tinents. Pour certains d’entre eux, tout va mal
après l’abstinence (femme partie, enfants
ingrats, chômage, finances à zéro, etc.) et
pourtant ces patients maintiennent leur absti-
nence, bien qu’ils puissent présenter plus de
facteurs d’alcoolisation après qu’avant ! Leur
motivation à ne pas boire peut être alors
beaucoup plus forte qu’elle n’a jamais été et
aucune “cause”, aucune “raison” ne pourront
la faire céder !
Traiter la pathologie alcoolique
en priorité
La pathologie psychiatrique associée à l’al-
coolisation est le plus souvent secondaire à
cette alcoolisation et rarement primitive.
Même dans ce dernier cas, elle reste un fac-
teur et non une cause déterminante. Le plus
souvent, la pathologie psychiatrique
(dépression, angoisse, phobie, voire délire)
cesse ou s’améliore considérablement avec
l’arrêt du produit et ne peut, quoi qu’il en
soit, être prise en charge correctement que si
la pathologie alcoolique est traitée pour elle-
même. En effet, il est difficile, voire souvent
impossible, de traiter la pathologie psychia-
trique en dehors de l’abstinence. C’est pour-
quoi la pathologie alcoolique doit être traitée
pour elle-même et prioritairement sans
attendre une résolution du problème psychia-
trique laquelle risque de ne jamais advenir.
Prescrire certaines médications (benzodia-
zépines par exemple) en l’absence de
sevrage véritable, risque de venir compli-
quer ou aggraver la dépendance.
Dans le cadre des urgences psychiatriques,
nous rencontrons assez fréquemment des
sujets admis pour tentative de suicide qui ont
associé médicaments et alcool. Il est toujours
intéressant d’analyser finement l’ordre de la
prise des produits : dans un nombre de cas,
peut-être majoritaires, la prise d’alcool a pré-
cédé le geste suicidaire et l’a induit directe-
ment, ou en tout cas l’a permis.
Persuader le patient
de la nécessité de décider
d’arrêter de boire
Il n’existe pas de traitement médical de la
dépendance alcoolique. Le seul traitement
réside dans la prise de décision d’arrêter
complètement et définitivement la consom-
mation de toute boisson alcoolisée. Tous les
efforts thérapeutiques, toute la stratégie
thérapeutique doivent être axés sur cette
idée très simple. Les hospitalisations, les
cures, les postcures sont inutiles et ineffi-
caces si cette direction n’est pas envisagée.
Toutes ces mesures suspendent la consom-
mation et, en soi, elles peuvent être utiles
ou venir renforcer la décision de l’arrêt.
Aucun facteur extérieur au sujet alcoolique
ne peut venir le contraindre à s’arrêter de
boire s’il ne l’a pas décidé par lui-même. Si
cette décision n’est pas prise, l’arrêt ne se
fera pas. En cas contraire, cet arrêt ne dure
que le temps que dure la contrainte (prison,
hospitalisation). Dans certains cas extrêmes,
c’est d’ailleurs la seule possibilité, parfois
acceptée, voire demandée, par certains
patients pour que cesse la prise du produit.
Le traitement psychologique va donc
consister à obtenir une décision d’arrêt
complet du produit. Pour y parvenir, il est
nécessaire de mettre en scène la situation
sous une forme quelque peu dramatisée : il
faut évidemment nommer la problématique
alcoolique et la décrire frontalement dans
toutes ses dimensions, en particulier là où
le sujet ne la reconnaît pas, là où il l’ignore,
là où ses troubles cognitifs ne lui permet-
tent pas de la reconnaître et de l’analyser. Il
faut donc lui présenter clairement, sans cul-
pabilisation ni fausse honte, toutes les
facettes de sa problématique. Cela veut dire
qu’après avoir écouté avec bienveillance le
discours sur les “causes”, celui-ci doit être
pointé comme un piège différant la prise de
décision, et qui de toute façon ne pourra pas
la remplacer. Il faut décrire et expliquer les
conséquences de l’alcoolisation dans leurs
détails (effets sur la santé physique et intel-
lectuelle, conséquences professionnelles,
familiales, sociales, conséquences judiciaires
etc). Enfin, il faut placer le patient devant un
choix qui offre deux possibilités (et pas trois).
Celui-ci s’adresse à ce qu’il y a de plus
important en lui, sa liberté. Il faut dire que ce
choix ne dépend pas seulement de lui, mais
qu’il ne tolère aucune contrainte extérieure :
soit la poursuite de la consommation qui peut
être un choix librement décidé, avec toutes les
conséquences (décrites précédemment), soit
l’arrêt complet et définitif du produit avec
toutes les possibilités ouvertes dans un sens
positif qu’il faut expliquer et décrire.
Finalement, il faut laisser le sujet devant sa
décision et lui donner le temps de la réflexion
après lui avoir fourni toutes les explications.
Tout ce qui reste à faire ensuite, c’est de le
revoir pour être le témoin de sa décision et,
éventuellement, pour lui “resservir” le même
discours.
Cette décision peut être obtenue très rapide-
ment comme elle peut advenir après des
années de souffrance. Pour cette raison, il ne
faut jamais désespérer, car dans les cas appa-
remment les plus difficiles nous avons sou-
vent l’heureuse surprise d’assister à une
métamorphose brutale si nous avons su main-
tenir le contact et n’avons jamais rejeté le
patient en échec d’abstinence. L’arrêt viendra
au moment où le patient l’aura choisi et déci-
dé et non pas au moment où nous ou ses
proches l’auront décidé. En attendant, le tra-
vail pédagogique d’explication, doit être
repris sans cesse. Après le sevrage, ce soutien
devra être poursuivi sous des modalités qui
peuvent varier. L’expérience de la rechute est
souvent nécessaire et parfois indispensable.
Ce travail de persuasion nécessite de la part
du thérapeute un effort d’explication, de
compréhension, d’empathie et de convic-
tion, voire de dramatisation. Il demande de
la part du thérapeute, non pas une finesse
d’analyse psychologique, mais la participa-
tion à un drame existentiel et l’effort pour
convaincre son prochain que l’existence
est invivable avec l’alcool.
Le dénouement apparaît comme une déci-
sion qui peut se prendre en toute liberté et en
toute simplicité. Le fait de la formuler en ces
termes soulage souvent le buveur, elle lui
semble très souvent comme une voie qu’il
n’avait jamais pensé emprunter, en tout cas
dont ni lui ni son entourage n’avait jamais
parlé car le buveur attendait une solution
extérieure à son problème. Cette formulation
doit venir rompre totalement et définitive-
ment avec toute possibilité de solution exté-
rieure. Cette solution de rupture a un carac-
tère déculpabilisant puisque c’est uniquement
pour lui-même et par lui-même qu’il se traite.

113
Lorsqu’une consommation
résiduelle persiste...
Malgré les explications répétées et l’expérien-
ce acquise au cours de son parcours émaillé de
rechutes, certains patients peuvent avoir du
mal à maintenir une véritable abstinence.
Insistons sur un point : il est exceptionnel que
la poursuite de l’alcoolisation soit une volonté
délibérée de se détruire car ceux qui veulent en
arriver là procèdent d’une autre façon ! En tout
cas, les alcooliques que nous avons rencontrés,
s’ils peuvent évoquer cette possibilité comme
une “cause” dénoncée plus haut, ne nous ont
jamais affirmé cette décision de destruction
absolue, bien au contraire, ce qu’ils deman-
dent, c’est de vivre. Nous rencontrons là un
autre paradoxe, mal compris par la psycholo-
gie, voire par la psychanalyse, l’alcoolisation
aboutit bien à la destruction mais ce n’est pas
là pourtant le but poursuivi par l’alcoolique !
Le but est au contraire celui de l’effet, à savoir
l’illusion que procure le produit et non le résul-
tat réel. L’alcoolisation entretient l’illusion que
l’avenir peut se poursuivre ainsi, bien que le
raisonnement qui émerge dans les périodes de
sevrage puisse dire le contraire. C’est pour-
quoi, dans ces circonstances, nous devons
redoubler d’efforts et de compréhension et
dénoncer cette illusion.
Certains buveurs mettent en avant le progrès
parcouru et la diminution importante de leur
consommation, leur entourage constate leurs
efforts et les encourage, mais la consommation
persiste et continue à être problématique. Il
faut alors insister pour débusquer cette
consommation résiduelle et la dénoncer
comme une consommation qui continue à
mettre en danger l’existence. Ce danger est
mal apprécié par le buveur ayant éventuelle-
ment ou soi-disant diminué sa consommation :
il voit seulement l’effort fourni et ne voit pas
que l’édifice continue à se délabrer et que, tôt
ou tard, il va s’effondrer. L’illusion procurée
par la poursuite de la consommation ne permet
pas d’apprécier à sa juste mesure la loi du tout
ou rien : une consommation qu’il croit modé-
rée est encore une consommation qui compor-
te tous les risques dénoncés plus haut. Avec lui,
il faut reprendre son mode de vie dans les
détails. Les difficultés qui persistent, en géné-
ral bien repérées par les proches ou l’entoura-
ge, sont celles qu’il a du mal à mesurer ou qu’il
considère comme des reproches injustifiés.
Dans ces cas, il ne faut pas hésiter à faire des
entretiens avec la famille ou les proches qui
permettent une objectivation de la situation
réelle. Parfois une hospitalisation pour un
sevrage, va permettre la prise de conscience,
mais elle peut aussi échouer donnant l’illusion
d’une guérison facile. Alors surgissent assez
souvent au cours des entretiens des questions
existentielles sur le sens de la vie qui doivent
pas être considérées comme les signes d’une
dépression à traiter. Elles doivent être abordées
avec authenticité, car la vie prend sens par les
décisions qui sont prises, dans la quotidienne-
té des relations tissées, qu’au sein de la famil-
le, avec les proches, le monde du travail etc.
C’est l’alcool qui écarte le sens de cette quoti-
dienneté et qui doit être dénoncé comme tel.
Là aussi, dans ce questionnement, l’espoir peut
renaître et le drame existentiel doit pouvoir se
dénouer par une participation active du théra-
peute ainsi que des proches.
Indispensable : le travail de
renversement de la causalité
Cette position peut paraître radicale car elle
inverse toutes les “causalités”. En effet, l’al-
coolisation ne doit pas être considérée comme
un symptôme, tout au moins si l’on se place à
un niveau individuel et non pas sociologique.
En effet, ce symptôme aurait alors des
“causes” à traiter. Au contraire, pour l’indivi-
du dépendant, l’alcoolisation peut être consi-
dérée comme la cause première de multiples
symptômes. Ce travail de renversement de la
causalité doit être mis au cœur du traitement
individuel de la personne dépendante et il ne
faut pas mélanger les différents niveaux de la
problématique de l’alcoolo-dépendance,
sociologiques, statistiques et individuels.
Cette démarche implique une forme de foi
dans le sens de l’existence qui, au final, doit
être communiquée au patient. Elle peut se dire
en quelques mots : après l’arrêt complet et
définitif, tout est possible, tout peut être espé-
ré... Donner sens à la vie passe aussi par ce
genre de décision transcendant toute causalité.
Nous sommes là au cœur du paradoxe de la
liberté prise au piège.
Bien sûr, il existe des cas extrêmes où l’inca-
pacité de l’arrêt de la boisson est liée directe-
ment à la pathologie psychiatrique (schizo-
phrène alcoolique, limitation intellectuelle,
etc). Alors la pathologie mentale n’est pas la
“cause” de l’alcoolisme, mais avec la dépen-
dance installée, elle rend impossible la mobi-
lisation des ressources qui seraient nécessaires
à la prise de décision de l’arrêt. Dans ces cas
extrêmes, il ne reste plus comme solution que
l’hospitalisation sous contrainte ou des
mesures d’encadrement extrêmement rappro-
ché (hôpital de jour, foyer occupationnel).
Mais nous sommes là devant des pathologies
psychiatriques déjà très invalidantes par elles-
mêmes. La thérapeutique est alors du ressort
de l’étayage.
Quant aux consommations “à risques”, elles
risquent surtout d’aboutir à la dépendance.
Leur traitement doit donc s’inspirer de celui
de la dépendance.
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
Implication de la sérotonine dans les mécanismes
neurobiologiques de la dépendance
Toutes les études, chez l’animal comme chez l’homme, l’ont confirmé : le sys-
tème sérotoninergique est impliqué dans les comportements de self contrô-
le, un tonus sérotoninergique anormalement bas étant souvent associé à l’im-
pulsivité, voire à l’auto- et l’hétéro-agressivité. Ainsi, des psychostimulants
comme la cocaïne, en diminuant ce tonus, permettent l’expression du craving
chez le sujet dépendant. Or, lorsque l’on administre à des rats du tryptopha-
ne, qui augmente la synthèse de la 5-HT, ou des antidépresseurs de type SSRI
comme la fluoxétine, ils s’autoadministrent beaucoup moins de drogues
addictogènes, comme la cocaïne, l’amphétamine ou la morphine. Ces résul-
tats ont été confirmés en clinique chez les sujets cocaïnomanes, y compris
ceux qui sont sous méthadone, chez lesquels la fluoxétine et la sertraline
diminuent effectivement le cra-
ving et la consommation de
drogues.
Chez l’animal, on a déjà démon-
tré que les agonistes des récepteurs 5-HT 1B et les antagonistes des récep-
teurs 5-HT 2 (entre autres) étaient capables de réduire l’appétence pour la
cocaïne et la consommation volontaire de cette drogue. Par ailleurs, on a mis
aussi en évidence l’efficacité d’un antagoniste des récepteurs CB1 des canna-
binoïdes pour faire baisser, chez le rat, l’autoadministration d’héroïne. On
cherche donc aujourd’hui à mettre au point une thérapeutique fondée sur
l’utilisation de ligands sélectifs de certains récepteurs de la 5-HT, associés avec
des produits qui diminuent l’appétence pour les drogues, comme des anta-
gonistes des récepteurs des cannabinoïdes.Hamon M. Bull Acad Méd
2002 ; 186, n°2, séance du 19 février 2002.
S. Berthelier
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
1
/
3
100%