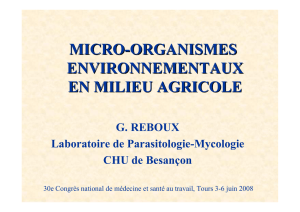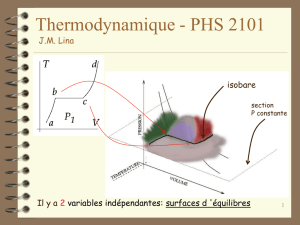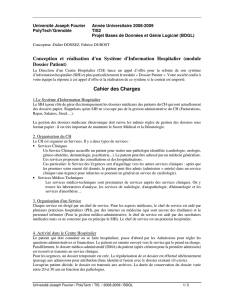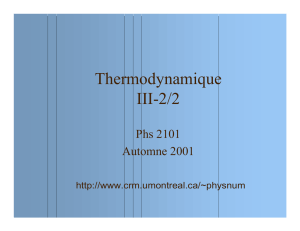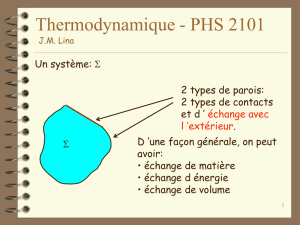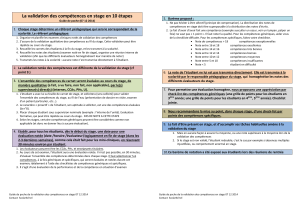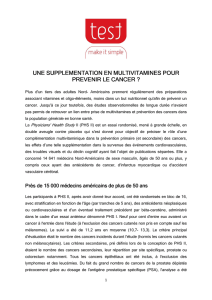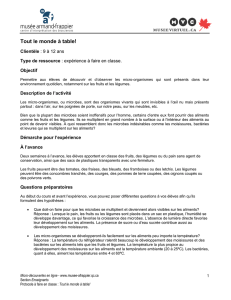L Pneumopathies d’hypersensibilité : causes cachées

8 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013
MISE AU POINT
Pneumopathies
d’hypersensibilité :
causes cachées
Hypersensibility pneumonitis: hidden causes
A. Gondouin*, P. Manzoni**, J.C. Dalphin*
* Service de pneumologie, CHU de
Besançon.
** Service de radiologie, CHU de
Besançon.
L
es pneumopathies d’hypersensibilité (PHS) sont
des pneumopathies de mécanisme immuno-
allergique dues à l’inhalation chronique de subs-
tances antigéniques, le plus souvent organiques,
mais parfois aussi chimiques ou métalliques.
Avant d’identifier la cause d’une PHS, il faut déjà en
assurer le diagnostic et nous ferons un rappel sur les
aspects cliniques, histopathologiques, radiologiques
et fonctionnels de ces pathologies.
Les causes sont multiples, parfois évidentes, parfois
difficiles à préciser. Nous évoquerons donc les causes
classiques, puis les causes plus rares et la démarche
diagnostique à mettre en œuvre devant une PHS dont
l’étiologie n’apparaît pas claire au premier abord.
Rappels
Manifestations cliniques respiratoires
et extrarespiratoires
Les manifestations cliniques respiratoires et extra-
respiratoires des PHS ont jusqu’à présent été
décrites au moyen de la classification, en 3 stades,
de Richerson (1), qui a été récemment remise en
cause. Une nouvelle classification propose de retenir
2 entités qui permettent d’orienter également le
diagnostic étiologique et évolutif.
◆La classification de Richerson
Elle distingue :
➤
une forme aiguë, dont les symptômes apparaissent
2 à 9 h après l’exposition, atteignent leur maximum
au cours des 24 premières heures et évoluent durant
quelques heures à quelques jours ; il s’agit d’un état
pseudo-grippal souvent prédominant et de symp-
tômes respiratoires tels que la toux et la dyspnée ;
➤
une forme subaiguë, qui apparaît progressive-
ment en quelques jours ou semaines, dominée par
la toux et la dyspnée, et qui peut progresser vers
une dyspnée sévère conduisant à l’hospitalisation ;
➤
une forme chronique, de survenue insidieuse sur
une période de quelques mois, avec une toux et une
dyspnée d’effort progressivement croissantes, une
fatigue et un amaigrissement.
◆Nouvelle proposition de classification
L’étude de Y. Lacasse et al. (2) a identifié 2 tableaux
cliniques, qui permettent de suspecter un type de
source antigénique, et d’évolution probablement
différente :
➤
dans la forme 1, les symptômes sont essentiel-
lement pseudo-grippaux, semi-retardés et récidi-
vants, le cliché thoracique est fréquemment normal,
et la fonction respiratoire, peu altérée. Le plus
souvent, l’étiologie est microbienne : l’exemple le
plus typique est la maladie du poumon de fermier,
avec ses facteurs étiologiques représentés pas des
bactéries (actinomycètes thermophiles) ou des
moisissures ;
➤
la forme 2, la plus répandue, avec crépitants,
possible hippocratisme digital, altération de la
fonction respiratoire (restriction, hypoxie, diminu-
tion de la diffusion de l’oxyde de carbone (DLCO)
et fréquentes opacités réticulaires à l’imagerie, est
généralement d’étiologie aviaire.
Cette classification ne recouvre pas celle de
Richerson, puisque la forme 1 est diagnostiquée pour
la moitié des cas en forme aiguë et l’autre moitié
en forme subaiguë ou chronique, et la forme 2 est
diagnostiquée essentiellement (80 % des cas) en
phase chronique.
LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 8 28/02/13 16:22

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013 | 9
Résumé
Les pneumopathies d’hypersensibilité (PHS) sont des pathologies qui partagent les mêmes aspects cliniques,
fonctionnels, histologiques et radiologiques, mais dont les antigènes responsables et les circonstances
dans lesquelles ils se développent sont extrêmement variés. C’est cette grande diversité qui complique le
diagnostic étiologique d’une PHS.
Une fois le diagnostic posé, l’identification de la cause d’une PHS se fait par :
»l’interrogatoire, qui est la phase essentielle ;
»le dosage de précipitines, qui permet de prouver une exposition chronique à une substance ;
»des prélèvements dans l’environnement du patient, si nécessaire ;
»des tests de provocation respiratoires réalistes, de moins en moins usités actuellement.
Mots-clés
Pneumopathies
d’hypersensibilité
Causes
Interrogatoire
Précipitines
Prélèvements
environnementaux
Summary
Hypersensitivity pneumonitis
(HP) are diseases which share
the same clinical, functional,
histologic and radiologic aspects.
However, the responsible anti-
gens and their circumstances of
development are highly varied.
This diversity complicates the
aetiological diagnosis of HP.
When the diagnosis is done, the
cause of a HP is specified by:
- a thorough history, which is
essential;
- the assay of precipitins, which
allows to prove a chronic expo-
sure to a substance;
- takings in the patient’s envi-
ronment if necessary;
- realistic provocation tests,
which are nowadays rarely used.
Keywords
Hypersensitivity pneumonitis
Causes
History
Precipitins
Environmental takings
La forme 1 avec manifestations cliniques systémiques
a un pronostic probablement meilleur que la forme 2.
Histologie
Sur le plan histologique, les PHS réalisent une infil-
tration lymphocytaire et granulomateuse des bron-
chioles et de l’interstitium (figure 1).
Il est important de connaître les aspects histolo-
giques, car ils permettent de comprendre les aspects
radiologiques et fonctionnels des PHS (3, 4).
On note une inflammation péribronchiolaire
s’étendant à l’interstitium et aux alvéoles adja-
centes, composée principalement de lympho-
cytes, mais aussi de polynucléaires neutrophiles,
de macrophages, de plasmocytes et de mastocytes,
accompagnés de cellules géantes et se groupant
en granulomes de petite taille, mal organisés, sans
nécrose caséeuse, de localisation centrolobulaire. Par
ailleurs, ces granulomes entourent et/ou compriment
les bronchioles terminales et respiratoires, dont la
lumière peut en outre comporter de la fibrine et des
cellules inflammatoires.
Enfin, il existe dans certaines formes des lésions de
fibrose interstitielle et bronchiolaire.
Imagerie
Les aspects radiologiques découlent des atteintes
histopathologiques, et sont au mieux analysés sur
une tomodensitométrie (TDM) thoracique avec
coupes millimétriques et expiratoires.
Les granulomes péribronchovasculaires sont respon-
sables des images de micronodules flous en verre
dépoli de topographie centrolobulaire (figure 2, p. 10).
Si le granulome inflammatoire est localisé dans l’al-
véole ou dans sa paroi, le lobule secondaire apparaîtra
uniformément hyperdense, réalisant un aspect en
verre dépoli diffus, souvent inhomogène, “en carte
de géographie” (figure 3, p. 10). Néanmoins, du fait
de l’obstruction des bronchioles par des granulomes
péribronchiques, certains lobules seront épargnés par
le processus pathologique et donneront un aspect
de poumon “en mosaïque”. En fonction du degré de
cette obstruction bronchiolaire, le trappage aérique
avec distension lobulaire pourra apparaître soit spon-
tanément, soit lors de l’expiration (figure 4, p. 11).
Enfin, des lésions de fibrose parenchymateuses et
bronchiolaires, se développant dans les formes chro-
niques, peut résulter un aspect tomodensitométrique
comparable à celui des fibroses pulmonaires idiopa-
thiques (FPI), mais la répartition typique, périphérique
et dans les bases, des lésions de FPI manque, et il faut
rechercher attentivement des signes d’“activité” de
la maladie, sous la forme de quelques micronodules
inhabituels dans les FPI, ou de plages en verre dépoli,
qui orienteront le diagnostic (figure 5, p. 11).
Épreuves fonctionnelles respiratoires
Les épreuves fonctionnelles respiratoires mettent en
évidence un trouble ventilatoire restrictif, incons-
tant, avec une hypoxie de repos ou révélée à l’effort,
et une altération de la DLCO. Mais une atteinte
obstructive distale, due à l’atteinte bronchiolaire, est
également classique. Notons que les anomalies des
volumes et des débits sont réversibles en quelques
semaines à quelques mois, alors que la DLCO reste
altérée en moyenne 1 an après le diagnostic, ce qui
en fait un examen diagnostique de valeur lorsque
le patient est vu avec retard.
Figure 1. Aspect de bronchiolite constrictive avec granulomes à cellules géantes dans la
paroi bronchique et infiltrat lymphocytaire étendu aux cloisons alvéolaires adjacentes.
LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 9 28/02/13 16:22

10 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013
Pneumopathies d’hypersensibilité : causescachées
MISE AU POINT
Lavage bronchoalvéolaire
Le lavage bronchoalvéoalaire (LBA) est également
d’un grand apport diagnostique. La cellularité est
élevée, et l’hyperlymphocytose constante (> 30 %
chez le non-fumeur et > 20 % chez le fumeur), son
absence éliminant le diagnostic. La formule peut
varier selon le moment de la réalisation du LBA par
rapport à l’exposition, et, si celle-ci est récente, on
pourra voir également des polynucléaires neutro-
philes, quelques plasmocytes et mastocytes ainsi
que des macrophages spumeux, cet aspect étant très
évocateur d’une PHS. L’étude des sous-populations
lymphocytaires n’a pas grand intérêt ; en tout cas, le
dogme de l’alvéolite à lymphocyte CD8+ doit être
oublié, ce que confirme une étude rétrospective multi-
centrique française qui porte sur 139 cas de PHS (5).
Proposition de critères diagnostiques
Le diagnostic reste difficile à l’heure actuelle et
aucun des nombreux “algorithmes” diagnostiques
proposés dans la littérature n’a été validé. Une étude
multicentrique internationale comportant plus de
600 sujets a identifié 6 prédicteurs diagnostiques
“cliniques”, indépendants les uns des autres, qui
permettent de distinguer les PHS des autres pneu-
monies interstitielles avec une bonne sécurité (6).
Ces prédicteurs, ou critères diagnostiques, classés
par ordre de poids décroissant, sont les suivants :
➤
exposition à un antigène connu pour être pathogène ;
➤
positivité de la sérologie sanguine vis-à-vis de
cet antigène ;
➤
récurrence des symptômes à type de fièvre, fris-
sons, douleurs diffuses, toux, dyspnée ;
➤
apparition des symptômes 4 à 8 heures après
l’exposition à l’antigène ;
➤présence de crépitants à l’auscultation ;
➤amaigrissement.
Il faut cependant préciser que ce diagnostic difficile
ne sera parfois évoqué qu’après une biopsie pulmo-
naire chirurgicale. Ce sera alors l’aspect histologique
compatible avec une PHS qui conduira à reprendre
le bilan et, en particulier, un interrogatoire orienté.
Traitement
Le traitement de ces PHS est l’éviction antigénique,
parfois associée à une corticothérapie par voie géné-
rale dans les formes aiguës et sévères. Cette éviction
permet, si elle est précoce, d’éviter l’évolution vers
la fibrose pulmonaire et l’insuffisance respiratoire.
Causes des pneumopathies
d’hypersensibilité
Les PHS peuvent survenir dans un contexte profes-
sionnel ou non professionnel.
Les causes organiques sont de loin les plus
fréquentes : bactéries, moisissures, substances
protéiques d’origine animale (protéines aviaires).
Les exemples les plus connus sont la maladie du
poumon de fermier – les substances responsables
Figure 2. Tomodensitométrie thoracique (haute résolution) en inspiration, coupe milli-
métrique. Micronodules flous centrolobulaires des 2 champs pulmonaires : maladie
du poumon de fermier.
Figure 3. Tomodensitométrie thoracique (haute résolution) en inspiration, coupe milli-
métrique. Plages de verre dépoli inhomogènes : pneumopathie d’hypersensibilité liée à
des moisissures domestiques.
LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 10 28/02/13 16:22

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013 | 11
MISE AU POINT
sont alors des bactéries (actinomycètes thermo-
philes) ou des moisissures se développant dans
le foin (7, 8) – et la maladie des éleveurs d’oiseaux –
les antigènes y sont des protéines aviaires (9).
D’autres étiologies deviennent classiques, qu’elles
soient identifiées dans des circonstances profes-
sionnelles ou domestiques : PHS liées à des moisis-
sures domestiques se développant au domicile des
patients (10), PHS des mécaniciens liées à des myco-
bactéries colonisant les huiles de coupe (11), PHS
des jacuzzi (12) où sont mises en cause des myco-
bactéries colonisant les circuits d’eau, etc.
Mais d’autres substances non organiques peuvent
être en cause dans les PHS : chimiques (isocyanates,
cobalt, zinc), enzymatiques (enzymes protéolytiques
contenus dans des produits ménagers, etc.).
Les circonstances les plus fréquentes sont regrou-
pées dans le tableau, p. 12. La liste complète des
causes des PHS peut être consultée dans la Référence
pratique actuelle rédigée par le GERM“O”P et actua-
lisée en 2010 (13). Les causes professionnelles ont
fait l’objet d’un recensement récent (14).
Causes évidentes et causes cachées
Lorsque l'on suspecte une PHS devant une pneu-
mopathie interstitielle diffuse pour laquelle on a
un faisceau d’arguments, la cause peut apparaître
d’emblée à l’interrogatoire : PHS chez un agriculteur,
ou chez un mécanicien manipulant des huiles de
coupe, PHS chez un patient qui décrit des foyers de
moisissures à son domicile, ou qui possède un jacuzzi.
Mais, dans certaines circonstances, le diagnostic
étiologique peut être difficile, la cause étant dans
un premier temps cachée.
Plusieurs cas de figures peuvent se présenter.
◆Cause fréquente, connue et classique, mais
l’exposition n’est pas retrouvée au premier abord
Cas d’une secrétaire, sans animaux à son domicile,
en contact régulier avec des oiseaux lors de visites
chez ses parents qui possédent une volière.
L’interrogatoire ne doit donc pas se limiter à l’envi-
ronnement direct du patient ; une exposition pourtant
classique pourrait alors être facilement méconnue.
◆La cause est connue (par exemple
des moisissures), mais les substances antigéniques
se développent dans des circonstances rares,
inhabituelles, et sont parfois véritablement cachées
Les exemples de PHS diagnostiquées dans
ces circonstances sont nombreux et très variés,
Figure 5. Tomodensitométrie thoracique (haute résolution) coupe millimétrique : aspect
de fibrose pulmonaire avec réticulations et distorsion architecturale avec bronchectasies
de traction pouvant évoquer une fibrose pulmonaire idiopathique, mais la répartition
périphérique et basale fait défaut et on note encore quelques plages en verre dépoli :
pneumopathie d’hypersensibilité aviaire.
Figure 4. Tomodensitométrie thoracique (haute résolution), coupes (1,25 mm) en inspiration
et expiration de 2 patients. Patient 1 : micronodules et discrètes plages en verre dépoli. Les
coupes en expiration démasquent des hyperclartés lobulaires, traduisant le piégeage aérique
lié aux lésions de bronchiolite et réalisant un aspect “en mosaïque” : maladie du poumon de
fermier. Pour le patient 2, les coupes en inspiration peuvent apparaître quasi normales, mais
les coupes en expiration révèlent l’aspect “en mosaïque” : maladie du poumon de fermier.
Patient 1
Patient 2
LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 11 28/02/13 16:22

12 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013
Pneumopathies d’hypersensibilité : causescachées
mise au point
Tableau. Causes les plus fréquentes ou classiques des pneumopathies d’hypersensibilité (extrait de la Référence pratique actuelle 2010 du GERM“O”P [13]).
Dénomination Réservoir antigénique habituel Antigène en cause
PHS professionnelles
Maladie du poumon de fermier Foin, fourrage, paille, céréales, fumier, substances végétales moisies Bactéries (actinomycètes thermophiles dont
Saccharo-
polyspora rectivirgula
, bactéries Gram–), moisissures
(micromycètes dont
Absidia corymbifera
,
Eurotium
amstelodami
et différents types de
penicillium
)
Maladies des éleveurs d’oiseaux Déjections, sérum d’oiseaux (pigeons, poules, dindons, oies) Protéines aviaires
PHS des fromagers Moisissures des fromages Moisissures de type
penicillium
PHS des champignonnistes
(lycoperdose)
Compost des champignons, champignons eux-mêmes Bactéries (actinomycètes thermophiles), moisissures
(micromycètes), spores deschampignons
PHS des cribleurs de pommes
deterre
Moisissures présentes sur les pommes deterre Actinomycètes thermophiles,
Aspergillus
sp.
PHS des vignerons Moisissures du raisin (pourriture grise), araignée rouge
Botrytis cinerea, Panonychus ulmi
Bagassose Résidus moisis de canne à sucre Actinomycètes thermophiles
PHS des ouvriers du malt Orge moisie, houblon germé
Aspergillus fumigatus, Aspergillus clavatus
PHS au saucisson Fabrique de saucissons secs, de salamis, étiquetage des saucissons Moisissures de type
penicillium
PHS des travailleurs du bois Poussières de chêne et d’érable, deséquoia, moisissures sous l’écorce
dubois, dans les vieilles planches, dansla sciure
Moisissures
Stipatose Sparte (herbe de la famille des graminées entrant dans la composition
de paniers, cordes, ficelles, plâtre, produits et fibres denettoyage)
Moisissures (actinomycètes thermophiles,
micromycètes),
Stipatenacissima
PHS des mécaniciens Aérosols de liquide d’usinage desmétaux Mycobactéries
(Mycobacterium immunogenum,
Mycobacterium chelonae complex), Pseudomonas
fluorescens ?
PHS des travailleurs de l’industrie
chimique (ou de secteurs industriels
utilisateurs)
Industries (et utilisation) du plastique, laques, vernis, peintures,
mousses polyuréthanes, moulage en fonderie
Isocyanates, anhydrides trimélitiques, résines époxy-
diques
PHS des prothésistes dentaires Méthylmétacrylate
PSH non professionnelles
PHS aviaires domestiques Tourterelles, perruches, inséparables, perroquets, colombes,
canaris, pigeons
Protéines aviaires
PHS des humidificateurs
ouclimatiseurs
Système de climatisation et/ou d’humidification, ou système de
ventilation ou de chauffage par air pulsé, humidificateurs portables,
humidificateurs ultrasoniques, huile deradiateur soufflant
Moisissures (actinomycètes thermophiles,
micromycètes), bactéries, antigène aqueux
Fièvre d’été (au Japon) Poussières de maisons provenant destoitsou des sols
Trichosporon cutaneum, Trichosporon ovoides,
Trichosporon asahii, Cryptococcus albidus
PHS liées aux moisissures
domestiques
Moisissures se développant dans lespiècesd’eau, les habitations
humides, lorsdedégâts des eaux
Diverses moisissures
PHS des jacuzzi Moisissures se développant dans les canalisations des jacuzzi
Cladosporium cladosporioides, Mycobacterium avium
intracellulare
tant en milieu professionnel que domestique :
➤
agriculteur possédant un tracteur dont le
système de climatisation est contaminé par des
bactéries (piège avec une maladie du poumon de
fermier classique !) ;
➤
ouvriers saupoudrant des moisissures sur des
objets laqués pour les vieillir artificiellement (fabri-
cation artisanale de bibelots au Japon) ;
➤vignerons exposés à des moisissures de raisin ;
➤
ouvriers du liège (bûcherons ou ouvriers d’entre-
prises de fabrication de bouchons) développant des
PHS aux moisissures du liège (subérose) ;
➤
ouvriers du nettoyage à sec manipulant du tétra-
chloroéthylène ;
➤
musiciens utilisant des instruments à vent et
inhalant des moisissures développées dans les
anches, le bec ou le corps de l’instrument ;
➤
patient utilisant un ventilateur en pression
positive continue nocturne mis en place pour un
syndrome d’apnées du sommeil dont la tuyauterie
était contaminée par des moisissures ;
➤
patients au domicile desquels peuvent se déve-
lopper des moisissures inapparentes, par exemple
après un dégât des eaux provoquant le dévelop-
pement d’agents fongiques sous les linoléums ou
sous les parquets ;
➤
patiente utilisant un fer à repasser dont le réser-
voir d’eau était contaminé par des moisissures.
LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 12 28/02/13 16:22
 6
6
 7
7
1
/
7
100%