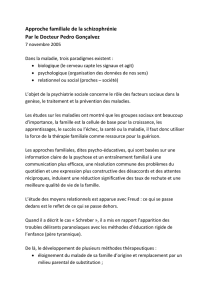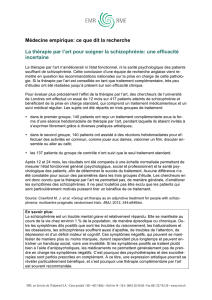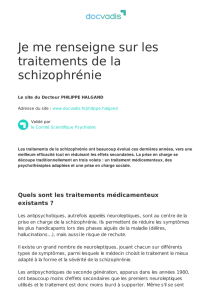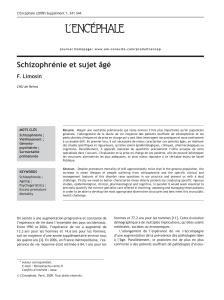revue de presse Revue de presse Pour clore l’année 2000,

revue de presse
Revue de presse
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (17) n° 10, décembre 2000 346
Pour clore l’année 2000,
nous vous proposons une mise
à jour des thèmes abordés
précédemment dans la rubrique
E. Bacon, Unité INSERM 405,
clinique psychiatrique, Strasbourg.
Consentement éclairé et
recherche sur la schizophrénie
Baltimore (États-Unis)
La capacité de décision des
patients schizophrènes est au cœur des
débats sur l’éthique de la recherche en psy-
chiatrie. La schizophrénie s’accompagne
de distorsions de la perception, de désor-
ganisation de la pensée, d’émoussement de
la motivation et de la sensibilité, et chacun
de ces éléments de la maladie peut, en théo-
rie, réduire la capacité à prendre des déci-
sions. Les médias se sont emparés de ce
problème et ont posé en public la question
de savoir si ces gens bizarres et qui n’ont
pas l’air “dans le coup” sont bien capables
d’émettre un jugement informé concernant
leur participation à la recherche. Pourtant,
la plupart des patients ne sont pas consi-
dérés comme incompétents et sont
capables de mener à bien leurs affaires quo-
tidiennes. Le but de l’étude du Dr Carpen-
ter et de ses associés était d’établir le degré
de perturbation décisionnelle d’une
cohorte de patients schizophrènes. Ils ont
évalué dans quelle mesure les symptômes
de la schizophrénie et les perturbations
cognitives peuvent affecter leur capacité de
décision et exploré l’efficacité d’une inter-
vention à visée éducative pour améliorer la
capacité de prise de décision de patients
perturbés (Carpenter W, Gold J, Lahti A et
al. Decisional capacity for informed
consent in schizophrenia research. Arch
gen Psychiatry 2000 ; 57 : 533-8). La capa-
cité de décision a été évaluée chez
30 patients schizophrènes, par comparai-
son avec 24 sujets sains. Les caractéris-
tiques psychopathologiques (selon le
DSM IV) et cognitives des patients schi-
zophrènes ont été enregistrées. La capacité
décisionnelle des sujets a été évaluée par
le MacCAT-CR, un instrument qui prend
en compte quatre aspects de la capacité
décisionnelle, en relation avec les normes
légales de compétence exigées pour don-
ner son consentement à un traitement et à
une recherche : la compréhension de l’in-
formation pertinente, l’appréciation des
implications de l’information pour sa
propre situation, l’utilisation de l’informa-
tion fournie pour un raisonnement logique
en relation avec la décision à prendre, et la
prise de décision. Les sujets qui avaient
présenté une performance médiocre à ces
mesures de capacité décisionnelle suivaient
ensuite une intervention de type éducatif
destinée à améliorer leur capacité à four-
nir un consentement éclairé et étaient retes-
tés ensuite. Les résultats montrent, pour les
patients schizophrènes, des performances
moindres aux échelles mesurant les capa-
cités de prise de décision concernant la par-
ticipation à une recherche. La baisse de
performances n’était que modérément cor-
rélée aux symptômes psychiatriques pro-
prement dits, mais fortement corrélée aux
perturbations cognitives. Les résultats
montrent aussi que, lorsqu’on leur offre des
possibilités supplémentaires d’acquérir et
de comprendre l’information nécessaire, la
plupart des patients schizophrènes sont
capables d’améliorer leur capacité déci-
sionnelle jusqu’à atteindre celle des sujets
témoins. Des travaux complémentaires
s’imposent néanmoins pour vérifier si ces
résultats, obtenus sur un nombre réduit de
patients et un seul site, sont généralisables
à d’autres échantillons de patients, à
d’autres groupes de diagnostics et à diffé-
rents types de recherches, et pour identi-
fier les moyens les plus efficaces pour pal-
lier les limitations cognitives des patients.
Mots clés. Schizophrénie – Recherche –
Consentement éclairé – Déficits cognitifs.
Obésité : ce que
les professionnels de santé
mentale doivent savoir
New York (États-Unis)
L’ obésité est une des affections
médicales les plus faciles à reconnaître et
les plus difficiles à traiter. Elle a pourtant
des conséquences non négligeables sur la
santé. Bien que la plupart des praticiens de
santé mentale soient habituellement ame-
nés à traiter des personnes obèses, il
n’existe pas de consensus sur la question
de quand ou comment considérer l’obésité
dans la prise en charge globale du patient.
Cet article représente le fruit des efforts de
trois auteurs, un psychiatre, un psychologue
et un médecin de famille, dans le but de
mettre en évidence les questions auxquelles
sont confrontés les professionnels de la
santé mentale lorsqu’ils ont en face d’eux
des patients obèses. Il fait également le
point sur les connaissances actuelles, par
l’examen de la littérature consacrée à ce
sujet au cours des dix dernières années
(Devlin M, Yanovski S, Wilson T. Obesity :
what mental health professional need to
know. Am J Psychiatry 2000 ; 157 : 854-
66). Des facteurs génétiques, dont certains
sont médiés par le comportement alimen-
taire, contribuent de façon importante à la
prédisposition à l’obésité. L’“expression”
de l’obésité est favorisée par des facteurs
environnementaux, tels ceux qui augmen-
tent les possibilités de disposer de nourri-
ture riche en calories et découragent l’acti-
vité physique. Il semble qu’il existe des
sous-groupes distincts de personnes obèses
qui présentent des profils de perturbations
alimentaires particuliers, accompagnés de
taux élevés de trouble psychique. Par
ailleurs, certains traitements antipsycho-
tiques semblent contribuer à l’obésité. La
prise de poids est un des effets secondaires
les plus problématiques des psychotropes
et constitue un des motifs les plus fréquents
de la non-adhésion au traitement. Ainsi,

347
revue de presse
Revue de presse
plusieurs classes de psychotropes sont asso-
ciées à une prise de poids non désirée,
incluant les antipsychotiques, les antidé-
presseurs, les régulateurs de l’humeur et,
dans une moindre mesure, les anxioly-
tiques. D’une manière générale, les médi-
caments qui bloquent les récepteurs H1 de
l’histamine, 5HT de la sérotonine et D2 de
la dopamine semblent associés à la prise de
poids. Parmi les antipsychotiques courants,
les phénothiazines (chlorpromazine, thio-
ridazine, mesoridazine) et les nouveaux
antipsychotiques (clozapine, olanzapine,
rispéridone, quetiapine) sont le plus sou-
vent associés à une prise de poids clini-
quement problématique. La molindone est
unique en son genre car elle n’est jamais
associée à une prise de poids. Elle est à
l’origine d’une perte poids dans de nom-
breuses études. Lorsque la prise de poids a
lieu, elle est rapide au cours de la phase
aiguë du traitement et, en général, se stabi-
lise après un à deux ans. Chez un à deux
tiers des patients sous lithium, la prise de
poids est d’au moins 5 %, et parfois beau-
coup plus. La prise de poids semble liée à
la dose administrée. Elle apparaît principa-
lement au cours des deux premières années
de traitement et est plus fréquente chez les
patients présentant une surcharge pondé-
rale initiale. Un quart à la moitié des
patients traités par des anticonvulsivants,
dont l’acide valproïque et la carbamazé-
pine, grossissent dans les mêmes propor-
tions. En ce qui concerne les antidépres-
seurs, le traitement par les tricycliques et
par les IMAO s’accompagne de prise de
poids importante, en particulier lors du trai-
tement au long cours. Une revue de littéra-
ture récente semble néanmoins nuancer
cette affirmation : la prise de poids serait
modeste, même sur le long terme, mais en
revanche un petit nombre de patients pré-
senterait une prise de poids très importante.
On a longtemps pensé que les inhibiteurs
de la recapture de la sérotonine, comme la
fluoxétine, la sertraline, la paroxétine, la
fluvoxamine, étaient associés à une prise de
poids. Une étude multicentrique à large
échelle menée avec la fluoxétine
(60 mg/jour) a permis d’observer au
contraire une baisse de poids significative,
qui atteint son maximum après vingt
semaines de traitement. En moyenne, les
patients avaient retrouvé leur poids d’ori-
gine au bout d’un an de traitement. Les
sujets obèses doivent-ils essayer de perdre
du poids ? Le comportement souvent
observé de régime en “yo-yo” (perte de
poids suivie de reprise de poids) démora-
lise le patient, rend la perte de poids ulté-
rieure encore plus difficile et n’est pas sans
risque pour la santé. Les effets de la perte
de poids sur le long terme sont en vérité mal
connus et demandent à être systématique-
ment évalués. Il est certain qu’une perte de
poids, même modeste, permet de réduire
les risques sanitaires chez les patients
obèses, en tout cas sur le court terme.
L’ e xistence et l’augmentation du nombre
de personnes obèses constituent un pro-
blème sérieux qui ne doit pas être ignoré
par les professionnels de santé mentale. Le
traitement ne devrait pas s’adresser à l’obé-
sité seulement, mais aussi à ses effets sur
l’estime de soi, dans un climat culturel plu-
tôt hostile.
Mots clés. Obésité – Psychotropes.
Anomalies physiques
mineures et difficultés
familiales : facteurs de
risque pour la délinquance
violente à l’adolescence ?
Montréal (Canada)
La délinquance grave accompa-
gnée de comportement violent semble cul-
miner à la fin de l’adolescence et au début
de l’âge adulte. Toutefois, les comporte-
ments violents n’apparaissent pas brus-
quement chez un individu lors de son déve-
loppement, et des études longitudinales ont
démontré que des comportements turbulents
lors de l’enfance comptent parmi les
meilleurs prédicteurs de délinquance et de
personnalité antisociale à l’âge adulte. Le
délinquant violent aurait donc des compor-
tements prédicteurs dès le plus jeune âge.
Par conséquent, il serait logique de s’inté-
resser aux facteurs étiologiques précoces. Le
contexte familial et des complications péri-
natales sont parmi les facteurs les plus pré-
coces susceptibles d’influencer le dévelop-
pement comportemental. Plus précisément,
au cours de la grossesse, le fœtus est exposé
à des influences diverses pouvant affecter
négativement son développement, et des
anomalies physiques mineures sont consi-
dérées comme des indicateurs de perturba-
tion du développement fœtal. Le système
nerveux central peut lui aussi être affecté par
des facteurs provoquant des anomalies phy-
siques mineures, le développement du cer-
veau étant simultané à celui des organes pré-
sentant ces petites anomalies. Parce que l’on
sait que des anomalies neurologiques peu-
vent être associées à des problèmes com-
portementaux, il se pourrait bien que des
anomalies physiques mineures reflètent des
facteurs de risque pour le développement de
troubles comportementaux. C’est cette
hypothèse qu’ont cherché à démontrer les
auteurs de ce rapport : l’incidence cumulée
d’anomalies physiques mineures et de diffi-
cultés familiales lors de la petite enfance et
l’interaction de ces facteurs sont-elles des
prédicteurs de comportement de délin-
quance violente pour des adolescents d’ori-
gine urbaine ? Il s’agissait également d’iden-
tifier les anomalies spécifiquement
impliquées dans la délinquance violente, par
opposition à la délinquance non violente
(Arseneault L, Tremblay R, Boulerice B et
al. Minor physical anomalies and family
adversity as risk factors for violent delin-
quency in adolescence. Am J Psychiatry
2000 ; 157 : 917-23). Cent soixante-dix
adolescents blancs francophones, origi-
naires de banlieues défavorisées de Mont-
réal, ont été inclus dans l’étude. Ils étaient
de même culture et possédaient un pool

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (17) n° 10, décembre 2000 348
revue de presse
Revue de presse
génétique relativement homogène. Ils étaient
suivis depuis l’âge du jardin d’enfants,
comme faisant partie d’une étude longitudi-
nale destinée à évaluer les difficultés fami-
liales. Ces difficultés étaient évaluées à par-
tir de sept index socio-économiques incluant
le statut familial, le niveau d’études des
parents, l’importance sociale et le prestige
de leurs professions et leur âge à la naissance
du premier enfant. La délinquance des ado-
lescents était estimée à partir de question-
naires et de l’examen des registres officiels,
et prenait en compte des comportements tels
que les agressions physiques, le vol, le van-
dalisme, la toxicomanie, etc. Les crimes vio-
lents, classés selon le code canadien,
incluaient la détention d’armes, la cruauté
envers les animaux et les menaces violentes,
cependant que le vol, l’effraction et la pros-
titution, par exemple, étaient considérés
comme des actes non violents. Enfin, les
anomalies physiques prises en compte
étaient localisées sur cinq zones du corps :
la bouche, les oreilles, les yeux, la tête et les
mains. Les résultats des analyses de régres-
sion indiquent que les anomalies physiques
étaient en totalité significativement asso-
ciées à un risque accru de délinquance vio-
lente à l’adolescence. Contrairement à une
étude plus ancienne (1988), les auteurs n’ont
pas observé de rôle prédictif de violence en
ce qui concerne l’interaction entre les ano-
malies physiques et les difficultés fami-
liales. Les enfants présentant une propor-
tion plus élevée d’anomalies physiques
mineures, en particulier au niveau de la
bouche, pourraient être plus difficiles à
socialiser, pour des raisons diverses et
cumulatives : ils pourraient présenter des
déficits neurologiques et avoir eu des diffi-
cultés à s’alimenter lors des premiers mois
après la naissance. Des études longitudi-
nales s’imposent pour permettre de com-
prendre selon quel processus l’apprentis-
sage de l’inhibition de l’agression physique
est déficient chez ces enfants.
Mots clés. Agressivité – Violence – Ado-
lescence – Anomalies physiques mineures.
Le suicide chez les patients
hospitalisés
Oxford (Grande-Bretagne)
On dispose à ce jour de peu de
données fiables sur les facteurs de risque
suicidaire ou sur leur pouvoir prédictif. Par
ailleurs, le suicide d’un patient psychia-
trique est un événement rare mais grave, et
les patients hospitalisés constituent une
population à risque. Il est donc important
d’identifier les facteurs de risque et d’éva-
luer leur pouvoir prédictif pour localiser les
individus sensibles. Le Dr Powell et ses col-
laborateurs se sont attelés à une tâche déli-
cate, le comportement suicidaire étant dif-
ficile à prédire, et les facteurs de risque chez
les patients hospitalisés n’étant pas forcé-
ment les mêmes que ceux des autres popu-
lations (Powell J, Geddes J, Deeks J et al.
Suicide in psychiatric hospital in-patients.
Risk factors and their predictive power. Br
J Psychiatry 2000 : 266-72). Les auteurs
ont enregistré tous les cas de décès de
patients hospitalisés en psychiatrie dans
quatre comtés entre 1963 et 1992. Ils ont
identifié non seulement les décès ayant eu
lieu à l’hôpital, mais aussi les décès de
patients hospitalisés mais dont la mort a eu
lieu hors de l’hôpital. Les décès ayant eu
lieu plus d’un an après l’admission étaient
considérés comme n’étant pas représenta-
tifs de l’admission psychiatrique en phase
aiguë et n’ont pas été inclus dans le groupe.
Les sujets contrôles étaient sélectionnés au
hasard parmi les patients psychiatriques ne
s’étant pas suicidés, admis à la même
période et dans les mêmes hôpitaux. Deux
groupes de 112 patients ont ainsi été sélec-
tionnés. Les données cliniques et sociales
ont été obtenues pour tous les sujets. Pour
mesurer le degré d’idées suicidaires, les
auteurs ont mis au point une échelle à
cinq niveaux pour classer les patients (pas
d’idées suicidaires ; quelques idées suici-
daires mais sans préméditation ; avec pré-
méditation mais sans passage à l’acte ; une
tentative d’autolyse ayant amené à l’ad-
mission, ou s’étant déroulée durant celle-
ci). Les résultats révèlent un taux de sui-
cide de 13,7 pour 10 000 admissions chez
les patients hospitalisés en psychiatrie. Plu-
sieurs facteurs prédictifs apparaissent
comme pertinents : une tentative de suicide
planifiée, une tentative de suicide effective,
un deuil récent, la présence d’hallucina-
tions, une maladie mentale chronique et une
histoire familiale de suicide. Sur cette base,
seuls deux des patients qui se sont suicidés
avaient un risque prédit de suicide supérieur
à 5 %. Par conséquent, quoique plusieurs
facteurs de risque clairement associés au
suicide aient pu être identifiés, leur utilité
clinique a été limitée par leur faible sensi-
bilité et leur spécificité médiocre. S’ajoute
le fait que les suicides sont rares, même
dans ce groupe à haut risque. Il n’en reste
pas moins des événements graves, qui cau-
sent un préjudice important à la famille et
aux amis, et qui peuvent avoir des effets
significatifs tant sur les autres patients
qu’auprès des soignants, soulevant le pro-
blème de la responsabilité et de la culpabi-
lité.
Mots clés. Suicide – Patients psychia-
triques – Facteurs de risque – Facteurs
prédictifs.
Susceptibilité saisonnière :
les premières admissions
pour schizophrénie
dans l’hémisphère Sud
Queensland (Australie)
De nombreuses données expéri-
mentales semblent corroborer l’existence
d’un lien entre les fluctuations météorolo-
giques saisonnières et l’installation ou la
récurrence de divers types de symptoma-
tologie psychiatrique. Par exemple, le
trouble affectif saisonnier (SAD) est cor-
rélé aux saisons, et les mois où cette affec-
tion culmine diffèrent entre l’hémisphère

revue de presse
349
Revue de presse
Nord et l’hémisphère Sud. Dans l’hémi-
sphère Nord, on observe en été des taux
plus élevés de premières admissions pour
schizophrénie. Les fluctuations des pre-
mières admissions au cours de l’année
peuvent être reliées à des facteurs météo-
rologiques qui varient avec les saisons,
comme la température et la photopériode,
mais également (ou) avec des facteurs
sociaux, comme les vacances ou les fêtes
religieuses. Si les facteurs météorolo-
giques sont responsables au premier chef
des fluctuations saisonnières, alors on
devrait enregistrer dans l’hémisphère Sud
les taux les plus élevés de premières
admissions pendant les mois de décembre,
janvier et février. C’est ce qu’ont voulu
vérifier les auteurs de cet article, qui ont
ainsi réalisé la première étude de saison-
nalité concernant les premières admissions
pour schizophrénie dans l’hémisphère Sud
(Davies G, Ahmad F, Chant D et al. Sea-
sonality of first admission for schizophre-
nia in the Southern Hemisphere. Schizo-
phrenia Research 2000 ; 41 : 457-62). Les
mois et années de première admission
pour schizophrénie ont été enregistrés
pour 4 487 hommes et 3 252 femmes, tous
nés en Australie. Les données provenaient
du registre statistique de santé mentale du
Queensland et concernaient la période de
1973 à 1991. L’analyse spectrale montre
l’existence d’une importante périodicité
annuelle de première admission pour les
hommes, avec un pic au mois d’août, ce
qui correspond à l’hiver austral, et un
creux pendant les mois d’été, de décembre
à février. Le profil d’admission des
femmes présentait également une périodi-
cité annuelle. Ces résultats sont difficiles
à corréler avec ceux de l’hémisphère Nord.
Ils sont en accord, si on se réfère au mois
de l’année, mais pas en ce qui concerne la
saison. Par ailleurs, l’effet de saison est
dans cette étude plus marqué pour les
hommes, alors que la plupart des études
réalisées dans l’hémisphère Nord ne
démontrent de sensibilité saisonnière que
pour les femmes. La portée de ces résul-
tats est peut être limitée par le fait que le
climat du Queensland est assez différent
de celui des îles britanniques, qui fournis-
sent la plupart des données concernant
l’hémisphère Nord. La latitude est diffé-
rente, les températures annuelles sont rela-
tivement élevées, et les différences de
température et de photopériodes entre l’hi-
ver et l’été y sont moindres. Des études
complémentaires restent donc indispen-
sables pour clarifier l’impact de la latitude
et des facteurs météorologiques sur le mois
de première admission pour schizophré-
nie.
Mots clés. Saison – Première admission –
Schizophrénie.
Pour en savoir plus
✓
Kinney D, Jacobsen B, Jansson L et al.
Winter birth and biological family history
in adopted schizophrenics. Schizophrenia
Research 2000 ; 44 : 95-103.
Les résultats de cette étude suggèrent que
des facteurs environnementaux, associés
avec les naissances d’hiver, pourraient être
étiologiquement importants dans la schi-
zophrénie, particulièrement dans les cas
où les facteurs de prédisposition familiale
sont faibles. En revanche, un facteur fami-
lial de prédisposition, probablement géné-
tique, pourrait avoir un impact non négli-
geable pour les cas de schizophrénie des
patients nés pendant les saisons plus
douces.
✓
Herran A, de Santiago A, Sandoya M
et al. Determinants of smoking behaviour
in outpatients with schizophrenia. Schizo-
phrenia Research 2000 ; 41 : 373-81.
Soixante-quatre pour cent des patients
schizophrènes de cette étude étaient des
fumeurs réguliers, et ce taux est supérieur
à celui des autres patients psychiatriques
et de la population générale. Aucune
variable (à part le sexe) ne distinguait les
fumeurs des non-fumeurs, mais le nombre
de cigarettes par jour était corrélé avec
l’anxiété état et l’anxiété trait.
✓
Addington J, Addington D. Neuro-
cognitive and social functioning in schi-
zophrenia : a 2.5 year follow-up study.
Schizophrenia Research 2000 ; 44 : 47-56.
Les résultats de cette étude longitudinale
suggèrent que l’association entre les carac-
téristiques neurocognitives et le fonction-
nement social des patients schizophrènes
reste constante au fil du temps.
Le thème de la revue de presse
du mois de janvier 2001 sera :
Les effets des psychotropes
chez les enfants
1
/
4
100%