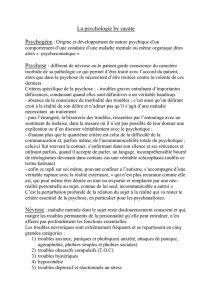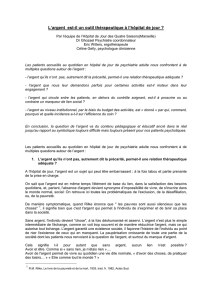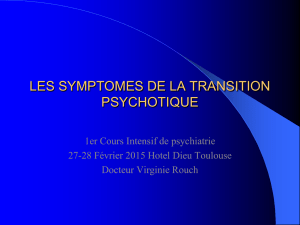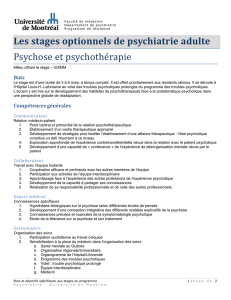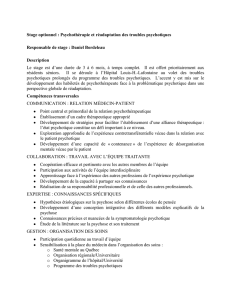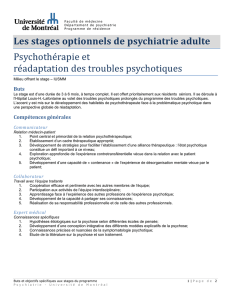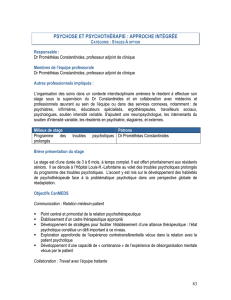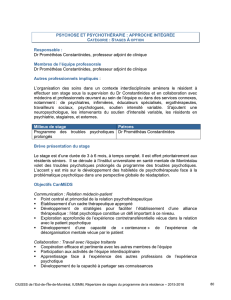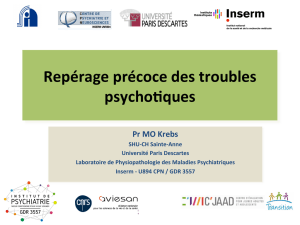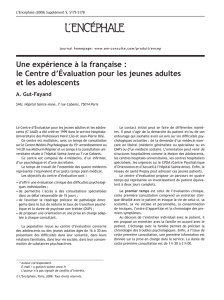Les symptômes non spécifiques de la transition

Les symptômes non spécifi ques
de la transition psychotique
M.-O. Krebs
Service hospitalo-universitaire, C’JAAD, Hôpital Sainte-Anne, UMR 894 INSERM Université Paris Descartes 75014 Paris, France
L’Encéphale (2011) 37, 10-14
© L’Encéphale, Paris, 2011. Tous droits réservés.
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep
Correspondance.
Adresse e-mail : [email protected] ; [email protected] (M.-O. Krebs).
Les signes prodomiques prépsychotiques
De nombreux signes prodromiques, précédant l’apparition
de la psychose, ont été décrits, de manière rétrospective.
Pour Edwards et McGorry, par exemple, on retrouve par
ordre de fréquence décroissante des diffi cultés de concen-
tration et d’attention, un échec scolaire, un manque
d’énergie et de motivation, une humeur dépressive, des
troubles du sommeil, une anxiété, un isolement ou repli sur
soi, une méfi ance, une détérioration du fonctionnement
social, une irritabilité.
D’autres signes prodromiques peuvent être retrouvés :
des troubles de la personnalité ; des abus d’alcool ou de
drogues ; des anomalies comportementales, en particulier
des prises de risque ; des signes pseudo-névrotiques ; des
changements cognitifs et affectifs subtils.
D’une façon générale, l’étude clinique des prodromes
permet de distinguer des indicateurs prodromiques pré-
coces, généralement non spécifi ques, et des indicateurs
prodromiques plus tardifs mais aussi plus spécifi ques, qui
revêtent la forme de symptômes psychotiques atténués
(Tableau 1).
Les symptômes de base
Huber a proposé d’individualiser des symptômes de base
(basic symptoms), qui peuvent être précocement détectés.
Ce sont des symptômes subjectifs, perçus en début d’évo-
La littérature internationale évoque généralement les
symptômes spécifi ques de la transition psychotique, à la
recherche de facteurs prédictifs, mais très peu les symp-
tômes non spécifi ques, qui sont souvent les signes d’appels.
La question de la transition psychotique s’inscrit naturelle-
ment dans une perspective évolutive, prenant en compte la
progression de la maladie. Les psychiatres d’adultes éva-
luent de manière rétrospective des éléments retrouvés plus
précocement dans la vie de sujets déjà situés dans un cadre
psychopathologique. À l’inverse, les psychiatres d’adoles-
cents doivent, face à des premiers signes parfois très dis-
crets, attribuer une valeur prédictive à un tableau clinique
qui peut être en partie non spécifi que : il s’agit soit d’étayer
un risque d’évolution péjorative, soit de l’éliminer malgré
quelques signes ou symptômes. Leur problématique est
alors plus probabiliste que catégorielle et diagnostique.
Dans l’optique probabiliste, on défi nit des états à très
haut risque de psychose (ou ultra-haut risque) sur la base
de symptômes cliniques potentiellement « prodro-
miques », succédant parfois à des états à « haut-risque »
combinant des facteurs de risque génétiques ou environ-
nementaux précoces (Fig. 1). Il a été bien établi que
l’évolution d’un trouble psychotique chronique est d’au-
tant meilleure qu’une intervention thérapeutique a eu
lieu dès le premier épisode. Ceci pourrait être encore plus
vrai pour les étapes préalables et l’on pourrait être en
mesure d’utiliser les capacités de résilience et de plasti-
cité cérébrale pour entraver l’évolution d’un trouble en
cours d’installation.

Les symptômes spécifi ques de la transition psychotique 11
ration des fonctions motrices, avec le sentiment d’être moins
habile qu’auparavant ; l’altération des sensations corpo-
relles ; l’altération des perceptions sensorielles ; l’altération
des fonctions autonomes ; enfi n, l’intolérance au stress, qui
peut conduire au déclenchement d’un épisode aigu. Un clas-
sement par ordre de fréquence de ces symptômes basiques
cognitifs a pu être proposé (Tableau 2).
Pour répondre à la question de la spécifi cité de ces symp-
tômes de base, une étude de Meng et al. [5] a comparé leur
fréquence d’une part dans une population d’adolescents
lution par le patient lui-même, avant la constitution d’une
psychose véritable [3]. Les perturbations en cause peuvent
être de nature cognitive, perceptive, affective, ou sociale.
Ces plaintes subjectives concernent ainsi l’affaiblissement
des fonctions cognitives, avec une altération des capacités à
se concentrer, à être attentif, à mémoriser ; l’altération de
leurs capacités à ressentir des émotions, pouvant aller de l’ir-
ritabilité, l’excitabilité, l’« impressionnabilité », jusqu’à
l’émoussement affectif ; la perte d’énergie (fatigue, état
d’épuisement soudain, hypersensibilité à tout effort) ; l’alté-
Détection précoce
des symptômes
de base
Détection précoce
des critères
« ultra-high-risk »
Phase
prodromique
« États mentaux à risque » : notion probabiliste
- Ultra-high risk : UHR = 40 % à 1 an
Philips et al, 2005
« Prodromes » : notion rétrospective = signes précédant
l’apparition d’un trouble psychotique ; signes annonciateurs
Intensité
et fréquence
des symptômes
psychotiques
positifs
Épisode
psychotique
aigu
Premiers
symptômes
prodromiques :
faible précision
pronostique
Symptômes
prodromiques
avec haute
précision pronostique
Figure 1 « Prodromes » vs « ét ats mentaux à risque ».
Tableau 1 Clinique des prodromes
Indicateurs prodromiques
précoces
(non spécifi ques)
Indicateurs prodromiques
tardifs
(symptômes atténués)
- Retrait social
- Détérioration
du fonctionnement
- Humeur dépressive
- Diminution
de la concentration
- Diminution
de la motivation
- Troubles du sommeil
- Anxiété
- Méfi ance
- Comportement étrange
- Diminution de l’hygiène
personnelle
- Affect inapproprié
- Discours vague
ou trop élaboré
- Discours circonstanciel
- Croyances bizarres
ou pensées magiques
- Expériences perceptives
inhabituelles
Tableau 2 Le « top 10 »
des symptômes basiques cognitifs
- Réactivité émotive accrue en réponse
à des événements quotidiens
- Perturbations de la mémoire à court terme
- Persévérance dans la pensée
- Diffi cultés de concentration
- Réactivité émotive accrue en réponse
à des interactions sociales courantes
- Tolérance altérée à travailler
sous la pression du temps
- Interférence dans la pensée
- Vision trouble
- Besoin diminué de contact avec autrui
- Capacité diminuée à communiquer
avec d’autres en présence d’un désir pour ces contacts

M.-O. Krebs12
ont été développés pour quantifi er cette symptomatolo-
gie : la CAARMS et la SIPS-SOPS. Dans ces échelles, la caté-
gorisation des sujets à haut risque repose sur la présence
des symptômes positifs, qui semblent les plus spécifi ques,
mais ces outils permettent d’évaluer des symptômes cou-
vrant l’ensemble de la psychopathologie (Tableau 3).
L’étude multicentrique NAPLS (North American Prodrome
Longitudinal Study) a testé la validité de la défi nition d’un
« syndrome prodromique à risque » de premier épisode psy-
chotique [6] en comparant diverses variables démogra-
phiques, symptomatiques, fonctionnelle, anamnestiques, ou
évolutives, parmi 5 groupes de sujets « prodromiques »,
contrôles, « demandeurs d’aide », « à risque familial de psy-
chose », « schizotypiques ». Les résultats montrent que les
sujets « prodromiques », ont, par rapport aux sujets
contrôles, une symptomatologie nettement plus marquée et
un fonctionnement altéré. Mais cette différence est moins
marquée entre les sujets prodromiques et les sujets « deman-
deurs d’aide » ; les sujets à haut risque familial ont un niveau
d’adaptation prémorbide aussi altéré ; et les sujets schizoty-
piques un fonctionnement et une symptomatologie au moins
aussi altérés, et même une adaptation prémorbide de nette-
ment moins bonne qualité (Tableau 4).
Les auteurs de cette étude plaident, avec de nombreux
autres, pour faire de l’existence de prodromes une catégo-
rie diagnostique, en particulier pour des raisons socio -
économiques (l’appartenance à une catégorie diagnostique
permet le remboursement des soins et le bénéfi ce d’un
soutien social). Ils soulignent que les patients du groupe
« prodromique à risque » se distinguent nettement des
sujets contrôles, ainsi que des sujets demandeurs d’aide et
suivis en psychiatrie pour un trouble psychotique (c’est-à-dire
remplissant les critères d’un premier épisode psychotique),
d’autre part dans une population d’adolescents suivi en psy-
chiatrie pour un trouble non-psychotique, et enfi n dans un
groupe contrôle d’adolescents représentatifs de la population
générale. Les résultats montrent que ces symptômes de base
sont retrouvés chez 30 % des adolescents de la population
générale, chez 81 % des adolescents suivis pour un trouble
psychiatrique non psychotiques, et chez 96 % des adolescents
suivis pour un premier épisode psychotique. On peut relever
que, dans cette étude, les symptômes les plus cognitifs sont
ceux qui permettent le mieux de faire la distinction entre
troubles psychotiques et troubles non-psychotiques.
Un travail réalisé dans l’unité de recherche de psycho-
pathologie de l’Hôpital Sainte-Anne [4] a utilisé la fl uence
verbale comme outil d’exploration des sujets à ultra-
haut-risque de psychose, vs des sujets demandeurs d’aide
psychologique mais qui ne sont pas à haut risque. Les
résultats montrent que les tâches de fl uence verbale
sémantique – et non celles de fl uence verbale phonolo-
gique – sont altérées chez les sujets à ultra haut risque.
Ceci est intéressant car les tâches de fl uence verbale sont
très aisées à réaliser, même en pratique clinique.
Mesure de la symptomatologie
des sujets à haut risque de psychose
Parallèlement à l’échelle de Bonn sur les symptômes de
base (Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms ou
BSABS), deux outils principaux, très proches l’un de l’autre,
Tableau 3 Liste des 28 items CAARMS 2006
1. Symptômes positifs
1.1. Troubles du contenu de la pensée
1.2. Idées non bizarres
1.3. Anomalies perceptuelles
1.4. Discours désorganisé
2. Changement cognitif Attention/Concentration
2.1. Expérience subjective*
2.2. Changements cognitifs observés
3. Perturbation émotionnelle
3.1. Perturbation émotionnelle subjective*
3.2. Émoussement de l’affect observé
3.3. Affect inapproprié observé
4. Symptômes négatifs
4.1. Alogie
4.2. Avolition/Apathie*
4.3. Anhédonie
5. Changement comportemental
5.1. Isolement social
5.2. Altération du fonctionnement
5.3. Comportements désorganisés/bizarres/stigmatisants
5.4. Comportement agressif/dangereux
6. Changements physiques/moteurs
6.1. Plaintes subjectives d’altération
du fonctionnement moteur*
6.2. Changements dans le fonctionnement moteur observés
ou rapportés par le tiers
6.3. Plaintes subjectives d’altération des fonctions
végétatives/autonomes*
6.4. Plaintes subjectives d’altération des sensations
corporelles*
7. Psychopathologie générale
7.1. Manie
7.2 Dépression
7.3. Intensions suicidaires et auto-mutilations
7.4 Changements d’humeur/labilité
7.5. Anxiété
7.6. Symptômes obsessionnels et compulsifs TOC
7.7. Symptômes dissociatifs
7.8. Diminution de la tolérance au stress habituel*
*symptômes de base de Muber

Les symptômes spécifi ques de la transition psychotique 13
La maturation pubertaire pourrait en soi perturber un
équilibre fragile. Les connaissances sur la maturation
cérébrale viennent compléter ces modèles de compréhen-
sion. Les évolutions de la substance grise durant l’adoles-
cence sont marquées chez le sujet sain, sur des régions
importantes quant à la symptomatologie psychotique,
comme le lobe temporal, le carrefour temporo-pariétal,
ou le cortex préfrontal [2] Par ailleurs, le nombre de
synapse varie nettement au cours du temps. Ces modifi ca-
tions se traduisent sur le plan fonctionnel par une modifi -
cation des balances motivationnelles et émotionnelles,
des modifi cations électrophysiologiques (traduisant en
particulier des troubles du sommeil), ainsi qu’une sensibi-
lité accrue aux indices environnementaux aversifs ou
appétitifs.
Conclusion
De nombreux travaux portent sur les symptômes de la
transition psychotique à l’adolescence, mais on manque
sans doute de données sur la description du processus nor-
mal de l’adolescence : l’adolescence n’est pas un état
pathologique, mais c’est une période critique, en termes
de développement, avec des retentissements fonctionnels
importants.
La vulnérabilité à la psychose est une condition favo-
risante mais non suffi sante au développement d’un
trouble psychotique : certains patients psychotiques
des sujets à haut risque familial, et que les jeunes patients
schizotypiques sont similaires à ce groupe « prodromique »
sur de nombreux items.
Cependant, les symptômes considérés comme « prépsy-
chotiques » ne sont pas nécessairement spécifi ques : ainsi,
près de 10 % des enfants de 7 ou 8 ans présentent des hal-
lucinations [1]. L’étude du devenir des troubles envahis-
sants du développement et de leur évolution vers une
schizophrénie peut également éclairer cette question : la
catégorie des MCDD (Multiple Complex Developpemental
Disorders) est par exemple une forme clinique particulière
évoluant dans fréquemment vers un premier épisode psy-
chotique.
Modèle de compréhension
physiopathologique
Le socle sur lequel se développe la psychose pourrait être un
ensemble d’anomalies développementales précoces
(troubles génétiques, infections virales, effets environne-
mentaux délétères…), conduisant à des anomalies céré-
brales, à la fois structurelles, biochimiques, et fonctionnelles.
Au fur et à mesure de l’évolution, apparaissent divers dys-
fonctionnements non-spécifi ques de la psychose : défi cits
cognitifs, symptômes affectifs, isolement social, échec sco-
laire… L’évolution vers la psychose se fait alors sous l’in-
fl uence d’événements précipitants (« triggers »), comme le
stress ou la consommation cannabique (Fig. 2).
Tableau 4 Comparaison/sujets prodromiques
Domaine (localisation des détails) Groupe de comparaison
CN CRA HRF TPS
Sévérité des symptômes positifs ↓↓ ↓ ↓↓ 0
Sévérité des symptômes négatifs ↓↓ ↓ …↑
Fonctionnement de base ↓↓ ↓ ↓↓ ↑
Adaptation avant l’apparition de la maladie ↓↓ 00↑↑
Co-morbidité affective ↓↓ ↓ …0
Co-morbidité d’un trouble de toxicomanie ↓↓ 000
Co-morbidité axe II ↓↓ 0…NA
Antécédents familiaux de psychose NA ↓NA ↑
Antécédents familiaux de maladie non psychotique ↓↓ ↓ ↓ 0
Conversion à la psychose ↓↓ ↓↓ ↓↓ 0
Note : ↓ ↓ indique un groupe de comparaison moins détérioré que les patients prodromiques sur toutes ou la plupart des mesures ; ↓ signifie
significativement moins détérioré sur certaines mesures ou numériquement moins détérioré sur la seule mesure du domaine ; 0 indique la non-
significativité sur toutes les mesures ou significativement plus détérioré sur certaines mesures mais significativement moins détérioré sur d’autres
ou numériquement similaire sur la seule mesure du domaine ; ↑ indique que le groupe de comparaison était significativement plus détérioré que
les patients prodromiques sur certaines mesures ou numériquement plus détérioré sur la seule mesure du domaine ; ↑ ↑ indique significativement
plus détérioré que les patients prodromiques sur toutes ou la plupart des mesures ;… signifie que les données étaient rares ; NA indique que les
groupes étaient différents des patients prodromiques par définition ; CN, comparaison normale ; CRA, comparaison en recherche d’assistance ;
HRF, haute risque familial ; TPS, trouble schizotypique de la personnalité.

M.-O. Krebs14
Références
[1] Bartels-Velthuis AA, Jenner JA, van de Willige G, et al. Preva-
lence and correlates of auditory vocal hallucinations in mid-
dle childhood. Br J Psychiatry 2010;196(1):41-6.
[2] Gogtay N, Thompson PM. Mapping gray matter development:
implications for typical development and vulnerability to psy-
chopathology. Brain Cogn 2010;72(1):6-15.
[3] Huber G, Gross G. The concept of basic symptoms in schizo-
phrenic and schizoaffective psychoses. Recenti Prog Med
1989;80(12):646-52.
[4] Magaud E, Kebir O, Gut A et al. Altered semantic but not pho-
nological verbal fluency in young help-seeking individuals with
ultra high risk of psychosis. Schizophr Res 2010;123(1):53-8.
[5] Meng H, Schimmelmann BG, Koch E et al. Basic symptoms in
the general population and in psychotic and non-psychotic
psychiatric adolescents. Schizophr Res 2009;111(1-3):32-8.
[6] Woods SW, Addington J, Cadenhead KS, et al. Validity of the
prodromal risk syndrome for first psychosis: findings from the
North American Prodrome Longitudinal Study. Schizophr Bull
2009;35(5):894-908.
n’ont aucun antécédent familial ni présenté de signes
prodromiques notables. Les désordres cognitifs et les
troubles du développement, facteurs prédictifs de la
transition psychotique, sont insuffi samment prédictifs du
risque de transition pour justifi er en soi une prise en
charge, mais plaident pour l’instauration de remédiation
cognitive spécifi que dès lors qu’ils s’accompagnent d’un
retentissement fonctionnel ou de détresse psycholo-
gique. Il reste nécessaire d’identifi er les biomarqueurs,
qu’ils soient biologiques, cognitifs, ou cérébraux (image-
rie cérébrale), pour progresser dans la connaissance de
l’adolescence et des déterminants de la transition psy-
chotique.
Confl its d’intérêts
M.-O. Krebs : aucun.
Symptômes non spécifiques et/ou négatifs
== Symptômes spécifiques
Durée
de 2 à 5 ans
Durée
de 6 à 12 mois
Phase
prémorbide
- Parler et marcher
- Relations avec les autres
- Problèmes précoces
et inattenudus à l’école
- Signes neurologiques légers
Étapes de développement
normal éventuellement retardées
ou non atteint :
Début d’addiction
à la drogue :
Début de la phase
prodromale :
Ultra-high-risk
(UHR)
Premier
traitement
Facteurs de rique
de développement de la psychose :
Durée de la phase
prodromaique sans traitement
Durée de la phase
psychotique sans traitement
Durée de la phase sans traitement
- principalement
le cannabis
- symptômes affectifs
- symptômes cognitifs
- symptômes négatifs
- prédisposition génétique
- complications liées à la grossesse
- complications à la naissance
Déclin fonctionnel :
- problème à l’école,
d’éducation ou au travail
- problèmes avec la familles,
les amis, etc.
- autres conséquences :
tentatives de suicide, aggressivité,
comportement déviant
Figure 2 Modèle de développement de psychose.
1
/
5
100%