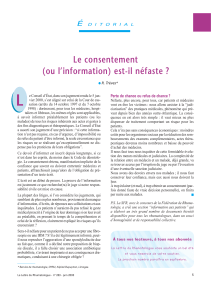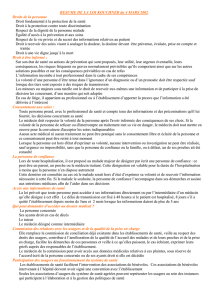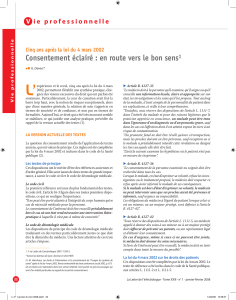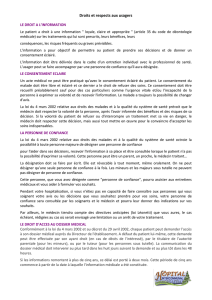L’ Consentement éclairé : en route vers le bon sens V

Vie professionnelle
Vie professionnelle
La Lettre du Rhumatologue - n° 340 - mars 2008
36
Cinq ans après la loi du 4 mars 2002
Consentement éclairé : en route vers le bon sens
© La Lettre du Cancérologue 2007;7:339-42.
IP G. Devers*
* Avocat au barreau de Lyon ; docteur en droit HDR.
(1) M. Harichaux, Les droits à l’information et le consentement de “l’usager du système de
santé” après le loi du 4 mars 2002. Revue trimestrielle de droit sanitaire et social 2002, p. 673.
(2) Les textes sont reproduits dans leur version littérale. Sont portés en gras les passages qui
sont d’un intérêt particulier au regard du recueil du consentement.
L’
expérience et le recul, cinq ans après la loi du 4 mars
2002, permettent d’établir une synthèse pratique, éloi-
gnée des visions excessives du droit qui ont parfois été
soutenues. Particulièrement, la cour de cassation avait fixé la
barre trop haut, avec la notion de risques exceptionnels, alors
que, d’une manière générale, la relation de soin s’apprécie en
termes de sincérité et de confiance, et non pas en termes de
formalités. Aujourd’hui, ce droit qui a été très mouvant semble
se stabiliser, ce qui justifie une analyse pratique, précédée du
rappel de la version actuelle des textes (1).
LA VERSION ACTUELLE DES TEXTES
La question du consentement résulte de l’application de textes
anciens, qui ont valeur de principe. Ces règles ont été complé-
tées par la loi du 4 mars 2002 et incluses dans le code de la
Santé publique (2).
Les textes de principe
Ces dispositions ont le mérite d’être des références anciennes et
d’ordre général. Elles sont issues de deux textes de grande impor-
tance, à savoir le code civil et le code de déontologie médicale.
Le code civil
La première référence est issue du plus fondamental des textes,
le code civil. L’article 16-3 figure dans ses toutes premières dis-
positions, ce qui en souligne l’importance.
“Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en
cas de nécessité médicale pour la personne.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli
préalablement
hors le cas où son état rend nécessaire une intervention théra-
peutique
à laquelle il n’est pas à même de consentir”.
Le code de déontologie médicale
Les dispositions de principe du code de déontologie médicale
traduisent en des termes particulièrement justes ce que doit
être la démarche du médecin. Une lecture attentive de ces trois
articles s’impose.
I
I
Article R. 4127-35
“Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou
qu’il conseille une
information loyale, claire et appropriée
sur
son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au
long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient
dans ses explications, et veille à leur compréhension.
“Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7,
dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le
praticien apprécie en conscience,
un malade peut être tenu
dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave
, sauf
dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un
risque de contamination.
“Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection,
mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si
le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné
les tiers auxquels elle doit être fait.
“L’article suivant examine les hypothèses où le patient n’est pas
en mesure de s’exprimer”.
Article R. 4127-36
“Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être
recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les inves-
tigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce
refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin
ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et
informés
, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci
est un mineur, ou un majeur protégé, sont définies à l’article
R. 4127-42”.
Article R. 4127-42
“Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin
appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé
doit
s’efforcer de prévenir ses parents
, ou son représentant légal
et d’obtenir leur consentement.
En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le
médecin doit donner les soins nécessaires
.
Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir
compte dans toute la mesure du possible”.
La loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients
Ces dispositions ont été complétées par la loi du 4 mars 2002. Le
texte de référence a été inclus dans le code de la Santé publique,
aux articles L. 1111-2 et L. 1111-5.
LR-NN-340-0308.indd 36 18/03/08 10:26:40

Vie professionnelle
Vie professionnelle
La Lettre du Rhumatologue - n° 340 - mars 2008
37
Article L. 1111-2
“Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traite-
ments ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences,
les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles
qu’ils comportent ainsi que sur
les autres solutions possibles et sur
les conséquences prévisibles
en cas de refus
.
Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, trai-
tements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont
identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en
cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le
cadre de ses compétences et dans le respect des règles profession-
nelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité
d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien indi-
viduel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un
diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des
tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés
au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires
de l’autorité parentale ou par le tuteur
. Ceux-ci reçoivent l’in-
formation prévue par le présent article, sous réserve des dispo-
sitions de l’article”.
Article L. 1111-5
“
Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une infor-
mation et de participer à la prise de décision les concernant
,
d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant
des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des
majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance
de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement
de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à
l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette
preuve peut être apportée par tout moyen”.
SYNTHÈSE SUR L’ÉTAT DU DROIT
Les points clés
De ces textes, se dégagent quelques points décisifs :
Il faut informer sur les risques, mais seulement ceux qui sont
fréquents, ou graves et normalement prévisibles. Il n’est plus
nécessaire d’informer sur les risques exceptionnels.
L’information doit porter sur les conséquences prévisibles
en cas de refus.
La loi n’exige pas d’écrit, mais souligne l’importance de
la relation et de l’échange avec le patient. Le médecin doit
faire preuve de conviction pour aider le patient à prendre
la décision adaptée. Ainsi, l’écrit a surtout pour mérite de
solenniser la relation et l’importance du consentement. En
revanche, il devient inutile et dangereux s’il n’est que formel,
et risque de créer une inquiétude, voire une angoisse. La
jurisprudence s’est toujours montrée très réticente quant à
tout ce qui pouvait conduire à une formalisation excessive
de ce consentement.
Le patient peut demander lui-même que cette information
soit limitée.
S’agissant des mineurs, la souplesse est nécessaire. En effet,
il a toujours été dit qu’en cas de nécessité, les soins devaient
être pratiqués même si les parents n’ont pu être contactés. De
même, il faut toujours chercher à informer l’enfant. Chacun
doit savoir que désormais les mineurs peuvent demander à
bénéficier de soins sans que les parents soient avisés, dès lors
qu’ils sont accompagnés d’une personne majeure. En cas de
situation traduisant le danger pour un enfant, le recours est le
procureur de la République chargé des mineurs, que l’on peut
contacter à toute heure en passant par le 17.
La preuve
Le rétablissement de la preuve à l’occasion d’un procès
Dès lors qu’il n’a pas été suivi de procédure fiable, et que le
praticien n’est pas en mesure de produire un écrit sincère, la
preuve de l’information sur les avantages et les risques sera très
difficile à établir à l’occasion d’un litige. Il ne restera que la force
de conviction des médecins pour exposer que l’information
adaptée a bien été donnée. À l’occasion d’une réunion d’exper-
tise, ou d’une audition par une juridiction, la parole sincère des
médecins garde un poids. Cela étant, cette parole restera peu
de chose si le dossier ne laisse pas apparaître, parmi la diversité
des moyens de preuves possibles, des éléments établissant la
sincérité de la démarche.
La constitution de preuve à l’occasion des soins
Plusieurs modalités peuvent être évoquées pour rationaliser
cette preuve :
La priorité est de soigner la qualité de l’écrit dans le dos-
sier. Cet écrit peut être sommaire, dès lors qu’il est sincère.
Ainsi, il importe que le dossier médical mentionne le jour de
l’entretien, le type d’informations fournies et éventuellement
quelques observations plus personnelles, notamment sur la
réaction du patient. Les tribunaux, et c’est heureux, posent
une présomption de véracité pour ce que le médecin a écrit
dans son dossier.
Parfois, l’information peut être donnée en présence d’un
tiers. La pratique courante n’est certainement pas en ce sens.
Mais lorsqu’il s’agit des situations les plus sensibles, à savoir
la conjonction d’une réelle option thérapeutique et de risques
connus, il est adapté de recourir à un entretien devant un tiers,
qui peut être un autre membre de l’équipe soignante, un autre
médecin ou la “personne de confiance”. Ces hypothèses ne
sont pas si fréquentes et doivent justifier une attention toute
particulière.
I
I
LR-NN-340-0308.indd 37 18/03/08 10:26:40

Vie professionnelle
Vie professionnelle
La Lettre du Rhumatologue - n° 340 - mars 2008
38
Peuvent s’avérer extrêmement utiles des correspondances du
praticien adressées à d’autres confrères, ou éventuellement au
patient. Ces courriers sont l’occasion de rappeler les discussions
qui ont eu lieu sur le bilan avantage/risque.
S’agissant d’interventions ou d’examens pratiqués de manière
régulière et dont les risques sont connus, il est tout à fait souhai-
table que le praticien dispose d’une documentation provenant
de sociétés savantes, ou qu’il a établi lui-même, et qui peut être
remise au patient en complémentarité de l’entretien.
Vient enfin la signature d’un écrit par le patient. La validité de
cet écrit suppose qu’il soit le plus simple possible, car, à défaut,
pourra être reproché par le patient son caractère difficilement
compréhensible. L’Anaes dans ses recommandations avait éga-
lement souligné la primauté de l’information orale, l’informa-
tion écrite constituant seulement un complément possible de
l’information orale (recommandations de mars 2000).
Dès lors, le souci de rationalisation de l’écrit est parfaitement
légitime. Cette démarche vise à fournir aux praticiens les
modèles les plus opératoires, en sachant qu’il ne faudra pas
hésiter, devant une situation complexe, à être plus précis, en
sortant de la référence commune.
La responsabilité
La qualité de l’information préalable doit être soignée lorsqu’il existe
une véritable option dans les conduites thérapeutiques, car le patient
doit être en mesure de participer à ce choix. Cette information préa-
lable doit être poussée lorsque, à la réalité du choix, se conjugue celle
d’un risque important et connu. À défaut, il pourrait être reproché
au praticien d’avoir privé le patient de la capacité d’exercer ce choix,
ce qui est de nature à engager la responsabilité civile.
S’agissant de l’indemnisation, la responsabilité du médecin ou
de l’établissement ne peut être retenue lorsque les soins ont été
consciencieux et de bonnes pratiques, alors même que l’informa-
tion préalable était défaillante. En effet, ce défaut d’information
n’a pas changé le cours des choses. Il ne résulte du défaut d’infor-
mation que l’expression d’un manque de considération pouvant
éventuellement ouvrir, mais dans des conditions très limitées, à
l’octroi d’une indemnisation pour un dommage moral.
Sur le plan déontologique, il est toujours nécessaire de recher-
cher le consentement et d’informer le patient dans l’esprit des
dispositions du code de déontologie. Le non-respect de cette
règle peut être sanctionné par le conseil de l’ordre.
En résumé, peuvent être posées les trois règles suivantes :
Le consentement exprime la qualité d’une relation de soin,
qui n’impose pas mais parvient à convaincre.
Lorsqu’il existe une option et des risques, l’information doit
être particulièrement soignée pour que le patient puisse parti-
ciper à la décision médicale.
L’écrit est hautement recommandé pour marquer la solennité
du moment, informer simplement, et témoigner de l’attention
du médecin. ■
Certains connaissent la célèbre interro-
gation de l’abbé Sieyès à propos du Tiers
État au début de la Révolution française
et, en la paraphrasant, cela donnerait :
qu’est-ce que le COFIPO ? Qu’a-t-il été
jusqu’à présent ? Que demande-t-il ?
Le Collège Francophone International
pour la Pathologie Ostéoarticulaire
(COFIPO) est né en 2000. Il s’agit d’une
association. Son secrétariat est assuré
par Thierry Appelboom, collègue de
Bruxelles, dont chacun connaît l’intérêt
pour la rhumatologie en général, les
déformations rhumatologiques dans la
peinture en particulier.
La présidence avait jusqu’alors été assurée
avec subtilité par Charles-Joël Menkes.
Richard Trèves lui succède. Son dyna-
misme et ses bonnes relations avec l’Afrique
francophone garantissent son succès.
Nous souhaitons pérenniser, avec le
conseil d’administration du COFIPO,
un rendez-vous bruxellois désormais
régulier (après avoir organisé des congrès
à Lille, Genève, Reims, Rabat), ce qui
devrait permettre une meilleure visibi-
lité du COFIPO.
Désormais, chaque année, à Bruxelles, au
musée de la médecine créé par ierry
Appelboom, nous continuerons à alterner,
comme nous le faisons depuis des années,
séances plénières et ateliers entrecoupés
de symposiums ouverts à l’industrie phar-
maceutique (sans l’aide de laquelle aucune
réunion, actuellement, ne pourrait se
dérouler avec succès et assiduité).
En 2008, le thème que nous avons retenu
fut la “rhumatologie interventionnelle”.
En 2009, nous avons choisi : “Aux confins
de la rhumatologie” puisque cette der-
nière, comme chacun sait, est la fille
aînée de la médecine interne. Ainsi, nous
comptons réunir une famille comprenant
des dermatologues, des cardiologues, des
pneumologues, des gastro-entérologues
et des néphrologues, etc.
Le COFIPO est ouvert à tous : Luxem-
bourgeois, Suisses, Africains (Maghrébins,
Subsahariens), Libanais et Québecois ; il
apporte une possibilité supplémentaire
aux confrères des pays du Sud de s’ex-
primer et de se retrouver.
Le COFIPO est accrédité en Belgique.
Venir à Bruxelles est rapide : 1 heure et
20 minutes en TGV depuis Paris.
Nous vous donnons rendez-vous en 2009 !
Pour toute information, écrire à :
Thierry[email protected].ac.be
Service de rhumatologie, hôpital Érasme,
8 808, rue de Lennik, 1070 Bruxelles, Belgique
Qu’est-ce que le COFIPO ?
IP Richard Treves, Thierry Appelboom, Charles-Joël Menkes
LR-NN-340-0308.indd 38 18/03/08 10:26:41
1
/
3
100%