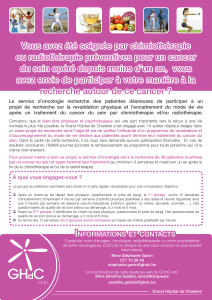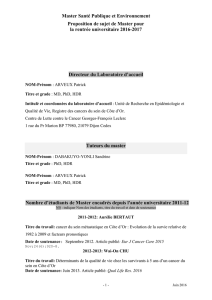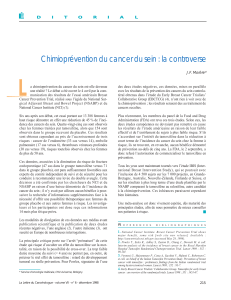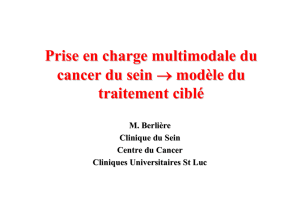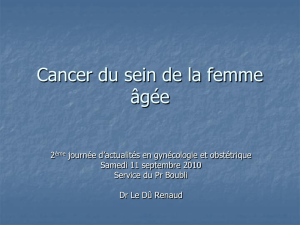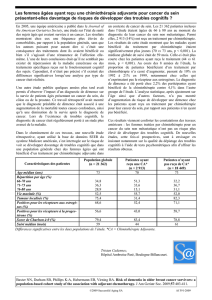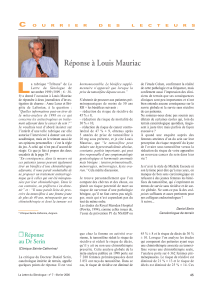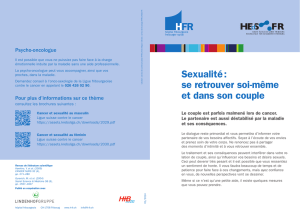L Traitements médicaux des cancers féminins et sexualité

410 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 8 - octobre 2009
DOSSIER THÉMATIQUE
Sexualité et cancers féminins
Traitements médicaux
des cancers féminins
et sexualité
Sexual functioning and cancer in women
P. Cottu 1
1
Département d’oncologie médicale,
Institut Curie, Paris.
L
a question de la qualité de vie après un cancer du
sein s’est considérablement développée depuis
une trentaine d’années. La revue de la littérature
récente parue dans le Journal of Experimental and
Clinical Cancer Research, couvrant les années 1974-
2007, a retenu 606 références pertinentes et a
montré, en parallèle, le nombre croissant de cita-
tions portant sur le sujet (1). Les années 1970 ont
permis de mettre au point et d’utiliser les premiers
outils de qualité de vie, et les années 1980-1990
ont vu le développement des échelles spécifiques
et leur validation dans différentes langues. Plus
récemment, de nombreuses échelles consacrées
au cancer du sein ont été développées et validées
(2), dont certaines sont dédiées au fonctionnement
sexuel, parfois même accessibles en ligne (www.
fsfiquestionnaire.com) [tableau I] (3).
Les cancers spécifiques de la femme concernent par
définition les organes sexuels féminins, primaires
ou secondaires. Les traitements anticancéreux mis
en œuvre s’adressent à ces mêmes organes, soit
directement – comme les traitements locorégionaux
(chirurgie et radiothérapie) –, soit indirectement par
l’action pharmacologique d’agents médicamenteux
anticancéreux. Nous examinons dans cet article les
effets indésirables d’ordre sexuel attribuables, au
moins en partie, aux traitements médicaux anti-
cancéreux.
Chimiothérapie
Sur le plan physiopathologique, il est difficile de
distinguer véritablement les effets de la chimio-
thérapie conventionnelle de ceux des traitements
hormonaux, en particulier des inhibiteurs de l’aro-
matase (IA) ou de la suppression ovarienne (4). La
ménopause induite peut être un marqueur clinique
de ces effets, et la probabilité de sa survenue est
directement liée aux traitements donnés et à l’âge
de la patiente (figure) [5, 6]. La chimiothérapie est
connue pour ses effets neuro-cognitifs (le chemo-
brain), muqueux, musculaires et endocriniens plus
ou moins intriqués. L’hypo-estrogénie secondaire
aux traitements hormonaux accompagne et majore
ces effets. Deux conséquences majeures sur le
fonctionnement sexuel sont ainsi identifiées : les
dyspareunies, associées à la sécheresse et l’atro-
phie vaginales, à la crainte de la pénétration et à
la méconnaissance des moyens thérapeutiques ; la
baisse du désir, elle-même liée aux dyspareunies, à la
crainte de la douleur, aux traitements concomitants,
à la dépression, à la crainte de perte de séduction, à
la perte de l’excitation (mammaire) et aux pensées
parasites liées au cancer (6).
Tableau I. Female sexual function index : un score est attribué pour chaque item, générant un
score global de la qualité de la fonction sexuelle.
Domaine Nombre
d’items
Score Minimum Maximum
Désir 2 1-5 2 10
Excitation 4 0-5 0 20
Lubrification 4 0-5 0 20
Orgasme 3 0-5 0 15
Satisfaction 3 0 (ou 1) à 5 2 15
Douleur 3 0-5 0 15

0,6
0,8
25 30 35
Chimiothérapie + hormonothérapie
Chimiothérapie seule
Hormonothérapie seule
Pas de traitement systémique
40 Âge
Probabilité
45 50 55
0,4
0,2
0,0
Figure. Probabilité de ménopause en fonction de l’âge et des traitements (5).
La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 8 - octobre 2009 | 411
Résumé
La prise en charge des cancers de la femme se conçoit désormais de manière globale. Les questionnaires
de qualité de vie développés depuis plus de 20 ans ont permis d’isoler ses différents paramètres, et en
particulier la sexualité. Nous revoyons ici l’impact sur la sexualité des traitements médicaux des cancers.
Mots-clés
Cancer féminin
Sexualité
Highlights
The care for cancers in women
must be now conceived as a
global approach. Quality of life
evaluation has now become
paramount in cancer therapy.
Among the parameters defining
the quality of life, sexual func-
tioning has been specifically
evaluated. We propose here a
review of the impact of medical
treatments of cancer in women
on sexual functioning.
Keywords
Women cancer
Sexual functioning
Dans la revue citée, A. Montazeri souligne qu’après
chimiothérapie adjuvante la plupart des patientes
récupèrent l’ensemble de leurs paramètres initiaux
de qualité de vie, sauf dans deux domaines : les
phénomènes vasomoteurs et la sexualité (1). Une
autre revue récente, reprenant 11 études portant
sur des patientes ayant reçu une chimiothérapie
adjuvante, confirme cette altération significative de
la sexualité sur plusieurs paramètres tels la libido,
les dyspareunies, la sécheresse vaginale, l’image du
corps et l’intérêt (tableau II) [7]. Cependant, aucune
altération ne peut être attribuée spécifiquement à la
chimiothérapie chez ces patientes, toutes opérées, et
dont la plupart ont aussi reçu une hormonothérapie.
Tableau II. Sexualité et chimiothérapie (7).
Auteur n Méthode Conclusion
Young
67 Questionnaire dédié Libido, dyspareunies, sécheresse vaginale, orgasme
Ganz
139 Questionnaire santé long terme Troubles sexuels persistants
Ganz
864 Questionnaire dédié Dysfonction sexuelle plus marquée
Lindley
86 Questionnaire général Dyspareunies, sécheresse vaginale, dysfonction sexuelle
Dorval
124 Questionnaire téléphone + contrôles Moins de satisfaction sexuelle
Spencer
223 Questionnaire général Sentiment d’être moins séduisante et désirable
Ganz
472 + 662 Questionnaire dédié Sécheresse vaginale, image du corps, ménopause induite
Mortimer
57 Questionnaire dédié Dyspareunies, sécheresse vaginale
Bergland
294 Questionnaire dédié Dysfonction sexuelle
Wilmoth
18 Interview Vieillissement, diminution des sensations sexuelles
(excitation, seins), sécheresse vaginale
Ganz
558 Questionnaire général Problèmes sexuels, manque d’intérêt

412 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 8 - octobre 2009
Traitements médicaux des cancers féminins et sexualité
DOSSIER THÉMATIQUE
Sexualité et cancers féminins
C’est l’approche tentée par S.R. Burwell et al. chez
209 patientes de moins de 50 ans, sexuellement
actives, dont seulement 28 % avaient reçu un traite-
ment hormonal (8). Les patientes étaient soumises
à un questionnaire rétrospectif tentant d’établir leur
fonctionnement sexuel avant le diagnostic, puis à
un questionnaire 6 semaines, 6 mois et 1 an après
l’intervention. Une chimiothérapie avait été admi-
nistrée à 56 % d’entre elles. Une détérioration nette
de la fonction sexuelle a été observée à 6 semaines
et à 6 mois, sur les quatre principaux paramètres
retenus (intérêt, excitation, relaxation et orgasme).
À 1 an, on observe une tendance nette à la récupé-
ration. L’analyse multivariée des facteurs associés
à ces variations du fonctionnement sexuel donne
deux enseignements majeurs. En premier lieu, les
éléments très personnels, comme le fonctionne-
ment avant le diagnostic, l’état général physique et
social, et la perception de sa propre séduction sont
fondamentaux. Parallèlement, la chimiothérapie
est un cofacteur puissant d’altération de la fonction
sexuelle, mais très bref et essentiellement pertinent
pendant les 6 premiers mois. Après 6 mois, l’effet
propre de la chimiothérapie a disparu. Une étude
plus récente menée par l’équipe du Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center (New York) et portant sur
92 patientes a tenté de différencier les effets respec-
tifs des différents traitements sur la sexualité (9).
Plus de 80 % des patientes de cette étude disaient
éprouver une forme ou une autre de dysfonction
sexuelle, mais, en définitive, la part attribuable à la
chimiothérapie reste là encore assez floue, avec des
niveaux identiques de gêne sexuelle sévère en cas de
chimiothérapie (48 %) et d’hormonothérapie (46 %).
Hormonothérapie
L’effet spécifique de la chimiothérapie est donc assez
difficile à isoler, et il se confond certainement avec
les effets endocriniens, ainsi qu’avec les effets des
traitements hormonaux, eux-mêmes fréquemment
associés à la chimiothérapie.
Le tamoxifène reste l’un des traitements hormo-
naux les plus prescrits. Nous disposons d’une expé-
rience originale dans l’indication de “prévention” des
cancers du sein reconnue aux États-Unis à la suite
des essais du NSABP P-1 et P-2 : c’est la seule situa-
tion où le tamoxifène a été administré à des femmes
saines, ne subissant pas en parallèle les autres traite-
ments du cancer du sein. Malheureusement, peu de
données sont disponibles, et les effets vasomoteurs,
plus que sexuels, sont au premier plan des effets
indésirables (4). De manière intéressante, l’essai P-2
rapporte un plus grand nombre de dyspareunies sous
raloxifène. Chez les patientes traitées pour un cancer
du sein par tamoxifène, sans chimiothérapie, peu
d’effets indésirables sexuels sont observés, mais les
cohortes sont anciennes et les outils anciens. Aucune
donnée fiable n’est disponible pour le fulvestrant.
Les récentes études randomisées comparant tamoxi-
fène et IA, conduites avec des études ancillaires de
qualité de vie, sont plus riches d’enseignements.
Trois situations cliniques ont été étudiées avec les
IA et ont apporté des données complémentaires.
Premièrement, les IA ont été comparés au tamoxi-
fène chez des patientes n’ayant pratiquement pas
reçu de chimiothérapie. Au sein de l’étude ATAC
(anastrozole versus tamoxifène), plus de 1 000 des
9 000 patientes incluses ont participé à l’étude de
qualité de vie (10). Au sein de l’étude TEAM (exémes-
tane versus tamoxifène), plus de 700 patientes (soit
28 %) ont participé à l’étude de qualité de vie (11).
Malgré des méthodes d’évaluation et de calcul diffé-
rentes, ces deux études arrivent à une conclusion
similaire : les IA altèrent significativement plus la
fonction sexuelle que le tamoxifène. Cette altération
perdure après 2 ans de traitement pour les patientes
sous exémestane. Elle est, par ailleurs, spécifique :
les scores endocriniens et la qualité de vie globale
ne sont pas différents entre anastrozole et tamoxi-
fène. Ces éléments sont confirmés chez la femme
présentant un cancer du sein avancé (12).
Deuxièmement, les IA, notamment l’exémestane,
ont été testés après 2-3 ans de tamoxifène au sein
de l’étude IES (13). Chez les patientes ayant reçu du
tamoxifène pendant au moins 2 ans, et n’ayant pas
rechuté, les scores de qualité de vie globaux après
cancer du sein (échelle FACT-B) et les scores endo-
criniens ne sont pas différents entre exémestane et
tamoxifène. De même, l’évaluation spécifique de la
fonction sexuelle ne montre pas de différence (14),
au contraire de la comparaison frontale précédem-
ment évoquée (11). Seules les pertes vaginales restent
significativement plus fréquentes avec le tamoxifène.
Enfin, l’étude MA17 a comparé placebo et létrozole
après 5 ans de tamoxifène (15). Aucune différence
significative de qualité de vie entre les deux groupes
n’a été observée. Le létrozole induisait significati-
vement plus de troubles physiques, vasomoteurs
et sexuels (16). L’analyse spécifique des troubles
sexuels mettait en avant essentiellement les compli-
cations physiques (bouffées de chaleur, douleurs et
sécheresse vaginale), mais sans modification de la
peur du regard de l’autre ou du désir (questionnaire
MENQOL) [16].

La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 8 - octobre 2009 | 413
DOSSIER THÉMATIQUE
Thérapies ciblées
Les effets sexuels des thérapies ciblées sont
encore mal connus chez la femme. Le trastuzumab
(Herceptin®) et le bévacizumab (Avastin®) n’exer-
cent aucun effet endocrinien et ne sont pas
supposés majorer d’éventuels troubles liés aux
traitements associés. Les inhibiteurs de tyrosine
kinase, comme le lapatinib (Tyverb®), ont des effets
indésirables cutanéo-muqueux, qui sont en cours
d’évaluation. Une étude, portant sur 35 patients
traités pour cancer du rein par sorafénib, suni-
tinib, temsirolimus ou évérolimus a également
montré des effets sexuels des thérapies ciblées
chez l’homme (17). Plusieurs paramètres sont
altérés : le désir, l’orgasme, l’érection et la satis-
faction globale. Nul doute qu’il faudra élargir à ces
thérapies l’évaluation de la sexualité.
Conclusion
La sexualité après cancer mammaire ou gynéco-
logique est fortement perturbée. De nombreuses
études menées au moyen d’échelles d’évaluation
multiples montrent qu’au moins 20 à 40 % des
patientes sont concernées par cette altération spéci-
fique de la qualité de vie. Spécifiquement, les effets
sexuels de la chimiothérapie sont constants mais
semblent réversibles, et les effets du tamoxifène sont
inconstants et surtout d’ordre vasomoteur. Les IA
semblent particulièrement invalidants sur ce point,
mais avec une durabilité qui reste encore à préciser.
Les équipes de cancérologie doivent compter des
spécialistes et proposer des documents d’information
permettant de faire prendre conscience aux médecins,
aux soignants… et aux patientes de la réalité de ce
problème et de la nécessité de sa prise en charge. ■
1. Montazeri A. Health-related quality of life in breast cancer
patients: a bibliographic review of the literature from 1974
to 2007. J Exp Clin Cancer Res 2008;27:32.
2. Atkins L, Fallowfield LJ. Fallowfield’s Sexual Activity
Questionnaire in women with without and at risk of cancer.
Menopause Int 2007;13:103-9.
3. Rosen R, Brown C, Heiman J et al. The Female Sexual Func-
tion Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument
for the assessment of female sexual function. J Sex Marital
Ther 2000;26:191-208.
4. Buijs C, de Vries EG, Mourits MJ, Willemse PH. The
influence of endocrine treatments for breast cancer
on health-related quality of life. Cancer Treat Rev
2008;34:640-55.
5. Goodwin PJ, Ennis M, Pritchard KI et al. Risk of menopause
during the first year after breast cancer diagnosis. J Clin
Oncol 1999;17:2365-70.
6. Schover LR. Premature ovarian failure and its conse-
quences: vasomotor symptoms, sexuality, and fertility.
J Clin Oncol 2008;26:753-8.
7. Knobf MT. The influence of endocrine effects of adjuvant
therapy on quality of life outcomes in younger breast cancer
survivors. Oncologist 2006;11:96-110.
8. Burwell SR, Case LD, Kaelin C, Avis NE. Sexual problems
in younger women after breast cancer surgery. J Clin Oncol
2006;24:2815-21.
9. Goldfarb SB, Dickler M, Sit L et al. Sexual dysfunction in
women with breast cancer: prevalence and severity. J Clin
Oncol 2009;27(Suppl. 15): abstract 9558.
10. Fallowfield L, Cella D, Cuzick J et al. Quality of life of
postmenopausal women in the Arimidex, Tamoxifen, Alone
or in Combination (ATAC) Adjuvant Breast Cancer Trial.
J Clin Oncol 2004;22:4261-71.
11. Van Nes JGH, Voskvil DW, Van Leeuwen FE et al. Quality
of life in relation to hormonal treatment of postmenopausal
women in the Dutch Tamoxifen Exemestane Adjuvant
Multicentre (TEAM) trial. Cancer Res 2009;69(Suppl.):
abstract 21.
12. Morales L, Neven P, Timmerman D et al. Acute effects
of tamoxifen and third-generation aromatase inhibitors on
menopausal symptoms of breast cancer patients. Anticancer
Drugs 2004;15:753-60.
13. Coombes RC, Hall E, Gibson LJ et al. A randomized trial
of exemestane after two to three years of tamoxifen therapy
in postmenopausal women with primary breast cancer.
N Engl J Med 2004;350:1081-92.
14. Fallowfield LJ, Bliss JM, Porter LS et al. Quality of life
in the intergroup exemestane study: a randomized trial of
exemestane versus continued tamoxifen after 2 to 3 years
of tamoxifen in postmenopausal women with primary breast
cancer. J Clin Oncol 2006;24:910-7.
15. Goss PE, Ingle JN, Martino S et al. Randomized trial of
letrozole following tamoxifen as extended adjuvant therapy
in receptor-positive breast cancer: updated findings from
NCIC CTG MA.17. J Natl Cancer Inst 2005;97:1262-71.
16. Whelan TJ, Goss PE, Ingle JN et al. Assessment of quality
of life in MA.17: a randomized, placebo-controlled trial of
letrozole after 5 years of tamoxifen in postmenopausal
women. J Clin Oncol 2005;23:6931-40.
17. Bessede T et al. ASCO GU 2009: abstract 516.
Références bibliographiques
1
/
4
100%