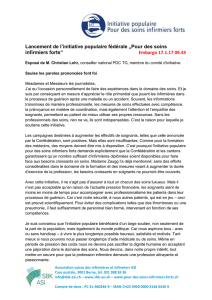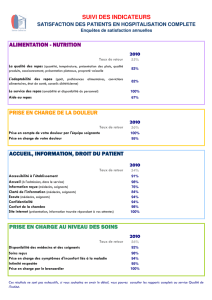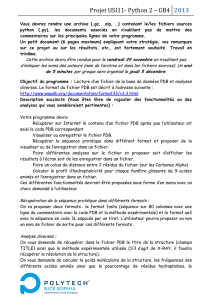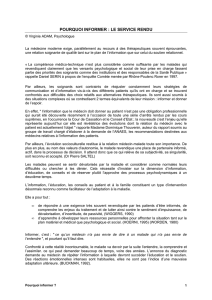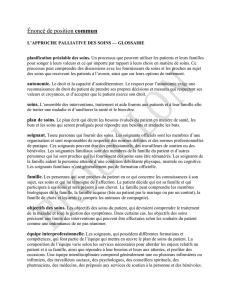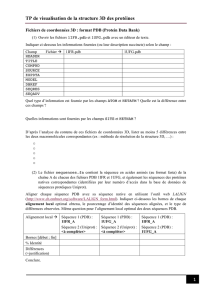Il suffit parfois d’un regard, d’un sourire...

Il suffit parfois d’un regard, d’un sourire...
Depuis plus de 20 ans, vous avez fré-
quenté de nombreux hôpitaux. Vous
souvenez-vous du premier regard
que vous portez sur les soignants ?
Philippe Pozzo di Borgo : Mon
épouse et moi-même n’avions ja-
mais mis les pieds dans un hôpi-
tal pour y être soignés. Le premier
contact se fait dans le privé, quand
Béatrice fait une fausse couche.
Pour nous, c’était important. Pour
le personnel soignant, c’était ba-
nal. Au second accident, nous
avions le sentiment que personne
ne prenait en compte notre dé-
tresse. Tout de suite, nous avons
senti un problème d’orientation.
Une grossesse, c’est normal quand
cela se passe bien. Sinon, tout est
cloisonné et, en service obsté-
trique, on ne va pas au-delà du
problème gynécologique et on ne
cherche pas plus loin si les tests
sont satisfaisants. Et puis, on fait
confiance aux médecins... malgré
la détresse physique et psycholo-
gique et le constat d’échec res-
sentis devant un enfant mort-né.
Nous avons souffert du manque
de tact en ces circonstances.
Vous faites ensuite l’expérience de
l’hospitalisation aux États-Unis, pour
les mêmes raisons.
P.PdB. : Rien à voir avec le sys-
tème français. Du moment que
l’on payait, on entrait dans le rap-
port client-soignant, avec tout ce
que cela comporte d’agréable,
même si ces rapports étaient un
peu trop “sucrés” à mon goût. Le
professionnalisme est poussé jus-
qu’aux limites. Cependant, tout
est fondé sur l’argent. Il vaut
mieux être un privilégié ! Mais,
quand ils n’ont pas compris les
échecs, ils ont voulu savoir. En ef-
fet, c’est aux États-Unis que l’on
a trouvé que tous les malheurs de
Béatrice avaient pour origine un
cancer de la moelle osseuse, très
rare, connu sous le nom de ma-
ladie de Vaquez.
Revenus en France, vous conduisez
de nouveau Béatrice à l’hôpital,
public cette fois.
P.PdB. : Une embolie pulmonaire a
nécessité une hospitalisation en ré-
animation cardiaque. Béatrice passe
un an en service de cardiologie où
on l’opère pour poser un clip-cave.
Vous parlez d’une entrée dans des
années de souffrance...
P. PdB. : C’était la descente aux en-
fers. Même si la malade accepte
son état sans se plaindre, et c’était
le cas pour Béatrice, elle subit une
solitude terrible parce qu’elle est
placée en dehors de sa maladie, car
on ne lui explique rien. Et que dire
de l’accompagnant, de la famille,
désemparé de voir souffrir quel-
qu’un de proche, et de cette igno-
rance dans laquelle on les tient
sous prétexte “qu’on ne sait pas”.
On est affolé par l’environnement,
désemparé d’entendre tous ces
“bips”, les soignants qui entrent et
sortent sans beaucoup de respect,
les médecins qui réduisent l’iden-
tité du malade à son numéro de lit.
Sans parler des réveils à l’aurore et
des repas du soir à l’heure du goû-
ter. On peut comprendre qu’il est
difficile d’organiser le planning
pour le personnel, mais enfin,
quand il y a de la grande souf-
france, un mourant à côté !
Vous faites alors l’expérience du long
séjour.
P.PdB. : A la suite de son opération
cardiaque, Béatrice est hospitalisée
en moyenne 6 mois par an. Le long
séjour change le relationnel.
Se tissent alors des rapports ambi-
gus, contradictoires, avec les soi-
gnants. On est à la merci d’un pou-
voir médical sans partage. “Ils”
savent, on ne sait rien, alors qu’“ils”
ne savent pas non plus puisque l’on
comprend bien qu’“ils” cherchent,
qu’“ils” expérimentent même. On
sent que tous se murent dans le si-
lence pour ne pas avouer leur im-
puissance et l’on devine même la
réprobation des infirmiers qui n’ont
pas le pouvoir d’informer, pas le
droit de douter de l’opportunité du
traitement, mais le devoir de s’in-
cliner devant une décision prise par
le “patron”. Or, les infirmières sont
plus sensibles à ce qui se passe réel-
lement, même si elles n’ont pas tou-
jours le temps. Ne pas comprendre
ce qui se passe plonge la famille
dans un désarroi total.
Ce qui adoucissait le séjour, c’est
l’indulgence du personnel qui
acceptait quelques dérogations,
comme celle de me permettre de
rester après l’heure des visites. Je
ne pouvais faire autrement à cause
de mon travail et de la solitude de
Béatrice qui était immense. Le ma-
lade est toujours seul face à sa ma-
ladie. Cette solitude le fragilise et
il sait très vite qu’il est limité par
son état de dépendance.
Vous aviez des médecins dans votre
famille ?
P. PdB. : En long séjour, le malade
et sa famille doivent apprendre
les règles de fonctionnement de
l’hôpital. Ils doivent faire preuve de
souplesse, voire de séduction, pour
apaiser les tensions, instaurer un re-
lationnel convivial. Cela se fait len-
tement. Quand les médecins de
notre famille arrivaient, ils voulaient
en savoir davantage, ne com-
Jusqu’à son accident, qui l’a rendu tétraplégique,
Philippe Pozzo di Borgo était un “homme dans le
monde”, un privilégié. Mais Béatrice était malade. Dans
un livre*, il fait part de ses douleurs mais aussi de son
appétit de vivre et d’aimer. Témoignage d’une longue
errance à travers des services hospitaliers.
●●●
Paroles de patient
5
Professions Santé Infirmier Infirmière - No33-34 - janvier-février 2002

prenaient pas les soins et pou-
vaient, par leur agressivité, réduire
à néant, en quelques minutes, le cli-
mat de confiance que nous avions
instauré avec les équipes soignantes.
Vous insistez beaucoup sur ce
manque d’information qui apparaît
comme une angoisse supplémentaire.
P.PdB. : C’est peu de le dire. Les ma-
lades devraient avoir accès au dos-
sier médical. Il faut les responsabi-
liser. De toute façon, quand un
malade veut savoir, il sait. Il de-
mande simplement qu’on l’aide à
comprendre ce qui se passe. Et s’il
a peur de savoir, il ne demande rien.
Par exemple, quand le chirurgien a
opéré mon épouse, il nous a bien
montré la nécessité de le faire de-
vant la gravité du risque d’embolies
à répétition. Mais nous n’étions pas
informés de tous les effets secon-
daires de l’opération, c’est-à-dire
des ulcères atroces qui saignaient
tout le temps. Or, lui le savait. Si
nous avions été informés, nous au-
rions réfléchi et certainement suivi
ses recommandations car, en toute
connaissance de cause, on accepte
mieux ce qui ce passe, même le
pire. Ces ulcères qui atteignaient
aussi Béatrice dans l’esthétique de
son corps étaient paradoxalement
plus insupportables que son can-
cer. Et ces soins très douloureux
avec le scalpel étaient vécus par
nous comme une véritable “char-
cuterie”. Là encore, ces actes si
naturels pour les soignants sont res-
sentis comme très cruels par les pa-
tients. Heureusement, quand nous
sommes retournés chez nous, les
infirmières qui soignaient à domi-
cile montraient une compétence et
une humanité hors pair. Elles ai-
daient même Béatrice dans son
souci de rester belle. Et quel soula-
gement d’être dans son environne-
ment familial, hors de l’hôpital !
Votre épouse est ensuite allée en ser-
vice de cancérologie.
P. PdB. : Ce sont des services très
durs. L’équipe du centre de trans-
fusion sanguine était formidable,
tant dans l’accueil que dans l’atten-
tion au malade et à la famille de ce-
lui-ci. Puis, il y a eu la bulle stérile
où a été placée mon épouse après
une septicémie. Malgré la compé-
tence des soignants, il est dur de
faire barrière aux infections noso-
comiales quand la structure du ser-
vice est vouée à la démolition (on
ne le sait qu’après bien sûr) et que
la rivalité des services s’exerce en
taux de réussites. Il faut rappeler
que ce cancer était rare et suscitait
la curiosité des chercheurs.
Entre temps, vous aviez eu votre
accident de parapente.
P. PdB. : J’étais tétraplégique depuis
trois ans. Je ne me souviens pas
d’avoir souffert dans l’accident. J’ai
été longtemps dans le coma et
maintenu en coma artificiel pen-
dant un mois. Je regrette la bruta-
lité de l’annonce du diagnostic à
ma famille, en bref : “Il a une
chance sur cinq de s’en sortir”. Il
y a aussi l’incompréhension de
certains chirurgiens qui acceptent
mal que l’entourage reste pour
parler au patient. Pourtant, si je ne
me souviens de rien, je suis sûr
que les paroles aident le comateux.
Comme toutes les personnes ali-
tées, j’ai fait l’expérience des es-
carres. C’est horrible. Là encore, le
malade est dépendant de la qua-
lité des soins. Je n’en ai pas eu dans
le service de réanimation, car il y
avait les massages fréquents et
aussi une alimentation adaptée.
J’ai eu des escarres en quelques
jours dès que j’ai changé de ser-
vice. J’ai pu constater les consé-
quences du manque de personnel
et de changement de régime ali-
mentaire. Résultat : intervention
chirurgicale pénible.
En centre de rééducation, vous
avez fait l’expérience de la vie en
communauté.
P.PdB. : Dans le centre de Bretagne
qui m’a accueilli, les soignants sont
formidables, pleins d’humanité et
d’indulgence. Ils m’ont réappris à
vivre. C’est une ambiance très
étrange. On se croirait dans le ro-
man de Thomas Mann La mon-
tagne magique. Il y a des pleurs mais
aussi des rires. Il y a beaucoup de
jeunes et l’on apprend à penser aux
autres. Il y a des drames humains,
beaucoup de solitude après un
handicap. Des familles qui se bri-
sent, qui ne reconnaissent plus le
démuni. Des amitiés aussi, des
amours parfois. Ce qui est formi-
dable, c’est que l’on nous considère
comme des êtres normaux, que
l’on accepte nos faiblesses, nos fa-
çons personnelles de nous en sor-
tir. Une chose importante : l’aide
d’un psychologue et d’un sexo-
logue. Ce qui rassure certains pa-
ralysés qui désespéraient sans oser
parler. Quand les soignants savent
nous mettre en confiance, on peut
enfin admettre le handicap, la dé-
pendance. Quand on peut pleurer
en face d’une infirmière, on ressent
alors un sentiment de partage et on
se met à espérer.
Avez-vous pensé à mourir ?
P.PdB. : J’ai essayé au début, à l’hô-
pital, mais, pour un tétraplégique,
c’est difficile. Il me reste des choses
à faire avant. Il faut passer le relais
à mes enfants. Je cultive l’espérance
transmise par mon épouse. Au-
jourd’hui, ce qui me gêne, ce sont
mes douleurs qui brûlent mon
corps inerte et que même la mor-
phine ne soulage pas. Heureuse-
ment, je suis un privilégié et je suis
entouré. Les infirmières sont cha-
leureuses et savent écouter. Ces in-
firmières, je les ai haïes quelquefois.
Mais je mesure aujourd’hui la dif-
ficulté d’exercer. Ce sont les soi-
gnants qui nous retiennent à la vie
quand on est aussi dépendant. On
ne peut les décevoir. Je me de-
mande si les infirmières se rendent
compte combien chaque regard,
chaque parole peuvent engendrer
l’espoir et l’envie de se battre.
Propos recueillis par
Andrée-Lucie Pissondes
*Le second souffle, Bayard, Paris, 2001,
192 p.
6
●●●
Professions Santé Infirmier Infirmière - No33-34 - janvier-février 2002
1
/
2
100%