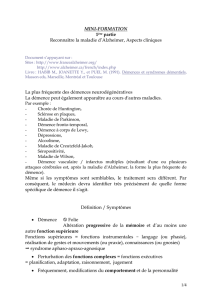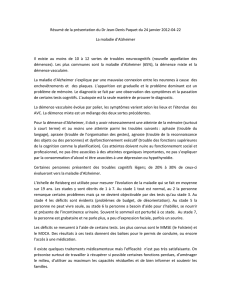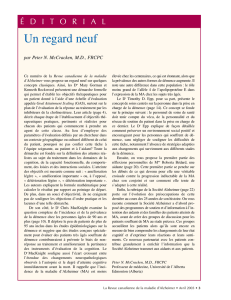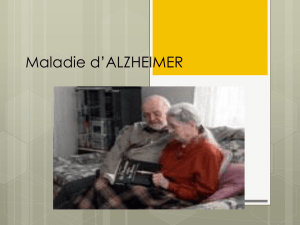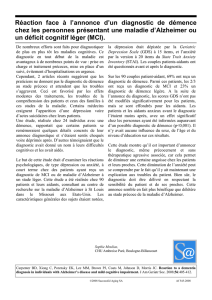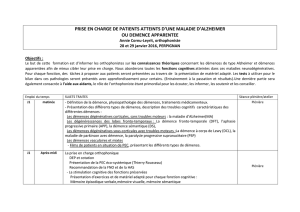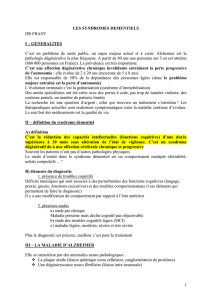JFR 2010 - L'imagerie de la maladie d'Alzheimer en pratique...

JFR 2010 - L'imagerie de la maladie d'Alzheimer en pratique clinique
Mis à jour le 05/07/2011 par
SFR
C Delmaire, Service de Neuroradiologie.
CHRU de Lille
Article issu du quotidien des JFR 210
- Samedi 23 Octobre
L
’
imagerie cérébrale fait partie intégrante
de l
’
exploration d
’
une démence. Elle
recherche des causes éventuellement
curables, comme les tumeurs, des signes
positifs de démence neurodégénératives,
comme une atrophie de localisation
évocatrice, ou des lésions vasculaires.
L
’
imagerie cérébrale est donc
systématique pour toute démence
d
’
installation récente (http://www.has
-
sante.fr/portail/jcms/c_668822/alzheimer
-
s
-
disease
-
and
-
related
-
conditions
-
diagnosis
-
and
-
treatment). Récemment, un protocole fondé sur les recommandations de la
Haute Autorité de la Santé (HAS) et sur la pratique de nombreux centres d
’
imagerie français, a été
proposé par la Société Française de Neuroradiologie. Cet examen doit permettre de dépister l
’
ensemble
des causes de démences en un temps raisonnable.
Contexte clinique
Selon la définition du DSM IV, la démence se définit par une atteinte des fonctions intellectuelles et
cognitives suffisamment sévère pour entraîner une perte d
’
autonomie dans les gestes de la vie
quotidienne ou dans les interactions sociales, évoluant depuis au moins six mois. Les démences
dégénératives représentent la première cause de démence du sujet âgé. La maladie d
’
Alzheimer est la
plus fréquente des démences en général, et des démences neurodégénératives après 65 ans (60 %). Un
diagnostic précoce permet d
’
améliorer la prise en charge des patients au sein d
’
une filière adaptée et de
débuter tôt un traitement par inhibiteurs de l
’
acétylcholinestérase, dont l
’
effet bénéfique est d
’
autant
plus marqué qu
’
il a été initié précocement. De nombreux travaux ont porté sur la phase pré
-
démentielle
de la maladie d
’
Alzheimer.
La définition d
’
une entité clinique nommée mild cognitive impairment (MCI, ou
«
déclin cognitif léger
»
)
vise à identifier un état intermédiaire entre le vieillissement physiologique et la démence, afin de cibler
les patients à fort risque de développer une démence, dans le but d
’
instaurer précocement un
traitement. Le MCI est un syndrome défini par un déclin cognitif plus important que celui que l
’
on
s
’
attend à trouver à un âge et niveau d
’
éducation donnés, mais qui n
’
a pas de retentissement sur les
activités de la vie quotidienne. Les patients ne sont donc pas déments. Cependant, le MCI représente
un concept clinique hétérogène, au sein duquel se situe la phase prodromale d
’
une maladie d
’
Alzheimer
et pour lequel le taux annuel de conversion vers la démence est estimé entre 12 et 15 %.
Le trouble de mémoire présenté par les patients MCI amnésiques, qui évoluent vers une maladie
d
’
Alzheimer a été récemment caractérisé grâce à des tests mnésiques spécifiques (rappel libre/rappel
indicé 16 items ou test de Grober et Buschke). Sur la base de ces tests, des critères de maladie
d
’
Alzheimer prodromale ont été proposés qui reposent sur un critère principal (l
’
atteinte précoce et
importante de la mémoire épisodique) et des critères additionnels (atrophie du lobe temporal médial,
taux de peptide Aβ1
-
42 bas et de protéine Tau totale ou phosphorylée élevés à la ponction lombaire,
baisse du métabolisme temporo
-
pariétal).
L
’
association aux lésions vasculaires
Les démences vasculaires (DV) représentent la deuxième cause
de démence, toutes causes confondues (8 à 15 %). Elles sont
associées à une maladie cérébro
-
vasculaire. On peut observer des
accidents ischémiques corticaux ou sous
-
corticaux, des infarctus
stratégiques, des lésions de leucopathie vasculaire par
hypoperfusion chronique, avec sténose des petites artères et des
lésions hémorragiques. Les critères diagnostics du NINDS
-
AIREN
(le National Institute of Neurological Institute of Neurological
Disorders and Stroke, et l
’
Association Internationale pour la
Recherche et l
’
Enseignement en Neurosciences) associent une
démence avérée, l
’
existence d
’
une affection cérébrovasculaire
clinique et radiologique et une relation temporelle entre démence
et lésion cérébrale. L
’
atrophie du lobe temporal médian a été
souvent décrite dans la démence vasculaire, cependant inférieure
à celle attendue dans une maladie d
’
Alzheimer. Toutefois, son
existence dans une démence vasculaire peut faire suspecter une
intrication entre la pathologie vasculaire et une cause
neurodégénérative responsable des troubles cognitifs. À l
’
inverse,
les anomalies vasculaires peuvent se rencontrer dans la maladie

d
’
Alzheimer (20 à 30 %), d
’
autant qu
’
une grande proportion de
patients présentant une démence neurodégénérative associent
une pathologie vasculaire concomitante. En cas de doute entre
une démence vasculaire ou dégénérative, le clinicien pourra
s
’
aider des examens paracliniques, en particulier de la ponction
lombaire.
Objectifs de l
’
examen d
’
imagerie IRM
Le clinicien référent qui va demander une IRM pour une suspicion de début de démence peut être
différent d
’
un centre à l
’
autre. Il peut s
’
agir d
’
un neurologue ou d
’
un gériatre spécialisé dans l
’
étude des
démences, d
’
un neurologue ou d
’
un médecin généraliste. La précision de l
’
étude clinique et neuro
-
psychologique du patient peut donc être différente mais il est recommandé de toujours effectuer le
même protocole standardisé qui suit les recommandations de la HAS. Le but de l
’
imagerie est multiple :
1) éliminer une étiologie neurochirurgicale, 2) montrer des lésions vasculaires, 3) contribuer au
diagnostic positif des démences neurodégénératives, et en particulier à celui de la maladie d
’
Alzheimer
grâce à des coupes coronales permettant de visualiser l
’
hippocampe. Le protocole IRM recommandé par
la SFR et la SFNR va permettre de répondre aux objectifs fixés et il est conforme aux recommandations
de la HAS. Il comporte les séquences suivantes :
•
La séquence volumique tridimensionnelle pondérée en T1
va permettre de rechercher et de localiser
une atrophie cérébrale. En raison de la très nette prépondérance épidémiologique de la maladie
d
’
Alzheimer, des reconstructions dans le plan coronal perpendiculaire au grand axe des hippocampes
sont indispensables. L
’
acquisition volumique présente de nombreux avantages qui la font préférer aux
séquences 2D coronales. Elle permet la correction d
’
une éventuelle asymétrie de positionnement
permettant au mieux d
’
apprécier et de quantifier l
’
importance de l
’
atrophie hippocampique. Les
reconstructions sagittales vont faciliter l
’
étude du gradient antéropostérieur de l
’
atrophie dans le cadre
d
’
une démence fronto
-
temporale ou d
’
une atrophie corticale postérieure. Elle permet une volumétrie de
l
’
hippocampe (manuelle ou à l
’
aide d
’
un logiciel spécialisé). Enfin, le volume T1 apparaît supérieur pour
la détection des lacunes, en particulier au niveau des noyaux gris centraux. La sauvegarde sur un
support informatisé permettra d
’
évaluer l
’
évolution de l
’
atrophie sur des coupes identiques et
d
’
améliorer la qualité de la comparaison, principalement visuelle, des modifications (Fig. 1).
•
La séquence FLAIR dans le plan axial
évalue la présence d
’
anomalie de signal de la substance
blanche et/ou de lésions ischémiques.
• La séquence pondérée en écho de gradient T2 (T2*) axiale est réalisée à la recherche de micro
-
saignements cérébraux (microbleeds). Ils sont des marqueurs de la sévérité de la microangiopathie et
sont plus fréquents chez les sujets hypertendus. Les micro
-
saignements cérébraux pourraient être un
marqueur péjoratif de la pathologie vasculaire, mais leurs valeurs diagnostique et pronostique restent
controversées. L
’
association entre la présence de micro
-
saignements et le déclin cognitif a été
démontrée chez le sujet sans et avec pathologie neurologique. La présence de micro
-
saignements
n
’
élimine pas le diagnostic de maladie d
’
Alzheimer, mais peut également faire évoquer une angiopathie
amyloïde.
• La séquence coronale pondérée T2 en coupes fines perpendiculaires au plan des hippocampes
peut être utilisée. Elle permet de rechercher des anomalies de signal au niveau du lobe temporal
médian faisant suspecter une origine vasculaire ou infectieuse et non dégénérative des troubles
cognitifs.
•
La séquence de diffusion axiale
peut être réalisée dans le cadre d
’
un bilan ou d
’
un suivi d
’
une
démence de type vasculaire. Elle est également très utile pour l
’
exploration de la maladie de
Creutzfeldt
-
Jakob.
L
’
injection de produit de contraste n
’
est pas systématique et sera réservée aux cas pour lesquels elle
présente une utilité, comme la sclérose en plaques ou les tumeurs.
Pourquoi et comment mesurer l
’
atrophie hippocampique en routine clinique ?
Une atrophie temporale médiale est observée de façon marquée et précoce dans la maladie d
’
Alzheimer.
Cette atrophie présente une valeur diagnostique et également pronostique chez les patients qui
présentent un trouble de mémoire. L
’
appréciation de la sévérité de l
’
atteinte temporale médiane pourra
se faire visuellement. On pourra s
’
aider d
’
échelles comme l
’
échelle de Scheltens. Cette échelle repose
sur trois items cotés sur une coupe coronale : la taille de l
’
hippocampe, l
’
élargissement de la corne
temporale ventriculaire et l
’
élargissement de la fissure choroïdienne (Tableau 1, Fig. 2).
Conclusion
L
’
imagerie IRM contribue au diagnostic positif des démences neurodégénératives, et en particulier à
celui de la maladie d
’
Alzheimer. L
’
analyse morphologique IRM des structures encéphaliques permet de
mettre en évidence des modifications visibles sous forme d
’
une atrophie focale ou d
’
anomalies de signal
spécifiques de certaines démences dégénératives. L
’
IRM participe également aux efforts d
’
identification
des patients ayant un risque élevé de développer une maladie d
’
Alzheimer.
La standardisation de l
’
examen IRM facilitera l
’
harmonisation des procédures en France, ainsi que la
lecture des images par les cliniciens, radiologues ou non.
Légendes
Fig. 1
–
Patient de 67 ans, consultation en 1997 pour un trouble de la mémoire. Aggravation des
troubles en 2001. L
’
évolution clinique et radiologique de l
’
atrophie temporale médiane sur l
’
IRM
réalisée en 2001 fait suspecter une évolution vers une démence neurodégénérative (MA).
Fig 2
–
Reconstructions coronales T1 illustrant les différents grades de l
’
échelle de Scheltens
estimés au niveau du corps de l
’
hippocampe. Le grade peut être asymétrique entre les
hippocampes droit et gauche.
Tableau 1
–
L
’
échelle tient compte de la largeur de la fissure choroïdienne, de la dilatation de la
corne temporale ventriculaire et de la hauteur de l
’
hippocampe.

1
/
3
100%