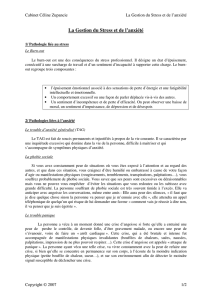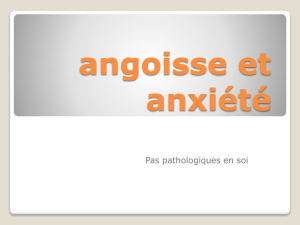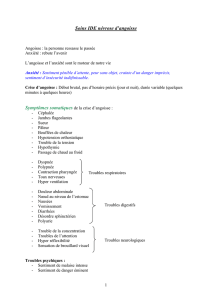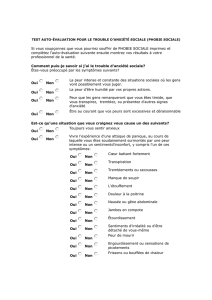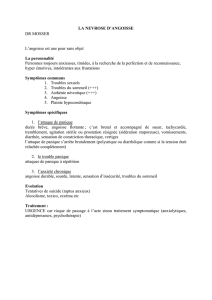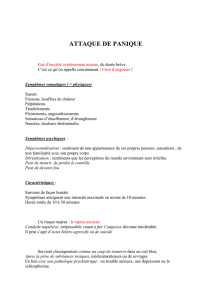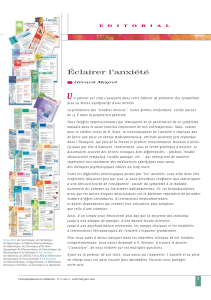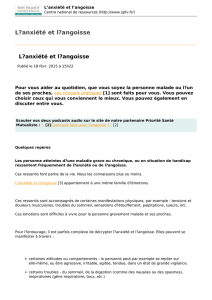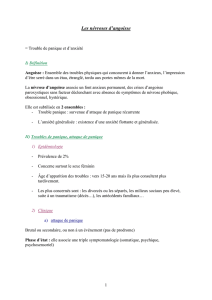Lire l'article complet

Médecine
& enfance
I
l importe de différencier l’anxiété
(qui est sans objet) de la peur, ou
de la crainte (éprouvée à l’égard
d’une personne, d’une situation ou d’un
objet) ; mais aussi de distinguer l’anxié-
té (qui est un phénomène psychique) de
l’angoisse (qui est son versant soma-
tique, avec des manifestations neurové-
gétatives).
Il faut aussi faire la différence entre une
anxiété « normale », qui correspond à
certaines périodes de la vie, lorsque sur-
viennent des modifications dans le
cours du développement de l’enfant (sé-
paration d’avec les parents, puberté,
changement de statut à l’adolescence)
et une anxiété pathologique, qui invali-
de, donne mal au ventre, à la tête, et qui
empêche d’aller à l’école.
Ou encore entre l’anxiété flottante et
celle qui s’attache à des objets (les pho-
bies), ou celle qui atteint tout l’équilibre
psychique de l’enfant (cette anxiété de
néantisation ou de dépersonnalisation
que l’on rencontre dans la psychose).
Ce n’est pas tout : il faut aussi distin-
guer entre la situation où l’angoisse est
évidente et s’exprime, comme dans les
phobies, et les manifestations liées à
l’angoisse, sans que cette dernière soit
nécessairement visible, comme dans les
obsessions, l’hystérie ou les somatisa-
tions (fonctionnelles et psychosoma-
tiques).
Notons en outre que nombre d’enfants
développent des angoisses associées à
une mauvaise estime de soi lorsqu’ils
sont confrontés à l’échec ou à l’inadap-
tation scolaires pour diverses raisons
(dyslexie, dyscalculie, dyspraxies, capa-
cités intellectuelles déficitaires ou dys-
harmonie de leurs capacités intellec-
tuelles).
Certains auteurs soutiennent avec de
bons arguments que l’école peut dura-
blement rendre malade d’angoisse cer-
tains enfants qui ne parviennent pas à
entrer dans le « moule » exigé par l’Edu-
cation nationale.
LA RÉFLEXION
PSYCHOPATHOLOGIQUE
EST INDISPENSABLE
La réflexion psychopathologique est in-
dispensable chez l’enfant, qui est un
être en développement, en transforma-
tion et en interaction. Il existe des
échelles d’anxiété (comme la Revised
Children’s Manifest Anxiety Scale, ou
RCMAS, éditée en français par les édi-
tions du Centre de psychologie appli-
quée, Catro, 1999) qui évaluent les
symptômes dans un objectif chimiothé-
rapique, mais le traitement exclusif du
symptôme chez l’enfant est insuffisant
et parfois est un non-sens.
C’est ainsi que la CIM 10 distingue l’an-
goisse de séparation, le trouble anxieux
phobique, l’anxiété sociale, l’anxiété gé-
néralisée ; chacun correspond à un en-
semble de symptômes requis pour poser
le diagnostic. Mais comment imaginer
un clinicien qui ne tiendrait pas compte
de l’ensemble de la personne qui se
trouve devant lui, et, notamment lors-
qu’il s’agit d’un enfant, de sa situation
familiale ?
Otto Rank, disciple de Freud, théorise
l’idée que la première angoisse ressen-
tie est le moment de la naissance. Plus
Parce que l’anxiété est sans doute, dans sa forme mineure, le symptôme psy-
chique le plus fréquent chez l’enfant, elle constitue un sujet qui concerne avant
tout les pédiatres. En pratique pédiatrique, les quatre situations anxieuses pa-
thologiques les plus fréquentes sont la phobie scolaire, l’angoisse de déper-
sonnalisation, l’angoisse réactionnelle, l’attaque de panique.
L’anxiété chez l’enfant
M. Boublil, Fondation Lenval, Nice
POINT PSY
avril 2009
page 179
121036_179- 20/04/09 14:40 Page 179

tard, Kubie considère que la seconde
source d’angoisse réside dans le défaut
de maternage. R. Spitz, lui, distingue
trois stades dans le développement de
l’angoisse au cours de la première an-
née de vie :
dès la naissance, la tension liée à la
faim, à la soif, au malaise physique, à la
colique, aux mauvaises positions, au
chaud ou au froid ;
après trois mois, la réactivation d’une
sensation déplaisante ;
puis entre six et huit mois, la réaction
à l’absence de la mère ou à la présence
d’un étranger (angoisse dite de l’étran-
ger).
Après l’âge de un an, puis dans toute la
petite enfance, c’est la séparation qui va
provoquer l’angoisse.
A trois ou quatre ans, l’angoisse est ex-
primée par la peur de personnages ou
d’animaux qui apparaissent dans les
rêves, au cours des terreurs nocturnes
ou dans l’imaginaire (c’est souvent la
peur d’être dévoré).
A cinq ou six ans, c’est la peur d’être pris,
d’être enlevé, qui se mêle à des angoisses
de mort : c’est un âge en effet où l’enfant
prend conscience de la mort. Cette an-
goisse se manifeste parfois sous la forme
de la crainte de la maladie (hypocon-
drie), et notamment du cancer, du sida,
des microbes. Elle peut donner lieu à des
rites de lavage sans que ceux-ci soient
nécessairement pathologiques s’ils de-
meurent intermittents et tendent à s’at-
ténuer avec le temps grâce à la réassu-
rance et aux explications des parents.
QUATRE SITUATIONS
ANXIEUSES
PATHOLOGIQUES
LA PHOBIE SCOLAIRE
Dans notre pratique, la situation
anxieuse pathologique la plus fréquente
est ce que l’on appelle la phobie scolai-
re. Après de nombreux signes d’alerte
(douleurs abdominales, céphalées du
matin, pollakiuries), un enfant est pris
d’angoisses très intenses au moment de
partir pour l’école. Il est fréquent que
les choses s’améliorent lorsqu’il est en
classe. Il désire d’ailleurs s’y rendre
mais il n’y parvient pas car il est sub-
mergé par son angoisse.
Le tableau peut se révéler grave, l’en-
fant étant empêché d’aller en classe
pendant des mois, voire des années.
Une grande mobilisation sociale se dé-
clenche (signalement, visite d’assistante
sociale ou d’éducateur). Dans les cas sé-
vères, un refus de soins de la part de
l’enfant va même conduire à une hospi-
talisation en pédopsychiatrie. Ces en-
fants sont souvent pris dans une situa-
tion complexe, non apparente au pre-
mier abord, génératrice d’une angoisse
importante qui est « déplacée » incons-
ciemment par eux sur l’espace scolaire
et est justifiée par des raisons plau-
sibles : « la maîtresse crie, les camarades
se moquent de moi ».
Dans de nombreux cas, ces angoisses
sont liées à la crainte de l’enfant de lais-
ser seul un parent (surtout la mère) ;
parfois, elles expriment la pathogénicité
d’un secret ou d’un non-dit (paternité,
etc.), ou encore mettent en scène la sé-
paration impossible d’avec la mère.
La première démarche doit être de cher-
cher à comprendre le sens des symp-
tômes. Le recours à des traitements
symptomatiques, parfois nécessaire, ne
peut être qu’une première étape de la
prise en charge, obligatoirement suivie
d’autres approfondissements.
L’ANGOISSE DE
DÉPERSONNALISATION
La seconde situation, heureusement
plus rare, est l’angoisse de dépersonna-
lisation. L’enfant est paniqué. Il cherche
à fuir ce qui se passe en lui en frappant,
en cassant, en se mettant en danger (il
peut par exemple vouloir se jeter par
une fenêtre). C’est une angoisse qui le
déborde et dont il veut à tout prix fuir
les sensations.
Souvent, chez de jeunes enfants, il s’agit
soit de manifestations de désorganisa-
tion psychique aiguës et temporaires,
liées à une situation de stress, agissant
sur une personnalité fragile (névrose ou
pathologie limite, en période de décom-
pensation), soit d’épisodes qui signent
l’entrée dans un processus psychotique
parfois schizophrénique : dans ce cas, la
simple excitation liée à une présence
trop nombreuse ou trop proche peut suf-
fire à déclencher des angoisses massives
et difficilement « compréhensibles ».
L’apaisement peut revenir grâce à un
isolement vécu comme protecteur.
L’ANGOISSE RÉACTIONNELLE
Le troisième type d’anxiété patholo-
gique que nous rencontrons est celui de
l’angoisse réactionnelle à une situation,
ou qui survient en liaison avec elle. La
plus fréquente est la menace de sépara-
tion des parents, la naissance d’un puî-
né, l’entrée à l’école maternelle (c’est
rare) ou élémentaire, ou au collège.
Ce type d’anxiété est accessible et gué-
rissable par des entretiens et/ou une
psychothérapie de soutien ou de type
psychanalytique, mais il faut de la dis-
ponibilité, du temps et un temps de gui-
dance parentale, qui ne peut pas ici être
exclu du traitement.
L’ATTAQUE DE PANIQUE
Le quatrième situation rencontrée (plus
souvent chez l’adolescent) est l’attaque
de panique. Prise au départ pour une
maladie somatique, un malaise vagal ou
un problème neurologique, son dia-
gnostic est précédé de multiples exa-
mens somatiques, qui vont souvent jus-
qu’à l’IRM. Le bilan somatique négatif
et la répétition des crises conduisant à
une forme de phobie sociale (le patient
finit par ne plus sortir de chez lui) si-
gnent souvent le diagnostic.
L’ANXIÉTÉ À LA MANIÈRE
NORD-AMÉRICAINE
Après avoir exposé la « manière » fran-
çaise de penser l’anxiété de l’enfant, je
ne résiste pas à l’envie de vous présen-
ter la « manière » nord-américaine,
scientifique, moderne et indiscutable,
organisée en étapes. L’étude a été pu-
bliée dans un numéro récent du New
England Journal of Medecine.
1. L’anxiété est très fréquente et invali-
dante chez l’enfant, sur le plan social,
Médecine
& enfance
avril 2009
page 180
121036_179- 20/04/09 14:40 Page 180

relationnel, familial et scolaire (ce dont
personne ne doute).
2. On prend 488 enfants entre sept et
dix-sept ans, qui viennent de six Etats
différents des Etats-Unis, qui sont trai-
tés pendant douze semaines, qui souf-
frent tous d’une anxiété modérée à sé-
vère de type anxiété de séparation,
anxiété généralisée ou phobie sociale.
Beaucoup souffrent d’une
« comorbidité », avec une anxiété liée à
un THADA ou à des problèmes d’ap-
prentissage.
On constitue quatre groupes que l’on va
traiter différemment : le premier grou-
pe reçoit une thérapie comportementa-
le et cognitive (x séances) [CBT] ; le se-
cond reçoit un traitement par Zoloft
®
,
seul IRSS (inhibiteur de recaptage spé-
cifique de la sérotonine) qui a l’AMM
chez l’enfant, grâce notamment à sa for-
me 25 mg. C’est usuellement un antidé-
presseur, mais le laboratoire veut le po-
sitionner pour son action anxiolytique
chez l’enfant, l’anxiété de l’enfant ayant
peut-être (dans certains cas) une origi-
ne dépressive ; le troisième groupe re-
çoit un CBT et du Zoloft
®
; le quatrième
reçoit un placebo (du sucre).
Résultats : 60 % de réussite dans le pre-
mier groupe, 55 % dans le deuxième,
81 % dans le troisième, 24 % dans le
quatrième.
Les auteurs constatent également que le
Zoloft
®
ne donne pas davantage d’effets
secondaires que le placebo.
L’option d’emblée médicamenteuse
n’est pas dans les habitudes françaises.
Chez l’enfant, le traitement médica-
menteux sera instauré en cas d’échec
des autres modes d’abord ; il est consi-
déré comme visant à atténuer une dou-
leur psychique invalidante, pour le
temps où l’abord psychothérapique se
met en place.
Après avoir lu cette étude, qui résistera
à la prescription qui donnerait au pa-
tient les meilleures chances de guérir ?
A court terme, avouons-le, ce type de
démarche de soins est très efficace.
Mais il faut toujours chez l’enfant pen-
ser à long terme, sauf si l’on recherche
une efficacité immédiate et symptoma-
tique.
ORIENTATIONS
THÉRAPEUTIQUES
L’ANXIÉTÉ RÉACTIONNELLE
Elle relève du domaine du pédiatre, qui
connaît la famille et prend du temps,
car la parole, la réassurance, la mise en
liens (« C’est parce que vous venez
d’avoir un bébé, que votre mari ne vous
aide pas suffisamment et que vous avez
moins de temps à consacrer à votre en-
fant qu’il ressent cette angoisse de sépa-
ration qui augmente »), l’explication
provenant d’un tiers, médecin qui ne
fait pas partie de la famille, mais en qui
elle a confiance, sont d’une grande aide.
L’ANXIÉTÉ DE SÉPARATION
PERSISTANTE
Elle nécessite souvent qu’on aborde de
manière plus globale le fonctionnement
familial et les dysfonctionnements, qui
quelquefois sont insolubles : absence de
père ou père absent ; enfant en fusion
avec la mère depuis la petite enfance
(cet enfant reste pour elle un soutien,
un consolateur, un petit défenseur
« contre le père »). Un suivi individuel
est à associer au suivi familial.
LES PHOBIES SCOLAIRES
La difficulté est plus grande, car soit la
phobie est brève et correspond à des
difficultés réactionnelles, soit elle est
plus forte, plus tenace, au premier
abord incompréhensible, et l’hospitali-
sation est alors parfois nécessaire, afin
que l’hôpital prenne une place tercei-
sante dans le lien fusionnel mère-enfant
(l’enfant ne veut pas aller à l’école pour
ne pas quitter sa mère) et impose à l’en-
fant la loi manquante du père. C’est cet-
te configuration qui permet à l’enfant
(qui craint une réhospitalisation qui
mettrait un terme à sa toute-puissance)
de reprendre l’école.
L’ANGOISSE DE
DÉPERSONNALISATION
Elle est d’un autre ordre. Il s’agit d’un mo-
ment où les parents parlent de « disjonc-
tage », de « possession », d’impression de
« deux personnes ». Ces épisodes sont
considérés aujourd’hui comme compor-
tant un risque d’être un mode d’entrée
dans la schizophrénie infantile très pré-
coce, car l’enfant manifeste une dissocia-
tion de ses contenus psychiques, dont il
ne parvient plus dans ces moments-là à
maintenir l’unité. Un suivi pédopsychia-
trique est nécessaire, et le consensus se
dirige aujourd’hui vers la mise en place
d’un traitement précoce psychothéra-
pique et/ou médicamenteux. On estime
que la prolongation d’un vécu altérant
son rapport à la réalité est un élément
pronostique négatif, d’où l’importance de
ne pas banaliser ces épisodes.
LES ATTAQUES DE PANIQUE
Dans ces manifestations, la symptoma-
tologie disparaît au bout de quelques
semaines de traitement avec un antidé-
presseur de type IRSS (la paroxétine est
le traitement de choix, mais il n’a pas
l’AMM chez l’enfant, et le Zoloft
®
à 25,
50 ou 75 mg est le traitement le plus
souvent prescrit). Cela ne dispense pas
d’un suivi psychothérapique, mais ce
sont généralement des patients qui ont
du mal à parler, sauf de leurs crises. On
retrouve souvent, à l’origine de ces at-
taques (sans que le patient lui-même
fasse le lien), un événement trauma-
tique de type deuil, perte, rupture,
contrariété refoulée.
CONCLUSION
L’angoisse est, chez l’enfant, un symptô-
me à la fois fréquent et polysémique. Il
vaut toujours mieux en rechercher le
sens que de masquer la souffrance par
un médicament dont l’effet ne va durer
que le temps de sa prise.
L’angoisse prend des formes différentes
selon les problèmes sous-jacents de per-
sonnalité. Mais elle peut aussi évoluer
dans sa symptomatologie au cours de la
vie de l’enfant. Chez le même enfant, on
peut voir des phobies succéder à des at-
taques de panique, puis être suivies,
quelques années plus tard, de somatisa-
tions ou d’angoisses de dépersonnalisa-
tion. L’important est toujours d’aider le
patient à établir des liens au long cours,
à avoir, plutôt qu’un médicament, des
Médecine
& enfance
avril 2009
page 181
121036_179- 20/04/09 14:40 Page 181

clés lui donnant accès au sens de ses
symptômes, lesquels en ont toujours un,
même s’il est parfois inaccessible dans
l’immédiat.
L’anxiété parentale projetée sur l’enfant
n’était pas le sujet du présent article,
mais elle constitue un chapitre impor-
tant des perturbations interactives pa-
rent-enfant. En effet, certaines patho-
mimies, la répétition de demandes
d’examens médicaux ou d’examens
complémentaires, les fausses croyances
concernant des pathologies infantiles
menant à une surprotection ne sont pas
rares. Au maximum, on trouve le syn-
drome de Münchhausen par procura-
tion, qui est considéré comme une for-
me de maltraitance.
Médecine
& enfance
avril 2009
page 182
Bibliographie
AJURIAGUERRA J. : Manuel de psychiatrie de l’enfant, 2
e
éd.,
Masson, Paris, 1977.
BOWLBY J. : « L’anxiété de la séparation», Psychiatr. Enf., 1962 ;
5:317-35.
BOWLBY J : Attachement et perte, PUF, Paris, 1978.
DIATKINE R. : « Figures de l’anxiété de l’enfance à l’adolescen-
ce », Neuropsychiatr. Enf. Adolesc., 1995 ; 43 : 197-200.
FREUD A. : Le Moi et les mécanismes de défense, 8
e
éd., PUF,
Paris, 1975.
FREUD S. : « L’inquiétante étrangeté » (1919), in L’inquiétante
étrangeté et autres essais, Gallimard, Paris, 1965 ; p. 211-63.
FREUD S. : Inhibition, symptôme, angoisse, PUF, Paris, 1975.
JALENQUES I., LACHAL C., COUDERC A.J. : Les états anxieux
de l’enfant, Masson, Paris, 1992.
LEBOVICI S., LE NESTOUR A. : « A propos des phobies scolaires
graves », Psychiatrie de l’Enfant, 1977 ; 20 : 383-432.
MOUREN-SIMEONI M.C., VILA G., VERA L. : Troubles anxieux
de l’enfant et de l’adolescent, Maloine, Paris, 1993 ; p. 103.
SPITZ R. : « Anaclitic depression. An inquiry into the genesis in
early childhood », Psychoanalytical Study of the Child, 1946 ; 2:
313-42.
WALKUP J.T., ALBANO A.M., PIACENTINI J., BIRMAHER B.,
COMPTON S.N., SHERRILL J.T., GINSBURG G.S., RYNN M.A.,
MCCRACKEN J., WASLICK B., IYENGAR S., MARCH J.S., KEN-
DALL P.C. : « Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a com-
bination in childhood anxiety », N. Engl. J. Med., 2008 ; 359 :
2753-66.
121036_179- 20/04/09 14:40 Page 182
1
/
4
100%