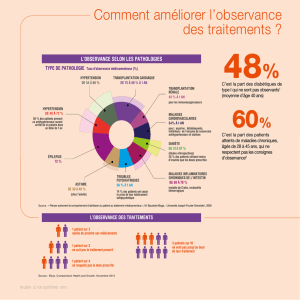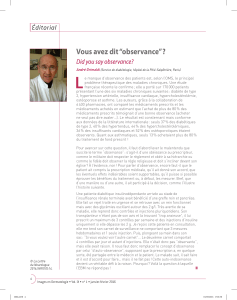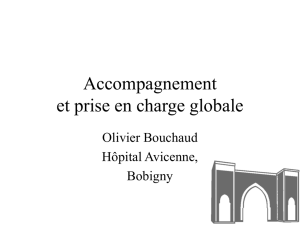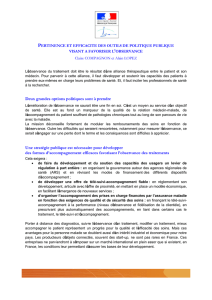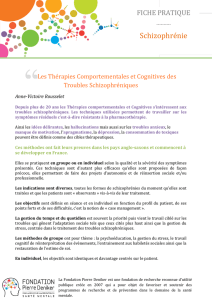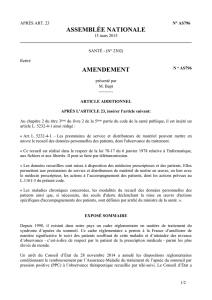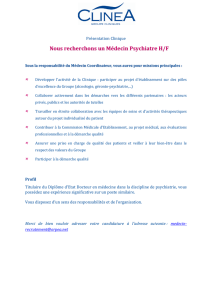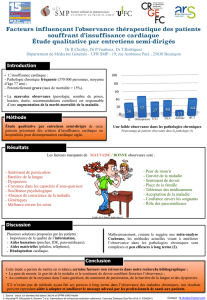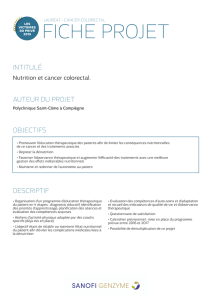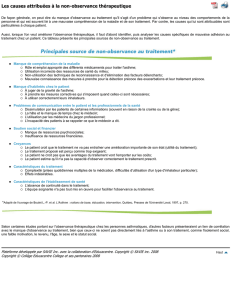L’engagement thérapeutique dans les troubles schizophréniques DOSSIER THÉMATIQUE

48 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 2 - mars-avril 2010
DOSSIER THÉMATIQUE
La schizophrénie :
penser le soin
L’engagement thérapeutique
dans les troubles
schizophréniques
Therapeutic commitment in schizophrenia
T. Bottai*, M. Benoit**, S. Bourcet***, D. Dassa****, P. Raymondet*****
* Pôle de psychiatrie générale,
service 13G24, centre hospitalier de
Mar tigues.
** Clinique de psychiatrie et de
psychologie médicale, pôle des
neurosciences cliniques, CHU Pasteur,
Nice.
*** Pôle de psychiatrie infanto-juvé-
nile, centre hospitalier de Toulon.
**** Pôle de psychiatrie Centre,
hôpital de la Conception, Assistance
publique - hôpitaux de Marseille.
***** Pôle de psychiatrie, service
83G01, centre hospitalier de Toulon.
Tout engagement génère des compromis,
et il est évidemment beaucoup plus facile de rester
soi-même en ne faisant rien.
Ethan Hawke
De l’engagement en général
Il est essentiel de cerner la problématique de l’enga-
gement, notamment celle de l’engagement théra-
peutique à laquelle tout médecin est confronté.
Nous sommes engagés par rapport à nos patients
et dans les soins, et il est utile d’avoir une lecture
critique de notre engagement quotidien.
S’engager sous-entend de s’impliquer activement
dans une situation, de prendre des responsabilités,
d’anticiper et d’ouvrir un avenir à l’action, et, surtout,
de se lier à soi-même dans le futur par rapport à ses
propres actes.
Au-delà de ces ébauches, l’engagement peut
être compris comme une conduite et un style de
conduite, d’une part, comme des actes et une
sommation d’actes, d’autre part.
L’engagement en tant que conduite consiste à
assumer activement une situation (c’est-à-dire à
être impliqué et concerné par la situation). Il s’agit
donc de reprendre à son propre compte une situa-
tion, a priori indépendante de soi, et de s’en consi-
dérer comme responsable. De cela doivent découler
un certain nombre d’actes qui visent, à partir du
présent, à reprendre le passé pour donner à l’avenir
un nouveau sens. Bien évidemment cette attitude
requiert une implication, une responsabilisation et
une anticipation de l’avenir. Surtout, elle s’oppose
radicalement aux attitudes qui manifestent une
non-prise de conscience de la situation, un retrait,
de l’indifférence ou un refus de participation.
L’engagement en tant qu’acte est une décision prise,
qui, à un moment donné, lie l’individu à lui-même,
à son propre projet et à son propre futur, bien plus
qu’à la situation externe. Une condensation s’opère
au moment de la décision et de l’acte, condensa-
tion du sujet d’une part, du présent et du passé de
la situation d’autre part, condensation qui engage
l’avenir, bien que celui-ci reste incertain, mais orienté
avec un nouveau sens. De manière en apparence
paradoxale, l’acte d’engagement n’engage que celui
qui le pose, mais il l’engage totalement par rapport
à lui-même et dans son futur, beaucoup plus qu’il
n’engage la situation externe et autrui.
Précisément, il y a différents types d’actes d’enga-
gement. Il est possible de s’engager dans une orga-
nisation, telle l’armée. Dans ce cas, l’engagement
reste circonscrit, instrumental, et de durée limitée
(on s’engage pour apprendre à être soldat, à obéir
aux ordres et à remplir sa mission de combattant
pendant un certain nombre de mois ou d’années,
mais on s’engage seulement à cela). On peut, à l’op-
posé, s’engager dans la défense d’une idéologie ou
d’une valeur (politique ou religieuse, par exemple).
Dans ce cas, l’engagement est beaucoup plus général
– les actes à accomplir ne sont pas définis au préa-
lable – et il impose beaucoup plus un style de vie
et un dévouement global sans de réelles limita-
tions. Enfin, un troisième type d’engagement en
tant qu’acte peut se développer en rapport avec une
personne. L’acte d’engagement prend alors la forme
d’une promesse ; d’une promesse faite à un instant

La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 2 - mars-avril 2010 | 49
Résumé
L’engagement thérapeutique dans les troubles schizophréniques implique deux dimensions : l’observance
(le comportement) et l’adhésion (ou la représentation psychique).
Pour les patients, l’observance est la prise des traitements et des soins. L’adhésion est l’acceptation globale
de ces soins.
Pour les psychiatres, l’adhésion correspond à la conviction de l’utilité des prescriptions et l’observance
correspond à la mise en œuvre effective des soins.
Cette approche devrait permettre une stratégie thérapeutique plus efficace, notamment durant la période
critique initiale des cinq premières années de la maladie, et favoriser un meilleur pronostic.
Mots-clés
Engagement
thérapeutique
Troubles
schizophréniques
Observance
Adhésion
Highlights
Therapeutic commitment in
schizophrenia involves two
dimensions: adherence (as a
behavior) and compliance (as
a psychic representation).
For patients, adherence is to
take antipsychotic medications
and to follow other therapeutic
interventions. Compliance is
the global acceptance of these
therapeutic interventions.
For psychiatrists, compli-
ance fits to conviction of the
usefulness of prescriptions
and adherence fits with real
efficacy of the prescriptions
(medications and therapeutic
interventions).
This approach could lead to
a better efficacy of the thera-
peutic strategies during the
first five years of schizophrenia
and could promote to a better
prognosis.
Keywords
Therapeutic commitment
Schizophrenia
Adherence
Compliance
donné de répondre de soi-même dans le futur. La
fidélité concerne l’engagement (et non l’autre en tant
que tel). La promesse est celle d’un don, d’être fidèle
et de se conformer à l’engagement pris au moment
de l’acte – qui peut d’ailleurs être un don mutuel
(finalement, chacun répond de soi par rapport à
lui-même en présence de l’autre).
L’exemple des professions médicales illustre les
différents aspects des actes d’engagement. L’as-
pect instrumental (de technicité) est retrouvé dans
l’impératif de faire ce qui est nécessaire pour acquérir
les compétences requises et dans la nécessité d’ac-
tualiser ces mêmes connaissances. L’aspect idéal
consiste à souscrire aux valeurs morales caractéris-
tiques de la profession. L’aspect relationnel suppose
que la pratique soit la plus efficace possible non
seulement sur le plan technique mais aussi sur
le plan intersubjectif (tout le temps), à l’égard
de chaque patient. En d’autres termes, ce qui est
attendu du médecin et du professionnel de santé,
qu’il accepte implicitement, c’est une forte mise en
jeu personnelle, un savoir-faire approprié, un souci
des malades et du dévouement à leur égard. Il s’agit
donc d’une relation instrumentale, mais aussi d’une
relation vraiment personnelle.
L’aspect concret de l’engagement se manifeste dans
la décision d’engagement. Cette décision a un sens,
car elle est réfléchie, systématiquement conduite,
elle vise à atteindre un objectif fixé et à introduire des
conditions nouvelles à dessein de modifier l’avenir.
Cependant, la décision d’engagement dans un
présent donné ne garantit pas d’atteindre l’objectif
fixé, car il y a des facteurs circonstanciels impossibles
à contrôler. Si l’exercice médical est une relation qui
nécessite un engagement, comme nous venons de le
voir, cet engagement a une réalité car il concerne non
seulement le cours du monde que le professionnel
de santé tente d’infléchir, mais surtout l’être qui
s’engage (en l’occurrence le médecin ou le soignant)
et son être à venir. Cette relation thérapeutique au
sein de laquelle le thérapeute s’engage relève de
l’alliance, qui facilite les moyens thérapeutiques,
mais aussi du contrat thérapeutique.
La conséquence de l’engagement est finalement le
contrat, or un contrat est une “promesse-devant-
être-tenue”. Mais, ordinairement, lorsque l’on signe
un contrat, on s’y soumet volontairement, on exerce
son libre-arbitre, son autonomie, sa liberté et sa
responsabilité. Si l’on considère la relation médecin-
patient, à plus forte raison en psychiatrie, force est
de constater que la relation est asymétrique et
que les deux contractants ne sont pas au même
niveau. Dans ces conditions, le patient ne peut pas
réellement exercer son libre-arbitre et sa respon-
sabilité pleine et entière : en fait, la responsabilité
contractante du médecin est entière alors que celle
du patient n’est que relative. Le médecin doit donc
être garant des conditions du contrat et de l’alliance
thérapeutique, bien que les variables qui condition-
nent cette dernière soient complexes et fassent appel
à des critères relationnels et psychiques propres au
patient ainsi qu’à des éléments environnementaux
provenant de l’entourage ou des média difficilement
contrôlables par le psychiatre.
De l’engagement dans les troubles
schizophréniques
L’étude observationnelle CATIE, portant sur la prise
en charge des troubles schizophréniques, montre
très clairement qu’il existe deux dimensions chez
les patients par rapport aux soins (1), sans que cela
soit propre aux troubles schizophréniques. L’examen
des taux d’attrition, c’est-à-dire des taux de patients
sortant de l’étude, rapporte que 23,7 % des patients
sortent de l’étude en raison du manque d’efficacité
du traitement, que 14,9 % en sortent pour effets
indésirables ou intolérance, et que 29,9 % sortent
par décision personnelle. Il est légitime de consi-
dérer que le manque d’efficacité et l’intolérance
conditionnent directement le comportement, alors
que l’attitude des 29,9 % de patients – presque un
tiers des patients – qui arrêtent par décision person-
nelle renvoie à leur adhésion au traitement et à leur
représentation mentale du trouble et des soins.
Nous pouvons donc définir ces deux dimensions : la
première, comportementale, concerne l’observance,
qui correspond au fait de prendre les traitements
prescrits et de se conformer à la prescription ; la
seconde relève de la représentation, de l’adhésion,
qui correspond à l’accord du patient sur les moyens
employés dans le cadre des soins, les buts du trai-
tement et le fait d’être malade (sans pour autant

50 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 2 - mars-avril 2010
L’engagement thérapeutique
dans les troubles schizophréniques
DOSSIER THÉMATIQUE
La schizophrénie :
penser le soin
être nécessairement d’accord sur la maladie). Bien
sûr, ces deux dimensions sont reliées entre elles et
se déploient sur un continuum d’intensité.
Si cela est vrai pour les patients, sans aucune spécifi-
cité psychiatrique puisqu’en médecine les taux sont
les mêmes, cela peut être vrai pour les soignants. La
proposition est donc la suivante : sur le plan pure-
ment pharmacologique, dans les troubles schizo-
phréniques, les soignants adhèrent-ils à la notion
d’utilité du traitement au long cours, et ont-ils un
comportement de contrôle des moyens mis en
œuvre pour une bonne observance ? Autrement
dit et plus généralement, sommes-nous convaincus
que fumer est mauvais pour la santé, continuons-
nous ou non de fumer et quels sont les moyens
comportementaux que nous mettons en œuvre
pour arrêter ?
L’adhésion des thérapeutes, c’est-à-dire l’enga-
gement en tant que conduite, dans le cadre des
troubles schizo phréniques, pose donc la question
de leur adhésion aux données de la science médi-
cale actualisée : données cliniques fondées sur les
descriptions, la psychopathologie et les expériences
professionnelles renouvelées, données neurobio-
logiques s’appuyant sur les avancées génétiques,
neuro-chimiques, et neuro-anatomiques fonction-
nelles, et données thérapeutiques concernant les
médicaments, l’observance, et les psychothérapies
ayant fait la preuve de leur efficacité. Plus préci-
sément, quelles sont nos convictions ? Existe-t-il
des troubles schizophréniques ? Ces troubles ont-ils
différentes phases évolutives (prodromique, critique
initiale et évoluée) ? Ont-ils des conséquences
socio-relationnelles ? Existe-t-il une efficacité
de certains médicaments, de certaines stratégies
psychothérapiques ? Y a-t-il une nécessité de
compensation sociale de ces troubles ? L’obser-
vance des thérapeutes, soit l’engagement en tant
qu’acte, impose de se questionner sur les moyens
mis en œuvre, sur les actes réellement effectués,
sur l’intentionnalité stratégique pragmatique et
sur la constance et la pérennité des soins contrôlés.
Prescrivons-nous des médicaments efficaces et nous
assurons-nous correctement de leur prise ? Prescri-
vons-nous suffisamment longtemps et de manière
contrôlée ? Proposons-nous des psychothérapies
efficaces – Sommes-nous formés à celles-ci ? – et
une psycho-éducation personnelle et familiale ?
Enfin, établissons-nous des compensations sociales
et financières ?
L’examen de l’évolution naturelle des troubles
schizophréniques, au vu de la littérature, montre
qu’il existe 3 grandes périodes de la pathologie :
une période prodromique, une période de début de
pathologie, d’environ 5 ans, qui est critique quant
aux interventions thérapeutiques, et, enfin, après
10 ans d’évolution, une période dite “évoluée”. Les
enjeux thérapeutiques sont bien évidemment diffé-
rents selon les périodes : en phase prodromique,
l’objectif est d’éviter la maladie, en période critique
initiale l’objectif est ambitieux et vise à guérir de
la maladie (quitte à ce que quelques petits signes
séquellaires demeurent), et, en période évoluée,
le but est de préserver les acquis et d’éviter une
évolution délétère vers la dégradation.
Si nous nous concentrons sur la période critique
initiale, avant 5 ans d’évolution des signes carac-
téristiques de la pathologie, nous devons convenir
des éléments suivants : il faut traiter le plus tôt
possible (l’intervention thérapeutique au début
d’une maladie est, classiquement, en médecine,
plus efficace qu’après une évolution du processus
morbide), car si la durée pendant laquelle la
psychose est non traitée (délai entre l’apparition
des signes psychotiques explicites et le premier
traitement efficace) est très délétère, la durée
pendant laquelle la maladie n’est pas traitée (qui
englobe aussi la période prodromique dont l’évo-
lution vers la psychose est univoque et qui corres-
pond au début réel de la pathologie, même si les
signes explicites permettant le diagnostic ne sont
pas encore présents) l’est plus encore et conditionne
le pronostic. Or les données couramment admises
dans la littérature internationale rapportent une
durée moyenne de psychose non traitée allant de
1 à 2 ans (sauf dans les programmes de recherche
de dépistage précoce) et une phase prodromique ou
prépsychotique d’au moins 1 an (2). Il faut traiter
de manière efficace suffisamment longtemps, et les
données les plus récentes montrent que 2 années
sont quasiment insuffisantes, puisque pratiquement
80 % des patients de l’étude de R. Emsley et al. (3)
rechutent à l’arrêt progressif du traitement instauré
2 années plus tôt. La durée de psychose non traitée
est classiquement définie comme celle s’écoulant
entre l’apparition des premiers symptômes et le
premier traitement efficace. Cependant, il faut
considérer que tout arrêt du traitement durant la
phase critique initiale, avant la réintroduction d’un
traitement correspond à une durée supplémentaire
de psychose non traitée et se cumule à la durée
initiale. Enfin, il faut admettre que la rémission est
possible tant sur le plan symptomatique que sur le
plan fonctionnel.
De cette adhésion doivent découler nos actes d’ob-
servance et notre comportement : prescription de

La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 2 - mars-avril 2010 | 51
DOSSIER THÉMATIQUE
médicaments efficaces, nécessité d’évaluer cette
efficacité (clinique, métrologique), facilitation
et contrôle de la prise (voie injectable d’action
prolongée, administration per os par un profes-
sionnel au domicile tous les jours, ce qui libère le
temps d’entretien psychiatrique de l’évaluation de
l’observance), et prescription supérieure à 2 ans en
informant très rapidement le patient de cette durée
nécessaire. Notre comportement de prescripteur
doit être complété par les interventions psychothé-
rapiques et sociales : information et éducation de
l’intéressé et de son entourage sur cette condition
médicale au long cours qui vise à l’abandon des
idées fausses, facilitation de leur adhésion et de leur
observance aux soins par le recours à des stratégies
motivationnelles d’observance médicamenteuse
telles que la méthode LEAP (Listen-Empathize-Agree-
Partner) de Xavier Amador (4) et à des programmes
psycho-éducatifs formalisés de groupe ; psychothé-
rapies validées et stratégies d’amélioration du fonc-
tionnement social et relationnel (entraînement aux
compétences sociales, à la gestion du stress, bilan
fonctionnel des compétences sociales et relation-
nelles) ; mise en place d’aides sociales au logement,
à l’insertion ou la réinsertion professionnelle ; et
enfin séquençage des diverses interventions.
Les enjeux sur le plan de l’engagement thérapeutique
dans la phase initiale peuvent être résumés ainsi : il
est nécessaire de définir sur le plan pratique qui, du
psychiatre, de l’infirmière de psychiatrie de secteur,
du médecin généraliste référent, de l’infirmière libé-
rale éventuelle, du psychologue, du pharmacien, de
l’entourage et enfin du travailleur social, fait quoi
durant cette période. Le psychiatre traitant, outre
son rôle propre, doit probablement coordonner tous
ces intervenants, répartir les tâches de chacun et
contrôler l’efficience de leurs interventions, bref
mettre en musique de manière harmonieuse les
partitions respectives des uns et des autres.
Sans doute faudrait-il mettre en place, après l’op-
timisation de la prise en charge durant la phase
initiale, la même démarche d’engagement dans
les deux autres phases cliniques des troubles
schizo phréniques, à savoir la phase prodromique
et la phase évoluée. Durant la phase prodromique,
le prérequis supposé emporter l’adhésion des
thérapeutes devrait être que les prodromes sont
univoques, évoluent fatalement vers la psychose,
qu’ils se distinguent ainsi des signes de vulnérabi-
lité au destin équivoque, et qu’il y a une nécessité
d’intervention thérapeutique. Les conséquences
interventionnelles et les actes d’engagement
thérapeutique se déclinent par la mise en place
de stratégies de dépistage et d’organisation d’accès
aux soins, et une information des intervenants,
de l’intéressé et de son entourage portant sur les
risques, les incertitudes, les facteurs précipitants et
les traitements éventuels (psychothérapies et médi-
caments adaptés à cette phase). Beaucoup plus
tardivement, durant la phase évoluée, après 10 ans
de maladie (cohorte particulièrement importante
dans nos secteurs de psychiatrie publique), l’adhé-
sion des thérapeutes devrait se cristalliser autour
de la nécessité de traiter à vie (fondée, toujours sur
l’idée que la période passée avec des symptômes
est délétère comme le montre la durée initiale
de psychose non traitée), autour d’une possible
rémission dans certains cas mais, à défaut, dans
l’immense majorité des cas, d’une stabilisation et
autour de la nécessaire compensation, sur le plan
fonctionnel, du handicap généré par la chronicité
des signes. Bien sûr, le comportement des théra-
peutes, soit l’engagement comme actes, impose
d’obtenir l’observance médicamenteuse à l’aide
des stratégies habituelles – celles-ci sont utilisées
de manière beaucoup plus centrée sur les équipes
de soins, qui deviennent souvent l’entourage réel
du patient –, d’évaluer les symptômes et le fonc-
tionnement et de compenser les handicaps par la
remédiation cognitive des compétences sociales,
les entraînements cognitifs et les activités occu-
pationnelles au sens large.
Conclusion
L’adhésion des thérapeutes aux données actuali-
sées de la science et de la médecine est nécessaire.
Les actes d’engagement qui doivent en découler
incluent la nécessité de l’engagement des patients
et de leur entourage, sous la responsabilité des
soignants. Cette nécessité pourrait prendre la forme
d’un contrat entre thérapeute et patient, définis-
sant les droits et devoirs respectifs de chacun. C’est
seulement à ce prix que nous pourrons éviter des
compromis qui s’apparentent à des compromissions
et qui se font au détriment des patients car “seuls
nos actes nous engagent”. ■
Références
bibliographiques
1.
Lieberman JA, Stroup TS,
McEvoy JP et al. Clinical Anti-
psychotic Trials of Intervention
Effectiveness (CATIE) Investi-
gators. Effectiveness of anti-
psychotic drugs in patients with
chronic schizophrenia. N Engl J
Med 2005;353(12):1209-23.
2.
Crumlish N, Whitty P,
Clarke M et al. Beyond the critical
period: longitudinal study of
8-year outcome in first-episode
non-affective psychosis. Br J
Psychiatry 2009;194(1):18-24.
3.
Emsley R, Oosthuizen P,
Koen L, Niehaus D, Martinez L.
A study of the clinical outcome
following treatment disconti-
nuation after rémission in the
first-episode schizophrenia. Eur
Neuropsychopharmacol 2009;
19(Suppl. 3):S486.
4.
Amador X. Comment faire
accepter son traitement au
malade : schizophrénie et
troubles bipolaires. Paris: Retz,
2007.
1
/
4
100%