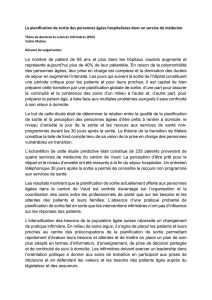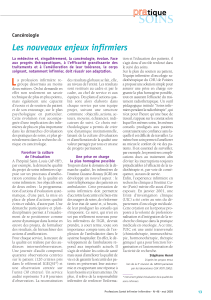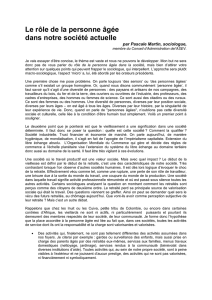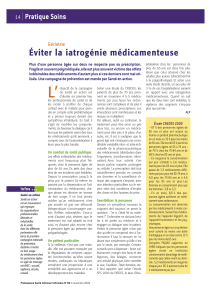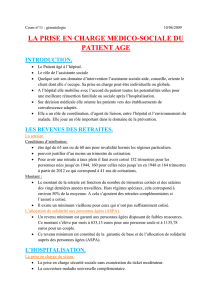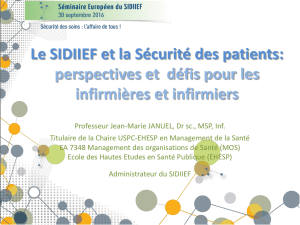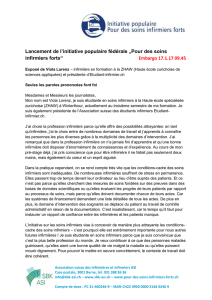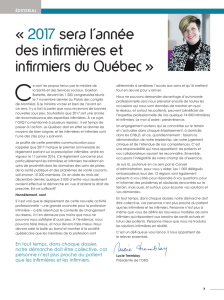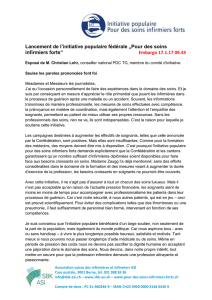La personne âgée

L’hospitalisation, un risque en soi pour la personne âgée
La personne âgée est plus vulnérable aux complications iatrogéniques1d’une hospitalisation
menant très souvent au déclin fonctionnel. Près du tiers des personnes âgées hospitalisées
en soins aigus subissent un déclin fonctionnel dont près de 40 % présente une perte d’auto-
nomie significative qui deviendra souvent irréversible (Sager, 1998). Cela affecte tant la
qualité de vie à long terme du patient âgé et celle de ses proches aidants, que le coût des soins
de santé (polypharmacie, augmentation de la durée de séjour et du taux d’hébergement...).
Paradoxalement, le déclin fonctionnel de l’aîné survient souvent en même temps que
l’amélioration de la condition ayant précipité son hospitalisation, ce que Palmer, Counsell
et Landefeld (2003) nomment un syndrome dysfonctionnel (voir la figure en page 3).
Bien que nous soignions avec la plus récente technologie, certaines
pratiques de soins ont été peu remises en question et nuisent à
la personne âgée (ex. : le repos au lit par défaut, la tolérance de
la malnutrition, etc.). Ces pratiques relèvent de certains mythes
reliés à la méconnaissance du vieillissement normal et des
besoins essentiels de la personne âgée malade. Cette ignorance
entraîne trop souvent des attitudes d’abandon ou de surprotection
de la part du personnel soignant et des proches.
Par ailleurs, les lieux physiques de l’hôpital ont été conçus en
fonction d’une population plus jeune et plus rapidement autonome
après un épisode de maladie aiguë et sont mal adaptés (chambres
exigües, salles de bain difficiles d’accès et d’utilisation, lits trop
hauts, etc.) à une clientèle âgée qui nécessite souvent une aide
technique (canne, cadre de marche).
l’Avant-Garde
Le journal des soins infirmiers du CHUM
Vol. 8 No3 Automne 2008
l’Avant-Garde
Au CHUM, la clientèle des personnes âgées
de plus de 65 ans hospitalisée en courte
durée est de 36 %. Cette proportion atteint
de 45 à 67 % dans certains services autres
que la gériatrie (cardiologie, médecine in-
terne, orthopédie, urologie). Comment le
CHUM envisage-t-il d’adapter et d’améliorer
les soins à cette clientèle? Notamment en
créant un projet d’OPTIMisation des soins
aux personnes Âgées à l’Hôpital, que l’on a
appelé OPTIMAH.
Sommaire
•OPTIMAH : ou comment mieux soigner les ainés 1
à l’urgence et dans les unités de soins aigus
•La planification du congé hospitalier 5
des personnes âgées... une affaire de famille !
•La personne âgée et le syndrome d’immobilisation :
un enjeu infirmier 9
•Perdre son permis de conduire :
une étape difficile pour la personne âgée 13
•Mot de la présidente du CII 15
•Ressources 16
•Adresses santé 16
Thème de ce numéro :
La personne âgée
OPTIMAH : ou comment mieux
soigner les ainés à l’urgence et
dans les unités de soins aigus
Par Sylvie Lafrenière, inf., M. Sc., et Dre Annik Dupras
Sylvie Lafrenière est conseillère en soins spécialisés, regroupement
de médecine contemporaine et soins prolongés. DreAnnik Dupras
est médecin interniste-gériatre. Toutes deux sont responsables
du projet OPTIMAH du CHUM.
1Iatrogénique : conséquences indésirables des soins et traitements médicaux.

2l’Avant-Garde Vol. 8 No3 Automne 2008
Des hôpitaux plus accueillants
pour les aînés
Depuis une dizaine d’années, aux États-Unis
et au Canada, des projets d’envergure visant
spécifiquement le soin des aînés en centre
hospitalier de courte durée ont été dévelop-
pés tant pour l’urgence que pour les unités
d’hospitalisation (Acute Care Geriatric Nurse
Network, 2007; Grenier, L’Heureux et Côté,
2007; Palmisano-Mills, 2007; Parke et Brand,
2004; Regional Geriatric Program of Ontario,
2006).
En mai 2008 à Montréal, le colloque Un hôpi-
tal accueillant pour les aînés a mis en com-
mun les initiatives et les projets québécois et
canadiens visant à mieux adapter l’hôpital
d’aujourd’hui aux besoins des personnes
âgées, en tenant compte des nombreux
besoins déjà clairement exprimés.
Ces projets sont basés sur des résultats
d’études confirmant que des changements
peu coûteux peuvent être apportés à l’ap-
proche aux aînés dans un cadre de soins
aigus, avec des bénéfices tant pour le patient
que pour l’établissement (Inouye, Baker,
Fugal et Bradley, 2006; Palmer et al., 2003).
Formation et prévention
Au CHUM, plusieurs activités de formation
ont été dispensées sur la prévention et la
gestion du délirium, le syndrome d’immobili-
sation, la prévention des chutes et les solutions
de rechange à la contention physique. Nous
offrons aussi toute une gamme de services interdisciplinaires spécialisés en gériatrie et, depuis plus de huit
ans, le CHUM compte six infirmières de suivi systématique de clientèle âgée dont une est présente à l’urgence
de l’Hôpital Notre-Dame 5 jours/semaine. Malgré tout, nous constatons toujours un manque de connaissances
en matière de soins aigus adaptés aux besoins des aînés ainsi qu’une trop faible intégration des enseignements
à la pratique.
À l’automne 2007, la direction du CHUM a désigné deux chargées de projet dont le mandat, en partenariat avec
les directions concernées, est de définir et d’implanter des interventions pour améliorer la prise en charge de
la clientèle âgée fragile, à l’urgence et dans les unités de soins. Ces interventions visent la prévention du déclin
fonctionnel relié aux syndromes gériatriques et aux complications iatrogéniques.
Dans le cadre de ce projet, chaque regroupement clientèle, service, unité et équipe professionnelle est appelé
à examiner ses pratiques en matière de soins à sa clientèle plus âgée, à identifier celles à maintenir et à
améliorer, ainsi que les obstacles pour y arriver. De plus, les gestionnaires seront sensibilisés à l’acquisition de
matériel adapté et à la mise en place d’améliorations aux environnements physiques favorisant le maintien de
l’autonomie fonctionnelle.

l’Avant-Garde Vol. 8 No3 Automne 2008 3
OPTIMAH : l’affaire de tous mais plus particulièrement des soins infirmiers
Bien qu’OPTIMAH nécessite la participation de toutes les disciplines, les infirmières sont
particulièrement visées vu la place prépondérante qu’elles occupent durant l’hospitalisa-
tion, notamment en matière d’évaluation et d’intervention précoce, ainsi que pour leurs
compétences à mobiliser l’équipe de soins infirmiers et à établir un partenariat avec le
patient et ses proches.
De « Clinical intervention trials.
The ACE unit » de R. M. Palmer, S.
R. Counsell et S. C. Landefeld, 1998,
Clinics in Getriatric Medecine, 14(4),
p. 832. Traduit et reproduit avec la
permission de Elsevier Limited.
Parce que le projet repose en grande partie sur des activités préventives, il est
nécessaire de valoriser certains soins infirmiers dits de base qui sont des
interventions de prévention essentielles pour contrer les risques associés à la
maladie aiguë et à l’hospitalisation et ainsi assurer une récupération fonctionnelle
maximale. Ces soins de base sont les suivants :
Favoriser
•l’orientation et la communication (compenser
les problèmes de vision et d’audition);
•une mobilisation précoce;
•l’arrêt des soins et des traitements qui ont un impact
sur la mobilité le plus rapidement possible (sonde
urinaire, intraveinothérapie en continu, etc.);
•l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne
(ne pas faire pour le patient ce qu’il est en mesure
de faire lui-même);
•l’élimination et la continence urinaire;
•le sommeil par des moyens non pharmacologiques.
Les infirmières doivent avoir ces soins en tête lors de la rédaction du plan
thérapeutique infirmier, assumer un leadership mobilisateur auprès de leur
équipe et des proches aidants et reconnaître les efforts de chacun.
Modèle conceptuel du syndrome dysfonctionnel
Personne âgée fonctionnelle
Personne âgée avec atteintes fonctionnelles
Maladie aiguë
Atteinte fonctionnelle possible
Hospitalisation
Environnement hostile
Dépersonnalisation
Alitement
Malnutrition
Médicaments
Procédures
Humeur dépressive
Attentes négatives Atteinte physique
Assurer
•un apport hydrique et
nutritionnel adéquat;
•le soulagement optimal de la
douleur tout en appliquant des
mesures de pharmacovigilance;
•un environnement physique
sécuritaire et adapté aux
besoins d’aide.

4l’Avant-Garde Vol. 8 No3 Automne 2008
Références
Acute Care
Geriatric Nurse
Network. (2007).
Geriatric emer-
gency nursing ini-
tiative. Consulté le
17-07-2007 à
www.acgnn.ca/
geriatric_
emergency_nurse
_initiative.html
Fulmer, T. (2007).
How to try this :
Fulmer SPICES.
American Journal
of Nursing,
107(10), 40-48.
Grenier, L.,
L’Heureux, M. et
Côté, E. (2007).
Développement
des pratiques
professionnelles
en matière de
dépistage, d’éva-
luation et d’inter-
vention auprès
des personnes
âgées à risque de
perte d’autonomie
nécessitant des
soins aigus.
Rapport
Forces/Extra.
Inouye, S. K.,
Acampora, D.,
Miller, R., Fulmer,
T. Hurst, L. D. et
Cooney, L. M. Jr.
(1993). The Yale
geriatric care
program. A model
of care to prevent
functional decline
in hospitalized
elderly patients.
Journal of the
American Geria-
trics Society,
41(12), 1345-1352.
Inouye, S. K,
Baker, D. I., Fugal,
P. et Bradley, E. H.
(2006). Dissemina-
tion of the hospital
elder life program.
Implementation,
adaptation and
sucesses. Journal
of the American
Geriatrics Society,
54(10), 1492-1499.
Palmer, R. M.,
Counsell, S. R. et
Landefeld, S. C.
(1998). Clinical
intervention trials.
The ACE unit.
Clinics in Getria-
tric Medecine,
14(4), 831-849.
Palmer, R. M.,
Counsell, S. R. et
Landefeld, S. C.
(2003). Acute care
for elders units.
Practical conside-
rations for opti-
mizing health out-
comes. Disease
Management
Health Outcomes,
11(8), 507-517.
Palmisano-Mills.
C. (2007). Common
problems in hos-
pitalized older
adults. Four pro-
grams to improve
care. Journal of
Gerontological
Nursing, 33(1),
48-54.
Déceler, traiter, assurer le suivi
Dès l’admission, à l’aide de l’outil d’évaluation initiale, les infirmières
peuvent déceler la présence d’une atteinte fonctionnelle et de facteurs
de risque de complications tels le délirium et les chutes. Ce repérage
devrait déclencher une série d’actions préventives et thérapeutiques,
telles que déterminées au plan thérapeutique infirmier (PTI) et être
transmis à tous les membres de l’équipe de soins infirmiers. Par la suite,
les infirmières, en collaboration avec les préposés et infirmières auxiliaires,
évaluent tout au long du séjour les signes de conditions de santé à
risque d’affecter le statut fonctionnel soit : les changements cognitifs
(délirium), la perte de mobilité ou l’incapacité aux
AVQ, la déshydratation, la malnutrition, l’insomnie,
l’incontinence de novo, les plaies de pression. L’ins-
tallation d’une de ces conditions, si elle n’est pas
traitée précocement, peut déclencher une cascade
d’événements défavorables.
Ces « signes vitaux gériatriques », tels que désignés
par Inouye et al. (1993), n’ont rien de nouveau et
font déjà l’objet de surveillance clinique, mais leur
présence ne déclenche pas assez souvent l’état
d’alerte conduisant à une modification du plan d’in-
tervention. C’est pourquoi Fulmer (2007) a élaboré un
outil pour l’évaluation infirmière des personnes âgées
prenant la forme de l’acronyme SPICES. L’équipe
OPTIMAH du CHUM a développé une adaptation
française de cet outil ainsi qu’un guide d’utilisation.
L’acronyme utilisé est AINÉES : Autonomie (mobilité
et hygiène) et chutes, Intégrité de la peau, Nutrition,
Élimination, État cognitif et comportement, Sommeil.
Faire équipe avec le patient âgé et ses proches
L’équipe de soins infirmiers favorise le partenariat avec les patients âgés
et leurs proches en les informant des moyens pour prévenir le déclin
fonctionnel lors du traitement d’une maladie aiguë ou d’un séjour hospi-
talier. Entre autres, les proches peuvent contribuer à la compréhension et
à la motivation du patient en plus de participer à certaines interventions
(hydratation, alimentation, mobilisation, orientation).
Des soins « high tech » et « high care »!
L’adaptation des soins hospitaliers aux besoins des personnes âgées vulné-
rables exige plus que de la formation et la bonne volonté des individus.
Seule une approche concertée et systémique peut mener à une réelle
transformation des pratiques institutionnelles. L’amélioration des soins
aux aînés passe d’abord par la valorisation des actions quotidiennes
des infirmières, des préposés aux bénéficiaires et des infirmières
auxiliaires, visant à prévenir le déclin fonctionnel. Les médecins et
les autres professionnels doivent appuyer et valoriser ces interventions.
Les gestionnaires, quant à eux, sont appelés à examiner les moyens pour
soutenir les bonnes pratiques cliniques en lien avec les soins aigus des
aînés.
Dans un environnement où les prouesses technologiques et médicales
sont à l’avant-scène et desservent bien la clientèle âgée, la vulnérabilité
des aînés nous rappelle toute la valeur des soins quotidiens axés sur la
récupération de l’autonomie et le maintien de la qualité de vie.
Parke, B. et
Brand, P. (2004).
An elder-friendly
hospital. Transla-
ting a dream into
reality. Nursing
Leadership,
17(1):62-77.
Regional Geriatric
Programs of
Ontario. (2006).
Geriatric Emer-
gency Manage-
ment. Provincial
Interim Report
2005-2006.
Abridged version.
Consulté le 5-11-
2007 à http://rgp.
toronto.on.ca/PDF
files/gem2005-06
yearendreporta
bridged.pdf
Sager, M. A. et
Rudberg, M. S.
(1998). Functional
decline associated
with hospitaliza-
tion for acute ill-
ness. Clinics in
Getriatric Mede-
cine, 14(4), 669-
679.
Pourquoi des signes vitaux
gériatriques (AINEES) ?
•Structurer l’évaluation en fonction de six aspects
de la santé où une détérioration est considérée
prédictive de complications et de déclin fonctionnel
•Mettre davantage l’emphase sur l’état de santé
global du patient âgé plutôt que de cibler uniquement
la maladie l’ayant conduit à l’hôpital
•Identifier de façon précoce les signes d’installation
ou de présence de conditions à risque
•Fournir une vue d’ensemble de la réponse du
patient âgé aux soins et traitements dispensés

l’Avant-Garde Vol. 8 No3 Automne 2008 5
Recherche Par Francine Ducharme, inf., Ph. D.
Dre Francine Ducharme est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l’Université
de Montréal et titulaire de la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille.
La planification du congé
hospitalier des personnes âgées...
une affaire de famille !
Planification du congé hospitalier
Depuis près d’une quinzaine d’années, plusieurs études
ont été réalisées sur l’hospitalisation des personnes
âgées, entre autres, sur les effets des différentes
modalités de planification du congé hospitalier et de
suivi systématique lors du retour à domicile (Burns,
Lamb et Wholey, 1996; Congdon, 1994; Jackson,
1994a). Plusieurs appellations sont utilisées pour
qualifier ces modalités de prestation des soins. On parle
parfois de gestion de cas (case management), de soins
intégrés (managed care), de gestion du processus de
soins ou de cheminement clinique (care map).
Ces différentes façons de faire ont été développées
afin de favoriser une transition harmonieuse lors du
passage de l’hôpital au domicile. Cette transition cons-
titue une période de changement dans les habitudes
de vie des personnes âgées, de même qu’une période
de grands déséquilibres et de vulnérabilité. Elle se
caractérise bien souvent par la nécessité d’apprendre
de nouvelles habiletés, de modifier l’environnement
familier (le domicile) et de changer les rôles et fonc-
tions au sein de la famille (Schumacher, Jones et
Meleis, 1999).
Malgré le fait que différents programmes de planifi-
cation du congé hospitalier aient été développés
dans plusieurs milieux de pratique, il semble que de
20 à 40 % de ces programmes ne répondent pas aux
besoins des personnes âgées (Leclerc, Wells, Craig et
Wilson., 2002). Une des raisons invoquées pour expli-
quer cet insuccès serait que les professionnels n’im-
pliquent pas suffisamment les familles dans le
processus de planification du congé. Cette situation
concerne bien évidemment les infirmières qui ont un
rôle prépondérant à jouer au cours de ce processus.
Avec le vieillissement de la population et les grands changements
dans la structure des familles et des systèmes de santé, de nouvelles
problématiques et de nouveaux besoins ont émergé au cours des
dernières décennies dans la plupart des pays industrialisés. Parmi
ceux-ci, on ne peut passer sous silence le phénomène du soin dans
la famille. Notamment, le fameux virage que l’on dit « ambulatoire »
met grandement à profit l’engagement des membres des familles
dans les soins offerts à leurs parents vieillissants. L’objectif de ce
virage est de permettre une réintégration rapide des personnes âgées
au sein de leur domicile, tout en réduisant les journées d’hospi-
talisation et les coûts. Dans cette perspective, il va de soi que la
planification du congé hospitalier prend une importance capitale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%