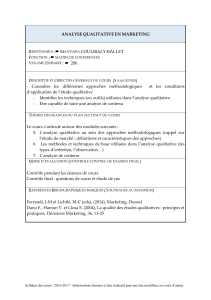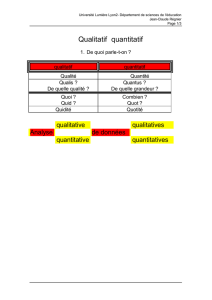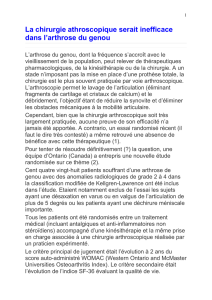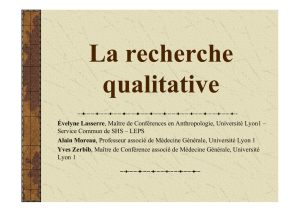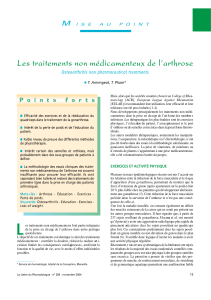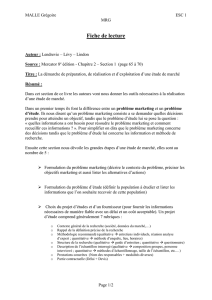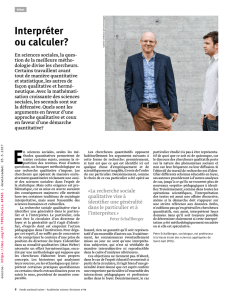Recherche qualitative et arthrose Qualitative research for osteoarthritis

26
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 01 - Octobre - novembre - décembre 2013
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
MISE AU POINT
Recherche qualitative et arthrose
Qualitative research for osteoarthritis
Sophie Alami*, Serge Poiraudeau**
* Département de
sociologie Interlis ;
InsermUMR1153,
Paris.
** Service de
médecine physique
etderéadaptation,
pôle ostéoarticulaire,
hôpital Cochin ;
Université
Paris-Descartes ;
Inserm UMR1153 ;
Institut fédératif
derecherche
surlehandicap,
CNRS, Inserm, Paris.
L’intérêt porté à la recherche qualitative socio-
anthropo logique dans les domaines de la santé se
développe peu à peu, notamment pour les pathologies
chroniques comme l’arthrose. Alors que les approches
quantitatives (épidémiologie clinique, biostatistiques)
analysent des cohortes, des enquêtes en population,
le résultat d’essais cliniques et testent la métro-
logie des instruments de mesure, ce qui nécessite en
général des échantillons de grande taille, représen-
tatifs de la population, les approches qualitatives font
principalement appel à l’analyse d’entretiens semi-
structurés, individuels ou de groupe, et à l’obser-
vation directe, et portent sur des échantillons plus
restreints.
Actuellement, le recours aux recherches qualita-
tives répond essentiellement à une volonté de com-
préhension plus fine du vécu, des représentations
et des besoins des patients ou des professionnels
de santé dans un objectif d’amélioration de l’adhé-
rence aux traitements, de développement de pro-
grammes d’éducation thérapeutique, d’amélioration
de la validité du contenu des instruments de mesure
rapportés par le patient et de développement des
stratégies de recherche en fonction des priorités
des patients.
Dans un éditorial publié il y a plus de 5ans, les
éditeurs de la revue
PLoS Medicine
insistaient sur
l’importance de développer la recherche qualita-
tive en médecine afin de mieux comprendre pour-
quoi près de la moitié des patients tuberculeux ne
prenaient pas ou pas correctement un traitement
pouvant leur sauver la vie
(1)
. Plus récemment, la
nécessité d’adopter des approches qualitatives pour
développer des instruments de mesure rapportés
par le patient a été rappelée par la Food and Drug
Administration (FDA). En effet, lorsqu’un instrument
de mesure rapporté par le patient est utilisé comme
critère principal d’efficacité dans un essai clinique,
la FDA exige, pour enregistrer cet essai, que l’ins-
trument de mesure ait fait la preuve de sa validité
de contenu dans des études qualitatives
(2,3)
. Ainsi,
l’émergence de nouvelles exigences réglementaires,
couplée à l’accent mis sur la prévention, la détec-
tion précoce, l’éducation thérapeutique, la qualité
de vie et la participation des patients, conduisent à
développer des stratégies de recherche qui n’inter-
rogent plus seulement les dimensions biologiques,
thérapeutiques ou technologiques des maladies
chroniques, mais également les pratiques de prise
en charge et les comportements des patients dans
leur environnement social quotidien. Dans ce
contexte, l’amélioration de la prise en charge des
patients nécessite de mobiliser des approches de
recherche complémentaires aux approches quanti-
tatives, qui permettent d’intégrer la perspective du
patient, tout au long de son parcours thérapeutique
et dans l’ensemble du processus de décision médi-
cale, au-delà de la seule détection des symptômes
ou des effets indésirables.
Recherche qualitative et arthrose
Des études assez nombreuses ont été publiées, portant
principalement sur 4 domaines :
•
mieux comprendre ce qui est important pour les
patients et les thérapeutes (opinion, besoins, symp-
tômes) ;
•
mettre en évidence des facilitateurs et des barrières
à l’adhérence au traitement ;
•
analyser le processus de décision de chirurgie,
notamment pour les remplacements prothétiques ;
•
évaluer la validité de contenu d’instruments de
mesure rapportés par le patient.
Opinions des patients
et des professionnels desanté
Concernant les opinions des patients et des acteurs de
santé, les études mettent en évidence la nécessité de
mieux formaliser les informations et les conseils aux
patients, le plus tôt possible au cours de la maladie,
d’adopter des évaluations et des approches théra-
peutiques globales (le patient atteint de gonarth-
rose ayant parfois l’impres sion d’être “uniquement”
un genou). Ces études soulignent également que les
patients ont des représentations paradoxales concer-
nant les thérapeutiques pharmacologiques, notam-
ment les anti-infl ammatoires non stéroïdiens (AINS),
considérés comme potentiellement effi caces mais
dangereux. Les patients ont également un sentiment
d’incertitude médicale à propos de l’arthrose, ce qui
diminue probablement l’adhérence aux traitements.
Pour ce qui concerne les thérapeutes de soins pri-
maires, la demande principale concerne l’élaboration
d’une aide (boîte à outils) pour le diagnostic et les choix
de traitement. Il apparaît clairement dans ces études
que les vues des patients et des acteurs de santé dif-
fèrent largement
(4,5)
.
Mots-clés : Arthrose - Recherche
qualitative - Éducation -
Instruments d’évaluation
Keywords: Osteoarthritis -
Qualitative research - Education

27
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 01 - Octobre - novembre - décembre 2013
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
Une ré-analyse des symptômes
Un des avantages signifi catifs des approches qua-
litatives concerne les symptômes jugés importants
pour les patients. À ce titre, 2exemples, concernant la
fatigue et la douleur, sont assez démonstratifs. Pour la
douleur, qui n’est généralement pas un symptôme clas-
sique évalué dans l’arthrose, une étude anglaise met en
évidence que les patients qui en souffrent rapportent
des niveaux de fatigue importants, qu’ils attribuent à
la fois à la douleur et au traitement de la douleur. La
fatigue est décrite comme ayant un impact sur la fonc-
tion et la participation. Les patients rapportent qu’ils
ne discutent généralement de ce symptôme avec per-
sonne, sauf avec leur conjoint
(6)
. Cette étude suggère
donc que, comme dans les rhumatismes infl amma-
toires, la fatigue est un symptôme à prendre en compte
dans l’arthrose.
Concernant les douleurs, une étude menée conjoin-
tement par l’OARSI
(OsteoArthritis Research Society
International)
et l’OMERACT
(Outcome Measures in
Rheumatology)
suggère que les patients distinguent
2types de douleur, la douleur dite “habituelle”, chro-
nique, constante au cours du temps, celle habituelle-
ment mesurée par les échelles de douleur utilisées
en pratique courante et en recherche clinique, et un
deuxième type de douleur, intermittente, très intense,
imprédictible, émotionnellement contraignante, qui
constitue pour les patients la principale raison d’éviter
des activités sociales ou de loisir
(7)
. Il se pourrait donc
que la douleur la plus incapacitante et la plus impor-
tante pour les patients ne soit pas celle qui soit évaluée
en pratique quotidienne ou dans les essais cliniques.
L’adhérence aux traitements
Une autre question, très largement étudiée dans les
études qualitatives dans l’arthrose, concerne l’ad-
hérence aux traitements pharmacologiques ou non
pharmacologiques.
•Traitements pharmacologiques
Les études soulignent que les patients sont réticents
à prendre des antalgiques ou qu’ils les prennent à des
doses inférieures ou à une fréquence inférieure à celle
prescrite et qu’ils justifi ent cette attitude en minimisant
leur douleur ou en déclarant qu’ils ont une tolérance
importante à la douleur
(8)
.
Une étude qualitative réalisée chez des patients âgés
souffrant d’arthrose montre qu’ils ne connaissent pas
toujours les risques de la prise d’AINS par voie orale ou
qu’ils sont incapables de reconnaître ces effets indé-
sirables. De plus, les patients se désengagent active-
ment d’une information sur les risques spécifi ques
des AINS, de 3manières :
•
“mon médecin généraliste ne me prescrirait pas
quelque chose de dangereux” ;
•
“tous les traitements ont des effets secondaires,
ilsuffi t de diminuer les doses” ;
•
“j’ai déjà pris des AINS sans problème, je dois être
immunisé contre les effets secondaires”
(9)
.
Ces résultats soulignent l’importance de renforcer
l’éducation thérapeutique dans ces domaines.
•Traitements non pharmacologiques
L’adhérence aux programmes d’exercices théra-
peutiques a également fait l’objet de plusieurs travaux
de recherche. Les exercices sont en effet un des traite-
ments recommandés dans l’arthrose, notamment des
membres inférieurs. Les programmes supervisés ont
une effi cacité largement démontrée, mais l’adhérence
aux programmes d’exercices à la maison demeure non
satisfaisante. Plusieurs études se sont attachées à
essayer de comprendre les raisons de cette adhérence
imparfaite. Il apparaît qu’elle dépend de la perception
qu’a le patient de ses symptômes, de l’effi cacité des
exercices, de ses capacités à les inclure dans sa vie
de tous les jours et du support et des encouragements
des kinésithérapeutes
(10)
.
Une autre étude propose 4typologies de patients face
à l’exercice
(11)
:
•
les patients habitués de longue date à une activité
physique régulière et chez qui des programmes ambi-
tieux intensifs peuvent être proposés ;
•
les patients sédentaires de longue date pour qui
des programmes d’activité physique beaucoup plus
simples devraient être proposés ;
•
les patients ayant fait de l’exercice mais ayant aban-
donné, se rapprochant des patients sédentaires de
longue date et chez qui l’intensité des programmes
devrait être adaptée à leurs objectifs ;
•
les patients récemment convertis à l’exercice, pour
qui des programmes d’intensité progressivement crois-
sante pourraient être testés.
Processus de décision conduisant
àlaproposition d’un remplacement prothétique
Les études analysant des processus de décision concer-
nant la chirurgie prothétique sont nombreuses. Une des
questions abordées est celle de la réticence de certains
patients, considérés par les chirurgiens comme des
indications idéales à se faire opérer. Dans ce cadre,
3éléments sont mis en avant pour expliquer cette
situation
(12,13)
:
•
l’arthrose est vue par les patients non comme une
maladie, mais comme un vieillissement normal ;
•
certains patients considèrent qu’il faut avoir plus
de douleurs et d’incapacité fonctionnelle qu’ils n’ont
actuellement pour être opérés ;
•
d’autres considèrent qu’ils n’ont pas besoin de pro-
thèse tant que leur médecin habituel ne leur en a pas
proposée.
Parmi les éléments infl uençant les patients dans leur
décision de se faire opérer, les principaux détermi-
nants semblent être les expériences personnelles du
patient, les peurs, les attentes et la confi ance dans son
médecin et son chirurgien. Toutes les études soulignent
le fait que cette décision devrait être mieux partagée
entre les médecins ou chirurgiens et les patients
(14)
.
Concernant cette décision partagée entre le patient et

28
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 01 - Octobre - novembre - décembre 2013
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
MISE AU POINT
Références bibliographiques
1.
PLoS Medicine Editors. Qualitative research: understanding patients’ needs and experiences. PLoS Med 2007;4(8):e258.
2.
U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration. Patient-reported outcome Measures: Use in medical product
development to support labeling claims. Clinical/Medical 2009;74(35):65132-133.
3.
U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration. Guidance for industry: patient reported outcome measures: use
in medical product development to support labeling claims: draft guidance. Health Qual Life Outcomes 2006;4:79.
4.
Mann C, Gooberman-Hill R. Health care provision for osteoarthritis: concordance between what patients would like and what health professionals
think they should have. Arthritis Care Res (Hoboken) 2011;63(7):963-72.
5.
Alami S, Boutron I, Desjeux D et al. Patients’ and practitioners’ views of knee osteoarthritis and its management: a qualitative interview study.
PLoS One 2011;6(5):e19634.
6.
Power JD, Badley EM, French MR, Wall AJ, Hawker GA. Fatigue in osteoarthritis: a qualitative study. BMC Musculoskelet Disord 2008;9:63.
7.
Hawker GA, Stewart L, French MR et al. Understanding the pain experience in hip and knee osteoarthritis: an OARSI/OMERACT initiative.
Osteoarthritis Cartilage 2008;16(4):415-22.
8.
Sale JE, Gignac M, Hawker G. How “bad” does the pain have to be? A qualitative study examining adherence to pain medication in older adults
with osteoarthritis. Arthritis Rheum 2006;55(2):272-8.
son chirurgien, une étude est particulièrement éclai-
rante : elle montre que les chirurgiens prennent la
décision d’intervenir sur des facteurs qu’ils n’expri-
ment pas devant le patient
(15)
. Il s’agit bien sûr d’un
frein majeur à une décision partagée concernant la
chirurgie.
Une autre étude qualitative analysant les raisons d’une
consultation en orthopédie pour la mise en place d’une
prothèse propose une catégorisation des patients en
2groupes : le groupe consultant car les symptômes
ne sont plus supportables et le groupe consultant de
façon préventive, avant que les choses aillent plus mal.
La perception des patients sur leur besoin d’une pro-
thèse n’est pas forcément partagée par le chirurgien.
En cas de désaccord, il semble que l’anxiété du patient
augmente, ainsi qu’une incertitude quant à la chirurgie
et un sentiment de dépossession de la décision par le
clinicien
(16)
.
Comme pour les études quantitatives, les études qua-
litatives peuvent faire l’objet de métaanalyses. C’est
le cas pour les études s’intéressant au remplacement
prothétique. Une métaanalyse publiée en2007 mettait
en évidence que les principaux concepts conduisant
à la décision étaient les expériences de la douleur, la
comparaison avec les autres, les attentes concernant
leur condition et leur traitement, les stratégies d’adap-
tation ainsi que le contexte et le support social
(17)
.
Les instruments de mesure rapportés
parlespatients
Concernant la validité de contenu des instruments
de mesure rapportés par les patients, aucun d’entre
eux n’a fait l’objet d’une analyse qualitative pour la
sélection des items dans le cadre de l’arthrose. Les
questionnaires fréquemment utilisés pour évaluer le
retentissement de l’arthrose ou l’effet des traitements
doivent donc probablement être revus et faire l’objet
de ces analyses qualitatives. Nous avons récemment
utilisé les résultats d’une étude qualitative dans la
gonarthrose pour élaborer et valider un questionnaire
évaluant les attentes des patients à propos de leur
prise en charge et leurs peurs et croyances dans la
gonarthrose
(18,19)
.
Conclusion : la recherche qualitative
est-elle utile pour la pratique
clinique ou la recherche
danslecadre de l’arthrose ?
La recherche qualitative permet et permettra proba-
blement une approche plus centrée sur le patient, sa
prise en charge et son évaluation. Cependant, force
est de constater que malgré une amélioration de la
compréhension des vues et des besoins des patients et
des professionnels de santé, il n’existe pas de preuves
de l’effi cacité de la recherche qualitative sur la qualité
de la relation entre le patient et son thérapeute ou
d’une augmentation de l’adhérence au traitement chez
les patients. Une des raisons en est probablement
qu’aucun programme d’éducation n’a été élaboré
jusqu’alors à partir de l’analyse de données qualita-
tives. Pour ce qui concerne les instruments de mesure
rapportés par les patients, les analyses qualitatives
permettent de s’assurer de la validité de contenu qui
est capitale si on veut avoir une évaluation plus centrée
sur ce qui est important pour le patient. Les directions
futures pour la recherche qualitative dans l’arthrose
sont probablement l’utilisation de bases de données
qualitatives pour concevoir des programmes d’édu-
cation pour les patients et les acteurs de santé et
évaluer l’effi cacité de ces programmes, à la fois sur
des marqueurs intermédiaires comme la satisfaction
et le savoir, mais surtout sur des marqueurs termi-
naux tels que la douleur et l’incapacité fonctionnelle ;
enfi n, il faudra explorer de nouveaux concepts, l’un
d’entre eux étant probablement mieux analyser, mieux
comprendre et mieux gérer le fardeau à se traiter dans
les maladies chroniques
(18)
. La focale portée sur
le patient ne doit en effet pas se cantonner à l’envi-
sager comme seul acteur au cœur des changements
nécessaires à l’amélioration de sa prise en charge. En
pointant les écarts de perspectives entre soignants et
soignés, les études qualitatives permettent en effet
de réinterroger les pratiques médicales quotidiennes
et d’identifi er des points à améliorer dans l’informa-
tion et la formation des professionnels de santé, mais
aussi dans les modalités d’interactions possibles avec
leurs patients.

29
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 01 - Octobre - novembre - décembre 2013
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
9.
Milder TY, Williams KM, Ritchie JE, Lipworth WL, Day DO. Use of NSAIDs among older-aged primary care patients: engagement with information
and perceptions of risk. Age Ageing 2011;40(2):254-9.
10.
Campbell R, Evans M, Tucker M, Quilty B, Dieppe P, Donovan JL. Why don’t patients do their exercises? Understanding non-compliance with
physiotherapy in patients with osteoarthritis of the knee. J Epidemiol Community Health 2001;55(2):132-8.
11.
Hendry M, Williams NH, Markland D, Wilkinson C, Maddison P. Why should we exercise when our knees hurt? A qualitative study of primary
care patients with osteoarthritis of the knee. Fam Pract 2006;23(5):558-67.
12.
Hudak PL, Clark JP, Hawker GA et al. “You’re perfect for the procedure! Why don’t you want it?” Elderly arthritis patients’ unwillingness to
consider total joint arthroplasty surgery: a qualitative study. Med Decis Making 2002;22(3):272-8.
13.
Ballantyne PJ, Gignac MA, Hawker GA. A patient-centered perspective on surgery avoidance for hip or knee arthritis: lessons for the future.
Arthritis Rheum 2007;57(1):27-34.
14.
Suarez-Almazor ME, Richardson M, Kroll TL, Sharf BF. A qualitative analysis of decision-making for total knee replacement in patients with
osteoarthritis. J Clin Rheumatol 2010;16(4):158-63.
15.
Gooberman-Hill R, Sansom A, Sanders CM et al. Unstated factors in orthopaedic decision-making: a qualitative study. BMC Musculoskelet Disord
2010;11:213.
16.
Sansom A, Donovan J, Sanders C et al. Routes to total joint replacement surgery: patients’ and clinicians’ perceptions of need. Arthritis Care
Res (Hoboken)2010;62(9):1252-7.
17.
O’Neill T, Jinks C, Ong BN. Decision-making regarding total knee replacement surgery: a qualitative meta-synthesis. BMC Health Serv Res
2007;7:52.
18.
Benhamou M, Boutron I, Dalichampt M et al. Elaboration and validation of a questionnaire assessing patient expectations about management
of knee osteoarthritis by their physicians: the Knee Osteoarthritis Expectations Questionnaire. Ann Rheum Dis 2013;72(4):552-9.
19.
Benhamou M, Baron G, Dalichampt M et al. Development and validation of a questionnaire assessing fears and beliefs of patients with knee
osteoarthritis: the Knee Osteoarthritis Fears and Beliefs Questionnaire (KOFBeQ). PLoS One 2013;8(1):e53886.
20.
May C, Montori V, Mair F. Future directions for qualitative research in OA: the burdens of treatment. BMJ 2009;339.
1
/
4
100%