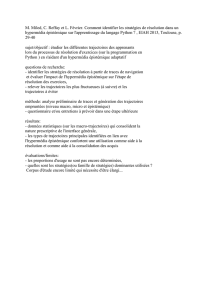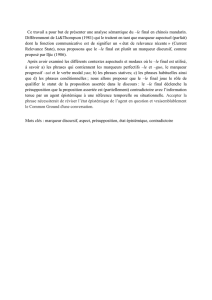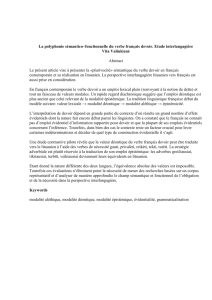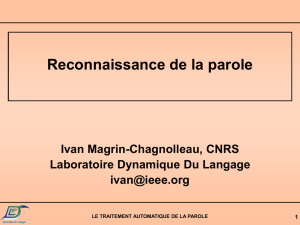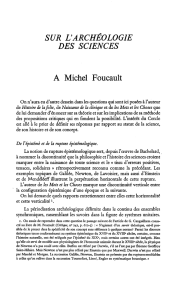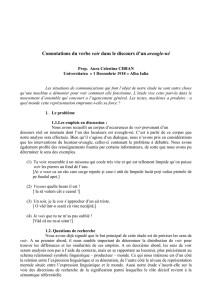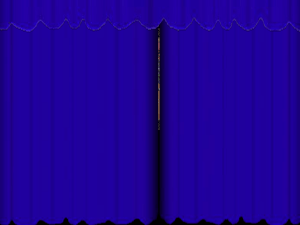Télécharger

Etudes de syntaxe : français parlé, français hors de France, créoles
Actes du colloque franco-allemand, Paris X, le 19 octobre 2007
1
Le marquage épistémique de l’énoncé en français parlé
Gerda Haßler
Université de Postdam
I. Le marquage épistémologique
Définition d’une notion
Le langage nous permet de parler du monde extérieur, mais notre connaissance du monde est
souvent imparfaite. C’est pourquoi le langage nous offre des moyens pour opérer une modalisation
épistémique des énoncés. Ce marquage épistémique concerne la langue écrite aussi bien que la
langue parlée, mais la langue parlée permet d’étudier mieux que dans la langue écrite les processus
en œuvre dans ce domaine. J’utilise le corpus français publié dans C-ORAL-ROM en gardant les
abréviations des auteurs (Cresti / Moneglia (2005). La partie française de C-ORAL-ROM a été établie
par l’équipe DELIC à Aix-en-Provence qui possède le plus large corpus de français parlé. Il est
constitué de 2,5 millions de mots qui sont accessibles à des logiciels montrant des concordances.
Grâce à la modalisation épistémique nous pouvons présenter les énoncés comme plus ou moins
probables. Pour réaliser cette modalisation épistémique, qui se présente comme quantitative, nous
pouvons utiliser des adverbes modaux, comme dans la phrase (1)
(1) Probablement, Jean va terminer son travail demain.
En français, le conditionnel épistémique, dit parfois « journalistique », est traditionnellement considéré
comme relevant de la catégorie linguistique de modalité. Le conditionnel dans la phrase (2)
exprimerait un fait douteux :
(2) Selon le communiqué d’hier, les syndicats seraient prêts à des négociations.
De la même manière, on considère le verbe modal devoir en interprétation épistémique comme un
marqueur de la modalité épistémique. Le verbe épistémique devoir de l’exemple (3) dénoterait la
« probabilité » :
(3) Pierre n’est pas venu à la réunion. Il doit être malade.
Quand nous opérons une modalisation épistémique, nous présentons les énoncés comme plus ou
moins probables. Après l’analyse des adverbes, j’examinerai aussi la proposition récente de
considérer le conditionnel et le modal devoir comme relevant de la catégorie de l’évidentialité.
La possibilité de mettre en œuvre un marquage évidentiel des énoncés nous permet d’indiquer la
source ou la nature de la source d’où provient l’information transmise. Dans cette hypothèse, le
conditionnel journalistique indiquerait que l’information transmise par l’énoncé est empruntée à autrui
(cf. Dendale 1994, Kronning2003 : 131) et le devoir épistémique dénoterait que l’information est
obtenue par inférence.
Avant de se poser la question de savoir s’il est utile de traiter le conditionnel et devoir en termes de
modalité épistémique ou d’évidentialité, je parlerai brièvement de la valeur de la catégorie
d’évidentialité en typologie et je montrerai l’interrelation de ces deux catégories en français parlé.
L’évidentialité dans la description de langues non-indoeuropéennes
Il y a des langues qui ont développé une catégorie grammaticale propre de l'évidentialité et qui
l’expriment de façon obligatoire. Dans quelques cas, ce sont des moyens développés par voie
métaphorique à partir des expressions qui désignent la perception de la parole. Dans leur nouvelle
fonction, ils ne font plus partie de la prédication, mais ils ne se réduisent pas non plus à des rapports
pragmatiques. Barnes (1984) a décrit le système des évidentiels dans la langue Tuyuca parlée au
Brésil et en Colombie. La notion d’évidentialité s’inscrit donc d’abord dans le contexte théorique des
processus de grammaticalisation et de la description de leurs résultats.
1
(4a) díiga apé-wi
football jouer -3ª PERS. PRET. VISUEL
‘Il a joué au football [je l’ai vu]’
(4b) díiga apé-ti
1
Pour l’étude de l’évidentialité voir Aikhenvald 2004, Aikhenwald/Dixon 2003, Chafe/Nichols 1986, Cornillie 2007,
Dendale/Tasmowski 1994, Dendale/Liliane Tasmowski (2001), Hoff 1986, Ifantidou 2001, Lazard 2001, Mushin 2001, Nuyts
2001, Plungian 2001, Willett 1988, Bybee/Perkins/Pagliuca (1994), Haßler 2001, 2003; et avec une désignation
consciemment différente (médiatisation) Guentchéva 1996. Pour la délimitation entre modalité épistémique et évidentialité
voir De Haan 1999, Frawley 1992, Jakobson 1957, Schlichter 1986, Squartini 2004, Volkmann 2005, Wachtmeister
Bermúdez 2006.

Etudes de syntaxe : français parlé, français hors de France, créoles
Actes du colloque franco-allemand, Paris X, le 19 octobre 2007
2
football jouer-3ª PERS. PRET. NON VISUEL
‘Il a joué au football [je l’ai entendu, mais pas vu]’
(4c) díiga apé-yi
football jouer -3ª PERS. PRET. INFERENCE
‘Il y a des indices qu’il a joué au football, mais je ne l’ai pas vu’
(4d) díiga apé-yigi
football jouer -3ª PERS. PRET. COMMUNICATION
‘On m’a dit qu’il a joué au football’
(4e) díiga apé-hĩyi
football jouer -3ª PERS. PRET. DEDUCTION
‘Il est logique de supposer qu’il a joué au football’
Dans les traductions approximatives de ces phrases, le marquage de l’évidentialité se trouve
transformé en une phrase prédicative, ce qui ne correspond pas à l’original dans lequel l’évidentialité
se marque par une sorte de suffixe.
Il y a au moins quatre raisons de marquer explicitement que l'énonciateur actuel n'est pas la source de
l'information: (1) il s'agit de la transmission d'un savoir généralement reconnu, (2) le locuteur actuel tient
son information d‘une troisième personne ou de l'ouï-dire, (3) il a déduit le contenu de son information à
partir d'autres circonstances, (4) le contenu de l'information est le résultat d'un raisonnement.
En prenant ces raisons comme point de départ dans une étude sur des langues qui n’ont pas de
marqueurs évidentiels morphologiques, on rencontre les problèmes théoriques posés par la
généralisation conceptuelle d’une catégorie linguistique telle que l’évidentialité. Il s’agit d’un des très
rares cas, dans l’histoire de la linguistique, dans lesquels la description des langues européennes
s’est emparée d’une catégorie élaborée dans un contexte non-indoeuropéen.
II. Des adverbes épistémiques et évidentiels dans la langue parlée française
Commençons l’analyse par le cas le plus facile du marquage épistémique, les adverbes modaux. Il y a
des adverbes qui dénotent le contenu de l’énoncé comme plus ou moins probable : probablement,
vraisemblablement, possiblement, éventuellement, peut-être. Ils se distinguent déjà par la fréquence
de leur usage dans le corpus. Dans la partie française de C-ORAL-ROM, nous avons trouvé 8
occurrences de probablement, 6 d’éventuellement, 207 de peut-être, tandis que vraisemblablement et
possiblement n’y sont pas représentés.
Peut-être
Pour l’adverbe le plus fréquent, peut-être, on constate l’usage très répandu comme adverbe de phrase
modalisant toute la prédication. En tant qu’adverbe de phrase, peut-être se pose soit après le verbe,
comme dans exemples (5) à (7), soit à la gauche de la proposition (8) :
(5) c’est peut-être l’anniversaire de sa mort / non ? [ffamcv03]
(6) n’entraînent pas des jeunes des cités / qui eux aimeraient peut-être s’en sortir
autrement / # ça veut dire qu’on offre à la majorité des jeunes une perspective
[fnatpd02]
(7) CAR : il est peut-être à peine assez frais hein ? [fpubmn03]
(8) et elle se repose // # et # moi je sais que peut-être / # je vais m'emparer de son âme /
# [fmedin02]
Mais on le trouve aussi comme modalisateur d’énoncés sans verbe :
(9) EST: ben / à une prochaine fois peut-être // [ftelpv24]
Peut-être remplit aussi la fonction d’affaiblissement d’un élément de la phrase dont le locuteur n’est
pas tout à fait sûr. Dans ce cas, il est mis avant ou après l’élément auquel il se rapporte :
(10) [/] ça doit remonter quand même [/] # ouais / ça fait peut-être six mois qu’on se connaît //
mais comme on se voit pas régulièrement // ben regarde là / ça faisait [/] ça faisait un mois / que
je l’avais pas vu [ffamcv07]
(11) c’est ce que je ressens / # qu’il faudra encore peut-être bien # une génération / #
[ffamdl06]
(12) il y a # trente ans maintenant / quarante ans peut-être / # disait la moyenne des
Français &euh [ffamdl21]
Il y a une position syntaxique de peut-être qui est particulièrement fréquente dans la langue parlée : il
est suivi de la conjonction que qui introduit une proposition formellement subordonnée, mais qui porte
le contenu principal de l’énoncé qui se modalise comme probable (peut-être que P) :
(13) C’est encore un mouvement / qui est assez important // # peut-être qu’il y a encore
des influences // # [ffamcv03]

Etudes de syntaxe : français parlé, français hors de France, créoles
Actes du colloque franco-allemand, Paris X, le 19 octobre 2007
3
(14) euh # non mais je voyais pas &f oui // # peut-être que j’avais pas envie / je voyais
<pas // &euh> [ffamcv12]
(15) MAR: si il y avait eu moins de malhonnêteté / &euh peut-être que les gens auraient #
des relations // [ffamdl06]
(16) c’est plus encore / # parce que l’huile ça coûte cher / peut-être qu’avec la farine [/]
avec le [/] # la farine et l'eau [/] moi je sais [/] un peu de levure / on peut faire du pain
[fnatpr03]
Pour peut-être, cette structure semble être parfaitement possible et même parfois préférable à
l’insertion de l’adverbe dans la phrase qui exigerait plus d’effort et plus de planification. Du point de
vue fonctionnel, peut-être que remplit déjà la fonction d’un adverbe de phrase antéposé.
En ce qui concerne le rôle cognitif de peut-être, on peut remarquer qu’il introduit souvent une
supposition ou des fragments d’un savoir dont le locuteur ne dispose pas entièrement. Dans ces cas il
est presque toujours précédé de je (ne) sais pas et il marque l’effort du locuteur de donner des
explications qu’il ne peut pas donner avec sécurité :
(17) alors on peut imaginer qu’elle a [/] qu’elle a perdu son mari / je ne sais pas / peut-
être à la guerre / peut-être [/] je ne sais pas ce qui s'est passé [fnatpr03]
(18) Mais ça marche mieux sur Aix // je sais pas pourquoi en fait # peut-être parce qu’il y
a plus d’étudiants // j’en sais rien [ffamcv02]
Probablement
Pour probablement, nous avons trouvé surtout des emplois comme adverbe de phrase, intégré après
le verbe ou antéposé:
(19) Le dix-neuvième siècle est aussi probablement / jusqu’à maintenant est aussi
probablement / jusqu' à maintenant [/] # est aussi probablement / # le siècle le plus / #
délaissé / du point de vue / des études métalexicographiques [fnatte03]
(20) Mais c’est [/] c’est [/] c’est flagrant / que les [/] les [/]les [/]les [/] les maîtres des
classes [/] je &s [/] probablement je ne sais pas jusqu' où / parce que je me suis pas [/]
jamais préoccupé du second cycle / euh mettant ça hors de ma compétence // mais voir /
cette espèce de [/]de [/]de [/]de / comment dirais-je / d’incompréhension de leur mission
essentielle/ [ffamdl21]
Dans l’exemple (20), l’antéposition se trouve particulièrement soulignée par la rupture précédente : le
locuteur voulait dire je sais pas, mais il s’interrompt en introduisant un probablement qui marque son
incertitude particulière et ne se réfère pas au contenu propositionnel de la phrase, le fait de ne pas
savoir ne nécessitant pas de modalisation épistémique. Il continue par la formule de négation
complète je ne sais pas qui est très rare dans le corpus et qui marque un certain poids que le locuteur
lui concède.
Nous avons trouvé un exemple dans lequel probablement fonctionne comme peut-être comme
élément formellement subordonnant avec que :
(21) nombre / # de mots qui viennent du français // # donc probablement que ça vient du
français / mais &euh ça j’en suis pas sûre [fnatte02]
Ce phénomène pourrait s’expliquer par une certaine analogie des adverbes modaux qui se posent
dans une position syntaxique plus commode.
Éventuellement
Pour éventuellement, on peut constater la position de l’adverbe de phrase qui modalise le contenu
entier dans (22) ainsi que la relativisation d’un élément de la phrase, dans (23) d’un membre d’une
énumération :
(22) euh # moi je pense que on peut [/] on [/] oui on peut éventuellement vous mettre une
salle à disposition pour &euh pour les repas froids [fpubdl02]
(23) euh ou sur des [/] dans les salons ou &euh éventuellement dans des galeries d’art /
mais enfin ça c' est pas pour tout de suite [ffamdl28]
Regardons maintenant les adverbes d’évidentialité. Y a-t-il des adverbes d’évidentialité en français ? Il
y a des adverbes qui, par leur sémantique lexicale, dénotent la provenance des connaissances
transmises par le locuteur du sens de la vue : visiblement, apparemment, évidemment. Dans le corpus
de C-ORAL-ROM, nous avons trouvé 6 occurrences de visiblement, 39 d’apparemment et 95
d’évidemment.
2
Visiblement
Pour visiblement, dans la majorité des cas, il est justifié de supposer une véritable liaison à ce qui est
visible. Son interprétation comme marqueur de l’évidentialité paraît donc possible. Dans (24),
2
Voir pour l’espagnol Haßler 2004.

Etudes de syntaxe : français parlé, français hors de France, créoles
Actes du colloque franco-allemand, Paris X, le 19 octobre 2007
4
visiblement se réfère à l’apparence extérieure du Président qui donne à voir qu’il est fatigué. Dans
(25), il est question d’un texte dont les qualités extérieures montrent qu’il est achevé :
(24) de sa vigueur # en comparaison avec le Président / # visiblement fatigué // # lors
d’une manifestation à Hide Park / [fmedrp03]
(25) alors que la préface / elle / # est un texte / # clos / # un texte / # visiblement achevé
/ # et / # non moins visiblement destiné / en quelque sorte à être lu [fnatte03]
Mais, il y a au moins deux raisons de douter du caractère purement évidentiel de visiblement. D’abord
c’est son usage relativement peu fréquent qui met en doute sa capacité à marquer la provenance
visuelle du savoir du locuteur. Ensuite, c’est son usage dans des contextes où ce qui a été perçu
visiblement n’est pas clair :
(26) en fait ça faisait quand même quelques jours qu'on le trimbalait / et visiblement &euh
# c' est un peu l' habitude chez ces gens-là // euh il vivait à nos crochets quoi // il (/)
c’était le pique-assiette [ffammn11]
Cet usage flou de visiblement est rendu explicite par l’exemple (27)
(27) quand on se &p [/] quand on parlait même en société / visiblement donc d’après ce
[/] ce qu'on nous a dit après / # c’est qu’en fait ça [/] ça se voyait quoi // on voyait très
bien qu’on s’aimait dans le regard [ffamdl03]
Dans cet exemple, le locuteur utilise visiblement pour décrire d’où il sait qu’on s’aimait dans le regard,
mais il dit tout suite que ce savoir, il l’a reçu par ouïe dire (d’après ce [/] ce qu'on nous a dit après),
pour revenir à la vue par l’expression ça se voyait quoi // on voyait très bien. Visiblement a donc perdu
sa valeur de marquer exclusivement la provenance des connaissances transmises par la vue, mais il
reste un marqueur de l’évidentialité plus générale.
Apparemment
C’est d’autant plus le cas d’apparemment, qui s’utilise surtout comme adverbe de phrase et qui ne
marque plus une apparence visible comme source du savoir transmis. Dans les exemples (28) à (30),
le locuteur marque une conclusion à partir de l’apparence extérieure d’une personne ou à partir
d’autres indices :
(28) / &euh # que Carole / elle avait [/] elle avait &euh apparemment trouvé l'homme de
sa vie / qu’elle pourrait pas en trouver un autre [ffamcv12]
(29) ses mœurs un peu bizarres hein on &sa [/] # il connaît apparemment [/] il connaît
toutes les boites de Lyon [ffammn01]
(30) trente pour cent de réduc / # parce que le gars apparemment les fait marcher
souvent // # donc il me ramène / # o [ffamdl01]
Dans (31), apparemment se réfère plutôt à une conclusion tirée des circonstances (il est minuit) qu’à
une source visuelle :
(31) alors / # tout va bien // bon là on est apparemment les seuls patients // il est [/] il est
minuit / minu [ffammn05]
Évidemment
Cet éloignement de la signification ‘d'une manière évidente, manifeste aux sens et notamment à la
vue’ est encore plus manifeste dans les exemples avec évidemment dans lesquels l’adverbe ne
marque qu’un renvoi par le locuteur de la responsabilité du contenu de l’énoncé à autrui :
(32) donc &euh &c [/] c'est une société assez fermée évidemment // et puis l' état / # n' a
aucune force // [ffammn17]
(33) on a de la danse hip hop / # &euh qui concerne évidemment beaucoup plus le
secteur adolescent [ffammn27]
(34) &euh // on (ne) compte pas les heures évidemment // comme on dit / # on doit être à
autour de cinquante [ffammn28]
(35) je vous le répète / # l'entreprise se doit / bien évidemment / # de connaître / #
parfaitement bien cet environnement [fnatte01]
Comme nous l’avons vu à travers l’exemple des adverbes, la délimitation entre la modalité
épistémique et l’évidentialité pose problème. Même si nous partons d’éléments dont la fonction
originaire est le marquage de la provenance du savoir du locuteur, cette fonction est contingente à
celle de la modalisation épistémique. Dans une phrase comme (32a), la présence de l’adverbe
évidemment réduit la probabilité et l’évidence, ce qu’on peut voir facilement par une comparaison avec
(32b) :
(32a) C’est une société assez fermée évidemment.
(32b) C’est une société assez fermée.
Ce qui est vraiment évident ne nécessite pas une explication linguistique, c’est pourquoi chaque
marquage évidentiel subit un changement sémantique. Ce changement est dû au fait pragmatique

Etudes de syntaxe : français parlé, français hors de France, créoles
Actes du colloque franco-allemand, Paris X, le 19 octobre 2007
5
que tout marquage évidentiel est interprété comme une restriction de l’évidence réelle de la phrase.
C’est aussi le cas de mots qui par leur signification lexicale signifieraient le plus haut degré
d’évidence.
III. Le verbe modal devoir
Ces dernières années, on a essayé d’utiliser le concept d‘évidentialité pour expliquer des
phénomènes décrits jusqu'ici de façon peu satisfaisante dans les langues romanes. Dans les travaux
de Patrick Dendale sur le verbe modal devoir, c’est une nécessité théorique qui entraîne la distinction
entre évidentialité et modalité. Dendale (1994) a étudié les valeurs modales de devoir qui présentent
une large variété d’emplois difficilement concevable en terme de modalité. Ce qui est commun à
toutes les occurrences de devoir, c’est l’expression d’un choix entre plusieurs inférences possibles à
partir d’un fait donné. La propriété évidentielle de devoir consisterait à choisir une des conclusions
possibles et à la marquer comme celle qui est probable. Il résume, pour ainsi dire, toute une suite de
procédés cognitifs réalisés par le locuteur, mais qui ne s’exprime pas en surface. Devoir ne marque
pas principalement une qualité épistémique de l’information donnée, mais il caractérise l’opération
même qui crée l’information. C’est donc une qualité autoréférentielle du langage qui produit la
distinction entre modalité et évidentialité.
Dans une description structurelle, devoir, en tant que marqueur évidentiel, se décrit par plusieurs
oppositions. Tout d’abord, il s’oppose à l’énoncé non-évidentiel qui présente l’information que Caroline
est malade comme fait „évident“ au sens strict (36a):
(36a) Caroline n’est pas au travail aujourd’hui. Elle est malade.
(36b) Caroline n’est pas au travail aujourd’hui. Elle doit être malade.
En tant que marqueur d’un processus créateur d’information, devoir s’oppose à d’autres marqueurs
d’évidentialité, comme le conditionnel épistémique dans (37b) qui indique un discours ou une réflexion
intérieure rapporté dans un récit, et la phrase subordonnée dans (37c) qui explique une vérité
généralement connue.
(37a) Tiens on sonne à la porte. Ça doit être le facteur.
(37b) Tiens on sonne à la porte. Ce serait le facteur.
(37c) Si on sonne à la porte à midi, c’est le facteur.
Dans l’énoncé (38a), le futur antérieur du verbe, grâce à sa valeur inactuelle, permet de comprendre
l’énonciation comme une supposition, tandis que devoir souligne, dans la périphrase verbale de (38b),
la création d’une information. Il marque le choix entre plusieurs possibilités qui pourraient expliquer le
comportement d’une personne:
(38a) Il l’aura fait par pitié.
(38b) Il doit l’avoir fait par pitié.
La valeur évidentielle de devoir s’oppose à l‘expression de la perception concrète d’une chose par le
locuteur même qui rend superflue toute référence aux sources de son savoir. C’est pourquoi une suite
d‘énoncés comme (39) serait difficilement acceptable:
(39) Ça doit être ma mère.
?
*Je l’avais immédiatement vue et reconnue.
L’instabilité des valeurs modales de devoir, qui s’étend de la nécessité à l’incertitude, conduit donc à
la conclusion que son noyau fonctionnel est l’indication de l’évidentialité (Dendale 1994, 37). Le point
de départ de l’introduction du concept d’évidentialité est une sorte d’économie de la
grammaticographie. Une multitude de fonctions qui tout d’abord ne semble être qu’énumérable se
réduit à un principe commun. La définition du marqueur évidentiel donnée par Dendale / Tasmowski
correspond à cette idée: « Dans ce contexte, un marqueur évidentiel est une expression langagière
qui apparaît dans l'énoncé et qui indique si l’information transmise dans cet énoncé a été empruntée
par le locuteur à autrui ou si elle a été créée par le locuteur lui-même, moyennant une inférence ou
une perception » (Dendale/Tasmowski 1994: 5).
Dans le corpus C-ORAL-ROM, on peut vérifier cette hypothèse sur la fonction évidentielle de devoir.
Après avoir exclu les occurrences de doit où il désigne une obligation, nous avons relevé 70 énoncés
dans lesquels la forme doit marque que l’information est obtenue par inférence. On pourrait ajouter
aux exemples analysés ceux avec les autres formes de devoir.
(40) une maman / euh # qui a accouché sous X / # et &euh / d’une petite fille / qui doit
avoir à peu prés quatorze ans maintenant // # et elle essayait de faire changer les papiers
[ffamcv10]
(41) vous voulez pas prendre le plat du jour ou le menu où ça doit vous coûter dans les
cent balles // # et puis vous so [ffammn22]
(42) qui c'est qui cite Winlox ? # on s'est dit / oh mais ça doit être Christophe / ça va // #
ça va / c'est bon // # [fpubdl14]
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%