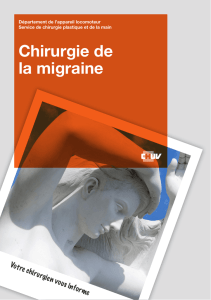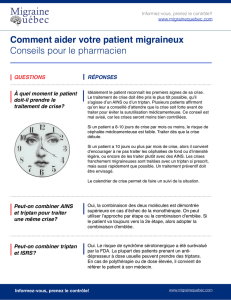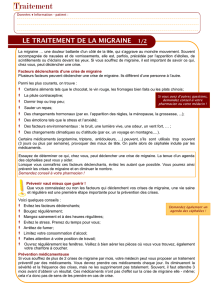La migraine : un mal ou une maladie ?

Santé
LE PLUS VIEUX CASSE-TÊTE DU MONDE
La migraine : un mal
ou une maladie ?
La migraine est une affection fréquente puisqu’elle concerne plus de 10 % de la
population française, avec une nette prédominance féminine. Au point d’ailleurs d’en
être souvent caricaturée comme un mal-prétexte, une fausse maladie finalement car
sans traduction objective déterminante
En médecine, on qualifie de céphalées tous les maux de tête. La migraine est
une céphalée parmi d’autres, que l’on ne doit pas confondre avec les maux de
tête courants qui accompagnent de nombreuses pathologies (état grippal,
sinusite, otite, arthrose cervicale, douleurs dentaires…) ou sont consécutifs à
des événements occasionnels (repas trop arrosé, sortie nocturne agitée,
atmosphère bruyante et enfumée).
Des critères précis
Pour qu’on puisse parler de migraine, il faut que soient réunis divers critères :
une douleur durant entre quatre et soixante-douze heures ; comportant au
moins deux des caractères suivants : être unilatérale, pulsatile (battant au
rythme du cœur), modérée ou sévère, aggravée par l’effort physique. Et il doit
exister au moins un de ces deux critères : soit nausées ou vomissements, soit
gêne à la lumière et au bruit.
Il existe deux formes de migraines : celles sans aura (l’aura désigne un trouble
neurologique précédant le mal de tête), ou migraines communes, et celles avec
aura, ou migraines accompagnées. Ces dernières concernent 10 à 15 % des cas
de migraines. Elles présentent des symptômes neurologiques (troubles visuels
et sensitifs) qui se développent progressivement dans l’heure qui précède le
déclenchement de la crise.
La nature du mal

L’aura migraineuse est pour ainsi dire un dérèglement transitoire du cortex
cérébral. Elle serait provoquée par une forme de dépression corticale, comme
une vague partant de l’arrière du cerveau vers l’avant.
La douleur migraineuse s’explique par un autre processus, à la fois vasculaire
et neurologique. On pense, aujourd’hui, que tout débute par une stimulation
nerveuse au niveau de fibres particulières du nerf trijumeau (ce nerf
correspond à la cinquième paire de nerfs crâniens et doit son nom au fait qu’il
se divise en trois branches : le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire supérieur et
le nerf maxillaire inférieur, d’où son implication dans les douleurs faciales). Il
en résulte une libération de neuromédiateurs au niveau des vaisseaux
méningés. La conséquence en est une réaction inflammatoire qui favorise la
dilatation des vaisseaux, à l’origine de la douleur.
La crise de migraine implique donc à la fois les nerfs et les vaisseaux
cérébraux, mais tout partirait d’une stimulation nerveuse.
L’arrivée de l’orage
Souvent, l’accès migraineux survient sans crier gare, mais de nombreux
malades, par habitude, reconnaissent les signes annonciateurs du calvaire qui
les attend. Ces prodromes sont variables selon les personnes mais souvent
identiques chez un même individu : sensation de lassitude, de malaise général,
tendance nauséeuse, intolérance aux odeurs et au bruit, réaction dépressive
ou, au contraire, hyperexcitation, etc.
La crise peut survenir à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, mais elle
se rencontre plutôt au petit matin, réveillant le sujet, ou au lever. Le début est
parfois brutal mais plus souvent progressif, la douleur s’accentuant dans les
trois ou quatre heures qui suivent. S’ensuit une phase en plateau pendant
plusieurs heures, avant un apaisement assez fréquent en début de soirée, la fin
de crise intervenant avec le retour du sommeil.
Dans la majorité des cas, la douleur est d’abord localisée, en avant sur la
tempe et au-dessus de l’orbite, avant de diffuser à la moitié du crâne. Elle
s’accompagne parfois de nausées et de vomissements mais se caractérise
toujours par une intolérance à la lumière et au bruit, générant dans certains cas
un état de prostration absolu, couché dans le noir, dans une attente de fin du
monde.
Après la tempête
La durée habituelle des crises se situe entre 4 et 72 heures, et leur fréquence
varie d’une fois par mois jusqu’à une à deux fois par semaine. Petite gêne
passagère pour certains – que l’on calme rapidement avec un « cachet » –, elle
est proprement invalidante pour près d’un quart des migraineux.
Il faut pourtant savoir que la maladie peut changer dans son évolution au fil
des années. Il y a des périodes fastes – grossesse, par exemple – où les crises
régressent mais tout aussi bien des périodes critiques – changements de

rythme de vie, moments de tensions psychologiques, et parfois sans raison
décelable – où les crises succèdent aux crises sans guère de répit.
On considère cependant que, passé la cinquantaine, la migraine se fait moins
prégnante, notamment chez les femmes, à la ménopause, mince consolation
pour celles-ci du changement hormonal qu’elles subissent. Mais le caractère
génétique de cette maladie ne fait guère de doute car on relève une incidence
familiale dans plus des deux tiers des cas. Il y a un terrain migraineux et l’on
supporte cette tendance toute la vie.
Vivre avec la migraine
La migraine est une pathologie que l’on ne prend pas assez au sérieux, bien
que son coût social – en arrêts de travail – soit fort élevé. D’ailleurs, beaucoup
de migraineux ne consultent pas pour leur migraine et se débrouillent comme
ils le peuvent, pratiquant une automédication à la fois empirique et aléatoire.
Il faut dire que le corps médical, globalement, n’a pas toujours été à la hauteur
face à ce problème, laissant souvent le patient dans un grand désarroi, en tête
à tête douloureux avec un mal susceptible de procéder aussi bien du foie que
de la vésicule, de la vue que des sinus, d’une arthrose que des nerfs… toutes
ces fausses pistes sur lesquelles des médecins bien intentionnés mais peu
spécialisés se sont fourvoyés.
Pourtant la panoplie thérapeutique ne cesse de s’élargir, et des centres de
consultation en milieu hospitalier existent maintenant à peu près partout en
France. La compréhension puis le contrôle des facteurs déclenchants
constituent la première étape thérapeutique, avant le traitement proprement
dit. Le praticien a d’abord recours aux antalgiques mineurs ou aux anti-
inflammatoires non stéroïdiens, avant de faire appel, en cas d’inefficacité, à
des médicaments plus spécifiques tels que les vasoconstricteurs (ergot de
seigle et triptans), qui s’opposent à la vasodilatation des vaisseaux méningés.
Lorsque la fréquence des crises est trop importante et que la prise
d’antalgiques risque de conduire à un abus médicamenteux, le médecin peut
proposer un véritable traitement de fond, dont la logistique s’appuie sur les
dérivés de l’ergot de seigle, les bêta-bloquants (habituellement prescrits dans
le traitement de l’hypertension artérielle), certains antidépresseurs.
On entre alors dans le cadre d’un traitement spécifique de la migraine, de la
maladie migraineuse, où le patient doit s’astreindre à un suivi thérapeutique,
seul garant d’une meilleure qualité de vie.
Quelques migraineux célèbres
Ce n’est sans doute qu’un maigre réconfort d’apprendre que de nombreux
personnages illustres endurent les mêmes épreuves que vous, mais on ne peut
que se sentir momentanément flatté d’appartenir à une si noble confrérie.

César, Napoléon, Bismarck souffraient eux aussi de migraines, comme Pascal,
Emmanuel Kant ou Freud. Les musiciens Henry Purcell, Chopin, Tchaïkovski,
Wagner en étaient également accablés, à l’instar d’une pléiade d’écrivains :
Cervantès, Mme de Sévigné, Alfred de Vigny, Edgar Poe, Tolstoï, Nietzsche,
Flaubert, Maupassant, André Gide, Roland Barthes…
La famille des triptans
Les triptans constituent une nouvelle famille de molécules spécialement
conçues pour combattre la crise de migraine. D’une grande efficacité, ils
agissent au niveau du récepteur d’un important neuromédiateur, la
sérotonine. Les médecins ont désormais à leur disposition plusieurs molécules
différentes permettant une utilisation par voie intraveineuse ou sous-cutanée,
mais aussi par voies orale, nasale ou rectale.
1
/
4
100%