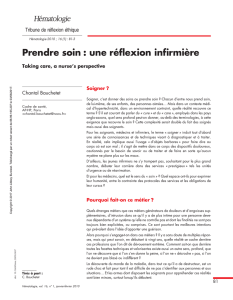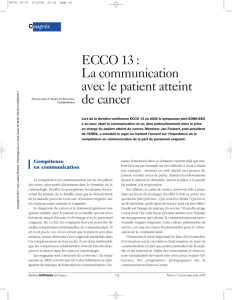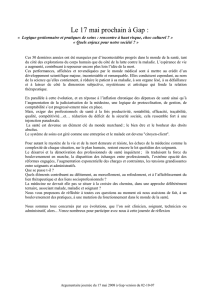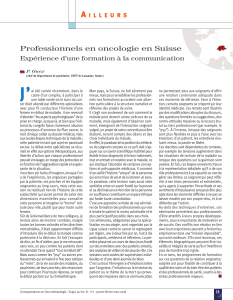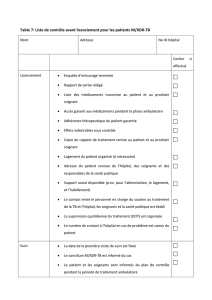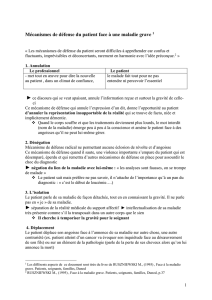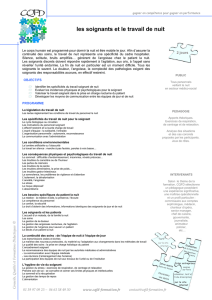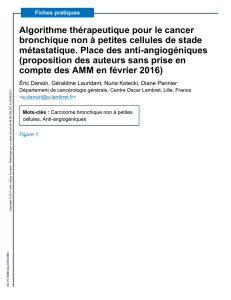Le soignant face à lPenfant qui peut ou qui va mourir

Le soignant face à l’enfant
qui peut ou qui va mourir
Daniel Oppenheim
Département d’oncologie pédiatrique et Unité de psycho-oncologie, Institut de Cancérologie
Gustave Roussy, 39 rue Camille Desmoulin, 94805 Villejuif
Il n’est pas facile pour un soignant de trouver la juste position face à un enfant
qui peut ou qui va mourir. Les difficultés cliniques et éthiques sont intimement
liées, et inhérentes à cette situation. Nous en décrivons les principales, ainsi que
les façons de s’y confronter. Au-delà des impératifs de bienfaisance, de respect
de son autonomie, de justice, les questions centrales sont : « qui est-il pour
moi ? » ;« qui suis-je pour lui ? » ;« que (me) veut-il ? » ;« que veux-je pour
lui ? ».Ceciimpliquedesavoircequ’est un enfant, ce qu’estlamortpourlui,de
ne pas prendre au pied de la lettre ses paroles, de se méfier des idées toutes
faites, mais aussi d’être suffisamment au clair avec sa vocation, ses idéaux, ses
objectifs, son travail et ses collègues. Il importe de tenir compte du présent et de
l’avenir de l’enfant, de ses parents et de sa fratrie (et de l’équipe). Le travail
collectif est indispensable.
Mots clés : enfant, éthique, mort, soignant
L’éthique du soignant est un enga-
gement responsable auprès de
celui qu’il a accepté de soigner, et
pour lequel il doit :
–être compétent ;
–penser à l’intérêt de l’autre et
non au sien ;
–faire que les actions lui appor-
tent un bénéfice bien supérieur aux
risques, aux contraintes et aux incon-
vénients ;
–assumer la responsabilité des déci-
sions mais ne pas oublier que le patient
doit être authentiquement d’accord
avec celles-ci ;
–veiller à ce qu’il ne perde pas
son autonomie, ainsi que le droit de
regard et de décision sur sa vie [1-3],
pas plus que sa dignité, et le sentiment
de sa valeur et de son identité.
Il importe également de penser au
présent et au court terme, mais aussi à
son devenir (aussi court qu’il puisse
parfois être) et à celui de ses proches
[4]. Il est donc nécessaire de tenir
compte de ce qui est important pour
lui (qui ne coïncide pas toujours tota-
lement avec l’objectif de la guérison)
[5, 6] et de ceux qui comptent pour
lui. Mais le soignant ne doit pas
oublier les autres patients, quelles
que soient leurs caractéristiques socia-
les, culturelles, académiques [7], qui
ne doivent être ni privilégiés par rap-
port à lui ni lésés par l’attention qui lui
est portée.
Pour parler d’éthique, il est préfé-
rable de le faire en son nom personnel,
ce qui n’est pas contradictoire avec la
connaissance de l’expérience et de la
réflexion éthique des autres, proches et
lointains, ni avec la confrontation avec
ces derniers.
Face à l’enfant
Un enfant traité pour une maladie
grave peut en mourir. Les soignants ne
doivent pas être obsédés par cette
m
t
p
Tirés à part : D. Oppenheim
doi: 10.1684/mtp.2009.0262
mt pédiatrie, vol. 12, n° 6, novembre-décembre 2009
Dossier
416
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

mort possible, même lorsque le pronostic est péjoratif, dès
le diagnostic ou en cours de traitement. Ils doivent le voir
comme n’importe quel autre enfant, ou n’importe quel
autre enfant malade. Parallèlement, ils ne peuvent ignorer
la réalité du pronostic. Il leur faut donc tenir compte de ces
deux réalités irréductibles :
–cet enfant est un enfant vivant, tant qu’il vit ;
–il est atteint d’une maladie dont il peut mourir.
Cette position ne consiste pas en un compromis entre
optimisme et pessimisme, entre illusion et strict réalisme
médical, et il importe aussi de ne pas « zigzaguer » entre
ces termes extrêmes, selon les moments du traitement ou
les autres situations médicales auxquelles sont confrontés
les soignants. Cette position difficile ne peut être mainte-
nue seule. En effet, le travail collectif est nécessaire dans
un tel contexte, impliquant la compétence et la solidarité
entre soignants, mais aussi l’accord authentique (jamais
stabilisé une fois pour toutes) avec les choix du service
(choix de recrutement, de traitement, organisation de
l’équipe, choix financiers…) et les décisions concernant
cet enfant. La mort possible d’un enfant ne laisse pas ses
soignants indifférents, ce qui est rassurant, mais mobilise
leur regard sur leur place dans l’équipe et leurs relations
aux collègues. Elle mobilise également les raisons mêmes
de leur vocation, de leurs choix professionnels (en pédia-
trie, en cancérologie pédiatrique, par exemple), surtout
lorsque, avec le temps, ils se sont confrontés à l’expé-
rience de la réalité avec les déceptions inévitables, les
doutes, les moments de découragement. Le stress, qui
découle de ces situations, est l’une des causes majeures
de l’usure des soignants [8]. C’est pourquoi la présence
d’un soutien extérieur (un psychanalyste animant un
groupe de parole ou un groupe Balint) [9] est particulière-
ment utile. Mais ce peut être celui du « psy » du service
(psychologue, psychiatre, psychanalyste) qui occupe dans
l’équipe une place un peu différente des autres soignants.
Il fait en effet partie, comme eux, de cette équipe, mais
n’a pas les responsabilités de décider des traitements ou
de les appliquer. Les risques de déstabilisation de l’équipe
sont forts, qu’il s’agisse de faire bloc, ou au contraire
d’être tenté par le chacun pour soi, ou encore de voir
s’exacerber des divisions préexistantes, structurelles,
inévitables : entre « vieux » et « jeunes », entre médecins
et infirmières, entre ceux ou celles qui se sentent à l’aise
(voire attirés) par l’enfant en danger et ceux ou celles qui
ne le supportent pas et préfèrent se mettre à distance.
Ces diverses attitudes sont compréhensibles, aucun
soignant n’est un robot polyvalent, froid, supportant
toute situation sans émotion, et elles ne sont pas
dangereuses (ni pour l’équipe, ni pour les patients), à
condition qu’elles restent compréhensibles aux uns et
aux autres, qu’elles ne soient ni excessives, ni systémati-
ques. Il n’y a pas, dans une équipe, de « spécialistes » de
la mort de l’enfant. En revanche, il peut y avoir des soi-
gnants spécialisés en soins palliatifs, en soins de support,
en traitement de la douleur, car ces activités demandent
une formation spécifique, qui peut se transmettre au sein
de l’équipe.
Ainsi, face à un enfant qui peut ou qui va mourir, il
importe de savoir ce qu’est un enfant, un enfant atteint
d’une maladie grave [10], ce qu’est la mort pour un enfant
et comment lui en parler [11], ce qu’est sa propre relation
à la mort et sa relation au patient. Celle-ci implique la
relation à l’enfant (et à l’adolescent ou au bébé), mais
également à ses parents et à sa fratrie, puisqu’un enfant,
encore moins qu’un adulte, n’est jamais absolument seul.
Car la première condition de l’éthique est d’être compé-
tent, particulièrement dans une situation où l’autre attend
beaucoup, pour pouvoir répondre à son attente, ses
demandes, ses besoins, et garder une relation authentique
et égalitaire autant que possible avec lui, sans lui nuire.
L’enfant face à la mort
Face à la mort, un enfant, comme un adulte d’ailleurs,
mais à sa manière, se pose des questions nombreuses et
différenciées. Il se demande comment « le mourir » risque
de se passer. Il s’appuie sur ce qu’il a pu voir dans sa
famille ou dans le service, mais également sur ce qu’il a
vécu jusqu’alors dans son traitement ou avant sa maladie.
La question de la douleur est, bien entendu, fondamen-
tale, mais aussi celle de tous les symptômes physiques
(troubles respiratoires, cutanés, gênes diverses…)etilse
demande si ses soignants et ses parents pourront les trai-
ter. Il se demande s’il pourra garder ses capacités physi-
ques et intellectuelles jusqu’au bout, et donc ne pas rester
passif, dépendant, coincé dans son lit. Mais aussi s’il
pourra jouer avec sa fratrie et garder sa relation à elle
ainsi qu’à ses copains. Il se demande s’il pourra aussi
continuer à dialoguer avec les autres, se faire compren-
dre, les comprendre. C’est pourquoi il faut être attentif
aux troubles cognitifs et aux troubles de la conscience,
ainsi qu’à tout ce qui peut gêner la préservation de cette
relation. Il peut s’agir de trouver le juste équilibre du trai-
tement antalgique (calmer la douleur suffisamment, mais
préserver suffisamment la lucidité et la vigilance), du trai-
tement des hallucinations (lorsqu’elles sont excessive-
ment angoissantes et accaparent toute l’attention de
l’enfant) ou de la confusion mentale (qui risque d’effrayer
les proches et de rendre l’enfant incompréhensible à leurs
yeux, ou de susciter des malentendus gênants). Dans un
tel cas, ils se demandent s’il ne devient pas fou, ou s’ils ne
doivent pas prendre au sérieux ses paroles et ses compor-
tements, et y percevoir la « vérité » de ce qu’il pense
d’eux.
L’enfant cancéreux, par exemple, n’est pas seulement
un enfant qui a un cancer et qui peut mourir (même si la
majorité d’entre eux guérissent) ou qui va mourir, comme
mt pédiatrie, vol. 12, n° 6, novembre-décembre 2009 417
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

il peut être un enfant blond, grand, un écolier, un sportif…
Tous ces éléments s’ajoutent à son identité fondamentale,
sans la bouleverser. Il n’est pas l’addition de ces trois ter-
mes, il est totalement chacun d’eux, qui tous ont une
importance majeure, et il importe qu’aucun d’eux
n’occupe seul tout le terrain, recouvre ou exclut les
autres. Il s’agit de notre responsabilité de soignant d’aider
l’enfant et ses parents à tenir compte de ces trois
éléments.
Certains parents (ou certains adolescents) veulent pré-
server une normalité impossible à soutenir, comme si la
maladie n’existait pas. D’autres ne peuvent plus regarder
leur enfant qu’avec des yeux médicaux ou infirmiers,
attentifs aux seuls signes cliniques qui leur indiquent
l’espoir, aussi minime et provisoire soit-il parfois, ou la
confirmation de son destin fatal et de leur détresse.
D’autres encore ne voient plus que la mort à venir (que
cela corresponde au pronostic médical ou pas), et pour
que cette attente intolérable (celle de sa mort, mais aussi
le constat de sa dégradation, et de leur impuissance à
l’aider) et la peur du vide que son absence laissera en
eux ne les fassent plus souffrir, ils se plongent vite, bruta-
lement, dans l’eau glacée du deuil prématuré. Chaque
parent peut éprouver, plus ou moins fortement et durable-
ment, ou répétitivement, ces tentations (et les soignants
n’y échappent pas, même si chez eux elles n’ont, en
général, aucune commune mesure avec celles des
parents). Les soignants doivent aider les parents et l’enfant
(et la fratrie) à préserver, jusqu’au bout, leur relation habi-
tuelle, à rester parents, fratrie, et lui enfant, même si cela
implique parfois d’aller très loin, bien plus loin qu’en
temps normal, dans ce que nécessite d’occuper cette
place, tout en s’adaptant aux éléments de la situation
(fatigue, faiblesse, troubles physiques, cognitifs…).
La juste relation à l’enfant
L’éthique consiste d’abord à penser à l’autre, ici
l’enfant, mais aussi, et peut-être encore plus, à se laisser
penser par lui : qu’il puisse nous percevoir derrière notre
fonction et notre travail de soignant. Ceci n’implique pas
un naïf et artificiel « copinage » (et surtout pas avec les
adolescents, malgré leurs demandes ou leurs incitations),
ni de dévoiler sa vie privée, ses pensées, ses émotions, ses
doutes et ses faiblesses, mais de ne pas se défendre de les
laisser transparaître, tout comme sa personnalité : rester
soi-même, sans utiliser sa fonction et sa blouse blanche
comme un écran, une muraille, un masque ou un imper-
méable. Ceci n’est pas contradictoire, loin de là, avec
l’accomplissement rigoureux des tâches professionnelles.
Il est important que l’enfant puisse se voir dans notre
regard, dans notre visage. Si nous gardons un masque
impassible, une attitude trop contrôlée, nous le laissons
face à un mur, aveugle. S’il ne voit que de l’émotion, de
la pitié ou du désarroi, son inquiétude et son propre
désarroi augmentent, il se voit comme dans un miroir
déformant, et nous ne lui apportons que du négatif.
Mais notre émotion incite à nous demander quelle en
est la cause : même si nous sommes des soignants sensi-
bles, nous ne sommes pas les parents de cet enfant. Est-ce
parce que nous nous sommes excessivement attachés à
lui (et pour quelles raisons ?), parce qu’il nous rappelle
d’autres enfants, que nous avons soignés, nos propres
enfants, les épreuves que nous avons pu connaître dans
notre enfance ?... Sans entrer dans une auto-analyse, il est
bon de se poser ces quelques questions et de voir les pen-
sées ou les souvenirs qu’elles suscitent : cela nous aide à
prendre du recul, sans perdre notre sensibilité. Est-ce
parce que nous en avons trop vu et que nous commen-
çons à être usés, provisoirement ou plus durablement ?
Cela vaut la peine de nous interroger, sans honte ni culpa-
bilité, sur notre parcours professionnel et où nous en som-
mes. Est-ce parce que nous ne sommes –ou n’avons pas
été –totalement d’accord avec les choix thérapeutiques
qui ont été faits, que cette émotion excessive exprime
notre colère, notre culpabilité, nos regrets ?... Nous pou-
vons nous poser ces questions en nous-mêmes, avec les
collègues, en réunion ou avec le « psy » du service. Cela
n’implique pas de dévoiler notre vie privée, cela
concerne notre travail. L’éthique, c’est aussi être suffisam-
ment au clair avec nous-mêmes pour que nos émotions,
notre trouble, ce que nous sommes avec nos qualités et
nos défauts, ne gênent pas trop la qualité de notre travail
et notre relation aux patients et à nos collègues.
La question de l’éthique
de la fonction soignante
La question majeure de l’éthique de la fonction soi-
gnante reste :
–« qui est-il pour moi ? », et pas qui est-il ?
–« qui suis-je pour lui ? », et pas seulement « me suis-
je bien présenté et identifié ? »
–« quelle est la nature de la relation entre nous ? »,et
pas seulement une relation soignant-soigné, aussi
« humaine », chaleureuse et attentive qu’elle peut être.
Mais également quels sont nos objectifs ? Pas seule-
ment le traiter dans les meilleures conditions possibles et
selon l’état actuel de la médecine, mais l’aider à ce qu’il
reste lui-même, qu’il garde son droit de regard et de déci-
sion sur sa vie, que la maladie et le traitement non seule-
ment ne le déstabilisent pas, mais ne lui fassent pas perdre
l’estime de lui-même, le sentiment de son identité et de sa
valeur, la confiance en lui-même, en ses parents, en nous,
en la société dont nous sommes, lui et nous, membres, et
que ici, pour lui, nous représentons.
mt pédiatrie, vol. 12, n° 6, novembre-décembre 2009
Le soignant face à l’enfant qui peut ou qui va mourir
418
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Par ailleurs, qu’est-ce qui nous permet de lui faire ce
que nous lui faisons ? Et pas seulement bien évaluer les
bénéfices et les inconvénients ou les risques du traite-
ment ? Il ne s’agit pas non plus de nous efforcer de tenir
lorsque la situation nous semble excessivement dure : il
importe de différencier volontarisme, culpabilité et senti-
ment de sa responsabilité, jamais acquis une fois pour
toute, à réévaluer sans cesse, non pour nous paralyser
mais pour avancer lucidement.
« Qui est-il pour moi ? »
Il s’agit de chercher à le connaître, au-delà des néces-
sités médicales ou infirmières, au-delà des bouleverse-
ments provoqués en lui par sa situation médicale (le
trouble qui en découle) et les divers éléments qui la
constituent (fatigue, douleur, troubles cognitifs, physi-
ques, de conscience, y compris confusion mentale) afin
de retrouver, avec lui, les éléments fondamentaux de ce
qu’il a toujours été et qu’il reste. L’une des pires détresses
est de ne pas se reconnaître et de ne pas être reconnu par
les plus proches, d’où l’importance d’être attentif à cette
phrase trop souvent entendue : « il a tellement changé, je
ne le reconnais plus ». Cet effort de le connaître ne doit
pas empêcher de respecter son opacité relative, néces-
saire, inévitable. Il est important (et l’enfant y est attentif)
de s’approcher de lui, chercher à le comprendre, et pas
uniquement sur le plan technique, lorsqu’il ne peut plus
ou plus suffisamment parler clairement (le comprendre
dans l’expression de son visage, ses attitudes, ses moin-
dres gestes, son regard), mais en étant conscient qu’il res-
tera toujours une différence, une distance, une opacité
irréductible entre lui et nous, comme entre lui et ses
parents, lui et sa fratrie, comme aussi entre eux et nous.
Les souhaits de l’enfant
Ce qui est important pour l’enfant ne l’est pas toujours
pour les parents, ou pour le soignant, et réciproquement.
Il faut se méfier de ce qui apparaît évident. Ceci peut
concerner le traitement de la douleur, des traitements
qui peuvent prolonger (un peu, significativement, pour
qui ?) la vie de l’enfant, mais au détriment de ses projets,
de ses souhaits, de l’attention que les parents doivent por-
ter à leurs propres parents malades ou à leur fils adoles-
cent en plein désarroi, à leur situation professionnelle.
Les motivations des uns et des autres peuvent apparaître
compréhensibles, raisonnables et rationnelles, ou inadé-
quates, ou encore découler de raisons de pertinence
diverses qu’il est bon de démêler avant de les accepter
ou de s’y opposer [12]. Ces raisons peuvent être conscien-
tes, ou en rapport avec des pensées inconscientes (d’où
l’intérêt que le psycho-oncologue ait aussi une formation
de psychanalyste), en rapport avec la situation actuelle de
l’enfant ou avec des situations plus anciennes (par exem-
ple la relation des parents avec leurs propres parents) [13].
Mais il est également essentiel de savoir jusqu’où aller
dans la réflexion et la discussion, tenir compte de la dis-
ponibilité de l’enfant et des parents à cette réflexion, de la
nécessité de prendre une décision.
Sa colère
De même, nous pouvons penser qu’il est préférable
que l’enfant meurt apaisé et réconcilié (avec ses parents,
nous, lui-même, la société ?), mais il peut aussi vouloir
(plus ou moins consciemment) mourir en colère. Il n’a
aucune raison d’être content de quitter cette vie qu’il
aime, à laquelle il tient. Cette colère peut correspondre
à son caractère, à ce qu’il a toujours été, à son identité
qu’il ne veut pas perdre : il veut mourir en restant lui-
même. Il se peut aussi que ni ses parents, ni ses soignants
n’ont trouvé les moyens de calmer cette colère, lorsqu’ils
pensent qu’elle le fait souffrir au lieu de lui convenir. Mais
nous devons aussi nous demander si cette colère est bien
la sienne : n’est-elle pas l’expression de celle de ses
parents, ou de l’effet artificiel des corticoïdes, d’une
confusion mentale, d’une tumeur cérébrale ? Alors notre
attitude ne serait pas la même.
Sa douleur
Il en est de même pour l’utilisation des antalgiques.
La priorité est de calmer la douleur autant que possible,
mais l’enfant ou les parents (ils peuvent également avoir
des positions différentes) peuvent préférer la possibilité de
préserver la lucidité et une relation de qualité suffisam-
ment bonne entre eux, quitte à supporter (l’enfant et les
parents, chacun à leur manière) la présence d’une cer-
taine douleur. Inversement, l’enfant peut souhaiter être
« shooté », parce que lui est insupportable l’idée de sa
mort (indépendamment de la douleur), la détresse de ses
parents, ou le constat de son état physique ou cognitif, et
qu’il ne sait comment se retirer du monde autrement.
Il peut avoir envie d’en accélérer le moment le plus pos-
sible, pour n’avoir plus à se réveiller. Pour tous ces élé-
ments, à évaluer, une aide symptomatique ou de dialogue
peut être réalisée. Des parents peuvent faire la même
demande, pour des raisons semblables, parce qu’ils ne
supportent plus la détresse muette dans ses yeux (qu’ils
associent à des reproches terrifiants) ou, au contraire,
refuser les antalgiques jugés nécessaires par le médecin
et souhaités par l’enfant pour garder encore une relation
suffisante avec lui, aussi longtemps que possible, quel
qu’en soit le prix.
Il ne s’agit pas de juger ou de hiérarchiser la valeur de
ces attitudes, qui peuvent bouger dans le temps, mais de
les repérer, d’en comprendre la logique, d’aider l’enfant et
ses parents à faire la part entre leurs bonnes raisons (celles
en accord avec la situation médicale et les autres, qui
découlent de craintes fantasmatiques, du sentiment de
ne pouvoir faire face à la situation et d’y jouer suffisam-
ment son rôle, de la réactivation de souvenirs anciens…).
Ainsi, il est possible d’aider les parents à percevoir la
mt pédiatrie, vol. 12, n° 6, novembre-décembre 2009 419
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

diversité des émotions de leur enfant sur son visage,
même lorsqu’il ne peut plus parler, à préserver la relation
avec lui, même quand sa conscience est faible, à différen-
cier rejet, dépression, révolte et besoin légitime –à accep-
ter –de se replier progressivement sur lui-même, de
rompre sans brutalité ses liens avec le monde et avec
ceux qui l’habitent (et d’abord avec ses parents).
La proximité du décès
Il en est de même de la conscience (ou du savoir) sur
la proximité ou la certitude de sa mort. Le soignant est
souvent rassuré quand l’enfant montre clairement qu’il a
compris sa situation (certains sont même tentés de lui
poser, parfois avec insistance, la question, mais cela
apparaît cruel et peu respectueux de sa position). Il faut
respecter le souhait de l’enfant de ne pas savoir, à condi-
tion, bien entendu, que « son ignorance » ne découle pas
d’un manque d’information ou de compréhension, mais
que ce soit par trouble cognitif ou réticence psycholo-
gique à savoir (dans ce cas, il peut montrer des signes
d’angoisse). Certains préfèrent savoir –parce qu’ils ont
toujours voulu savoir ou veulent prendre des décisions –,
mais parfois en préservant une marge d’incertitude. Mais
même si l’enfant dit qu’il sait, comment savoir ce que
recouvre cette parole et ce savoir. Les mots « mourir » ou
« mort » enveloppent tant d’éléments différents. Il le dit
peut-être pour rassurer, ou arrêter les questions, ou parce
qu’il croit savoir. Il est préférable de s’appuyer sur les
signes d’angoisse, d’inquiétude, de désarroi, de dépres-
sion, de détresse, de mal-être, de gêne dans la relation
(avec nous ou avec ses parents), pour essayer, avec lui et
dans le dialogue, quels qu’en soient les modalités, de
mieux comprendre où il en est et ce qu’il attend de nous.
Le dialogue est ainsi essentiel, mais particulièrement diffi-
cile. Le soignant peut être tenté de ne pas aborder les ques-
tions difficiles [14], de penser –à tort –[15] que le patient
ne souhaite pas connaître sa situation médicale [16], mais
le dialogue peut s’apprendre [17, 18].
Il est bon de se demander en quoi pourraient nous
rassurer ces réponses (« Je sais »), ou la phrase « tu peux
partir », que certains trouvent important de prononcer ?
L’enfant peut la comprendre comme une autorisation,
mais également un abandon, comme l’expression de la
tendresse de ses parents ou de leur désir d’en finir au
plus vite…Il semblerait préférable que chacun lui montre
en actes sa position.
Les parents lui disent qu’ils ne lui en veulent pas de sa
maladie et des problèmes qu’elle leur a causés, qu’ils ne
regrettent pas sa naissance, qu’ils gardent la mémoire des
moments heureux vécus ensemble, qu’ils ne l’oublieront
pas, qu’ils ne le remplaceront pas, que leur désir de cou-
ple qui fut à l’origine de sa naissance reste préservé. Sa
fratrie lui dit qu’elle ne lui en veut pas d’avoir accaparé
l’attention et le temps des parents, de les abandonner, que
sa place parmi eux restera préservée : s’il est l’aîné, il le
restera. Ses soignants lui disent qu’ils ne lui en veulent pas
des colères, des oppositions qu’il a pu montrer, qu’ils
s’occuperont de lui jusqu’au bout, qu’ils ne l’oublieront
pas, lui et les qualités qu’il a montrées tout au long du
traitement. Chacun le dit, le montre, avec sa personnalité
propre et la relation spécifique tissée avec lui.
Ainsi, chacun, de sa position spécifique, continue à
reconnaître l’enfant, malgré les transformations physi-
ques, cognitives, psychiques que la maladie a pu induire,
et reste reconnaissable (pas interchangeable, pas ano-
nyme, pas réduit à sa fonction) aux yeux de l’enfant.
Les soignants comme les parents doivent trouver le juste
équilibre entre le sentiment d’avoir fait, depuis le début,
ce qu’ils devaient faire, et le doute quant à leurs inévita-
bles insuffisances. Ils peuvent alors accepter les éventuels
reproches, formulés ou tacites, de l’enfant ou d’eux-
mêmes. Ces reproches peuvent porter sur les aspects
strictement médicaux ou relationnels : avons-nous tou-
jours été attentifs à ses demandes, ses craintes et ses
doutes, ses discrets signes de détresse ? L’enfant est parfois
bien plus tolérant avec les insuffisances des adultes
(lorsqu’elles sont de bonne foi, non égoïstes) que les
adultes eux-mêmes. Il importe de distinguer le sentiment
de culpabilité (troublant négativement) du sentiment de
responsabilité (poussant à la lucidité et à l’acquis de
l’expérience).
Conclusion
Il est bon de se poser ces questions, sans excès, de
savoir qu’elles existent et que les réponses ne peuvent
être en oui ou non. Ceci aide à la pratique clinique quo-
tidienne autant qu’à définir les décisions des soins, mais
aussi à mieux se situer par rapport à la question « que
nous lui voulons-nous ? », et pas seulement « que
voulons-nous pour lui ? ». Quelle idée nous faisons-nous
de ce qui serait bien pour lui, suivant quel idéal ou quel-
les images ? Nous sommes inévitablement influencés par
notre histoire, par ce qui circule dans notre société [19],
ce que nous avons perçu de ce qui serait bien pour lui,
même si l’enfant ne l’exprime pas clairement (mais en
revanche il repère bien ce qui n’y correspond pas lorsqu’il
le subit). De même, nous pouvons nous demander si ce
que nous faisons est d’abord dans son intérêt ou dans le
nôtre, ce qui n’est pas forcément condamnable, ni contra-
dictoire. Ainsi, proposer un essai de phase I-II signifie
donner une chance supplémentaire à un enfant auquel
les autres traitements ne peuvent plus rien apporter, mais
c’est aussi pour le médecin vérifier une hypothèse,
espérer une publication dans un journal prestigieux,
contribuer à définir et mettre en œuvre de nouveaux
traitements. Les points de vue du patient et du médecin
peuvent être différents sans être contradictoires [20].
mt pédiatrie, vol. 12, n° 6, novembre-décembre 2009
Le soignant face à l’enfant qui peut ou qui va mourir
420
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.
 6
6
1
/
6
100%