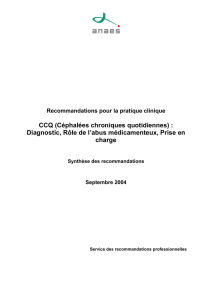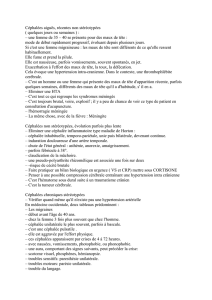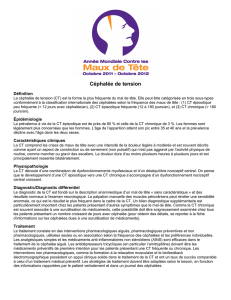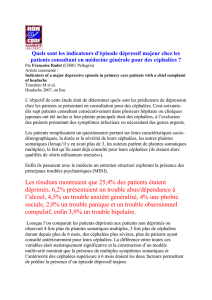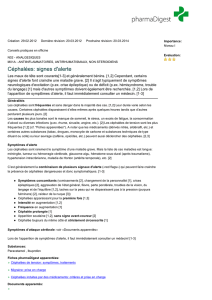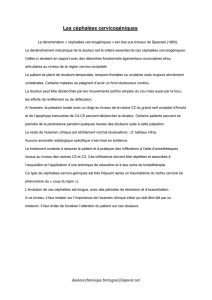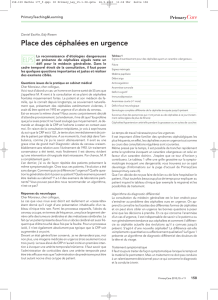Les céphalées aux urgences

Urgences
Les céphalées aux urgences
Dominique Valade
Hôpital Lariboisière, Centre d’urgence des céphalées, Paris
La prise en charge des céphalées aux urgences nécessite un interrogatoire extrêmement
rigoureux qui pourrait être suffisant lorsqu’il s’agit d’une céphalée primaire et qui permettra
d’orienter vers des examens complémentaires dès lors que l’on suspectera une céphalée
secondaire. Les causes les plus fréquentes de venue aux urgences sont la maladie migraineuse
suivie des céphalées dites de tension puis des céphalées secondaires bénignes (syndrome
grippal) et enfin des affections graves nécessitant des explorations et un traitement en urgence.
Devant toute céphalée récente, inhabituelle et persistante à début brutal ou progressif, deux
examens de base vont être réalisés de manière systématique : le scanner cérébral sans injection
et la ponction lombaire. En cas de nécessité, et suivant l’orientation de l’examen clinique, ils
pourront être complétés par un écho-Doppler cervical et transcrânien voire par une imagerie
à résonance magnétique et beaucoup plus exceptionnellement une angiographie cérébrale.
Les céphalées se répartissent en quatre grandes catégories : céphalées récentes à début brutal
(hémorragies sous-arachnoïdiennes, céphalées en coup de tonnerre, céphalées lors des
hématomes ou infarctus cérébraux, dissections artérielles, encéphalopathies hypertensives,
hypotension du LCR, hydrocéphalies aiguës et tumeurs intraventriculaires). Céphalées récen-
tes installées en quelques heures ou jours (hypertensions intracrâniennes, méningites et
méningo-encéphalites, artérites temporales, infections ophtalmologiques et ORL). Céphalées
primaires qui se divisent en deux grands types : céphalées paroxystiques, caractérisées par des
crises plus ou moins longues entrecoupées de périodes où le sujet est parfaitement bien
(migraines, algies vasculaires de la face, céphalées de tension) et les céphalées chroniques
quotidiennes dans lesquelles la douleur est continue durant des semaines.
Mots clés :urgence, migraine, céphalées secondaires, interrogatoire
Symptôme très fréquent, la cépha-
lée peut avoir des causes extrême-
ment variables [1]
dont les céphalées
primaires, sans lésion sous-jacente,
sont les plus fréquentes. Elles regrou-
pent principalement les migraines,
les céphalées dites de tension, les
algies vasculaires de la face et les
névralgies faciales idiopathiques.
Elles sont prises en charge en consul-
tation, le plus souvent en ville, et ne
nécessitent ni examen complé-
mentaire, ni hospitalisation dans
l’immense majorité des cas. Les
céphalées secondaires sont moins
fréquentes mais ont des causes beau-
coup plus variées dont certaines sont
potentiellement très graves. Dans les
services d’urgence [2, 3]
, l’objectif
prioritaire étant d’établir un diagnostic
étiologique précis et de trancher entre
une céphalée primaire, une céphalée
secondaire bénigne (syndrome grip-
pal) et une céphalée secondaire due à
une affection grave nécessitant des
explorations et un traitement en
urgence (hémorragie méningée,
méningite, hypertension intracrâ-
nienne, tumeur) [4, 5]. L’étape cru-
ciale dans cette démarche diagnosti-
que est l’interrogatoire. Ce dernier,
complété par l’examen clinique, va
déterminer la prise en charge : traite-
ment antalgique puis orientation vers
une consultation externe pour les
patients atteints de céphalées primai-
res ; explorations si nécessaire puis
traitement symptomatique en externe
des céphalées secondaires bénignes,
et enfin explorations complémentai-
res en urgence puis traitement étiolo-
gique en hospitalisation pour les
patients atteints de céphalées secon-
daires graves.
m
t
Tirésàpart:D.Valade
mt, vol. 11, n° 6, novembre-décembre 2005
412
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

L’interrogatoire d’un patient
céphalalgique
Il est la base de la démarche diagnostique et peut être
difficile chez les sujets qui souffrent de maux de tête
intenses. Il s’attache à préciser le mode d’installation, les
caractéristiques de la douleur, les circonstances d’appari-
tion et les signes associés.
Mode d’installation et profil évolutif
Les questions qui vont conditionner la démarche dia-
gnostique sont les suivantes :
–comment a débuté la céphalée ? (début brutal ou
progressif) ;
–depuis quand ? (céphalées aiguës ou chroniques) ;
–avez-vous déjà eu ce type de mal de tête ? (céphalée
inhabituelle ou nouvelle crise chez un céphalalgique
connu) ;
–évolution de la douleur depuis son installation ?
(amélioration spontanée, aggravation ou stabilité) ;
Selon la réponse à ces questions, les céphalées sont
classées en quatre types :
–les céphalées récentes inhabituelles à début brutal ;
–les céphalées récentes inhabituelles à début progres-
sif sur quelques heures, jours ou semaines ;
–les céphalées chroniques paroxystiques (migraine,
algie vasculaire de la face, névralgie faciale) ;
–les céphalées chroniques quotidiennes.
Les deux derniers types correspondent essentiellement
à des céphalées primaires. L’argument principal pour
entreprendre des explorations est le caractère récent de la
céphalée, d’installation rapide ou brusque, qu’elle sur-
vienne de novo ou chez un sujet ayant un passé de
céphalées primaires (migraines ou céphalées de tension)
mais immédiatement reconnues par le patient comme
complètement différentes de ses céphalées habituelles.
Caractéristiques de la douleur
L’intensité de la douleur ne permet en aucun cas de
trancher entre céphalée primaire et secondaire. Néan-
moins toute céphalée à la fois soudaine et sévère (« cépha-
lée en coup de tonnerre ») doit être considérée comme
secondaire et explorée en urgence. Il est important d’ana-
lyser la concordance entre l’intensité alléguée par le
patient et le retentissement sur son attitude (patient pros-
tré, ayant du mal à s’exprimer...). Le type de la douleur est
très variable (pulsatile, continu, décharge électrique,
broiement, pression, simple gène...) mais n’est pas spéci-
fique d’une étiologie particulière. La topographie consti-
tue parfois un élément d’orientation (douleur temporale
de la maladie de Horton) mais n’est pas spécifique d’une
cause particulière.
Circonstances d’apparition
Elles peuvent parfois orienter immédiatement le dia-
gnostic : traumatisme crânien (hémorragie ou contusion
cérébrale), prise de toxique, ponction lombaire, péridu-
rale ou rachianesthésie récentes (céphalées par hypoten-
sion du liquide céphalorachidien), maladie générale
fébrile, etc.
Mais les circonstances d’apparition peuvent égale-
ment être trompeuses : une céphalée d’effort ou une
céphalée coïtale peut être bénigne mais aussi révéler une
hémorragie méningée, une céphalée après ponction lom-
baire est le plus souvent une céphalée par hypotension du
LCS mais peut parfois révéler une thrombose veineuse
cérébrale [6].
Antécédents
Certains antécédents doivent être recherchés de
manière systématique car ils conditionnent la démarche
diagnostique : affections cardiovasculaires et HTA (AVC),
post-partum ou thrombose veineuse des membres infé-
rieurs (thrombose veineuse cérébrale), néoplasie (métas-
tases), infection par le VIH (toxoplasmose cérébrale),
anxiété et dépression (décompensation avec céphalées de
tension), consommation de toxiques et de psychotropes.
Symptômes associés
Toute céphalée récente et inhabituelle associée à un
symptôme neurologique (trouble de la conscience, crise
d’épilepsie ou signe focal) doit être considérée comme
due à une lésion intracrânienne jusqu’à preuve du
contraire. Une céphalée avec altération de l’état général
ou claudication intermittente de la mâchoire chez un sujet
de plus de 60 ans doit faire évoquer immédiatement une
maladie de Horton. En revanche, nausées, vomissement,
photophobie et phonophobie sont des symptômes non
spécifiques rencontrés aussi bien dans les syndromes
méningés que dans l’hypertension intracrânienne, sans
parler de la migraine. L’absence de tout symptôme associé
n’élimine en aucun cas une céphalée secondaire et ne doit
pas différer la réalisation d’examens complémentaires si la
céphalée est récente, inhabituelle et persistante.
Examen clinique
En plus de l’examen général avec mesure de la pres-
sion artérielle et prise de la température, il comportera un
examen neurologique et un examen locorégional. Toute
anomalie à l’examen neurologique ou locorégional
impose la réalisation d’examens complémentaires. En
revanche, un examen clinique strictement normal n’éli-
mine pas une cause grave et ne doit pas empêcher la
réalisation d’examens complémentaires.
Examen neurologique
En premier lieu, il apprécie l’état de conscience et
recherche un syndrome méningé. Ensuite, il recherche un
mt, vol. 11, n° 6, novembre-décembre 2005 413
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

déficit focal que l’interrogatoire aurait pu manquer : exa-
men des paupières et des pupilles (signe de Claude-
Bernard-Horner lors d’une dissection de l’artère carotide
interne ; mydriase unilatérale par compression du III par
un anévrysme de l’artère communicante postérieure),
recherche d’un syndrome cérébelleux (une ataxie cérébel-
leuse statique peut passer inaperçue chez un patient
allongé, très céphalalgique, qui vomit) et d’anomalies du
champ visuel (hémianopsie latérale homonyme gauche
d’une lésion occipitale droite chez un patient droitier qui
ne se plaint que de céphalées). Enfin, il comporte un
examen du fond d’œil à la recherche essentiellement d’un
œdème papillaire bilatéral témoignant d’une hyperten-
sion intracrânienne ou d’une rétinopathie hypertensive
pouvant orienter vers une encéphalopathie hypertensive.
Examen locorégional
Il comportera la palpation des artères temporales, la
pression des sinus, la recherche d’une rougeur oculaire,
d’une exophtalmie ou d’un gonflement des paupières, la
palpation des globes oculaires et l’auscultation qui peut
révéler un souffle. Il est également important de palper les
muscles cervicaux qui sont très souvent contractés et
douloureux lors d’une céphalée de tension exacerbée.
Stratégie des examens
complémentaires
Les examens sanguins habituels sont rarement sugges-
tifs, sauf une augmentation de la VS et de la CRP qui
oriente soit vers une artérite temporale chez un sujet âgé
de plus de 60 ans, soit vers un état infectieux.
Devant toute céphalée récente, inhabituelle et persis-
tante, à début brutal ou progressif, deux examens de base
devront être réalisés de manière systématique : le scanner
cérébral sans injection et la ponction lombaire [5].
Scanner cérébral
Premier examen à effectuer à la recherche d’une
hyperdensité spontanée témoignant de la présence de
sang soit dans les espaces sous-arachnoïdiens, soit dans le
parenchyme cérébral ou cérébelleux. Il peut aussi montrer
une hydrocéphalie, un effet de masse ou un œdème
localisé témoignant d’une lésion expansive (tumeur ou
abcès) et devra alors être complété ultérieurement par un
scanner avec injection ou une IRM [7]. S’il existe des
éléments d’orientation vers une sinusite aiguë, des coupes
sur les sinus peuvent être utiles. Un scanner cérébral
normal n’écarte pas une cause lésionnelle : ainsi5à10%
des hémorragies méningées, 30 % des thromboses vei-
neuses cérébrales, la quasi-totalité des dissections des
artères cervicales au stade céphalée avec seulement des
signes locaux, et la quasi-totalité des méningites, ont un
scanner normal d’où la nécessité de poursuivre les inves-
tigations.
Ponction lombaire (PL)
Elle doit être effectuée après le scanner devant toute
céphalée récente et inhabituelle, brutale ou progressive, à
scanner normal, à la recherche de sang ou d’une ménin-
gite, même en l’absence de syndrome méningé. À titre
exceptionnel, elle peut être pratiquée en première inten-
tion devant un syndrome méningé fébrile en l’absence de
troubles de la conscience ou de signes neurologiques
focaux, ou en cas de suspicion d’hémorragie méningée si
l’hôpital ne dispose pas de scanner ou si celui-ci est en
panne après réalisation d’un fond d’œil. Les deux princi-
pales contre-indications à la PL sont les troubles de
l’hémostase sévères et l’hypertension intracrânienne avec
menace d’engagement (lésions expansives hémisphéri-
ques ou cérébelleuses avec effet de masse sur le système
ventriculaire). Elle doit être effectuée préférentiellement
par un opérateur expérimenté afin d’éviter une ponction
traumatique.
Chez les patients ayant une céphalée inhabituelle
d’apparition brutale ou progressive, lorsque le scanner est
strictement normal, il n’y a pas de risque à faire une PL et
il est alors essentiel de mesurer la pression du LCS qui doit
être inférieure à 20 cm d’eau (patient en décubitus latéral,
en branchant sur l’aiguille un manomètre ou une tubulure
tenue verticalement, avant toute soustraction de LCS).
Une hypertension intracrânienne (pression du
LCS > 20 cm d’eau) avec scanner normal impose la réali-
sation d’une IRM avec angio-IRM (ARM) à la recherche
d’une thrombose veineuse cérébrale ou d’une fistule
durale.
Écho-Doppler cervical et transcranien
Cet examen doit être pratiqué en urgence chaque fois
que le tableau clinique oriente vers une dissection des
artères carotides ou vertébrales. Les dissections peuvent se
manifester par une céphalée unilatérale aiguë, parfois
isolée, mais le plus souvent associée à des signes locaux
(Claude-Bernard-Horner douloureux, acouphènes, para-
lysie des derniers nerfs crâniens) ou à des signes d’isché-
mie rétinienne ou cérébrale. L’échographie peut visualiser
l’hématome dans la paroi artérielle dont le Doppler évalue
le retentissement hémodynamique éventuel. Ces deux
examens peuvent cependant être strictement normaux
notamment dans les formes purement céphalalgiques soit
lorsque la dissection siège sur la portion intracrânienne
des artères à destinée cérébrale, soit lorsqu’elle n’entraîne
pas de sténose artérielle significative (dissection sous-
adventicielle). Les explorations doivent alors être complé-
tées par une IRM avec ARM.
Imagerie par résonance magnétique
L’IRM est le moyen diagnostique de choix des throm-
boses veineuses cérébrales qui peuvent se manifester par
une céphalée aiguë isolée avec scanner et ponction lom-
baire normaux. Le thrombus veineux est visualisé directe-
Urgences
mt, vol. 11, n° 6, novembre-décembre 2005
414
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

ment sous la forme d’un hypersignal sur les séquences T1
et T2, net à partir du 5
e
jour et persistant jusqu’au 30
e
.
Avant le 5
e
jour, le thrombus peut encore apparaître en
hyposignal ou en isosignal difficile à déceler. Il faut alors
compléter les examens par une angiographie (soit une
angiographie par résonance magnétique ARM, soit un
angioscanner, soit une angiographie conventionnelle
intra-artérielle).
L’IRM est un examen fondamental dans le diagnostic
de dissection artérielle. L’hématome de paroi est visualisé
sous la forme d’un croissant en hypersignal au contact de
l’artère disséquée sur les coupes axiales au niveau cervical
ou intracrânien. Cet aspect caractéristique n’est cepen-
dant bien visible que sur les séquences T1 avec saturation
de graisse et seulement quelques jours après la survenue
de la dissection.
L’IRM peut encore déceler une lésion de la fosse
postérieure ou de l’hypophyse (nécrose ou hémorragie)
non visible au scanner ou montrer, après injection de
gadolinium, une prise de contraste diffuse des méninges
orientant, selon la symptomatologie, soit vers une pachy-
méningite infectieuse ou carcinomateuse (céphalées pro-
gressives permanentes), soit vers une hypotension du LCR
(céphalées orthostatisques).
Angiographie cérébrale
Elle n’est indiquée en cas de céphalées aiguës que
dans deux éventualités :
–les hémorragies méningées dans lesquelles l’angio-
graphie doit être pratiquée par voie intra-artérielle à la
recherche d’un anévrisme rompu avant son traitement
chirurgical ou endovasculaire ;
–les céphalées brutales sévères non régressives lors-
que tous les examens précédents sont normaux, ce qui ne
permet d’exclure formellement ni une thrombose vei-
neuse cérébrale, ni une dissection artérielle, ni certaines
angiopathies des artères de moyen calibre. Une ARM ou
un angioscanner peuvent alors être effectués en première
intention, complétés éventuellement par une angiogra-
phie intra-artérielle. Ce dernier examen est souvent le seul
à pouvoir montrer clairement les irrégularités de calibre en
« chapelets » d’une angiopathie cérébrale aiguë réversi-
ble qui peut se manifester par un ou plusieurs épisodes de
céphalées en coup de tonnerre, avec scanner, PL et IRM
normaux, voire d’une artérite dans laquelle la céphalée est
cependant rarement isolée.
Les principales étiologies
Les études épidémiologiques sur les céphalées dans les
services d’urgences sont rares [8]. Globalement, la fré-
quence des céphalées comme motif d’admission dans un
service d’urgence polyvalent de l’adulte se situe entre 1 et
2 %. Les patients sont en majorité des femmes et leur âge
moyen est voisin de 35-40 ans. La plus grande partie des
patients vient pour des céphalées secondaires à des causes
bénignes, en particulier des infections extraneurologiques
(infections respiratoires, syndromes grippaux). De 5 à
15 % des patients ont une pathologie neurologique grave
(hémorragies méningées : environ 3 %). Parmi les cépha-
lées primaires, les céphalées dites de tension sont au
moins aussi fréquentes que les migraines.
Céphalées récentes à début brutal
Hémorragie sous-arachnoïdienne
Elle est le premier diagnostic à envisager devant toute
céphalée inhabituelle à début brutal [9]. La céphalée peut
être totalement isolée, sans syndrome méningé (qui peut
être retardé de plusieurs heures) ni troubles de la cons-
cience (dont l’apparition dépend de l’abondance de
l’hémorragie). Le diagnostic positif repose sur la réalisa-
tion en urgence d’un scanner cérébral sans injection et,
dans tous les cas où celui-ci est normal, d’une ponction
lombaire avec recherche de pigments biliaires [10]. La
probabilité de détecter une hémorragie méningée avérée
au scanner décroît graduellement de plus de 90 % dans
les 24 premières heures à 50 % après la première semaine
et presque à 0 % après la troisième semaine. L’IRM céré-
brale n’est pas actuellement un examen de première inten-
tion dans le diagnostic de l’hémorragie méningée et ceci
principalement pour des raisons d’accessibilité. Pourtant,
les séquences T2 en écho de gradient et les séquences
Flair sont plus sensibles que le scanner pour détecter une
hémorragie méningée, que ce soit à la phase aiguë ou
après deux ou trois semaines [11, 12]. La PL reste indis-
pensable en cas de scanner normal et le diagnostic
d’hémorragie méningée repose sur la présence de sang et
surtout de pigments biliaires dans le LCR. La classique
épreuve des trois tubes pour différencier hémorragie
méningée et ponction traumatique est beaucoup moins
fiable que la recherche de pigments produits par la dégra-
dation de l’hémoglobine. Ces pigments sont responsables
de l’aspect xanthochromique du surnageant visible à l’œil
nu ou après centrifugation du LCR. En cas de surnageant
d’aspect clair, une spectrophotométrie ou un dosage des
pigments est indiqué. La xanthochromie est constante
après 12 heures de présence de sang dans le LCR et reste
détectable pendant deux semaines dans 100 % des
hémorragies méningées. Si la ponction est effectuée pré-
cocement, les pigments peuvent être absents. Si cette
recherche est négative, une deuxième ponction sera faite
après 12 heures. Une fois le diagnostic établi, le patient
doit être transféré en neurochirurgie sans délai.
Céphalées en coup de tonnerre
Ce sont des céphalées généralement sévères d’appari-
tion très brutale, comme « une explosion dans la tête », de
durée variable [13]. Le premier diagnostic à évoquer est
celui d’une hémorragie sous-arachnoïdienne et toute
céphalée en coup de tonnerre implique la réalisation en
mt, vol. 11, n° 6, novembre-décembre 2005 415
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

urgence d’un scanner puis d’une PL. De nombreuses
autres pathologies peuvent se révéler par une céphalée en
coup de tonnerre : dissection artérielle, thrombose vei-
neuse cérébrale, nécrose hypophysaire, anévrisme non
rompu (50 % des patients victimes d’une hémorragie
méningée par rupture d’anévrisme décrivent, lors des
jours ou mois qui précèdent, une céphalée sentinelle à
type de céphalée en coup de tonnerre), hypotension du
LCR, méningite, ou encore angiopathie cérébrale aiguë
idiopathique ou secondaire [14-16]. L’exploration d’une
céphalée en coup de tonnerre doit donc être complétée en
hospitalisation par la pratique d’une IRM cérébrale
(thrombose veineuse, hypophyse), avec injection de pro-
duit de contraste si la céphalée après son apparition
explosive prend un caractère postural (hypotension du
LCR) et avec coupes cervicales axiales (dissection). Un
écho-Doppler cervical recherche une dissection des artè-
res cervicales. Une angiographie doit être systématique-
ment pratiquée tout d’abord de manière non invasive (par
ARM ou angioscanner) à la recherche d’un anévrisme non
rompu, mais aussi d’arguments en faveur d’une dissection
ou d’une thrombose veineuse à la phase très précoce.
Dans les rares cas où tous les examens précédents sont
normaux et a fortiori si la céphalée persiste, une artério-
graphie intra-artérielle conventionnelle est nécessaire à la
recherche d’une dissection vertébrale ou d’une angiopa-
thie cérébrale aiguë.
Céphalées lors des hématomes et infarctus cérébraux
Les céphalées sont fréquentes lors des hématomes et
des infarctus cérébraux mais sont le plus souvent au
second plan du tableau clinique dominé par les signes
neurologiques focaux et parfois les troubles de cons-
cience. Cependant, certaines topographies peuvent don-
ner des signes focaux discrets. Ainsi, les hématomes et les
infarctus œdémateux du cervelet peuvent se manifester
par une céphalée aiguë intense avec vomissements abon-
dants, sans syndrome cérébelleux très net. Le diagnostic
repose sur la pratique du scanner cérébral en urgence qui
permettra de reconnaître aisément l’hyperdensité d’un
hématome mais plus difficilement l’ischémie qui peut ne
se manifester au début que par une compression du 4
e
ventricule. Ces patients doivent être transférés en neuro-
chirurgie.
Dissections artérielles
La céphalée est de loin le symptôme le plus fréquent de
dissection (75 % des cas) et comporte souvent une com-
posante cervicale (douleur latérocervicale des dissections
carotidiennes, douleur rétro-auriculaire des dissections
vertébrales). Elle est souvent associée à d’autres signes
locaux déjà mentionnés. Elle constitue le symptôme inau-
gural dans 33 à 86 % des cas avant l’apparition éventuelle
de signes d’ischémie rétinienne ou cérébrale. Le diagnos-
tic repose sur l’écho-Doppler cervical complété par l’IRM
avec ARM. L’angiographie par voie artérielle reste souvent
nécessaire au diagnostic des dissections vertébrales.
Encéphalopathie hypertensive
Elle est responsable d’une céphalée aiguë brutale ou
rapidement progressive avec élévation majeure de la pres-
sion artérielle (plus de 240/120 mmHg). La céphalée peut
précéder les autres signes d’encéphalopathie : troubles
visuels bilatéraux et crises comitiales. Le fond d’œil mon-
trant des signes de rétinopathie hypertensive est l’examen-
clé, mais le diagnostic différentiel avec un œdème papil-
laire de stase peut être difficile. Le traitement consiste à
faire baisser la pression artérielle.
Hypotension du LCR
Les hypotensions du LCR iatrogènes sont souvent
d’apparition rapide voire brutale dans les heures qui sui-
vent le geste en cause. Les céphalées par hypotension du
LCR secondaires à une brèche durale iatrogène (ponction
lombaire, péridurale, rachianesthésie, infiltration) appa-
raissent de manière brusque ou rapide, le plus souvent
quelques heures après le geste. Si le patient consulte en
urgence en rapportant clairement la réalisation d’un tel
geste dans les jours qui précèdent, ces céphalées ne
posent pas de problème diagnostique. Ceci les oppose aux
formes spontanées qui demeurent souvent méconnues
[17]. Leur installation est le plus souvent progressive sur
quelques jours, mais peut également être rapide et même
explosive, notamment après un effort. Qu’il s’agisse d’une
forme iatrogène ou spontanée, le diagnostic est évoqué
devant une céphalée posturale, qui apparaît dès la mise en
position debout ou assise, et disparaît très rapidement en
décubitus [18]. La céphalée peut s’associer à d’autres
manifestations : cervicalgies, acouphènes, baisse d’acuité
auditive, nausées, vomissements, diplopie horizontale par
paralysie d’un ou des deux VI. En cas de survenue spon-
tanée de ce syndrome, le diagnostic clinique sera
confirmé par l’IRM cérébrale qui montre un réhaussement
intense des méninges après injection de produit de
contraste, un déplacement craniocaudal des structures
nerveuses (descente des amygdales cérébelleuses dans le
trou occipital) et parfois un aspect collabé des ventricules.
L’hypotension du LCS peut parfois se compliquer d’un
hématome sous-dural qui peut aggraver les céphalées et
leur faire perdre leur caractère strictement postural. Le
traitement consiste en la réalisation d’un blood-patch,
qu’il s’agisse d’une hypotension du LCS iatrogène ou
spontanée. Ce geste sera réalisé au mieux lors d’une
courte hospitalisation de type hôpital de jour. L’opérateur
injecte du sang (prélevé stérilement au patient) jusqu’à
provoquer une douleur lombaire franche (le plus souvent
autour de 30 ml) en péridural au niveau lombaire. Le
patient doit ensuite rester allongé 2 heures puis peut se
mettre debout. En cas d’échec, un second blood-patch est
proposé. Dans les formes spontanées, une recherche de
brèche sera entreprise en hospitalisation après échec de
Urgences
mt, vol. 11, n° 6, novembre-décembre 2005
416
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%