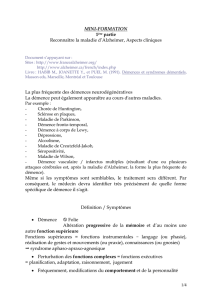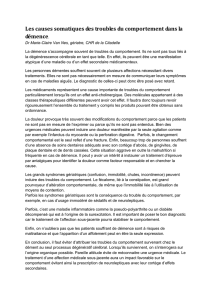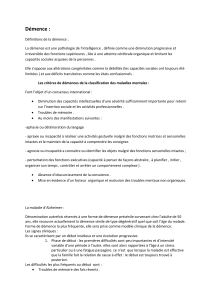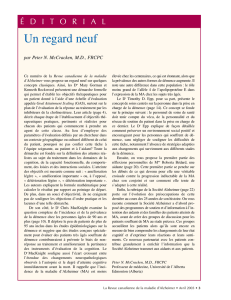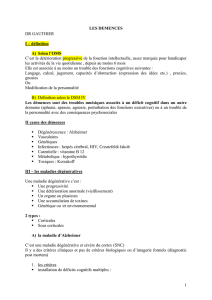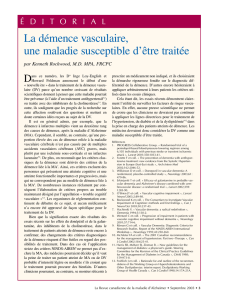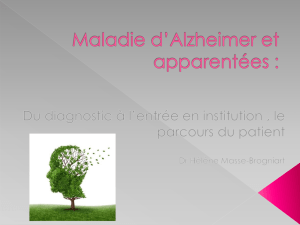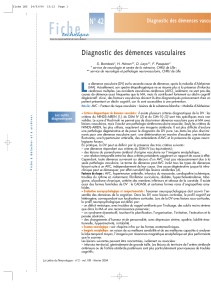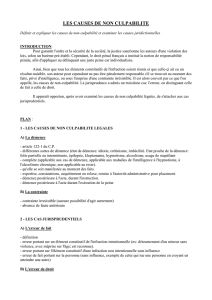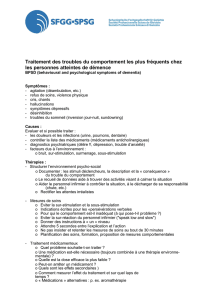demence vasculaire - Psychologie

Revue thématique
La démence vasculaire :
un cadre incertain
CHRISTIAN DEROUESNÉ
Université Paris VI,
Faculté de médecine
Pitié-Salpêtrière, Paris
Tirésàpart:
C. Derouesné
Résumé. La démence vasculaire n’est pas une affection définie, mais un concept qui réunit
des manifestations extrêmement hétérogènes aux plans clinique, neuropathologique, phy-
siopathologique et étiologique. L’absence de définition neuropathologique et l’existence,
dans la grande majorité des cas, de lésions dégénératives associées, en particulier de type
Alzheimer, l’hétérogénéité même du concept expliquent que le diagnostic clinique demeure
très incertain en dépit des divers critères de diagnostic qui ont été proposés. La notion de
vascular cognitive impairment apporte une certaine clarification et surtout attire l’attention
sur des déficits cognitifs légers dont la prise en charge peut éviter l’évolution vers une
démence. L’essentiel, au plan pratique, est de reconnaître et prendre en charge les facteurs
de risque vasculaire accessibles à la thérapeutique, qu’ils soient isolés ou associés à des
lésions dégénératives dont les lésions vasculaires aggravent les conséquences.
Mots clés : démence vasculaire, vascular cognitive impairment, microangiopathie, lésion
de la substance blanche, lacune, lipohyalinose
Abstract. Vascular dementia is not a disease or even a clearly defined disorder. It is a
construct, which brings together very heterogenous disturbancies at the clinical, pathologi-
cal and etiological levels. Due to the absence of neuropathologic diagnostic criteria, the
frequency of associated degenerative pathology (mainly of Alzheimer type), and the hete-
rogenity of the construct, its clinical diagnosis remains questionable using various diagnos-
tic criteria. The concept of vascular cognitive impairment (VCI) has been proposed as a
substitute for vascular dementia to provide some clarification about the relationship
between ischemic brain lesions and cognitive dysfunction. Its main interest is to allow
diagnosis and treatment of minor cognitive deficits associated with ischemic brain lesions
before the occurrence of dementia. Clinical and neuropsychological manifestations of VCI
are of fronto-subcortical type, quite distinct from those of Alzheimer’s disease. From a
practical point of view, the main point is to find out and to treat the vascular risk factors
which cause cognitive deficits by themselves or increase those associated with Alzheimer’s
disease.
Key words:vascular dementia, vascular cognitive impairment, white matter lesion,
lacunae, lipohyalinose, microangiopathy
Dans un livre consacré à la démence vasculaire
en 1996, les éditeurs titraient leur introduc-
tion : « The dubious disease ». Dans l’article
suivant, Bowler et Hachinski [1] écrivaient que, depuis
son isolement à la fin du XIX
e
siècle, la démence vascu-
laire n’a cessé d’être « une source de confusion et de
débats, plutôt que de clarté ». Les controverses à son
propos sont toujours d’actualité. La raison essentielle
en est que, à la différence des autres affections respon-
sables de démence qui sont définies par la présence
soit de lésions histopathologiques spécifiques (plaques
séniles, dégénérescences neurofibrillaires, corps de
Pick ou de Lewy), soit par une topographie particulière
des lésions cérébrales (démences frontotemporales), la
démence vasculaire n’a pas de définition neuropatho-
logique claire. C’est un concept ou, si l’on veut, une
construction de l’esprit (construct) qui englobe des
tableaux cliniques, des lésions cérébrales, des méca-
nismes physiopathologiques et des étiologies multi-
ples. Il en résulte une profonde confusion que reflètent
les innombrables études qui lui ont été consacrées.
Naissance et évolution du concept
Au XIX
e
siècle, lorsque la démence est isolée
comme syndrome clinique, on lui reconnaît deux étio-
logies : la paralysie générale, chez les sujets âgés de
moins de 50 ans et la démence sénile, après 60 ou
70 ans. En 1891, Klippel isole de la paralysie générale
un tableau neuropathologique caractérisé par des alté-
rations diffuses du parenchyme cérébral (pseudo-
paralysie générale des arthritiques) [2]. Quelques
années plus tard, Binswanger fait le lien entre démence
et lésions artérioscléreuses des artères cérébrales, la
démence artériopathique est née. Il en isole une forme
Psychol NeuroPsychiatr Vieil 2005;3(2):89-96
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 3, n° 2, juin 2005 89

particulière, définie par l’importance des lésions de la
substance blanche sous-corticale, à laquelle Alzheimer
donnera le nom de maladie de Binswanger. La
démence sénile, de son côté, était considérée à cette
époque comme le résultat d’un défaut d’apport san-
guin au cerveau du fait de l’artériosclérose des artères
cérébrales. La séparation, au plan neuropathologique,
entre démences dégénératives (maladie d’Alzheimer,
maladie de Pick, démence sénile « pure ») et démence
artériopathique (sénile et présénile) apparaît au début
du XX
e
siècle. La démence artériopathique est rappor-
tée à un défaut d’apport sanguin au cerveau du fait des
lésions artérielles : c’est le concept hémodynamique
d’insuffisance circulatoire chronique qui dominera la
pensée médicale jusqu’aux années 1960.
Dans les années 1960 plusieurs éléments vont
conduire à rejeter cette explication :
1) la théorie hémodynamique des accidents ischémi-
ques cérébraux est rejetée au profit de la théorie
thromboembolique : la pratique courante de l’artério-
graphie cérébrale et les travaux neuropathologiques
montrent que les infarctus cérébraux sont dus à l’occlu-
sion de l’artère qui irrigue le territoire lésé soit par une
lésion locale (thrombose) soit par une embolie partie
du cœur ou d’une artère en amont. Ce rejet de la théo-
rie hémodynamique sera conforté par les études du
débit sanguin cérébral en PET-scan qui conduisent à
mettre en doute l’existence de l’ischémie cérébrale
chronique ;
2) dans le cadre de la démence vasculaire, les travaux
neuropathologiques de Tomlinson et al. [3] ont mis en
évidence l’importance des destructions du paren-
chyme, ce qui a conduit au remplacement des termes
de démence artériopathique ou de démence vasculaire
par celui de démence par infarctus multiples [4] ;
3) en 1980, le DSM-III a fixé des critères pour le dia-
gnostic de démence et opposé deux types de
démence : « la démence dégénérative primaire » et « la
démence par infarctus multiples ».
À partir des années 1980, deux éléments nouveaux
vont relancer la discussion sur la nature de la démence
vasculaire et ses rapports avec les lésions dégénérati-
ves :
1) le renouveau d’intérêt porté à la maladie d’Alzhei-
mer, du fait de l’élévation de sa fréquence chez les
sujets âgés et de la naissance de perspectives théra-
peutiques ;
2) le développement de l’imagerie cérébrale qui allait
révéler la fréquence des anomalies de type vasculaire
chez les sujets âgés présentant ou non une démence.
Dès lors, la discussion de la responsabilité respec-
tive des lésions vasculaires et des lésions dégénérati-
ves dans le déterminisme des démences du sujet âgé
n’a cessé d’être une source de controverses opposant les
tenants d’une sous-estimation de la démence vasculaire
à ceux qui, à l’inverse, soulignent la rareté des démences
imputables aux lésions vasculaires pures [5]
.
L’incertitude
de la neuropathologie
Il n’existe pas de neuropathologie caractérisée des
démences vasculaires. Une démence, concept clinique,
peut être associée à des lésions vasculaires cérébrales
très variées [6].
Schématiquement on peut distinguer les lésions
artérielles, les lésions parenchymateuses et les lésions
de la substance blanche.
Lésions artérielles
Les occlusions des gros troncs artériels résultent
soit de lésions primitives de ces artères, très habituelle-
ment dues à l’athérosclérose, soit d’embolies d’origine
artérielle (à partir de lésions athéroscléreuses d’artères
situées en amont) ou cardiaque (cardiopathies emboli-
gènes, en premier lieu fibrillation auriculaire).
L’occlusion des petites artères est en rapport soit
avec une microangiopathie non spécifique, souvent
décrite sous le nom de lipohyalinose, soit avec une
angiopathie amyloïde, soit, beaucoup plus rarement,
avec une angéite inflammatoire dans le cadre d’une
maladie systémique. Les lésions de la microangiopathie
par lipohyalinose sont favorisées essentiellement par
l’âge et l’hypertension artérielle, mais aussi par le dia-
bète et la présence d’une athérosclérose des gros troncs
et des artères coronaires. L’angiopathie amyloïde est
caractérisée par un dépôt de peptide amyloïde Aß dans
Points clés
•La démence vasculaire n’est pas une affection
définie, mais un concept réunissant des phénomè-
nes extrêmement hétérogènes.
•La notion de déficit cognitif vasculaire apporte une
certaine simplification et surtout permet de recon-
naître et de prévenir les lésions ischémiques céré-
brales avant qu’elles ne s’accompagnent d’une
démence.
•Dans la grande majorité des cas, les lésions vascu-
laires sont associées à des lésions de type Alzhei-
mer.
•En pratique, ce qui compte, c’est la prise en charge
des facteurs de risque vasculaire au même titre que
celle des lésions dégénératives.
C. Derouesné
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 3, n° 2, juin 200590

la paroi artériolaire. Elle peut être isolée, responsable
d’accidents ischémiques ou hémorragiques, ou associée
à des lésions de type Alzheimer.
Lésions parenchymateuses
•Lésions ischémiques
Ce sont les plus fréquentes. Il peut s’agir d’infarctus
cortico-sous-corticaux en rapport avec l’occlusion d’un
gros tronc artériel ou d’infarctus dits lacunaires, pro-
fonds, de petite taille, souvent multiples, en rapport
avec l’occlusion d’une artère perforante de petit cali-
bre. Deux éléments sont invoqués dans la genèse des
déficits cognitifs : le volume de parenchyme détruit et
la topographie des lésions. Tomlinson et al. [3] avaient
émis l’hypothèse qu’une démence vasculaire corres-
pondait à une perte de parenchyme de 50 à 100 cc. En
réalité, une telle perte ne s’accompagne pas toujours
de démence et, à l’inverse, la possibilité de survenue
d’une démence dans les lésions focales peu volumi-
neuses (par exemple dans les deux thalamus) est
connue depuis longtemps. Récemment, dans les
lésions diffuses, Zekry et al. [7] ont mis en évidence
l’importance des lésions du cortex limbique, des zones
d’association multimodales et de la substance blanche.
Deux types de lésions particulières sont à signaler :
1) l’atrophie corticale granulaire caractérisée par des
foyers ischémiques multiples situés dans les zones de
jonction des territoires artériels ;
2) l’infarctus incomplet qui se traduit par la présence de
cellules ischémiques, une gliose sans destruction tissu-
laire ou sous forme de nécrose laminaire du cortex. Ces
lésions peuvent être d’origine variée, mais elles sont
souvent la conséquence de perturbations hémodyna-
miques, liées à une chute de la pression artérielle sys-
témique entraînant la chute du débit sanguin cérébral
ou une anoxie.
•Lésions hémorragiques
Il peut s’agir d’hématomes lobaires ou de micro-
saignements (microbleeds) en rapport avec une
microangiopathie.
•Les dilatations des espaces périvasculaires
Les dilatations des espaces périvasculaires (DEPV)
(espaces de Virchow-Robin) sont le plus souvent obser-
vées au niveau des noyaux gris centraux et se tradui-
sent par des lésions de type lacunaire à distinguer des
infarctus lacunaires car, dans la majorité des cas, elles
ne s’accompagnent pas d’altération du tissu cérébral.
Leur physiopathologie est mal connue et ferait interve-
nir des facteurs mécaniques (rigidité des artères), mais
également des phénomènes de transsudat liés aux
lésions des parois artériolaires et favorisés par des
poussées d’hypertension artérielle [8].
Les lésions de la substance blanche
Elles caractérisaient jadis la maladie de Binswanger.
L’imagerie cérébrale a mis en évidence leur fréquence
chez les sujets âgés. La nature de ces lésions n’est pas
univoque, mais, dans bien des cas, elles sont de nature
ischémique, en rapport avec une microangiopathie non
spécifique. Les lésions diffuses sont souvent associées
à des infarctus lacunaires ainsi qu’à des DEPV. Leur
sévérité est très variable, allant d’un simple œdème de
la myéline, à la destruction des axones avec gliose [9].
Dans leur déterminisme, on invoque un facteur hémo-
dynamique, une ischémie liée à une chute du débit
sanguin cérébral dans le territoire des artérioles perfo-
rantes dont le calibre est rétréci du fait de la lipohyali-
nose.
Plus récemment, des lésions diffuses de la subs-
tance blanche ont été mis en rapport avec une angiopa-
thie d’origine génétique, isolée sous le nom de Cadasil
(encadré).
La question des démences mixtes
La fréquence des démences vasculaires dans les
séries autopsiques varie de4à34%,cequimontre la
difficulté du diagnostic neuropathologique. Cette diffi-
culté provient notamment de la fréquence de l’associa-
tion de lésions vasculaires avec des lésions dégénérati-
ves, en particulier des lésions de maladie d’Alzheimer.
Le rôle des lésions vasculaires dans l’apparition de
la démence ou l’aggravation des déficits cognitifs chez
Cadasil
Cerebral autosomal dominant arteriopathy with
subcortical infarcts and leucoencephalopathy [18]
Angiopathie d’origine génétique débutant habituel-
lement vers 40-50 ans, mais parfois plus tardive-
ment, elle est caractérisée :
–au plan clinique par l’association de crises de
migraine (20-30 % des cas), d’accidents ischémiques
transitoires (66 % des cas), de dépressions sévères
(20 %) et d’un tableau de démence sous-corticale
(33 % des cas) en rapport avec des lésions diffuses
de la substance blanche ;
–au plan neuropathologique par une artériopathie
diffuse touchant les artères perforantes et ménin-
gées, mais aussi les tissus périphériques (permet-
tant le diagnostic par biopsie) ;
–au plan génétique, par des mutations du gène
Notch 3 situé sur le chromosome 19 à l’origine d’une
dégénérescence des cellules musculaires lisses vas-
culaires.
Démence vasculaire
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 3, n° 2, juin 2005 91

des patients présentant une maladie d’Alzheimer a été
mis en évidence dans plusieurs études [10, 11]. Le
terme de démence mixte est appliqué aux cas dans
lesquels la démence paraît résulter de l’association de
lésions vasculaires et dégénératives. Ce terme est tou-
tefois critiqué du fait de la difficulté à apprécier le rôle
Tableau 1.
Critères pour le diagnostic de démence vasculaire (auparavant démence par infarctus multiples) selon le DSM-IV-TR [15]
.
Table 1. Criteria for the diagnosis of vascular dementia (formerly multi-infarct dementia) according to the DSM-IV-TR [15].
A. Apparition de déficits cognitifs multiples comme en témoignent à la fois :
1. une altération de la mémoire (altération de la capacité à apprendre des informations nouvelles ou à se rappeler les informations
apprises antérieurement)
2. une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes :
a. aphasie (perturbation du langage)
b. apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des fonctions motrices intactes)
c. agnosie (impossibilité de reconnaître ou d’identifier des objets malgré des fonctions sensorielles intactes)
d. perturbations des fonctions exécutives (faire des projets, organiser, ordonner dans le temps, avoir une pensée abstraite)
B. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 sont tous les deux à l’origine d’une altération significative du fonctionnement social ou
professionnel et représentent un déclin significatif par rapport au niveau de fonctionnement antérieur
C. Présence de signes ou symptômes neurologiques en foyer (par exemple, exagération des réflexes ostéo-tendineux, réflexe cutané
plantaire en extension, paralysie pseudo-bulbaire, troubles de la marche, faiblesse d’une extrémité) ou mise en évidence par les examens
complémentaires d’une maladie cérébro-vasculaire (par exemple infarctus multiples dans le cortex et la substance blanche sous-corticale)
jugée liée étiologiquement à la perturbation.
D. Les déficits ne surviennent pas exclusivement au cours de l’évolution d’un delirium
Tableau 2.Critères de diagnostic pour la démence vasculaire selon le National institute of neurological disorders and stroke
(NINCDS) et l’Association internationale pour la recherche et l’enseignement en neurosciences (AIREN) [16].
Table 2. Diagnostic criteria for vascular dementia according to the NINCDS-AIREN [16].
I. Démence vasculaire probable
1. Démence caractérisée par un déficit mnésique associé à deux ou plus déficits dans d’autres domaines cognitifs, interférence avec la
vie quotidienne non liée aux déficits neurologiques
2. Maladie vasculaire cérébrale définie par la présence de signes neurologiques focaux et de signes radiologiques à l’imagerie
(infarctus cortico-sous-corticaux, lacunes de la substance blanche ou lésions extensives de la substance blanche)
3. Relation entre 1 et 2 mise en évidence ou suggérée par un ou plus des signes suivants :
- début de la démence dans les trois mois suivant un AVC reconnu
- détérioration brutale des fonctions cognitives ou évolution en marches d’escalier
II. Les manifestations cliniques en accord avec le diagnostic de démence vasculaire probable sont :
a. la présence précoce de troubles de la marche (marche à petits pas, ataxie de la marche, marche extrapyramidale)
b. des troubles de l’équilibre avec chutes fréquentes
c. des troubles urinaires précoces non expliqués par une affection locale
d. une paralysie pseudo-bulbaire
e. des modifications de l’humeur et de la personnalité (dépression, incontinence émotionnelle, ralentissement psychomoteur, troubles
des fonctions exécutives)
III. Les signes qui rendent le diagnostic de démence vasculaire incertain ou improbable sont :
a. des troubles mnésiques précoces et l’évolution progressive des déficits cognitifs
b. l’absence de signes neurologiques focaux
c. l’absence de lésions vasculaires à l’imagerie
IV. Le diagnostic de démence vasculaire possible peut être fait en présence d’une démence avec des signes neurologiques focaux en
l’absence de signes neuroradiologiques ou en l’absence d’une relation temporelle claire entre la démence et un AVC ou chez les patients
avec un début insidieux et une évolution variables des déficits cognitifs (détérioration en plateaux et amélioration) et une évidence d’AVC
V. Le diagnostic de démence vasculaire certaine nécessite :
a. les critères cliniques pour une démence vasculaire probable
b. une preuve histologique de maladie vasculaire cérébrale
c. l’absence d’une quantité de DNF et de PS supérieure à l’âge
d. l’absence d’autre affection clinique ou pathologique capable de causer une démence
VI. La classification nécessite de spécifier : démence vasculaire corticale, démence vasculaire sous-corticale, maladie de Binswanger,
démence thalamique.
Le terme de MA avec AVC correspond au diagnostic de MA possible avec présence de signes cliniques ou radiologiques d’AVC.
C. Derouesné
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 3, n° 2, juin 200592

réciproque de ces lésions dans le déterminisme de la
démence, ce qui laisse une grande marge de subjecti-
vité dans le classement de ces cas, aussi bien au plan
clinique que neuropathologique.
Un travail récent, portant sur les 382 cerveaux de
patients déments de la banque de cerveaux de Floride
[12], a montré une fréquence globale de 18 % des cas
classés comme démences vasculaires, loin derrière la
MA (77 %) et la démence à corps de Lewy (26 %). La
fréquence des démences vasculaires était liée à l’âge :
elle passait de 5 % des cas avant 60 ans à 26 % après
80 ans. Mais, fait essentiel, seulement 3 % des cas clas-
sés comme démences vasculaires ne présentaient que
des lésions vasculaires pures. La fréquence des cas de
démences vasculaires pures apparaît ainsi, dans les
travaux neuropathologiques, très inférieure à celle que
lui attribuent beaucoup de cliniciens.
L’incertitude
des critères de diagnostic
de démence vasculaire
Plusieurs types de critères ont été proposés pour le
diagnostic de démence vasculaire. Les plus communé-
ment utilisés sont présentés dans les tableaux 1 à 3.
Tous reposent, en fait, sur la triple association : 1) d’une
démence définie selon les critères de l’Association psy-
chiatrique américaine (DSM-III), c’est-à-dire un déficit
cognitif multiple comportant obligatoirement des trou-
bles de mémoire et d’intensité suffisante pour entraîner
un déclin des activités de la vie quotidienne ; 2) de
lésions vasculaires cérébrales ; 3) d’un jugement que 1
et 2 sont liés.
Aucun de ces critères, en réalité, ne permet de clari-
fier la situation et les différents critères définissent des
groupes de patients différents [14]. Au plan clinique, la
question de la démence vasculaire se pose dans deux
circonstances cliniques très différentes selon que la
démence survient dans les suites d’un ou plusieurs
AVC clairement identifiés ou que les troubles cognitifs
apparaissent primitifs.
AVC et démence
Les études portant sur les accidents vasculaires
cérébraux (AVC) du sujet âgé insistent sur le caractère
réservé du pronostic, particulièrement en raison de la
fréquence d’apparition d’une démence dans les suites
de l’AVC.
Deux questions se posent :
1) la difficulté d’application des critères de démence.
Les déficits moteurs et cognitifs de l’AVC peuvent réali-
ser un tableau de déficits cognitifs multiples retentis-
sant sur la vie quotidienne. Sur quels éléments peut-on
alors porter le diagnostic de démence vasculaire ? On
peut d’ailleurs se poser la question de l’utilité d’un tel
diagnostic qui n’a guère d’intérêt ni au plan de la prise
en charge du patient ni du traitement de l’AVC qui sont
parfaitement codifiés. En revanche, parler de démence
comporte le risque de méconnaître une dépression
post-AVC accessible à la thérapeutique ;
2) l’AVC peut favoriser l’apparition d’une démence chez
des patients présentant une MA débutante. Les argu-
ments en faveur d’une MA associée sont : l’importance
des troubles de mémoire dans la vie quotidienne, les
caractères du déficit mnésique évoquant une atteinte
hippocampique (trouble de la mémorisation plus que
du rappel), la présence d’une atrophie franche des cor-
nes temporales, une aggravation progressive.
Devant un déclin cognitif apparemment primitif
La situation est différente selon que l’installation
des troubles cognitifs est brutale ou progressive.
L’installation brutale d’un tableau démentiel est
évocatrice d’une origine vasculaire. L’origine peut être
un accident ischémique localisé dans un territoire qui
ne donne pas de manifestations cliniques évidentes :
lobe temporal droit, lésions thalamiques, frontales ou
occipitales bilatérales. Cliniquement, la présence de
signes neurologiques focaux est à rechercher systéma-
tiquement (signe de Babinski, asymétrie des réflexes
ostéotendineux, hémianopsie latérale homonyme).
L’imagerie cérébrale, tout particulièrement l’IRM,
beaucoup plus sensible que le scanner-X, permet de
confirmer la présence et le siège d’anomalies de type
ischémique.
Les difficultés les plus importantes sont observées
lorsque le déclin cognitif est insidieux et progressif.
Dans un souci de simplification, il est possible de dis-
tinguer deux situations selon le tableau clinique :
1) lorsque les déficits mnésiques sont au premier
plan, que leurs caractères évoquent une atteinte hippo-
campique, qu’il existe des troubles d’autres fonctions
supérieures (langage, praxies...), qu’il existe une atro-
phie hippocampique franche, le diagnostic de MA est
hautement probable. La présence de signes focaux à
l’examen neurologique ou d’anomalies vasculaires à
l’imagerie pose simplement la question du rôle des
lésions vasculaires associées. Le classement comme
démence vasculaire, démence dégénérative avec
lésions vasculaires associées ou encore comme
démence mixte dépend largement des idées de chacun
et des critères utilisés. Ce caractère subjectif du juge-
ment sous-tend la polémique sur la fréquence de la
démence vasculaire qui est considérée par certains
comme la 2
e
cause de démence derrière la MA et, par
d’autres, comme une cause rare de démence en
Démence vasculaire
Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol. 3, n° 2, juin 2005 93
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%