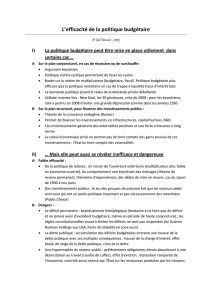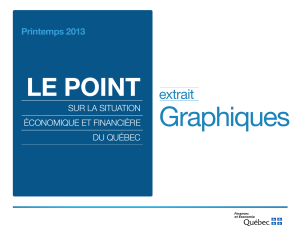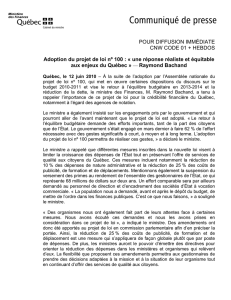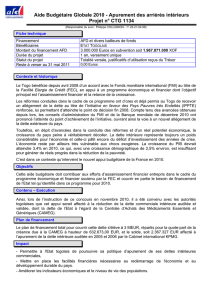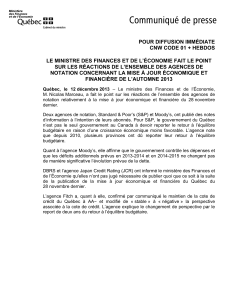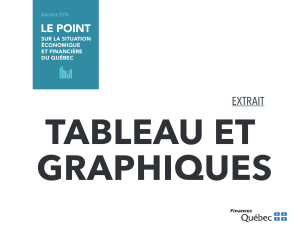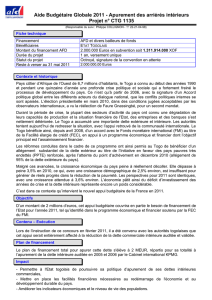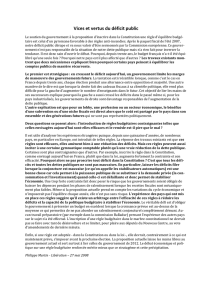Politique budgétaire et gestion de la dette publique

Politique
budgétaire et
gestion de la
dette publique
Economie contemporaine - Avril 2011
Préparation au concours d’attaché territorial
Fiche de Connaissances

Centre national de la fonction publique territoriale - Avril 2011
1 / 29
Fiche de Connaissances
Préparation au concours d’attaché territorial
Economie contemporaine - Politique budgétaire et gestion de la dette publique
INTRODUCTION
La politique budgétaire constitue, avec la politique monétaire, l’un des principaux leviers de
la politique économique de l’État.
Elle consiste à utiliser certains instruments budgétaires (dépenses publiques, endettement
public, prélèvements scaux) pour inuer sur la conjoncture économique.
Jusqu’à la crise des années 1930, la gestion des nances publiques a eu pour principal objectif
d’assurer le nancement des services publics.
Le volume des dépenses de l’État n’était alors pas considéré comme une variable susceptible
d’inuencer le niveau d’activité de l’économie.
L’analyse de l’économiste britannique John Maynard Keynes a modié cette conception en
soulignant l’impact d’une politique de relance conjoncturelle via l’augmentation des dépenses
publiques sur le niveau d’activité économique d’un pays.
Aussi, la plupart des pays développés ont mené, depuis les années 1930, des politiques de
relance budgétaire lors des périodes de récession ou de moindre croissance.
Cependant, à compter de la crise consécutive au choc pétrolier de 1973, les théoriciens
libéraux ont souligné les limites de la politique budgétaire et dénoncé, selon les
circonstances, les eets néfastes des décits et/ou de la dette publique.

Centre national de la fonction publique territoriale - Avril 2011
Centre national de la fonction publique territoriale - Avril 2011
2 / 29
Fiche de Connaissances
Préparation au concours d’attaché territorial
Economie contemporaine - Politique budgétaire et gestion de la dette publique
OBJET, EFFETS ET LIMITES DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE
L’ACTION DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE SUR LA CONJONCTURE
Les économistes classiques limitaient les dépenses publiques à la fourniture des biens publics
et aux fonctions régaliennes de l’État.
Toute autre intervention publique était considérée comme nuisible à la bonne marche des
affaires.
Cependant, engendrant du chômage de masse, la récurrence des crises et les uctuations
conjoncturelles ont ni par remettre en cause la nécessaire neutralité des pouvoirs publics à
l’égard de la conjoncture.
C’est durant cette période que Keynes a souligné l’intérêt d’un accroissement des dépenses
publiques pour soutenir ou relancer l’activité économique.
Selon lui, en situation de sous-emploi des facteurs de production, les dépenses publiques
pouvaient suppléer la faiblesse de la demande privée.
UN EFFET DE RELANCE
En cas de forte dégradation de la conjoncture économique, les gouvernements peuvent être
tentés de mener une politique budgétaire volontariste.
Une telle politique consiste à soutenir l’activité économique à court terme, en faisant jouer le
«multiplicateur keynésien».
Dénition
On appelle «multiplicateur keynésien», le mécanisme macroéconomique mis en
évidence par Keynes, qui permet de compenser la faiblesse des dépenses privées
par un accroissement des dépenses publiques.
En effet, une augmentation des dépenses publiques engendre des revenus supplémentaires qui
sont :
- pour partie consommés,
- pour partie épargnés,
- pour partie récupérés par les administrations publiques sous la forme d’impôts et de
cotisations sociales.

Centre national de la fonction publique territoriale - Avril 2011
Fiche de Connaissances
Préparation au concours d’attaché territorial
Economie contemporaine - Politique budgétaire et gestion de la dette publique
3 / 29
Or, la partie de ces revenus supplémentaires qui est consommée vient nourrir la demande
intérieure adressée aux entreprises. Ces dernières peuvent dès lors augmenter leurs
investissements, leurs emplois, et distribuer des revenus supplémentaires.
Le surcroît de dépenses publiques provoque par conséquent un effet cumulatif (effet
multiplicateur) qui stimule d’autant plus l’activité économique que les revenus sont peu
épargnés, peu imposés, et que la demande de consommation s’adresse principalement aux
entreprises nationales.
L’ampleur de l’effet stimulant de la dépense publique sur la conjoncture va dépendre également
des modalités retenues par l’État pour nancer l’impulsion initiale, à savoir une augmentation
des impôts ou le recours à l’emprunt.
En cas de nancement intégral par un prélèvement scal nouveau, le théorème de Haavelmo
dit que l’effet multiplicateur se limite à l’impulsion initiale.
Voir série ÉC19, page 4
Pour assurer à la politique budgétaire un bénéce maximum, il vaut donc mieux recourir au
décit budgétaire qui sera progressivement comblé de toute manière par le surcroît de rentrées
scales lié à la reprise de l’activité.
ð L’endettement public devient un instrument de politique de budgétaire à part entière.
La période des "Trente Glorieuses" a vu se développer l’action de régulation conjoncturelle
de la politique économique via l’instrument budgétaire, non seulement dans le but de relance
de l’activité, mais aussi pour ralentir la croissance économique qui générait, en situation de
plein emploi des facteurs de production (capital et travail), de graves tensions inationnistes.
Cette succession de mesures budgétaires visant à relancer puis à ralentir la consommation et
l’investissement a été qualiée de politique «stop and go», faisant des dépenses publiques
un outil de réglage de la conjoncture.

Centre national de la fonction publique territoriale - Avril 2011 Centre national de la fonction publique territoriale - Avril 2011
Fiche de Connaissances
Préparation au concours d’attaché territorial
Economie contemporaine - Politique budgétaire et gestion de la dette publique
4 / 29
EFFET MULTIPLICATEUR ET THÉORÈME DE HAAVELMO
Le principe du multiplicateur, dans sa version très générale, est un principe dont
l’origine est attribuée à R. Kahn. Ce dernier, dont la formation mathématique était
plus solide que celle de J.M. Keynes, a mis en évidence, en 1931, le multiplicateur
d’emploi en montrant que la création d’un nombre donné d’emplois, par exemple par
le moyen d’une politique de grands travaux, entraîne –grâce aux nouvelles dépenses–
la création en cascade d’autres emplois. L’effet multiplicateur est surtout lié au nom de
J.M. Keynes qui a su mieux mettre en évidence les relations entre l’investissement, la
production nationale et l’emploi. Un accroissement de la dépense d’investissement, en
induisant la distribution de revenus monétaires utilisés en partie pour l’acquisition de
biens de consommation (l’autre partie de ces revenus étant épargnée), engendre par
une suite d’effets de réaction en chaîne un accroissement de la production nationale
d’un volume supérieur à l’impulsion initiale. L’accroissement de la production agit
lui-même positivement sur le volume d’offre d’emplois de l’économie. À la suite de
Keynes, les économistes d’inspiration keynésienne ont cherché à montrer que l’effet
est beaucoup plus important dans le cas d’une dépense publique nouvelle que dans
le cas d’une réduction d’impôt (qui a aussi pour effet de stimuler la consommation
privée) d’un montant équivalent.
Utilisant ces observations, Th. Haavelmo établit qu’un budget équilibré tend à exercer
aussi, dans certaines circonstances particulières, un effet multiplicateur. Un État qui
voudrait engager un budget en situation d’équilibre en augmentant ses dépenses doit
simultanément accroître ses recettes. Si les deux mouvements sont d’un montant
identique, il peut sembler que l’effet combiné des variations des dépenses et des
recettes soit nul. Il n’en est rien. Th. Haavelmo montre que, grâce au jeu des différents
multiplicateurs, un accroissement des recettes et un accroissement des dépenses
d’un même montant ne se compensent pas. L’effet bénéque des dépenses nouvelles
l’emporte sur celui des recettes supplémentaires. Une simple augmentation du budget,
dans une situation d’équilibre, est ainsi susceptible d’entraîner une expansion de
l’économie nationale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%