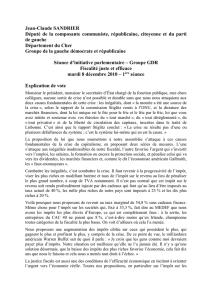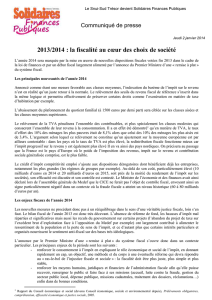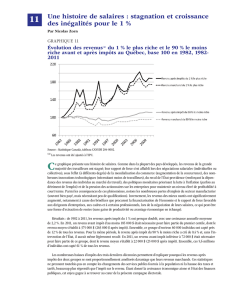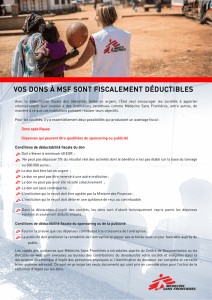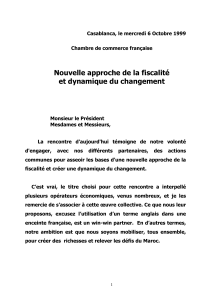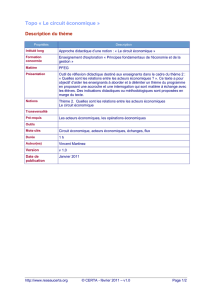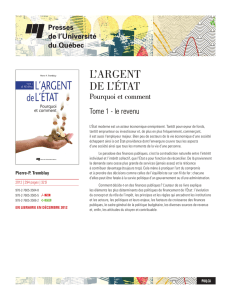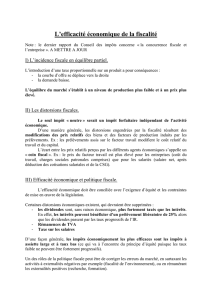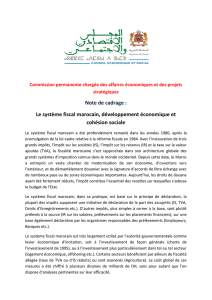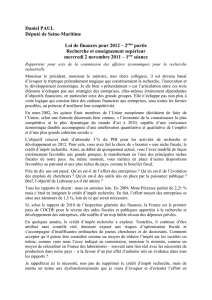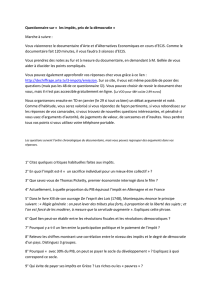Corrigé du devoir d`économie n°1

Centre national de la fonction publique territoriale
Préparation au concours interne d'administrateur territorial
2005-2006
Corrigé du devoir d’économie n°1
Sujet :
Servant à financer le fonctionnement des administrations centrales et locales et différentes actions
publiques, les impôts sont aussi un instrument de redistribution. En même temps, ils ponctionnent une
part de la richesse nationale et sont à ce titre critiqués pour leurs effets d’éviction et de désincitation
ainsi que pour les risques concurrentiels qu’ils génèrent dans l’économie mondiale actuelle, ce qui
justifie leur réforme et leur baisse. La question est désormais posée de savoir quelle place et quelle
légitimité sont accordées à l’impôt dans un État moderne comme la France.
À l’aide des documents joints vous rédigerez une note synthétique sur ce sujet.
Documents :
Document n° 1 : D. Martina et alii, « Les fonctions économiques de l’État », Économie générale, Nathan,
1995, pp. 185-187
p. 2
Document n° 2 : J. Brémond, A. Gélédan, « Impôt », Dictionnaire des Sciences Économiques et Sociales,
Belin, 2002, pp. 265-270
p. 5
Document n° 3 : Y. Crozet, « Les choix fiscaux », « Le révélateur des prélèvements obligatoires », dans
Analyse économique de l’État, Armand Colin, 1997, pp.51-54
p. 11
Document n° 4 : J.-P. Betbeze, « Financement public de la R&D : complémentarité ou substitution avec le
financement privé ? », dans « Financer la R&D », Les Rapports du Conseil d'analyse
économique, n° 53, 2005, pp. 61-64
p. 14
Document n° 5 : C. Saint-Étienne, J. Le Cacheux, « Quels enseignements de la théorie en termes de
concurrence fiscale ? », dans « Compétitivité », Les Rapports du Conseil d'analyse
économique, n° 56, 2005, pp.30-31
p. 18
Document n° 6 : T. Madiès, « Concurrence fiscale et comportements mimétiques des collectivités
locales », dans M. Debonneuil, L. Fontagne, « Croissance équitable et concurrence
fiscale », Les Rapports du Conseil d'analyse économique, n° 40, 2003, pp. 221-226
p. 20
Document n° 7 : H. Sterdyniak, « L’introuvable réforme fiscale », Lettre de l’OFCE, n°249, mai 2004 p. 26
Document n° 8 : M. Montoussé, D. Chamblay, « Les néolibéraux considèrent qu’il faut désengager l’État
et freiner la redistribution », 100 fiches pour comprendre les sciences économiques,
Bréal, 1998, pp. 20-221
p. 34
Document n° 9 : B. Guerrien, « La courbe de Laffer », Dictionnaire d’analyse économique, La
Découverte (Dictionnaires Repères), 1996, pp. 290-291
p. 35
Document n° 10 : A. Vatimbella, « Il faut supprimer les impôts », Dictionnaire des idées reçues en
économie, Alternatives Économiques & Éd. Syros, 1993, pp. 122-123
p. 36
Document n° 11 : « Plus de 10 millions de français ne paient pas l’impôt sur le revenu », Le Monde, 2/9/05 p. 38
Document n° 12 : L. Mauduit, « La mort programmée de l’impôt citoyen », Le Monde, 11/09/05 p. 39

Corrigé du devoir d’économie n°1 page 2
1. Commentaires sur le sujet et le dossier
Le sujet porte sur une question économique et sociale majeure, les impôts, en s’interrogeant sur leur place et leur
légitimité dans un contexte où d’un côté on assiste à un recul du rôle de l’État et une contestation de ses interventions
dans une économie mondialisée aboutissant à une intense concurrence fiscale, et où, de l’autre, existe une forte attente
d’intervention publique en matière de sécurité, de formation, de santé face à la persistance du chômage de masse et à la
résurgence de différentes formes de pauvreté et d’exclusion sociale.
La question à débattre doit bien entendu être resituée dans son cadre spatio-temporel : la France d’aujourd’hui (avec
ce qu’implique la dualité État central / collectivités locales) dans le cadre de l’Union européenne à l’heure de la
mondialisation.
Il conviendra de rappeler ce qu’est l’impôt, à quoi il sert et comment il est organisé en France, d’analyser les
différentes critiques le concernant et de se demander quelle réforme et, éventuellement quelle(s) baisses(s), des
impôts pourraient permettre de lui restaurer une place que ne peuvent légitimer que l’équité de la charge fiscale et
l’efficacité des dépenses publiques. Au-delà de l’impôt, c’est la question du rôle de l’État dans l’économie et la société
actuelle qui est posée même s’il faut éviter d’extrapoler au-delà du cœur du sujet qui concerne bien l’impôt.
Les documents figurant dans le dossier indiquent les principaux éléments à mettre en évidence :
- les différentes fonctions de l’État et la nécessité du budget consistant qui en découle,
- la philosophie (principe d’égalité devant l’impôt) et l’architecture du système fiscal français (impôts directs /
indirects, fiscalité nationale / locale, proportionnalité et progressivité, différents impôts et assiettes…),
- les problèmes d’efficacité de l’impôt au regard de la croissance, de l’investissement, de la R&D et de l’emploi
compte tenu des différents types de concurrence fiscale (internationale et intranationale),
- les problèmes d’équité de la charge fiscale entre les ménages, les ménages et les entreprises, les revenus du
travail et du capital,
- le débat entre les ultralibéraux et leurs adversaires sur la place et la légitimité de l’État et de l’impôt,
- les réformes récentes, les réformes en cours et les pistes de réforme possible.
Il peut être utile de se référer aux titres et intertitres des documents dont on peut même reprendre le libellé et
quelques éléments de contenu pour construire l’argumentation et illustrer son propos.
2. Commentaires sur les différents documents
Il s’agit de caractériser le type de document (informatif, descriptif, analytique ou argumentatif) auquel on a affaire et de
tirer l’essentiel de chaque document à partir d’une lecture rapide.
Document n°1 : D. Martina et alii, « Les fonctions économiques de l’État »
Il s’agit d’un document informatif rappelant de façon synthétique les principales fonctions économiques de l’État
lorsque celui-ci n’est pas limité aux fonctions régaliennes de l’État gendarme.
Ces trois fonctions sont :
- la production de biens et services collectifs,
- la stabilisation de l’économie à travers des politiques, notamment les politiques monétaires et budgétaires,
- la redistribution des revenus.
Les deux premières fonctions impliquent des dépenses qui doivent donc être couvertes par des recettes, en particulier
fiscales.
La redistribution des revenus passe par des prélèvements obligatoires (impôts, taxes, cotisations et charges sociales) et
des transferts sous forme de revenus sociaux ou de prestations en nature.
Questions par rapport au sujet :
- Quelle place reste-t-il à l’État « producteur » à l’heure des mises en concurrence et des privatisations ?
- Dans quelle mesure l’État peut-il encore utiliser les politiques monétaires et budgétaires alors que sa
souveraineté et sa capacité d’agir semblent reculer ? Cette question est d’autant plus posée pour la France et
les pays de la zone Euro que la politique monétaire appartient à la BCE et que la politique budgétaire est limitée
par le Pacte de stabilité et de croissance.
- Quelle est l’efficacité de la redistribution supposée limiter les inégalités de revenus et de niveaux de vie ?
En résumé, ces missions sont-elles encore d’actualité, sont-elles encore efficaces, sont-elles encore légitimes ?

Corrigé du devoir d’économie n°1 page 3
Document n°2 : J. Brémond, A. Gélédan, « Impôt »,
Il s’agit également d’un document informatif distinguant les différents prélèvements obligatoires et rappelant la
différence entre les deux grandes catégories que sont les impôts et les cotisations sociales. Il distingue ensuite les
impôts directs des impôts indirects en énumérant les principaux impôts en rappelant qu’ils servent à financer différents
budgets publics (État et collectivités locales). Sont enfin rappelés différents éléments et règles de calcul en matière
d’imposition : proportionnalité, progressivité, pression fiscale…
Questions par rapport au sujet :
- La diversité des impôts est-elle lisible ?
- Leur rôle redistributif est-il clair, efficace et acceptable ?
- Cette multiplicité et la gestion qu’elle implique n’amplifie-t-elle pas le poids supporté par les contribuables ?
En résumé, le système fiscal actuel peut-il durer ?
Document n°3 : Y. Crozet, « Les choix fiscaux », « Le révélateur des PO »
Ce document analytique traite de ce qui caractérise un système fiscal en général et le système français en particulier.
Il traite d’abord des choix en matière d’imposition en montrant qu’il existe différentes applications du principe de
« l’égalité devant l’impôt ». Il explique ensuite que les questions de méthode en matière de recouvrement de l’impôt ne
sont pas seulement techniques mais concrétisent les questions de principe d’établissement de l’impôt et de l’assiette
fiscale.
Rappelant les options et le fonctionnement des impôts en France, il appelle enfin à une réforme fiscale dont il montre
toute la complexité.
[Note : cette présentation a été rédigée avant la suppression de la vignette.]
Questions par rapport au sujet :
- Où la France en est-elle réellement en termes « d’égalité devant l’impôt » ?
- Une réforme fiscale globale est-elle nécessaire et possible ?
- Que faudrait-il réformer en priorité pour restaurer une meilleure légitimité de l’impôt ?
En résumé, quelle réforme pourrait conserver ou rendre une place légitime à l’impôt ?
Document n°4 : J.-P. Betbeze, « Financement public de la R&D :
complémentarité ou substitution avec le financement privé ? »,
Ce document analytique porte sur le financement public de la recherche et développement qui est considérée
aujourd’hui comme l’un des principaux facteurs de croissance. Se faisant l’écho de recherches récentes, l’auteur
s’interroge sur l’efficacité des dépenses publiques et des exonérations fiscales (donc des baisses de recettes publiques)
destinées à la R&D.
Il semble que l’efficacité de ces financements publics sur la croissance soit limitée dans la mesure où d’une part se
produisent de nombreux effets d’éviction et de substitution (les dépenses publiques n’accroissent pas les dépenses
totales de R&D mais limitent les dépenses privées) et où d’autre part l’impact de la R&D privée sur la croissance serait
plus important, ce qui peut cependant provenir d’un effet d’optique lié à des problèmes d’observation et de
comptabilisation d’externalités positives.
[Notes :
- Le terme « spillovers » peut se traduire par « effets de report ».
- Il y a une externalité quand une activité économique conduit à créer une utilité, un avantage (on parle alors
d’externalité positive) ou une désutilité, un inconvénient (on parle alors d’externalité négative) sans que le prix ne soit
comptabilisé, ni a fortiori payé ou empoché par son auteur.]
Questions par rapport au sujet :
- Faut-il orienter les dépenses publiques (donc les impôts) au service de la croissance et plus précisément au
financement de la R&D ?
- Ne risque-t-on pas alors de laisser les profits au privé et de financer les dépenses coûteuses sur fonds publics ?
En résumé, comment opérer de meilleurs arbitrages en matière de dépense publique ?

Corrigé du devoir d’économie n°1 page 4
Document n°5 : C. Saint-Étienne, J. Le Cacheux,
« Quels enseignements de la théorie en termes de concurrence fiscale ? »
Ce document analytique traite de la concurrence fiscale en particulier dans le cadre de l’Union européenne. Les auteurs
distinguent :
- une « concurrence fiscale productive » qui prend en compte le niveau de la fiscalité et l’utilité productive de la
dépense publique qui est une bonne chose de leur point de vue car elle oblige les États à organiser des dépenses
efficaces (en infrastructures, en formation, en R&D…) et ainsi à avoir des recettes fiscales judicieuses,
- une « concurrence fiscale prédatrice » qu’ils déplorent car elle met en difficulté les dépenses sociales de l’État-
providence et pousse à réduire la fiscalité appliquée aux agents économiques (entreprises, ménages fortunés,
salariés très qualifiés) pour éviter qu’ils ne changent de pays.
Considérant que l’harmonisation fiscale qui serait souhaitable dans l’UE est aujourd’hui impossible, ils prônent une
réforme fiscale en France (qui n’est pas détaillée dans cet extrait).
Questions par rapport au sujet :
- Faut-il et peut-on renoncer à toute harmonisation fiscale européenne ?
- Comment conserver une fiscalité souveraine et équitable en France dans un contexte de concurrence fiscale ?
En résumé, de quelle marge de manœuvre fiscale disposent aujourd’hui les pouvoirs publics français ?
Document n°6 : T. Madiès, « Concurrence fiscale et comportements mimétiques des collectivités locales »
Ce document analytique traite aussi de la concurrence fiscale. À la différence du document précédent, il ne s’intéresse
pas à la concurrence internationale, mais à la concurrence à laquelle se livrent les collectivités territoriales à l’intérieur
d’un même pays.
S’agissant de la France, l’auteur s’interroge sur la façon dont les collectivités locales fixent leurs taux, notamment pour
la taxe professionnelle. Il constate une surenchère à la baisse pour attirer ou maintenir des investissements et des
emplois et considère que cette surenchère doit plus à des comportements mimétiques qu’à des objectifs économiques
s’appuyant sur des résultats effectivement observés.
Des travaux du Conseil des impôts tendent en effet à montrer que les effets de la concurrence fiscale entre les
collectivités locales en matière de localisation d’entreprises sont limités dans la mesure où d’autres facteurs
(caractéristiques de la main-d’œuvre, infrastructures de transport notamment) commandent principalement les
arbitrages des entreprises. En outre, la prise en charge d’une part croissante de la taxe professionnelle affectant les
entreprises est prise en charge par l’État central (à travers des mesures de plafonnement et d’aides publiques) et la
multiplication des aides locales (dont 80% ne respectent pas la législation) venant précisément compenser les écarts de
taux fiscaux atténuent encore davantage l’effet supposé positif de cette concurrence fiscale.
Au bout du compte, le document plaide pour une coopération plutôt qu’une concurrence fiscale entre les collectivités
territoriales.
Questions par rapport au sujet :
- Quelle complémentarité entre l’État central et les collectivités locales dans le domaine fiscal ?
- Existe-t-il un dumping fiscal en France ? Ne met-il pas en cause la justice fiscale ?
- L’impôt est-il l’ennemi de l’emploi ?
En résumé, comment reconstruire une harmonisation fiscale rendant le système plus lisible et plus juste ?
Document n°7 : H. Sterdyniak, « L’introuvable réforme fiscale »
Ce document analytique énumère différentes pistes pour une réforme fiscale aussi nécessaire qu’ « introuvable » selon
l’auteur. Il s’interroge en particulier sur les moyens et les effets de deux grandes directions proposées : soit réduire
fortement les prélèvements obligatoires, soit mieux répartir la charge fiscale et améliorer la redistributivité du système.
L’auteur ne croit guère à la possibilité d’une baisse significative des recettes fiscales dans la mesure où il ne voit pas
quelles dépenses publiques pourraient réellement être allégées compte tenu du poids du chômage et de la précarité, des
modifications sociodémographiques et de la demande en matière de santé, d’éducation et de sécurité.
Il conteste ensuite la pertinence d’une baisse de différentes recettes fiscales et parafiscales :
- étendre les taux réduits de TVA ne serait selon lui ni juste en terme de répartition de la charge fiscale, ni efficace
du point de vue de l’incitation à l’activité et à l’emploi,
- réduire les cotisations sociales n’est guère possible compte tenu du déséquilibre des comptes sociaux
(Assurance-maladie, Unédic) sauf à transférer une part des coûts de la protection sociale des ménages vers les

Corrigé du devoir d’économie n°1 page 5
entreprises soit en augmentant la CSG, soit en taxant la valeur ajoutée des entreprises, ce que les gouvernements
ont refusé de faire jusqu’ici.
Il montre la nature archaïque de la taxation directe des ménages en raison de la diversité des impôts (IRPP, CSG, taxe
d’habitation…), de l’inégalité des impôts locaux et de la multiplicité des mesures dérogatoires rendant le système peu
lisible et éveillant donc la suspicion, fondée ou non, d’une grande injustice fiscale bénéficiant plutôt aux plus riches. Il
explique ensuite le fonctionnement de la taxation des revenus du capital qu’il juge « satisfaisant » tout en montrant que
ces revenus ne paie pas de prélèvement social, ce qu’il évalue à une parte de 7 milliards d’euros en 2004. Il critique en
revanche la Prime pour l’emploi (PPE), sorte d’ « impôt négatif » créé par le Gouvernement Jospin parallèlement aux
baisses d’impôt sur le revenu qu’il avait engagées afin que les ménages ne payant pas d’impôt tirent aussi un avantage
de cette politique fiscale. Il prône sa réforme et même sa suppression en modifiant parallèlement le Revenu minimum
d’activité (RMA) afin de mieux traiter les ménages les plus pauvres. À l’opposé, l’imposition des ménages les plus
riches se heurte de plus en plus à la concurrence fiscale liée à la mondialisation et à la construction européenne. Les
pistes de réformes sont d’autant plus complexes qu’une partie des recommandations (lutte contre les paradis fiscaux,
harmonisation fiscale en Europe) ne peuvent pas être appliquées par le seul gouvernement français. Il en va à peu près
de même à propos de la taxation des entreprises dont le problème majeur est le fait que la fiscalité pesant sur le travail
est contre-productive à l’heure du chômage de masse.
L’état des finances publiques (poids de la dette, niveau du déficit) rend à la fois une réforme fiscale indispensable et
très difficile à mettre en œuvre compte tenu de l’absence de marges de manœuvre. Au terme de l’analyse, l’auteur
envisage trois pistes de réforme :
- une stratégie donnant priorité à la baisse de l’imposition des plus riches pour tenir compte de la concurrence
fiscale. Problèmes : c’est compliqué à mettre en œuvre puisque cela impliquerait de limiter des dépenses sociales
qui ne seraient plus financées, c’est difficile à faire accepter et c’est dangereux pour l’activité économique car le
surplus de revenu des plus riches servirait peu à la consommation ;
- une stratégie donnant priorité à la baisse de l’imposition des entreprises également pour tenir compte de la
concurrence et gagner en compétitivité. Problèmes : cela impliquerait d’augmenter la fiscalité pesant sur les
ménages au risque de rencontrer l’hostilité de l’opinion publique (et de l’électorat) et de limiter leur demande, ce
serait entrer dans une logique de dumping fiscal au niveau européen dont on aurait ensuite du mal à sortir.
- une stratégie sans priorité consistant à accorder différentes baisses d’impôts à toute la population en supprimant
un certain nombre de mesures dérogatoires.
Si comme le dit l’auteur en conclusion, « réformer la fiscalité n’est pas chose aisée », on peut constater que les pistes
qu’il explore semblent renoncer a priori à une véritable réforme d’ensemble du système fiscal et à une harmonisation
fiscale européenne.
Questions par rapport au sujet :
- Le système fiscal français peut-il continuer sans une vraie réforme globale ?
- Ce système est-il réformable autrement que par « petites touches » ?
En résumé, comment disposer d’un système fiscal juste et efficace selon les critères et le contexte actuels ?
Document n°8 : M. Montoussé, D. Chamblay,
« Les néolibéraux considèrent qu’il faut désengager l’État et freiner la redistribution »
Ce document descriptif présente la position des économistes les plus libéraux, les néoclassiques contemporains, par
rapport à l’intervention de l’État et à l’impôt.
Ils préconisent un désengagement de l’État dont le rôle économique doit être minimum. Il doit veiller aux règles de la
concurrence et, pour le reste, « laisser faire » les agents privés et le marché.
Économistes de l’offre, ils considèrent que c’est la rentabilité de l’offre qui conditionne la bonne santé de l’économie.
En intervenant, l’État provoque des déséquilibres et des effets d’éviction en empêchant les agents privés d’arbitrer
rationnellement l’usage qu’ils font de leurs ressources (en, capital, en travail, en revenus).
Ils critiquent en outre la redistribution qui déresponsabilise les individus, taxe ceux qui « réussissent », désincite à
l’activité et au travail.
Questions par rapport au sujet :
- La faiblesse (relative) de la croissance et la persistance d’un chômage massif tiennent-elles à un excès
d’étatisme et de fiscalité ?
- Réduire le poids de la fiscalité est-il de nature à relancer l’économie et l’emploi ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%