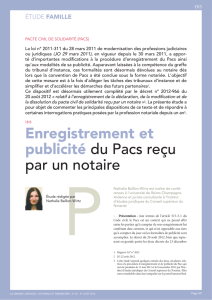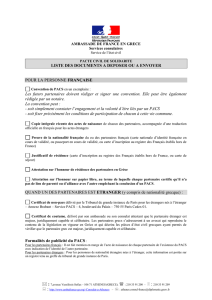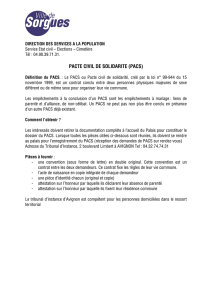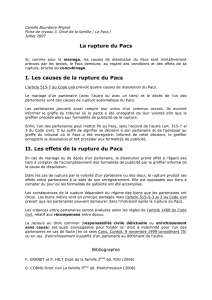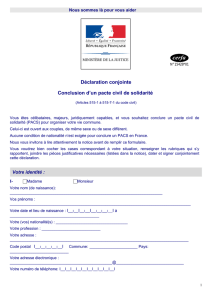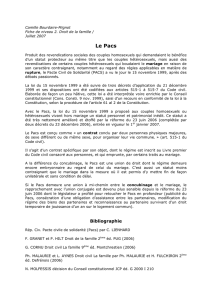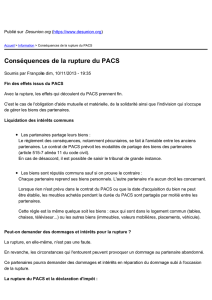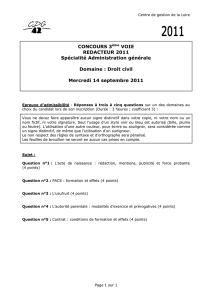Le PACS - sedillot et dumas notaires associes

Le PACS
Les renseignements contenus
dans la présente notice ont pour
but d’attirer votre attention
sur les points les plus importants
du sujet qui vous intéresse.
Pour de plus amples informations,
consultez votre notaire.
12, avenue Victoria, 75001 Paris - Tél. : 01 44 82 24 00
www.paris.notaires.fr
Chambre des Notaires de Paris - Direction de la Communication - Mars 2013
Imprimé sur papier recyclé
Retrouvez-nous :
www.paris.notaires.fr
@NotairesdeParis
www.facebook.com/notairesdeparis

23
LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) EST UN CONTRAT
PERMETTANT À DEUX PERSONNES (LES PARTENAIRES),
DE MÊME SEXE OU DE SEXE DIFFÉRENT, D’ORGANISER
LEUR VIE COMMUNE. IL EST CODIFIÉ AUX ARTICLES 515-1 ET
SUIVANTS DU CODE CIVIL.
SI LE PACS CONFÈRE CERTAINS AVANTAGES, IL CRÉE AUSSI
DES DEVOIRS ET DES OBLIGATIONS POUR LES PARTENAIRES.
DE PLUS, LA LOI NE RÈGLE PAS TOUT ; PRÉVOIR DES
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LA CONVENTION
PEUT S'AVÉRER TRÈS UTILE EN FONCTION DE CHAQUE SITUATION.
S’ENGAGER DANS LES LIENS D’UN PACS EST UN ACTE AUX
CONSÉQUENCES IMPORTANTES.
Même si l'intervention d'un notaire n'est pas
exigée par la loi, les conseils de ce professionnel
du droit de la famille et du patrimoine vous
seront très utiles.
QUI PEUT CONCLURE UN PACS ?
La loi exclut la conclusion d’un PACS par certaines
personnes : les mineurs, même émancipés et les personnes
déjà engagées dans les liens du mariage ou d’un PACS.
De même, le PACS ne peut pas être conclu entre ascendants
et descendants (grands-parents, parents, enfants) ou alliés
directs (belle-mère et gendre ; beau-père et belle-fille...)
et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus (frères
et sœurs, oncles/tantes et neveux/nièces).
COMMENT CONCLURE UN PACS ?
Il existe deux formes de patenariat :
■ L’acte sous seing privé : une convention doit être
établie par les partenaires en double exemplaire et déposée
par eux au greffe du tribunal d’instance du lieu de leur
résidence commune. Le greffier enregistre ladite
déclaration de PACS et effectue les formalités de publicité.
■ L’acte notarié : la convention est dite authentique.
Le notaire est seul compétent pour procéder aux formalités
d’enregistrement auprès du tribunal d’instance.
Le notaire qui a établi le PACS procède également à
l’enregistrement de la modification ou de la dissolution
pour cause de séparation, mariage ou décès ainsi qu’aux
formalités de publicité.
La déclaration de PACS est mentionnée en marge de
l’acte de naissance de chacun des partenaires avec mention
du nom de l’autre.
Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger,
cette mention est portée sur un registre tenu au Tribunal
de grande instance de Paris.
Le PACS prend effet entre les parties à compter de son
enregistrement. Il est opposable aux tiers après l’accom-
plissement des formalités de publicité.
PEUT-ON MODIFIER UN PACS ?
Le contenu du PACS peut être modifié d’un commun
accord entre les partenaires. La convention modificative
est remise ou adressée au greffe ayant reçu le pacte initial.
Elle peut aussi être établie par un notaire.
QUI CONSERVE LES CONVENTIONS
DE PACS ?
Le greffier ne conserve ni exemplaire ni copie de la
convention. Chaque partenaire est donc le gardien de
son original. Ainsi, en cas de perte, de vol, de
destruction ou de modification par un seul partenaire,
la preuve du contenu du PACS peut poser des difficultés.
Si le PACS est établi par acte notarié, le notaire
conserve la minute (original). Ainsi, en cas de
nécessité, chaque partenaire peut en obtenir
une copie.
QUELS SONT LES EFFETS DU PACS ?
L’obligation d’apporter une aide matérielle
et une assistance réciproques
La loi prévoit que les partenaires s’apportent une aide

54
matérielle et une assistance réciproques dont les modalités
sont déterminées dans la convention (exemples : versement
d’une somme d’argent mensuelle, mise à disposition de moyens
matériels d’existence comme un logement, participation à
des dépenses de nourriture).
À défaut de précision, l’aide est proportionnelle à leurs
facultés respectives.
La solidarité pour certaines dettes
Les partenaires sont légalement solidaires vis-à-vis des
tiers des dépenses relatives à la vie courante. Chaque
partenaire est alors tenu de la totalité de ces dettes même
si c’est l’autre partenaire qui a engagé la dépense. Ainsi,
l’un comme l’autre peut être poursuivi sur ses gains et
salaires et ses biens personnels. Les dépenses liées aux
besoins de la vie courante sont par exemple les frais de
nourriture, les achats de petit électroménager…
Mais la solidarité ne joue ni pour les dépenses mani-
festement excessives ni pour les emprunts, à moins que
ces derniers ne portent sur des sommes modestes
nécessaires aux besoins de la vie courante.
De plus, les partenaires sont solidaires du paiement
de certains impôts (voir ci-après).
La situation locative des partenaires
En cas de décès ou d’abandon de la résidence commune,
le bail continue au profit de l’autre. Aucune condition
d’ancienneté du PACS ou de durée de cohabitation n’est exigée.
Les conséquences du PACS sur les avantages
sociaux
Le PACS confère certains avantages sociaux, notamment,
la couverture sociale d’un partenaire profite à l’autre.
En outre, le capital décès de la sécurité sociale peut être
versé sous certaines conditions au partenaire.
Mais, la conclusion du PACS fait perdre le droit à l’allocation
parent isolé (API), à l’allocation de soutien familial (ASF)
et à l’allocation veuvage.
Le PACS n’ouvre pas droit à une allocation veuvage en
cas de décès d’un partenaire, ni à une pension de réversion.
Le partenaire de nationalité étrangère ne peut se prévaloir
du PACS pour l’obtention d’un titre de séjour.
Les conséquences fiscales du PACS
D’une part, les partenaires font l’objet d’une imposition
commune à l’impôt sur le revenu, à l’ISF et à la taxe
d’habitation, dès la conclusion du pacte. Ils sont
solidairement tenus du paiement de ces impôts. Ils ne
peuvent en être déchargés en cas de séparation que sous
certaines conditions.
À compter de l’imposition des revenus 2011 à déclarer
en 2012, les pacsés peuvent opter, l’année de la conclusion
de leur PACS, pour l’imposition distincte des revenus
dont chacun a personnellement disposé pendant cette
année. À défaut de justification de cette quote-part, ils
sont imposés chacun sur la moitié des revenus
communs.
L’année de la séparation les partenaires sont imposés
distinctement sur les revenus dont ils ont disposés pendant
l’année, ainsi que sur la quote-part des revenus
communs. À défaut de justification, cette quote-part est
égale à la moitié des revenus communs.
D’autre part, le PACS fait perdre au contribuable le droit
à avoir une part entière au titre du 1er enfant s’il vit seul
avec lui et en assume complètement la charge.
La situation familiale des partenaires
Le PACS n’a aucune conséquence sur la filiation, qu’il
s’agisse des enfants d’un partenaire ou de ceux qu’ils
ont eus ensemble, ni sur l’état civil.
Il ne confère pas de droit au partenaire survivant sur la
succession de l’autre (à l’exception du droit au logement
temporaire).
QUI EST PROPRIÉTAIRE DES BIENS
ACQUIS PENDANT LE PACS ?
Chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il
possédait avant la conclusion du PACS. Mais ils ont intérêt
à dresser la liste de leurs meubles respectifs et à l’annexer
à leur convention.

76
d’être certain que le contenu du testament est conforme
à la volonté de son auteur.
Le partenaire pacsé n’est pas soumis aux droits de succession
pour les décès intervenus depuis le 22/08/07.
Le partenaire survivant bénéficie d’un droit à la
jouissance gratuite pendant un an du logement qu’il
occupe à titre de résidence principale lors du décès et
du mobilier le garnissant.
Si le logement était loué ou en indivision entre le défunt
et une ou plusieurs personne(s) autre(s) que le partenaire,
les loyers ou l’indemnité d’occupation sont remboursés
par la succession au fur et à mesure de leur acquittement.
COMMENT LE PACS PREND-IL FIN ?
Il peut être mis fin au PACS soit par déclaration conjointe
au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel
l’un des partenaires a sa résidence, soit unilatéralement.
Dans ce dernier cas, le partenaire qui prend l’initiative
de la rupture doit en informer l’autre par voie
d’huissier. Une copie de cet acte d’huissier est envoyée
au greffe du tribunal d’instance ayant enregistré le PACS.
Le PACS cesse de produire ses effets entre les partenaires
au jour de l’enregistrement de la dissolution au greffe
et à l’égard des tiers au jour de l’accomplissement par
le greffier des formalités de publicité.
Il est ici précisé que dans le cas où les partenaires ont
fait appel à un notaire pour établir leur convention de
PACS, celui-ci est seul compétent pour enregistrer sa
dissolution pour cause de séparation, mariage, ou décès
ainsi qu’aux formalités de publicité.
Le mariage et le décès de l’un des partenaires mettent
fin immédiatement au PACS.
Les partenaires doivent alors procéder eux-mêmes à la
liquidation de leurs droits et obligations résultant du PACS.
À défaut d’accord, le juge aux affaires familiales peut
être saisi par l'un des partenaires pour statuer sur les
conséquences patrimoniales de la rupture.
Il est possible de prévoir les conséquences de la rupture
dans la convention de PACS, ce qui peut limiter les conflits.
À défaut, et en l’absence de justificatif, ces meubles
pourront être considérés comme étant leur propriété
commune.
Concernant les biens acquis pendant le PACS, ils
appartiennent à celui qui les acquiert (séparation
des patrimoines).
Les partenaires peuvent toutefois choisir de soumettre
leur PACS au régime de l’indivision les biens achetés.
Les biens achetés ensemble ou séparément sont alors
réputés appartenir à chacun pour moitié, sans recours
de l’un contre l’autre au motif d’une contribution inégale
au financement. La loi fixe toutefois une liste de biens
qui restent la propriété exclusive de chacun (exemple :
les biens ou quote-part de biens acquis au moyen de sommes
reçues par donation ou succession).
COMMENT ASSURER L’AVENIR
DU PARTENAIRE ?
Les donations
Le PACS n’est pas un acte de donation. Si les
partenaires le souhaitent, ils doivent se consentir des
donations par un acte distinct de la convention de PACS
et pour cela s’adresser à un notaire. Mais attention, les
donations sont définitives même si le PACS prend
ultérieurement fin.
Fiscalement, un abattement de 80 724 €est accordé
aux partenaires. Cet abattement est remis en cause en
cas de rupture du pacte avant la fin de l’année suivant
celle de sa conclusion pour un motif autre que le mariage
entre les partenaires ou le décès de l’un d’eux.
Au-delà de l’abattement, les droits de mutation à titre
gratuit sont compris entre 5% et 45 %.
Les successions
Les partenaires ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Pour
que l’un puisse avoir des droits dans la succession de
l’autre, la rédaction d’un testament est nécessaire, par
acte distinct de la convention de PACS. Le recours aux
conseils d’un notaire est particulièrement souhaitable afin
1
/
4
100%