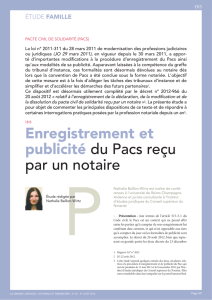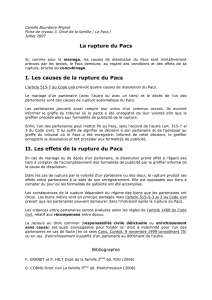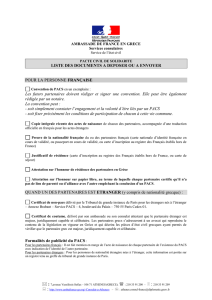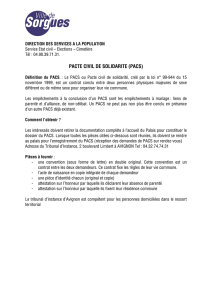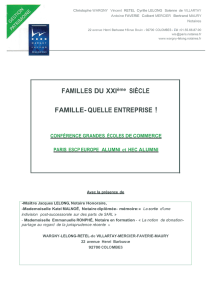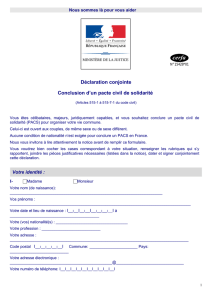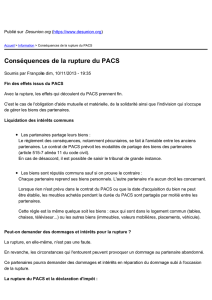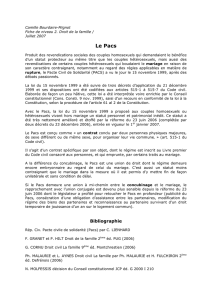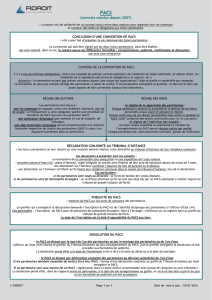MALADIE, HANDICAP

N°451 - Octobre 2015 Mensuel - 4,30 €
DIRECTIVES
ANTICIPÉES
Entretien avec
Jean Leonetti
FAMILLE
La rupture
du Pacs
PAGE 36
IMMOBILIER
Annuler un achat
pour vice caché
PAGE 34
INTERNATIONAL
Vers la fin
de l’adoption
PAGE 40
DOSSIER
MALADIE, HANDICAP
Faites valoir vos droits

Annuler un achat pour vice caché p. 34
Rupture du Pacs p. 36
SOMMAIRE
N° 451
Octobre
2015
OFFRE D’ABONNEMENT p. 32
ÉDITORIAL 5
EN BREF
Immobilier, ce qui change 6
La fausse bonne idée !
Consentir un leg à son médecin
pendant sa maladie 8
Baromètre de l’immobilier
et chiffres utiles 9
Combien ça coûte ?
La rupture du Pacs 11
DROITS DES MALADES
Bilan de santé
Entretien avec Marc Morel 14
Pour accéder à son dossier médical 16
Santé, handicap :
lutter contre les discriminations 18
Les solutions pour assurer son emprunt
Entretien avec Agnès Lecas
et Mehdi Aslam 20
Maladie, handicap,
des aides fiscales adaptées 22
Décryptage :
Mandat de protection future 24
Quand l’hôpital s’invite à la maison 26
Anticiper le pire
pour mieux vivre le présent 28
«Bientôt un modèle
de directive anticipée»
Entretien avec Jean Leonetti 30
Adoption internationale p. 40
IMMOBILIER
Annuler un achat pour vice caché 34
FAMILLE
La rupture du Pacs 36
ASSUNCE-VIE
Contourner les droits
de ses enfants 38
INTERNATIONAL
Vers la fin de l’adoption 40
SOLIDARITÉ
La donation temporaire d’usufruit
au profit d’une fondation 42
ENTREPRISE
Ouvrir une chambre d’hôtes 44
TVAIL
Inaptitude physique
et contrat de travail 46
VOS DROITS
Pratiques commerciales déloyales,
quels recours ? 48
DES LIVRES ET DES MOTS
Notre sélection du mois 50
3
Conseils des notaires - Octobre 2015 - N° 451
Donner au profit d’une fondation p. 42

16 Conseils des notaires - Octobre 2015 - N° 451
DROITS DES MALADES
D
Déménagement, changement de prati-
cien ou besoin d’accéder à certaines
informations. Il n’est pas rare de vouloir
récupérer son dossier médical. Depuis
la loi de 2002 relative aux droits des
patients, toute personne peut accéder
aux informations sur sa santé. Toutefois,
cette demande nécessite de réaliser
quelques formalités.
Un document légal
Nous possédons tous un dossier médi-
cal. Ce support contient toutes les infor-
mations qui concernent la prise en charge
et le suivi du patient. Il est constitué aussi
bien des données de nature administra-
tives, que sanitaires et sociales. Il s’agit
d’un document légal qui fait office de
support de communication. Le conserver
est donc indispensable puisque c’est lui
qui retrace l’historique du traitement du
patient. Les professionnels de santé ont
d’ailleurs l’obligation de veiller à la qualité
de cet outil.
kk
Majeur et mineur,
qui peut y accéder ?
Lorsque la personne est majeure, la
demande d’accès au dossier médi-
cal peut être effectuée par le patient,
le tuteur et le médecin du patient s’il
l’a choisi comme intermédiaire. Dans
le cadre d’un mineur, les parents ou les
représentants légaux sont les seuls à
avoir un droit d’accès. La loi ne prévoit
pas en effet la possibilité pour le mineur
Pour accéder
à son dossier médical
Récupérer ou consulter son dossier médical est un droit fondamental…
accessible à ceux qui en connaissent les règles.
Résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’hospitalisation
et autres correspondances entre professionnels de santé sont accessibles pour le patient.

de consulter lui-même son dossier.
Les textes prévoient cependant un
droit d’opposition à l’accès direct
de ses parents à son dossier médi-
cal, si le mineur en fait la demande.
Ce droit d’opposition peut être total
ou partiel. Dans ce dernier cas, les
parents pourront accéder aux infor-
mations du dossier de leur enfant,
mais uniquement par l’intermédiaire
d’un médecin.
kk
Après le décès
Sauf volonté contraire du défunt, les
ayants droit de la personne décé-
dée peuvent accéder au dossier
médical. Les héritiers doivent
cependant exprimer le motif de leur
demande. Seuls trois motifs sont
reconnus par la loi : connaître les
causes du décès, faire valoir leurs
droits (prouver que le patient n’était pas
sain d’esprit pour contester une dona-
tion ou un testament, par exemple) ou
défendre la mémoire du défunt.
kk
Les pièces consultables
Tout ou partie des pièces du dossier
peuvent être demandées. Il s’agit des
pièces formalisées concernant la santé
du patient, dès lors qu’elles ont contribué
à l’élaboration ou au suivi du diagnos-
tic et du traitement ou à une action de
prévention, ou ont fait l’objet d’échanges
écrits entre professionnels de santé. Il
peut donc s’agir des résultats d’examen,
des comptes rendus de consultation,
d’intervention, d’exploration ou d’hospi-
talisation ou des correspondances entre
les professionnels de santé.
Les démarches écrites ou orales
La demande peut se faire auprès de
son professionnel de santé (médecin,
dentiste, kinésithérapeute…) ou d’un
établissement de santé (hôpital, clinique
privée…). Il n’existe pas d’obligations
quant à la forme que doit prendre cette
demande : écrite ou orale. Cependant,
dans la pratique certaines procédures
sont plus adaptées selon le praticien à
qui l’on s’adresse. Ainsi, par exemple,
lorsqu’il s’agit de son médecin de famille,
un simple appel suffit généralement pour
que la requête aboutisse. Dans d’autres
cas, notamment avec les établissements
de santé, il est préférable de rédiger
un courrier, avec avis de réception. Le
mieux est alors de s’adresser au chef
de service ou au médecin responsable.
Pour faciliter les démarches, le deman-
deur peut préciser dans son courrier
la nature de la demande (information
souhaitée et, si possible, les périodes de
prise en charge). L’identité et la qualité
du demandeur doivent être vérifiées par
le personnel médical, il est donc indis-
pensable de joindre à son courrier une
photocopie de sa carte d’identité et les
éventuels justificatifs quand la demande
ne vient pas du patient : livret de famille,
courrier, acte notarié…
Une consultation gratuite
À compter de la date de réception de la
demande, le destinataire a huit jours pour
communiquer les documents demandés.
Si la date des dernières pièces détenues
(clôture du dossier) remonte à plus de
cinq ans, le délai est alors rallongé à
deux mois. Le délai d’accès ne court
qu’à partir du moment où la demande est
complète (pièce justificative d’identité et
de qualité).
La consultation du dossier peut se faire
soit directement sur place gratuitement,
soit par envoi. Dans ce cas, une somme
peut être demandée, mais celle-ci ne doit
pas excéder les frais de reproduction et
d’affranchissement.
Que faire en cas de refus ?
Lors d’un refus ou retard dans la trans-
mission du dossier, le plaignant dispose
de deux mois pour saisir la Commis-
sion d’accès aux documents adminis-
tratifs (CADA), s’il s’agit d’un hôpital ou
d’une clinique. L’organisme a un mois
pour émettre un avis et le transmettre
à l’établissement concerné. Toutefois,
la CADA n’est pas compétente en cas
de refus venant d’un médecin libéral
ou d’une clinique privée. Dans ce cas,
il est possible de saisir la commission
interne de l’établissement concerné. Si
la réponse reste négative, il pourra se
retourner vers la direction générale de
l’offre des soins (DGOS), du ministère
en charge de la santé. Lorsqu’il s’agit
d’un praticien libéral n’exerçant pas au
sein d’un établissement, il est possible de
se retourner vers l’Ordre des médecins.
Dans tous les cas, si le refus persiste,
le patient peut saisir le tribunal adminis-
tratif du lieu de résidence du cabinet du
praticien.
Magali Sennane
17
Conseils des notaires - Octobre 2015 - N° 451
Dans un souci de préservation
des proches du patient, les
pièces qui impliquent des personnes
qui n’interviennent pas dans la prise
en charge thérapeutique ne peuvent
être communiquées. Ainsi, des révé-
lations faites par des membres de
la famille, comme une situation de
maltraitance, des conduites à risque
ou un conflit familial, ne peuvent pas
être divulguées.
Des informations
non communicables
Mis en place en 2011, le dossier médical personnel (DMP) est un dossier médi-
cal informatisé destiné à accompagner le patient tout au long de sa vie et à
faciliter la coordination des soins entre les différents praticiens. Ce dossier est ainsi
consultable sur internet par le patient. Autrement, seuls les professionnels de santé
autorisés par le patient (médecin, infirmier, pharmacien…) peuvent y avoir accès.
Ce dossier concentre donc en un seul et même endroit toutes les informations
relatives au parcours médical : antécédents, allergies, résultats d’examens, radio-
graphies, etc. Le DMP peut se créer à l’accueil des établissements de santé ou lors
d’une consultation, à condition qu’ils disposent des outils informatiques adaptés.
Le dossier médical personnel
© mediaphotos

DROITS DES MALADES
P
Pourquoi La Ligue a-t-elle créé
le service Aidea ?
Tout partait d’un constat très simple.
Quand une personne a souffert d’une
maladie grave, du type cancer, assurer
son emprunt est particulièrement compli-
qué ou coûteux. Malgré la convention
AERAS* qui a offert de nouvelles pers-
pectives aux anciens malades en termes
d’accès au crédit et à l’assurance, le
parcours demeure difficile. Les dispo-
sitions de la convention sont souvent
mal maîtrisées par les établissements
bancaires et les emprunteurs ignorent
les rouages du système. Nous sommes
donc là pour les renseigner et les guider.
Quel est le profil des personnes
qui vous contactent ?
La majorité des appels concerne des
personnes âgées de 30 à 50 ans qui à
l’instar du reste de la population dans
cette tranche d’âge, souhaitent emprun-
ter pour réaliser un projet immobilier,
professionnel, de travaux ou souscrire
un prêt à la consommation. La pathologie
la plus souvent rencontrée est le cancer
du sein.
Concrètement, comment
procédez-vous ?
Il suffit d’appeler le 0810 111 101 (prix
d’un appel local depuis un poste fixe) et
de taper « 2 » pour être mis en relation
avec un conseiller technique. Le service
est gratuit, confidentiel et anonyme. Pour
chaque appelant, un numéro de dossier
est attribué. Nous sommes deux dans le
service, issus du secteur de la banque
et de l’assurance.
La première étape consiste à recueillir
toutes les données du dossier : type
d’emprunt, montant, situation person-
nelle, pathologie, date de fin de traite-
ment, âge… Ensuite, il ne s’agit pas pour
nous de prospecter pour trouver une
assurance ou un établissement bancaire
mais de conseiller sur les différentes
options dont les personnes disposent
afin de faire aboutir leur projet. Nous
donnons également des informations
sur les documents médicaux à mettre en
avant dans la constitution de leur dossier
à l’attention des compagnies d’assurance
afin qu’il soit le plus complet possible. Et
nous répondons à tous types de ques-
tions, l’une des plus fréquentes concer-
nant les risques encourus en cas de
fausse déclaration dans le questionnaire
santé de l’assureur.
Justement, quels sont-ils ?
Cette position peut s’avérer très dange-
reuse. En cas de problème de santé non
déclaré, non seulement votre contrat
d’assurance sera résilié de plein droit
mais vous pouvez de surcroît être
condamné à payer la totalité des primes
restantes. Parallèlement, l’octroi et le
maintien du prêt étant souvent condi-
tionnés à l’obtention de l’assurance, en
cas de fausse déclaration, la banque
peut vous demander le remboursement
de l’intégralité de l’emprunt. Il faut égale-
ment savoir que dans 99 % des cas les
fausses déclarations sont détectées par
les organismes d’assurance.
Emprunter sans assurance,
est-ce possible ?
Oui, aucune loi n’impose la souscription
d’une assurance pour emprunter. Cette
pratique des banques s’est développée
dans les années 70 sur le modèle de
l’assurance décès. Les banques en sont
adeptes car cela leur garantit un paie-
ment rapide. Avec l’hypothèque, la vente
Les solutions
pour assurer son emprunt
Créé en 2006, Aidea est un service gratuit proposé par La Ligue contre
le Cancer pour aider les personnes, ayant souert d’un grave problème
de santé, à assurer leur emprunt. Le point avec Agnès Lecas, déléguée
aux actions pour les malades, et Mehdi Aslam, conseiller technique.
20 Conseils des notaires - Octobre 2015 - N° 451
Aidea
Tel : 0810 111 101 (prix d’un appel
local à partir d’un poste fixe)
E-mail : aidea@ligue-cancer.net
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
www.ligue-cancer.net
Pour en savoir plus
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%