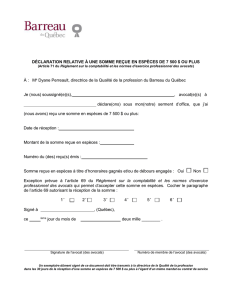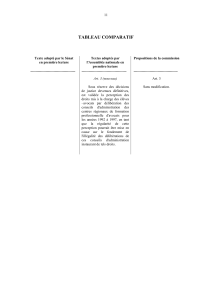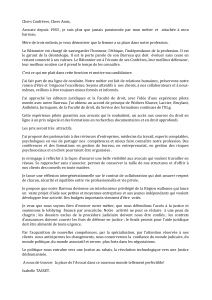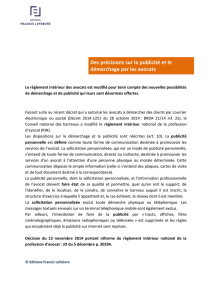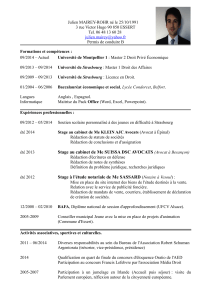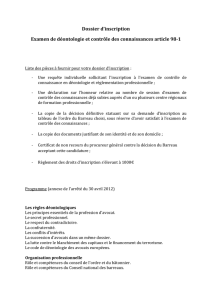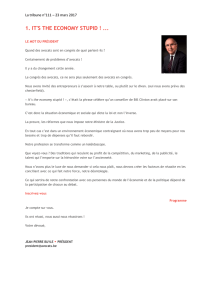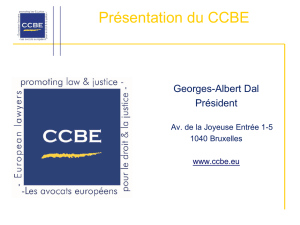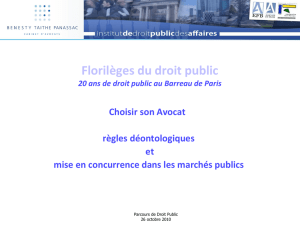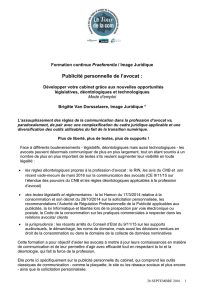Les professions réglementées

A usage officiel DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
Organisation for Economic Co-operation and Development
31-May-2007
___________________________________________________________________________________________
Texte français seulement
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES ENTREPRISES
COMITÉ DE LA CONCURRENCE
Groupe de travail n° 2 sur la concurrence et la réglementation
COMPETITION RESTRICTIONS IN LEGAL PROFESSIONS
-- France --
4 June 2007
The attached document is submitted by the delegation of France to Working Party No. 2 of the Competition
Committee FOR DISCUSSION under item III of the agenda at its forthcoming meeting on 4 June 2007.
Please contact Mr Sean Ennis if you have any questions regarding this document [phone number: +33
1 45 24 96 55; Email address: sean.ennis@oecd.org].
JT03228208
Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine
Complete document available on OLIS in its original format
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
A usage officiel
Texte français seulement

DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
2
1. Reglementation à l’entrée/Regulation of entry
1.1 Quality standards an entry
1.1.1 Accès à la profession
1. Le niveau requis pour accéder à la profession d’avocat est la maîtrise en droit ou un titre ou
diplôme reconnu comme équivalent. Ce diplôme est exigé quel que soit le type de services fournis
(postulation, représentation etc.). Nécessaire, ce niveau n’est toutefois pas suffisant, et doit être
complété, :t par une formation spécifique dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats
(CRFPA)
2. L’accès à cette profession peut également se faire par un système dit « de passerelle » bénéficiant
à certains professionnels justifiant d’une expérience juridique de plusieurs années.
3. L’accès aux CRFPA n’est soumise à aucun « numerus clausus » mais les impétrants doivent subir
un examen d’accès (CRFPA) et un examen de sortie (CAPA – certificat d’aptitude à la profession
d’avocat).La formation comprend des éléments théoriques et pratiques et dure 18 mois. Le programme de
formation et d’examen est arrêté par le Garde des Sceaux après avis du Conseil National des barreaux
(arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession
d’avocat). Les CRFP ont la qualité d’établissements d’utilité publique dotés de la personnalité morale en
application de la loi n°71-1130, article 13 modifié. L’examen final (CAPA) peut être représenté en cas
d’échec. En ce qui concerne la formation continue, le Conseil National des barreaux est chargé de définir
les principes d’organisation de la formation et d’en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle
les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, il détermine les conditions
générales d’obtention des mentions de spécialisation. La formation continue est obligatoire pour les
avocats inscrits au tableau de l’ordre. Un décret en Conseil d’État détermine la durée et la nature des
activités susceptibles d’être validées au titre de la formation continue. Le conseil national des barreaux
détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.
1.1.2 Conditions d’exercice
4. Hors les cas de prestations occasionnelles effectuées par des avocats établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne, l’exercice de la profession est subordonné à une inscription dans
un barreau. Les barreaux, établis auprès des tribunaux de grande instance, ont la faculté de se regrouper.
Chaque barreau est présidé par un bâtonnier élu par ses pairs pour deux ans et administré par un conseil de
l'ordre.
5. Une fois leur inscription autorisée par le conseil de l’ordre, les nouveaux avocats prêtent serment.
6. Le Conseil national des barreaux, instance nationale, est composé de représentants élus de la
profession. Il a vocation à harmoniser des règles de formation, unifier les règles et usages de la profession
et la représenter auprès des pouvoirs publics.
7. Il n’existe pas de « numerus clausus » ni local, ni national pour la profession d’avocat. Il en va
différemment pour les charges des officiers publics ministériels comme les avocats au Conseil d’Etat et à
la Cour de cassation (dont le ministère est obligatoire devant les cours suprêmes et qui dépendent d’un
ordre différent) les huissiers, les avoués à la cour d’appel (qui ont le monopole de la postulation devant les
cours d’appel), les greffiers des tribunaux de commerce, ou les notaires.

DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
3
8. Pour les huissiers le niveau exigé est la maîtrise en droit, suivi d’une formation au département
de formation des huissiers (2 années de stage) sanctionnée par un examen professionnel. Il existe aussi
l’École nationale de procédure qui forme tous les membres de la profession (huissiers et clercs). Le
ministère de tutelle est également celui de la justice et les chambres départementales des huissiers ont une
compétence de régulation. Les créations et suppressions des offices d’huissiers sont organisées par la
Commission de localisation des offices d’huissiers (CLHU), qui se réunit régulièrement sous la présidence
des services du ministère de la Justice. la DGCCRF y participe avec voix délibérative. Le maillage
concurrentiel est analysé au cas par cas et la protection du justiciable en matière d’accès à la justice
constitue une priorité. Une structure similaire existe aussi pour les offices de notaires (CLON).
9. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse peuvent exercer la profession
d’avocat dans les mêmes conditions que les nationaux. Les ressortissants des autres Etats sont admis
lorsqu’il existe des accords bi-latéraux de réciprocité et peuvent, dans certains cas, subir un examen de
contrôle de leurs connaissances En revanche, une condition de nationalité perdure pour les huissiers (décret
75-770 du 14 août 1975 modifié sur condition d’accès à la profession d’huissier), les notaires et les
greffiers des tribunaux de commerce, compte tenu de leur qualité d’officiers ministériels.
1.2 Exclusive rights
10. La profession d’avocat a le monopole de l’assistance et de la représentation des parties en justice
(article 4 de la loi de 1971). Les atteintes à ce monopole sont sanctionnées pénalement (loi n°71-1130 du
31 décembre 1971 art 72). Ce monopole comporte quelques exceptions en ce qui concerne notamment la
représentation des parties devant les tribunaux de commerce, les tribunaux d’instance, et les conseils des
prud’hommes.
11. La loi ne crée pas de monopole de la consultation juridique et de la rédaction d’actes sous seing
privé à leur profit, toutefois l’exercice à titre habituel et rémunéré de cette activité reste strictement encadré
tant au niveau des compétences requises que des modalités d’exercice (loi 71-1130 art 54 à 66-3 modifiés).
Ainsi les principales autres professions juridiques, avocats aux conseils, avoués, notaires, huissiers,
administrateurs et mandataires judiciaires disposent aussi, dans le cadre des activités définies par leurs
statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé
pour autrui. De même, les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée tels que les
architectes, experts comptables, géomètres experts, commissaires aux comptes, , agents immobiliers
peuvent dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations
juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent
l’accessoire direct de la prestation fournie. Pour les professions réglementées cette compétence résulte des
textes les régissant, pour les autres professions ou organismes autorisés à exercer à titre accessoire la
compétence juridique appropriée résultent d’un agrément ministériel donné après avis d’une commission.
Les professions juridiques au sens de l’article 56 à 58 de la loi de 1971 sont réputées posséder cette
compétence.
12. Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes,
faire des notifications prescrites par la loi et les règlements lorsque leur mode de notification n’a pas été
précisé et assurer l’exécution des décisions de justice (Nouveau code de procédure civile art 653 et
suivants).
13. Les huissiers peuvent procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances. En
matière de recouvrement amiable ils se trouvent toutefois en concurrence avec les sociétés de
recouvrement amiable de créances. Les huissiers de justice peuvent habiliter un clerc à procéder aux
constats dressés par les particuliers. Ils peuvent aussi exercer des activités accessoires d’administrateur

DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
4
d’immeuble et d’agent d’assurance après autorisation du procureur général de la cour d’appel. Ils peuvent
donner des consultations juridiques (cf. supra).
14. La pluridisciplinarité et les « one stop shop » sont possibles sous réserve que les règles
déontologiques relatives au respect du secret professionnel et des conflits d’intérêts soient respectées.
15. Le choix d’un avocat est entièrement libre. Il n’existe pas de compétence territoriale pour la
plaidoirie. En revanche, selon la loi du 31 décembre 1971 les avocats doivent respecter le principe de
territorialité pour les actes de représentations, ce qui peut nécessiter le recours à un avocat postulant.
16. Les actes de procédure en cause d’appel sont assurés en monopole par les avoués à la cour
d’appel qui sont des officiers ministériels nommés par le Garde des Sceaux.
17. Le Ministère d’un avocat aux Conseils est obligatoire devant la Cour de cassation, sauf dans les
cas où la loi en dispose autrement, et devant le Conseil d’Etat en matière de cassation (sauf deux
exceptions : les pensions et l'aide sociale).
18. Les huissiers ont en principe une compétence limitée au ressort du tribunal d’instance mais il
existe de nombreuses exceptions, cette situation est en train d’évoluer vers une compétence au niveau du
tribunal de grande instance (à compter du 1er janvier 2009), ce qui faciliterait le choix du justiciable et
ouvrirait la concurrence.
2. Regulation and market conduct
2.1 Fees
19. Les prix sont entièrement libres en ce qui concerne la profession d’avocat. La loi pose le principe
de la libre fixation par accord entre l’avocat et le client du montant des honoraires. Toute entente
corporatiste à cette liberté est contraire à l’ordre public économique. La publication de barème
d’honoraires est notamment proscrite comme une entrave à la libre concurrence. Plusieurs décisions du
Conseil de la Concurrence ont sanctionné de telles publications constitutives d’ententes. Les instances
ordinales n’interviennent plus dans ce domaine.
20. Il existe toutefois une exception pour les frais de postulation qui font l’objet d’une tarification,
ainsi que ceux liés à l’aide juridictionelle.
21. Les tarifs des huissiers sont réglementés par décret du Ministère de la justice. Pour les activités
sous monopole les tarifs sont réglementés par le décret du 12 décembre 96 modifié le 10 mai 2007, pour
les autres activités les honoraires sont libres.
22. Le calcul de la rémunération des avocats se fait principalement selon trois techniques :
• le taux horaire (le temps passé * par prix à l’heure), le forfait, l’abonnement (surtout pour les
entreprises) et un pourcentage sur les résultats obtenus, si cet honoraire de résultat est prévu
dès le départ.
23. La convention d’honoraires, discutée préalablement à tout engagement de procédure, est
largement encouragée par certains membres de la profession (ex : groupe GESICA – regroupement
d’avocats) et par les organismes de protection des consommateurs (Conseil National de la Consommation,
associations de consommateurs et d’usagers). Elle n’est toutefois pas obligatoire.

DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
5
24. Le bâtonnier est compétent pour régler les litiges en matière de contentieux d’honoraires. Les
chambres départementales d’huissiers sont compétentes pour les litiges de cette nature concernant leur
profession.
25. Il existe un système d’aide juridictionnelle en France, basé sur des conditions maximales de
ressources. L’aide juridictionnelle peut être partielle ou totale suivant les ressources du demandeur. Les
représentants de la profession d’avocat militent activement pour le relèvement du plafond des ressources
afin d’élargir le champ des bénéficiaires, ainsi que pour l’augmentation des tarifs de la rétribution de
l’avocat pour son intervention. Cette indemnité est fixée dans son montant et versée par le barreau qui
reçoit de l’État une dotation globale. Le montant de la dotation résulte d’une part du nombre de missions
d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient
par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Les coefficients sont fixés par décrets et l’unité
de valeur est déterminée chaque année par la loi de finances. Les prestations fournies avant que le client ait
obtenu l’aide juridictionnelle doivent être honorées par le client.
2.2 Advertising
26. Le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat a assoupli
les règles de publicité pour la profession d’avocat, même si le démarchage et la sollicitation active restent
prohibés. Les règles relatives à la publicité personnelle ont encore été assouplies, sous réserve de respecter
« les principes essentiels de la profession » (cf. également l’article 10 du règlement intérieur national
n°2005-003 érigé par le CNB). Des lignes de conduites sont ainsi préconisées en matière de papier à
lettres, cartes de visites, plaquettes, certifications, insertions dans les annuaires, publicité sur Internet etc.
27. Les mentions professionnelles et les indications sur les spécialités sont encouragées. Il n’y a pas
de publicité sur les prix à proprement parler, mais les taux horaires peuvent être mentionnés. La mention de
la coopération avec d’autres cabinets extérieurs est possible. La publicité comparative n’est pas admise ni
le démarchage actif.
28. Les huissiers n’ont pas le droit de faire de la publicité directe ou indirecte. Seules sont en principe
autorisées les publicités « fonctionnelles », c’est à dire relatives à la profession dans son ensemble. Dans la
pratique, un grand nombre d’offices dispose d’un site Internet, ce qui a conduit la Chambre nationale des
huissiers de justice à publier des conseils et des avertissements en matière d’information sur les sites
Internet : le site Internet doit être conforme aux règles édictées par le règlement intérieur des chambres
départementales, et respecter quelques indications d’ordre géographique, pratique et graphique. Le contenu
des sites est théoriquement soumis pour approbation à la chambre nationale mais il est difficile de savoir
dans quelle mesure cette procédure est effectivement respectée.
29. Les notaires n’ont pas le droit de faire publicité de leur personne et comme les huissiers ont le
droit de faire de la publicité fonctionnelle.
2.3 Partnerships and business organisation
30. Les avocats comme les huissiers peuvent exercer individuellement ou en sociétés. Ces sociétés
peuvent être des sociétés de personnes ou des sociétés de capitaux. Les avocats qui désirent se grouper
pour exercer ensemble leur profession peuvent soit conclure « un contrat d’association », soit constituer
une société civile professionnelle, soit une société d’exercice libéral (loi du 31 décembre 1990) ou une
société en participation d’avocats (loi du 31 décembre 1990). Les avocats peuvent également être membres
d’un groupement d’intérêts économique ou d’un groupement européen d’intérêts économique.
31. La pluridisciplinarité est autorisée dans certaines limites. L’article 16 du règlement intérieur
national (RIN) des avocats précité donne la définition des réseaux et autres conventions pluridisciplinaires.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%