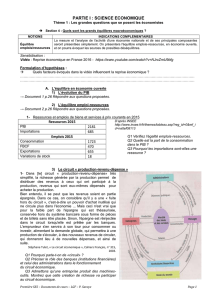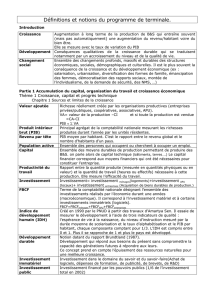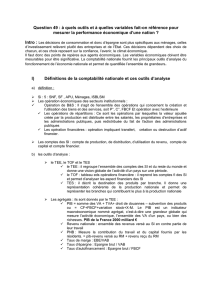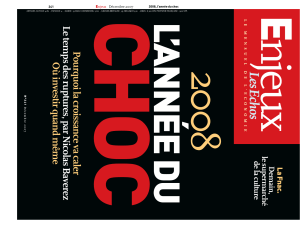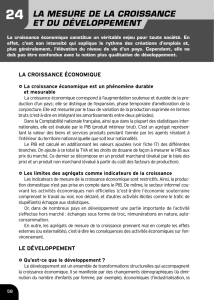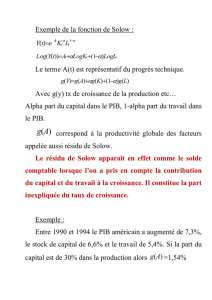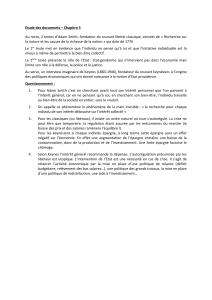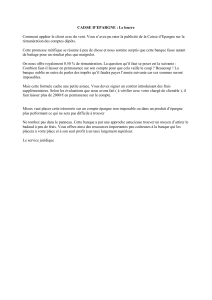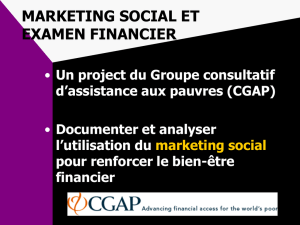Economie du développement : croissance et - Sen

Economie du développement : croissance et
développement
Présenté par : Dieynaba DIALLO, Fatou FAYE, Serigne Mohamadoul Abib FALL

CHAPITRE 5 : CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT
SECTION I : APERCU SUR LES THEORIES DE LA CROISSANCE
La croissance économique est généralement définie comme
l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues de
la dimension et de la structure d’une économie. Cette dimension, à
l’echelle de la nation, est mesurée par deux indicateurs: le Produit
Interieur Brut (PIB) et le Produit National Brut (PNB).
Evaluation du Produit National Brut : avantages et limites
L’analyse à laquelle procèdent Kuznets et Chenery est expérimentale. Ils rapellent que
le PNB est la somme de la valeur des produits finis et de services générés par une
société pendant une année donnée, à l’exclusion des biens intermédiaires (biens
utilisés à la production d’autres biens), en incluant les salaires et les profits engrangés
a l'étranger.
Le Produit Intérieur Brut est semblable au PNB, si ce n’est qu’il inclut tous les
revenus générés à l’intérieur des frontières d’un pays, y compris ceux des résidents
étrangers, mais exclut les salaires et les profits gagnés par les ressortissants du pays à
partir des sources étrangères.
Pour qu’il y ait croissance, il faut non seulement qu’il y ait augmentation de la
production, mais aussi que ce mouvement ascendant soit durable et non aléatoire (on
parle parfois de croissance pour traduire le mouvement d’augmentation de la
production à court terme, le terme approprié dans ce cas est expansion). La croissance
s’accompagne de changements de structure, des modifications des conditions de
production : investissement en hausse, modification des qualifications de la main
d’oeuvre, incorporation du progrès technique par les machines nouvelles, nouvelles
habitudes de consommation, modifications des anticipations des entrepreneurs, et
s’accompagne également des mutations sectorielles.
Approche par le produit
L'approche par le produit présente certains avantages. En effet, elle permet d’englober
la totalité de l’activité économique nationale dans statistiques resumées et cohérentes :
elle offre une technique rationnelle pour aditionner des tendances différents.
Si elle présente des avantages, la notion de PIB comporte également des
inconvénients inportants en particulier, lorsqu’il s’agit de comparer des schémas de
développement d’un grand nombre de pays en développement.

La première limite est relative à la disponibilité des données dans certains secteurs
tels que l’artisanat, l’argriculture. Dans une économie où coexistent deux secteurs : un
secteur traditionnel et un secteur moderne comme c’est le cas dans la plupart des pays
en développement, la collecte des données fiables pose un gros problème. Seules les
enterprises industrielles et minières offrent des statistiques relativement fiables.
En outre, des problèmes de méthodologie de base font aussi obstacle. La méthode de
calcul approprié du PNB consiste à totaliser tous les biens et services qui, produits par
un pays, sont ensuite vendus sur le marché. Or pour additionner des produits
différents, deux possibilités s’offrent:
- soit appliquer le prix auquel les produits sont vendus sur le marché,
soit appliquer le coût de tous les facteurs de production.
IL faut signaler que plusieurs apports utiles à la société sont exclus du PNB ; par
exemple, une large part de la production agricole sert à la consommation des membres
de ce secteur d’exploitation et n’atteint jamais le marché.
Ces difficultés de mesure du PNB rendent cette méthode quelque peu arbitraire et
donc les conclusions qui en découlent ne peuvent être fiables.
Pour comparer l’évolution du PNB de plusieurs pays il est commode de prendre une
monnaie de référence : c’est le dollar en général. Pour y parvenir, on utilise le Taux de
Change Officiel (TCO). Par ailleurs les taux de change des pays en développement
subissent fréquemment de fortes distorsions. Enfin la prise en compte des biens non
échangeables, c’est-à-dire ne donnant pas lieu aux échanges internationaux, dans le
calcul du PNB pose un problème de méthodologie. Néanmoins, on peut surmonter ce
problème de comparaision entre pays en calculant le taux de change fondé sur la
Parité des Pouviors d’Achat. En outre l’évolution des prix et le choix d’une année de
base peuvent biaiser l’évaluation du PNB selon que l’on utilise les prix enrégistrés
telle ou telle année
La production arachidière ou rizicole du Sénégal peut augmenter brusquement du fait
de nouvelles conditios climatiques ou d’une hausse des cours de ces deux produits,
accroisssant ainsi la production nationale, mais cet accroissement de la production,
qu’un hazard climatique ou une chute des cours peuvent effacer le lendemain, n’est
synonyme de croissance. On parlera de croissance si l’augmentation de production
est le fait de nouvelles techniques, de l’amélioration des qualifications de travail,
d’investissements supplémentaires, etc.
Le développement économique dans les PVD
Les pays en voie de développement ont aussi connu une croissance
économique rapide après la Seconde Guerre mondiale. Dans le groupe des économies
à revenu intermédiaire (où le revenu par habitant se situait entre 600 et 6 000 dollars

en 1990), le PIB par habitant a pu croître en moyenne de 2,3% entre 1965 et 1989.
Mais dans cette tranche hétérogène, on trouve des situations très contrastées : dans la
période considérée, la croissance par habitant fut négative au Sénégal et au Pérou
(respectivement –0,7% et –0,2%), alors qu’elle était forte en Malaisie (+4%) ou en
Corée du Sud (+7%). A côté des facteurs de dynamisme ou de blocage propres à
l’histoire, à la géographie et à la structure sociopolitique de chaque société, la
poussée démographique a joué un rôle important. En effet, un accroissement trop
èlevé de la population réduit considérablement les effets à court terme de la
croissance économique sur le niveau de développement du pays : ainsi, la population
du Sénégal augmentait de 2,9% par an entre 1965 et 1980, alors que dans le même
temps, le PIB ne progressait que de 2,1%; le niveau de vie moyen des sénégalais ne
pouvait donc que se détériorer. On retrouve le même phénomène dans la plupart des
pays en voie de développement à faible revenu (revenu par tête inférieur à 500 dollars
en 1990) mais à forte croissance démographique, comme le Congo, Madagascar ou la
Mauritanie
I – Les théories de la croissance
Le monde des théories de la croissance est varié et complexe avec beaucoup de
nuances dans les formulations. Tous les théoriciens, quelles que soient leurs
sensibilités particulières partagent :
-une analyse du sous- developpement menee en termes quantitatifs et d’économiste ;
-une approche méthodologique de modélisation du processus de croissance
économique ;
-une politique économique de croissance non pas optimum, mais celle qui
pourrait être la plus souhaitable parmi celles qui sont possibles.
L’analyse de ces trios élèments permet d’evaluer les contours des théories qui
portent à la fois les instruments et les politiques économiques.
L’approche quantitative se veut une analyse du sous-dévéloppement qui se
fonde exclusivement sur des critères quantitafiables. Pour beaucoup d’auteurs, cette
méthode presente au moins deux avantages. D’une part, face à l’extrême
enchevêtrement des faits, la théorie doit privilégier ceux qui sont les plus édifiants,
les plus décisifs, finalement ceux qui peuvent être quantifiables. Cette caractéristique
finit par leur conférer une valeur intrinsèque incontestable. D’autre part, la demarche
mettant en avant des faits mesurables, répond à un souci d’objectivité et
d’impartialité doctrinale car en définitive, elle se borne à rassembler des faits, à faire
un bilan des certitudes. Elle pourrait alors pense-t-on fournir une base commune à
tous les économistes, quelle que soit leur orientation idéologique. Cet empirisme a
fait qu’en fin de compte, cette forme d’analyse a permis de rassembler un materiau
statistique extrêment appréciable sur les pays en voie de développement.
De cette analyse, il resulte au moins deux conséquences qui déterminent la

suite de l’approche quantitative. La première conséquence est que derrière une
apparente diversité, les faits établissent une unité profonde de pays en développement
qui partagent les caractéristiques communes suivantes :
-une économie primaire dominée par des activités agricoles ou minières
souvent valorisées sur le marché mondial;
-une base industrielle réduite avec un modèle d’industrialisaton fonctionnant en
circuit fermé;
-une pauvrète importante qui se révèle dans les faibles revenus réels par tête
d’habitant;
-un sous-emploi massif faisant de ces pays des zones de chômage;
-enfin, une économie duale avec juxtapositon de deux secteurs
moderne et traditonnel informel obéïssant chacun à des centres de décisions
autonomes et surtout de très faibles liens.
II - Le modèle de LEWIS
En voulant adopter la théorie de croissance aux problèmes des pays en voie de
développement, Arthur LEWIS proposa de prendre en compte le caractère dual de ces
sociétés, où coexistent un secteur traditionnel, avec un surplus de main-d’oeuvre, et
un secteur moderne, capable de se développer grâce à la faiblesse des coûts salariaux
maintenus sous la pression d’une offre illimitée de main-d’oeuvre provenant du
premier secteur. Il espérait ainsi pouvoir dépasser pendant une longue période le
freinage de croissance induit par le plein emploi des factures. Mais, ne pouvant
fonder leur croissance, comme au début de la révolution industrielle européenne il ya
deux siècles, par l’utilisation de technologies simples fondées sur la main-d’oeuvre,
les pays en développement ont vu les modèles de croissance dualiste se heurter, dans
leur mise en oeuvre, aux contraintes de financement.
La seconde conséquence est que ces pays accusent une faible base autonome
d’accumulation et croissance l’établit la quantité impressionnante de matériaux
statistiques rassemblées. Dès lors, s’ils veulent s’en sortir et lever tous les obstacles
qui s’opposent à l’expansion, ils doivent faire de la croissance l’objectif économique
et politique majeur. C’est pourquoi la croissance pour ces pays doit atteindre des
performances. Elle doit y être rapide avec les taux les plus èleves possibles compte
tenu bien sûr des mesures naturelles, financiers et humaines qu’ils peuvent mobiliser.
En outre, la croissance doit être régulière et débarrassée de toute fluctuation trop en
baisse comme en hausse. Enifn,elle doit être équilibrée, c’est-à-dire que les capacités
de production et de consommation doivent correspondre et s’ajuster en permanence.
En d’autres termes. La croissance doit être au premier rang de toutes les
priorités, c’est-à-dire qu’il doit y avoir une augmentation, une articulation des
facteurs de croisssance telles qu’entre deux périodes un agrégat significatif de
l’activité économique soit le plus èleve possible. Que faire pour y aboutir ? Deux
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%