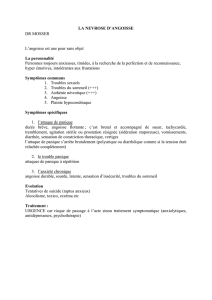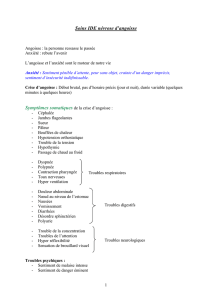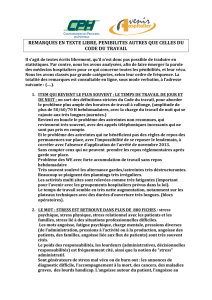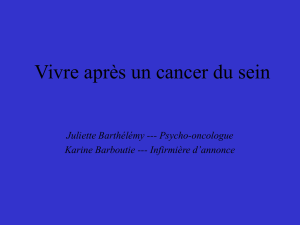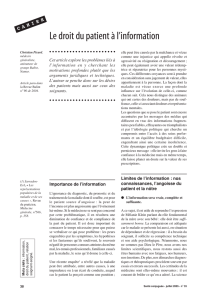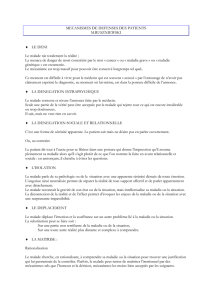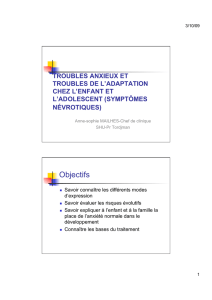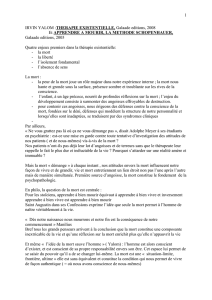L`inhibition par la peur et la débilité

L'inhibition par la peur et la débilité
Je souhaiterais par ces propos éclairer un des aspects de la dynamique inhibitrice qui apparaît bien souvent dans les «
débilités ».
« Débilité » est un de ces mots « auberge espagnole », où l'on trouve ce qu'on y apporte, c'est-à-dire ce qu'on y
projette. A l'origine, il signifie faiblesse. Et on trouve, en effet, chez les « débiles », une faiblesse des mécanismes des
apprentissages, dont la dynamique ne suit pas le cours normal des choses.
11 me semble que l'on n'explore pas suffisamment les rouages déficients de ces mécanismes lors du recrutement et du
suivi des « débiles » à l'Education Nationale. Une fois mieux perçue, mieux visualisée la marche de l'escalier cognitif
où est posé avec tant d'insistance le « débile », peut-être le pédagogue pourraient mieux oeuvrer à faciliter l'accès de
son élève à la marche supérieure.
Pour analyser le problème original de chaque « débile », il est indispensable de situer:
1) Le 0.1. (verbal et performance).
'A) Les stades du développement cognitif (selon Piaget), auxquels il est parvenu (tests spécifiques passations).
3) Les nigauds dynamiques de sa personnalité, par les tests de la sermonnant (TAT, Rorschach, etc ... )a
4) L'histoire précise du sujet depuis qu'il vit (grossesse de la mère comprise), et de son environnement.
1) Les chiffres du Q.I. ont une signification réductrice, figée, aléatoire ; ils ne peuvent mettre en évidence le
potentiel intellectuel et affectif de l'être. Ces chiffres ne fournissent pas d'indication sur les anomalies des
mécanismes d'acquisition des apprentissages peuvent être aisément réduits par les conditions d'examen : les facteurs
relationnels jouent un rôle important dans les performances de l'individu.
Les chiffres ne peuvent acquérir de véritable valeur diagnostique que confrontés aux résultats des tests passations,
ainsi qu'à ceux des tests projectifs.
2) Les tests piagétiens permettent de mettre en évidence les stades du développement de l'intelligence auxquels est
parvenu le sujet.
On sait qu'après une première période d'intelligence intuitive (qui succède elle-même à la pensée magique), suit
normalement vers 7 ans l'intelligence opératoire concrète, puis vers 12 ans l'intelligence opératoire formelle (ou
abstraite).
Dans chacune de ces phases, on détaille nombre d'étapes de capacités logiques, logistiques et stratégiques.
Or, à chacune de ces capacités correspondent les diverses possibilités d'apprentissage, partant des tâches les plus
concrètes et les plus simples aux plus abstraites et complexes.
3) Les tests de personnalité sont essentiellement des tests de projection de la vie affective, tel le TAT et le
Rorschach.
Ces outils sont incomparables pour mettre en évidence des mécanismes affectifs de blocage et d'inhibition qui se
déclenchent dans certaines situations.
13
1

On retrouve ici fréquement chez les sujets « débiles » des réactions de peur intense, de véritable panique, lors de certaines
demandes, quand les schémas d'apprentissage requièrent, chez le sujet, des repères qui lui sont inconnus.
On peut dans ces cas observer que, dans une situation nouvelle de contrainte d'apprentissage, le sujet réagit par un
système défensif, fait par exemple d'évitement phobique ; ou bien par une attitude obsessionnelle stéréotypée ; ou bien
encore par une réaction caractérielle, la peur déclenchant l'agressivité ; ou bien par un effondrement d'ordre dépressif (ce
dernier type de réaction est de meilleur pronostic, car la notion dépressive implique en partie un début de prise de
conscience par le sujet de ses limites actuelles).
Je ne donne ici que quelques cas de figure des processus, des attitudes pouvant être mises en place par le sujet dans ces
situations nouvelles d'apprentissage.
Il s'agit bien sûr d'un chapitre immense, car chacun de ces registres de réactions émotionnelles (telles la phobie,
l'obsession, la colère ou la dépression) s'intrique subtilement dans l'histoire affective intime dès la période intra-utérine
par le sujet.
Ici, il est indispensable de replacer les noeuds d'inhibition mis en évidence par le Rorschach et le TAT dans le contexte
dynamique d'évolution de l'individu, sans quoi ces résultats ne sauraient être correctement interprétés et utilisés ; il est
souvent difficile de faire la part des blocages induits par la. famille et le milieu social, ainsi que par le milieu
d'apprentissage.
4) C'est depuis le stade intra-utérin qu'il est essentiel de situer l'art et la manière avec lesquels chaque sujet a bâti sa
personnalité.
Mon expérience pratique me montre régulièrement combien les problèmes cognitifs et affectifs commencent à une
époque archaïque de la vie.
Les incidents somatiques, organiques sont, bien entendu, les premiers à repérer. Même s'ils n'ont pas entraîné de dégâts
physiques irréversibles, ils sont à l'origine de réactions d'angoisse, souvent lourdes de conséquences pour l'avenir. Plus
l'accident, l'anomalie est ancienne, plus le risque est accentué d'un noeud de blocage psychique répétitif, lié à la peur
archaïque, et plus l'intensité énergétique de ce noeud est grande. C'est dire aussi qu'il est possible de débloquer ces
noeuds, par une aide psychologique et pédagogique adaptée.
Quelles sont les phases-clefs du développement de la première enfance où peuvent plus particulièrement se
développer ces noeuds d'inhibition ?
A mon sens (ceci étant un point de vue personnel), ce sont les « crises », C'est-à-dire les changements brusques que vit
l'enfant, et qu'il vit nécessairement, naturellement. Quelles sont ces « crises » ?
- la naissance,
- l'angoisse dite du huitième mois (décrite par Spitz),
- la période critique entre 6 et 7 ans, qui inaugure la phase des opérations concrètes (selon Piaget),
- enfin la période critique des 11-12 ans, qui tout à la fois voit éclore la phase des opérations abstraites (selon Piaget) et la
transformation pubertaire, avec son cortège de mutations physiques, affectives et sociales qu'Henri Wallon a décrit avec
tant de finesse (qu'on ne me reproche pas un « pastis » des différentes théories ! J'en retire ici les aspects les plus
pragmatiques, les plus opérationnels , d'autre part Je crois, comme Ajuriaguerra, à un avenir où s'élaborera une théorie
des « conflits », laquelle reprendra les trois grandes théories actuelles, de Piaget, Wallon et Freud).
14

Bien entendu, les cinq phases critiques que je viens d'énumérer ne sont nullement exhaustives de l'ensemble de crises
qu'un enfant traverse. Elles sont comme les pics chaotiques d'une traversée mouvementée. Tout notre développement
est fait de ruptures et de réajustements successifs des pièces du puzzle du moi, lequel puzzle se disloque brièvement à
chaque nouvelle information.
Selon la rapidité et la netteté avec lesquelles le moi se reconstitue, l'individu se développera plus ou moins
harmonieusement.
Ces cinq « crises » sont tout particulièrement longues et intenses, émergences marquées des processus invisibles et
permanents qui commandent à notre développement.
Qu'ont-elles de commun ?
A chacune de ces périodes critiques, l'enfant est envahi d'angoisse, et il développe une réaction défensive et
constructive devant cette angoisse. Il s'agit d'un couple d'énergie contraires : angoisse -réaction active.
1) A la naissance, le nouveau-né exprime cette double énergie : on peut considérer la sortie du ventre maternel et de
l'environnement liquide comme la plus grande aventure de la vie ; l'angoisse de l'inconnu est doublée de l'exaltation
de la découverte. Le cri et l'extension du corps de l'enfant à l'air libre sont caractéristiques de cette double dimension.
C'est dire que, dans l'intensité du vécu du nouveau-né, chaque anomalie, chaque incident peuvent être redoutables de
conséquences, à court, moyen ou long terme.
En particulier, ce qui gêne la respiration ou la circulation normale du sang, avant, pendant ou après la naissance peut
entraîner des troubles variables, allant d'une angoisse temporaire simple, sans conséquences à long terme, à des
destructions cérébrales irréver
Chez certains nouveau-nés, les angoisses suffisent, parfois (sans qu'il y ait pour autant trouble du fonctionnement
physiologique du cerveau), pour entraîner des blocages une grande partie de leur vie durant, au moment des « crises »
qu'ils vont traverser.
Il est impossible de préjuger de telles évolutions défavorables au départ de vie de ces enfants. Sur ces questions, nous
n'en savons guère plus que l'homme de la préhistoire face aux mystères de la nature.
2) L'angoisse dite du huitième mois, décrite par Spitz, psychiatre anglo-saxon, se produit entre le 6éme et le 10e
mois environ, et correspond à la prise de conscience du moi de l'enfant, lorsqu'il réalise que sa mère est une réalité
séparée de la sienne : il est, dans cette prise de conscience, envahi par une terrible angoisse, l'angoisse de la solitude
qui l'inonde « mortellement » puisqu'il relie sa peur à son sentiment d'impuissance à agir pour survivre. Tout cela se
passe en deçà de la pensée, et les concepts que j'utilise, telles la solitude, la mort, la survie, cherchent maladroitement
à évoquer ce qui est en fait un vécu global, trouble et diffus.
Le visage de la mère, ses attitudes, ainsi que ceux de l'entourage seront déterminants dans les interactions
d'apprentissage que vivra l'enfant par la suite.
L'enfant développera peu à peu des stratégies de séduction, face au « maître de la -vie et de la mort » que représente
désormais pour lui sa mère (et donc les adultes, ces immenses figures tour à tour souriantes et menaçantes). Mélanie
Klein et Winnicot sont les grands psychanalystes décrypteurs de ces dynamiques.
Ce sont précisément ces stratégies qui augurent, pour l'enfant, de sa capacité cognitive à construire peu à peu des
systèmes de représentation du monde. Il en est comme-d'une partie d'échecs, mais dont l'enjeu est l'autonomisation,
c'est-à-dire la liberté face au pouvoir incommensurable de la mère.
15

Si l'enfant est trop envahi par son angoisse, il aura tendance à se soumettre à sa mère.
Il cherchera à éviter les situations nouvelles sources d'angoisse ; il fera en sorte de conserver le plus possible la
présence de la mère. Il déclenche un processus de débilisation caractérisé doublement par la recherche de la
protection des adultes et le refus des situations nouvelles.
Cette dynamique de limitation du champ de conscience qui vise à conserver une perception simple du monde (la
familiarité chaude et nourrissante des parents), nous la retrouverons dans les phases successives du développement.
3) La période critique de 2 à 4 ans de l'enfant normal est remarquablement décrite par Henri Wallon: c'est celle de
l'opposition et du narcissisme où l'enfant affirme l'omnipotence de son moi : c'est un ensemble de réactions à une
angoisse qui l'envahit lorsqu'il observe dans le miroir la transformation physique rapide que son système hormonal a
normalement déclenchée dans l'organisme, lors de cette période de croissance rapide.
En réaction à sa peur de ne pas se reconnaître, il utilise la pensée magique pour se convaincre de sa toute-puissance.
Lors de cette phase de croissance du corps, l'enfant dit « débile » aura tendance à se replier sur lui-même pour
maintenir le statu quo antérieur.
4) La période, critique elle aussi, de 6-7 ans, correspond chez l'enfant ordinaire à l'accès aux opérations concrètes,
c'est-à-dire les acquisitions des débuts du primaire.
Ici aussi, l'enfant vit une angoisse, plus ou moins consciente, devant ces outils complexes dont il doit impérativement
comprendre et effectuer le maniement (la lecture, l'écriture et le calcul sont des outils).
Le « débile » reproduira plus ou moins les mécanismes défensifs décrits aux phases précédentes, en rêvant par
exemple à sa chaude famille, lorsque l'enseignant lui demande de l'attention.
Est-ce à dire que ce « débile » est incapable d'acquérir les mécanismes cognitifs de ces apprentissages ?
Le problème est avant tout d'ordre émotionnel : il s'agit, dans un premier temps, d'apaiser, de calmer l'enfant, de
lui donner cette sécurisation affective dont il a besoin
il s'agit de le comprendre (comprendre veut dire « prendre avec »).
L'art du pédagogue consiste à créer d'abord un climat de confiance, c'est-à-dire de compréhension de l'autre,
compréhension cognitive et affective, avant de pouvoir transmettre son savoir. Cet art est lié à la maturité du
pédagogue ; il ne s'enseigne pas. On peut tout de même favoriser cette maturation, par la formation du pédagogue à la
connaissance du développement de Fenfant et de l'adolescent.
5) Quant à la phase critique de l'adolescence, elle ressemble par bien des points à la phase des 2-4 ans, par
l'opposition et le narcissisme que développe l'adolescent en même temps que la puberté transforme radicalement son
aspect physique.
Chez les « débiles », la dysharmonie entre l'épanouissement physique pubertaire et la fixation à des stades concrets de
la pensée opératoire crée des difficultés spécifiques, puisque le pédagogue doit concilier une double tonalité
relationnelle, respectant simultanément ce qui est mature et ce qui est immature chez son élève.
Voilà donc brossé ce bref tableau de l'évolution des noeuds d'inhibition de la débilité, à travers les âges de l'enfance.
16

Tableau lapidaire s'il en est, car on pourrait à juste titre le considérer comme scandaleusement simpliste, en regard de
la réalité des « débilités » infiniment plus variée et nuancée que ces quelques traits ne l'indiquent.
Je désirais surtout insister ici sur le processus dynamique de formation des noeuds d'inhibition qui entravent les
démarches d'apprentissage. Ce processus me paraît une constante de la « débilité ».
A décrire ce processus dans sa formation, on peut en déduire que ces noeuds sont mobilisables. A condition de
trouver les conduites à tenir spécifiques à chacun des sujets, et à en observer les effets graduels, aussi faibles
soient-ils au début de la prise en charge pédagogique.
Pour trouver ces conduites, il serait nécessaire, me semble-t-il, de travailler en col- étroite avec des psychologues qui
savent à la fois manier les tests de 01, les tests piagétiens et les tests de personnalité, de sorte qu'ils puissent
caractériser et analyser les types de noeuds propres à chacun des sujets qui bloquent son ouverture au monde logique.
Un point constant cependant ; à la pensée magique des premières années, succède la pensée intuitive, qui permet des
accès passagers à la compréhension logique. Pour l'enseignant qui sait reconnaître le fonctionnement intuitif de son
élève, il pourra plus aisément lui proposer des passerelles vers l'accès à la pensée opératoire.
Pour conclure, je ne saurais trop insister sur le fait que le développement affectif d'un être et son développement
cognitif sont les deux faces d'une seule et même pièce de monnaie -, que l'un ne se développe pas sans l'autre quoi
qu'on dise , que la proposition pédagogique ne peut être réussie de façon « sauvage » lorsqu'on a affaire à des êtres
dits
« débiles », c'est-à-dire présentant une faiblesse, une faille dans leur dynamique d'élargissement du champ de
conscience.
Il est donc indispensable que l'Education Nationale introduise le plus largement possible, dans une formation qui
s'intrique avec une longue pratique sur le terrain, les connaissances de la maturation affective et intellectuelle des
enfants et des adolescents ordinaires, parallèlement à celles des particularités des blocages spécifiques des « débiles
».
Il ne s'agit pas de confondre l'aspect pédagogique avec l'aspect des soins.
En aucun cas, le pédagogue ne peut remplacer le psychothérapeute, l'orthophoniste ou le psvcho-motricien, qui
apportent des soutiens irremplaçables pour le sujet.
Dans le domaine pédagogique, les méthodes de Feuerstein apportent une éclatante Confirmation des possibilités de
déblocage des processus cognitifs chez des adolescents massivement retardés. Ces méthodes sont centrées sur le
respect des zones d'autonomie Et d'auto-organisation des sujets. Le respect de la liberté intérieure est l'âme invisible
qui donne vie à ces techniques.
On commence à enseigner ces méthodes en France : mais elles se frayent difficilerient passage, car elles demandent
un grand investissement de temps, d'intelligence et l'argent pour les enseignants intéressés.
Elles demandent aussi une certaine humilité : celle de prendre conscience de ce que enseignant ne peut guère être
qu'un simple catalyseur, celui qui facilite l'éclosion du 1 euréka ! », de la compréhension chez son élève. Ce sont en
fait des méthodes maïeu- : elles visent surtout à susciter des interrogations fécondes chez l'élève.
Les pédagogues sont-ils tous bien conscients de ce que les efforts qu'ils déploient cour enseigner une « démarche
supérieure » ne sont qu'une simple déperdition d'énergie, s'ils s'adressent à un être qui n'a pas fini d'assimiler la «
marche précédente ».
17
 6
6
1
/
6
100%