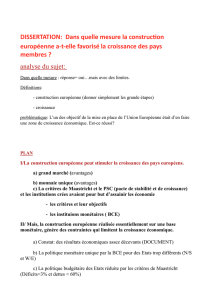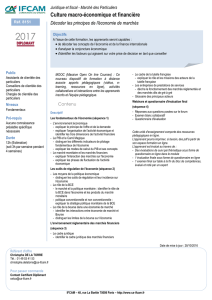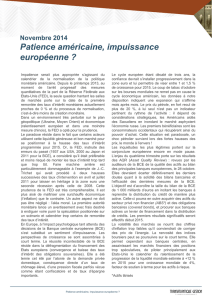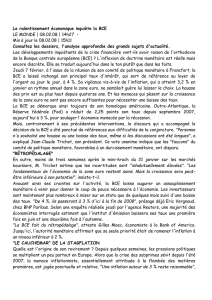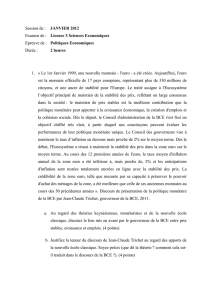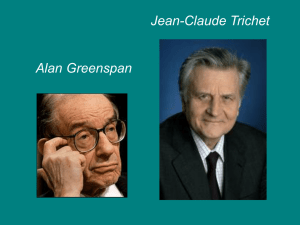Politique monétaire de la BCE : plus de cohérence, plus de

Politique monétaire de la BCE : plus de
cohérence, plus de souplesse, plus
d’efficacité
La montée des critiques contre la politique monétaire de la Banque Centrale
Européenne
Que peut-on attendre de la politique monétaire européenne ? Rien disent les fatalistes, qui
prennent acte de la volonté intraitable de son président qui refuse de baisser les taux d’intérêts
1, ce qui permettrait notamment de soulager les entreprises françaises dont les exportations
sont lourdement pénalisées par la forte appréciation de l’euro face au dollar. Les marchés
financiers européens qui avaient espéré une inflexion de la politique monétaire de la Banque
Centrale Européenne sont également déçus.
La politique de la FED est aujourd’hui à l’opposé de celle de la BCE, et même si la récession
n’est pas certaine, au moins dans les prochains mois, l’onde de choc de la crise du crédit
immobilier aux Etats-Unis (dite des “subprimes” aura nécessairement des répercussions sur
l’activité mondiale. Pour justifier que ces politiques sont aux antipodes, on nous explique
doctement que les situations économiques sont très différentes, mais à l’heure où les Etats-
Unis s’apprêtent à adopter un plan de relance très Keynésien pour soutenir la consommation
intérieure, où les banques d’affaires américaines sont contraintes d’emprunter à leurs clients
asiatiques les fonds qui leur permettront de couvrir leurs pertes, et d’éviter la faillite, on est en
légitimement en droit de se demander : que fait l’Europe ?
Dans une conjoncture qui laisse prévoir une croissance en 2008 inférieure à 2%, et à quelques
mois de la présidence française à la tête de l’Europe, on s’interroge légitimement sur le point
de savoir si la France aura réduit son déficit d’ici là, - sans doute au prix d’une “rigueur”
évoquée récemment à mots couverts dans le Financial Times -, comme elle s’y est engagée
vis à vis de ses partenaires européens.
Si s’en prendre à l’Europe pour masquer des difficultés économiques intérieures est un grand
classique de la politique française, il convient néanmoins de se demander si les critiques
adressées en France à la politique monétaire de la BCE relèvent du tropisme national ou si au
contraire, elles témoignent de l’urgente nécessité d’adapter la politique monétaire européenne
à la nouvelle donne économique résultant de la mondialisation.
Avant la crise des “subprimes” qui ébranle le capitalisme mondial dont les managers sont
actuellement réunis à Davos, on pouvait vanter la capacité d’adaption du modèle économique,
tout en affectant d’ignorer que le marché américain s’était progressivement libéré du carcan
jugé trop contraignant qu’il s’était vu imposer à la suite de quelques scandales retentissants
tels qu’Enron et autres.
Il apparait clairement que le marché est incapable de s’imposer à lui-même les règles qui
limitent son action, et qu’en cas de défaillance, c’est aux Etats de prendre le relai pour
imposer par la contrainte, les règles de la bonne gouvernance qui garantissent le bon
fonctionnement du système économique.

On avait cru que la mondialisation annonçait la fin de l’Etat, et que les entreprises
mondialisées prendraient le relai pour imposer leurs vues. Au moment où le capitalisme
semblait avoir triomphé des utopies altermondialistes, faute pour ses partisans d’être parvenus
à imposer un contre-modèle crédible, on assiste, crise après crise, à une montée de la défiance
envers le capitalisme sur le mode citoyen, ce qui n’est pas le moindre paradoxe, comme si la
meilleure façon de le combattre était de se l’approprier, en lui imposant notamment des
exigences qu’on pourait qualifier de “citoyennes” dont l’Etat est aujourd’hui comptable, au
nom de la gouvernance.
C’est cette notion élargie de gouvernement qui est également au coeur de la réflexion sur la
pertinence de la politique monétaire européenne, le citoyen s’interrogeant, au delà des
querelles d’experts, sur la mission même de l’institution européenne en charge de la politique
monétaire.
Dans un monde globalisé où l’interdépendance des acteurs est la règle, le capitalisme n’est
légitime qu’autant qu’il sert le citoyen, et ce dernier est légitimement fondé à exiger des
managers comme des politiques, qu’ils rendent des comptes sur la gestion des affaires du
monde qui ne peuvent se résoudre au seul niveau national.
Le discours idéologique sur les vertus du capitalisme opposé au communisme n’est plus la
priorité. Les managers ont cru un peu vite que la mondialisation annonçait la domination sans
partage de l’idéologie capitaliste, et que la légitimité tirée de la génération du profit dispensait
des contrôles.
Les crises successives et les scandales répétés qui mettent en lumière les disfonctionnements
du système n’ont pas ébranlé l’édifice au point de remettre en cause son utilité. La recherche
du profit est plus que jamais légitime, et le discours politique français sur le “pouvoir d’achat”
n’en est que l’habile transposition.
Mais le pouvoir économique, à l’instar du pouvoir politique, n’en est pas quitte pour autant
envers le citoyen. La raison d’être du profit est aujourd’hui questionnée sous l’angle éthique,
et cette préoccupation n’est pas moins exigeante envers l’entreprise et l’Etat que l’étaient hier
la lutte idéologique contre le capitalisme. Le terrain d’appréciation s’est seulement déplacé.
Hier abandonnée aux experts, la politique monétaire européenne est désormais entrée dans le
débat citoyen comme une variable affectant directement le mode de vie de chacun.
On est donc en droit d’exiger plus de cohérence, plus de souplesse, plus d’efficacité, de la
politique monétaire européenne.
Non pas qu’on soit soudainement devenus des experts de la question économique, mais
simplement parce qu’on est citoyen. Et c’est une raison qui se suffit à elle même.
PLUS DE COHERENCE
La montée des critiques contre une politique monétaire trop restrictive
- Le credo de la BCE : l’absence d’inflation est la condition de la croissance

La logique économique qui sous-tend cet objectif prioritaire de stabilité des prix est la
suivante : si stabilité des prix il y a, l’incertitude économique diminue, et les capacités
d’échange des entreprises, des ménages s’améliorent, donc la croissance s’améliore. Il y a
donc une lecture de la politique monétaire de la BCE qui conduit à relier la stabilité des prix
avec la croissance.
La BCE affirme que sa meilleure contribution à la croissance (augmentation du Produit
Intérieur Brut) et à l’emploi est le maintien d’un taux d’inflation stable à un niveau
relativement bas.
Au soutien de cette politique, la BCE fait valoir que les études économiques ont montré
également l’importance de l’indépendance d’une banque centrale dans la mise en œuvre de la
politique monétaire et des objectifs généraux qui lui ont été fixés. Il importe, en effet, selon
elle, que l’action de la Banque centrale présente de la stabilité (de façon à garantir la stabilité
des prix) et qu’elle ne puisse pas être utilisée pour stimuler temporairement l’activité dans un
but politique sans considération aucune pour les effets de ce stimulus sur les prix et l’activité
à plus long terme.
Cette même analyse explique actuellement le refus de la BCE de baisser les taux d’intérêts en
raison notamment de la très grande volatilité des marchés financiers.
Si son président, Jean-Claude Trichet, continue à “aboyer” contre l’inflation, plus personne ne
songe sérieusement qu’il puisse… “mordre”, c’est-à-dire relever ses taux directeurs, comme il
avait pourtant promis de le faire avant la crise des subprimes. Mais combien de temps encore
la crédibilité de la BCE, incapable de choisir entre soutien à la croissance et lutte contre
l’inflation, pourra-t-elle survivre à ce décalage croissant entre ses actes et ses propos ? Son
blocage idéologique risque de la démonétiser aussi sûrement que la Fed ses palinodies. 2
a) L’indépendance de la BCE ne doit pas empêcher le débat sur ses priorités : l’inflation
ou la croissance ?
Il est légitime d’utiliser la politique monétaire pour favoriser la croissance. Certaines études
de l’INSEE tendent à montrer que le taux de croissance augmente de 0,3 point au bout d’un
an à la suite d’une baisse des taux de 1 point. Les taux d’intérêt et donc la politique monétaire
ont donc une importance dans les fluctuations économiques. Il paraît légitime de vouloir
utiliser la politique monétaire pour favoriser une croissance atone.
- Une politique monétaire restrictive implacable appliquée par la BCE au détriment de la
croissance
En 2005, alors qu’aucun signe de retour à une croissance forte n’était en vue, le Président de
la Banque Centrale Européenne (BCE), M. Jean-Claude Trichet, annonçait la fin de « la
politique monétaire accommodante » (en d’autres termes la hausse des taux d’intérêt c’est-à-
dire le loyer de l’argent) a suscité de nombreuses critiques. 3 Le Président de l’Eurogroupe
(réunion des ministres des Finances des pays ayant adopté l’Euro comme monnaie, les douze
pays dits de la zone Euro) M. Jean-Claude Juncker a indiqué par exemple qu’il fallait éviter
de prendre des mesures qui pourraient aller à l’encontre de la croissance économique. Le
débat sur les objectifs de la BCE et la pertinence de son indépendance par rapport aux
gouvernements a ainsi été relancé. 4

On peut craindre que la BCE s’attache plus à la règle (le contrôle de la masse monétaire) qu’à
l’objectif (stabilité des prix à long terme) et perde auprès des agents économiques la
crédibilité qu’elle cherche justement à gagner.
“La stratégie de la BCE aujourd’hui minimise très vraisemblablement la croissance
potentielle européenne, et elle a donc tendance à réagir trop vite face à une amélioration
conjoncturelle. Dans ces conditions, elle limite la capacité des Etats à générer une
amélioration sensible et pérenne de la croissance économique.” 5
Jérôme Creel, directeur adjoint au département des études de l'OFCE, centre de
recherche en économie de Sciences-Po, et professeur d'économie à l'ESCP-EAP
PLUS DE SOUPLESSE
b) L’indépendance de la BCE n’est pas synonyme de politique monétaire restrictive
Les statuts et missions d’une banque centrale sont normalement définis par la loi. Cependant,
les missions de la BCE ne se résument pas à la stabilité prix.
La BCE a donc une marge de manœuvre pour mener une politique monétaire plus
accommodante.
L’indépendance institutionnelle n’est donc pas automatiquement synonyme de politique
restrictive.
PLUS D’EFFICACITE
c) La remise en cause politique des priorités de la BCE
A l’heure où Davos est sonné par la crise des “subprimes” et la perte abyssale de la Société
Générale qui affirme avoir été victime d’un trader indélicat, on constate que sur le sujet de la
“moralisation du capitalisme financier”, droite et gauche se retrouvent sur le même terrain
pour exiger un renforcement des contrôles des acteurs du marché, et s’en prendre à l’Europe
rendue responsable de nos déboires économiques 6, alors qu’en Allemagne, sans doute
marquée par son histoire monétaire, et forte du redressement économique initié par la Grande
Coalition dirigée par Angela Merkel, on considère toute attaque contre la BCE comme
intolérable.
“Ce n’est plus à M. Trichet de décider de notre avenir, c’est aux dirigeants démocratiquement
élus !”, déclarait Ségolène Royal lors du congrès des socialistes européens à Porto 7. Elle
affirmait la nécessité d’en finir avec l’impuissance des Etats membres à pouvoir contrôler
démocratiquement la politique menée par la BCE dans deux domaines : la fixation de ses taux
directeurs et l’évolution du taux de change avec le dollar.
L’appréciation continue de dollar face à l’euro qui pénalise gravement nos exportations va
donc continuer si, comme on peut le penser, la Banque Centrale Européenne refuse d’infléchir
sa politique monétaire.

d) Remise en cause du mandat de la BCE : comparaison avec la FED
Le mandat de la Fed comprend en effet la recherche du plein-emploi, quand celui de la BCE
met au premier plan l’objectif de la stabilité des prix, reléguant au second la croissance et
l’emploi.
Le modèle américain plus pragmatique, agit davantage sur la croissance que la BCE.
Quant au contrôle politique qu’exercent le Congrès et l’exécutif des Etats-Unis sur l’action de
la Fed, il tient à quatre instruments : les auditions régulières au Congrès, l’intervention du
Congrès et du président dans les nominations, le fait que le pouvoir fédéral contrôle un budget
équivalent à 20 % du PIB, la capacité du Congrès à modifier le système par le biais d’une
simple loi. Ces deux derniers éléments font cruellement défaut dans le système européen.
e) Améliorer la performance de la politique monétaire européenne
Les critiques à l’encontre du policy-mix 8 européen ont pris de l’ampleur avec les
conséquences néfastes pour la zone euro de l’appréciation de l’euro par rapport au dollar.
Selon Jérôme Creel, il y a vraisemblablement deux solutions pour améliorer les performances
de la BCE pour tous les Européens : d’une part, une convergence des systèmes sociaux mais
qui est compliquée. L’autre solution serait de laisser les gouvernements plus libres de
pratiquer des politiques budgétaire et fiscale de stabilisation. 9
f) Une politique monétaire à cohérence limitée en l’absence de politique économique
commune
La BCE est en charge de la politique monétaire pour l’ensemble des Européens, mais en
l’absence de convergence réelle des économies européennes qui ont des systèmes
économiques, des systèmes sociaux, et des niveaux de vie différents, sa politique a des effets
différents selon les pays.
Les Etats sont donc légitimement fondés à exiger plus de cohérence, plus d’efficacité et plus
de souplesse dans l’application de la politique monétaire européenne.
________________________
Rôles de la Banque Centrale européenne
La politique monétaire de la zone euro est confiée à la Banque Centrale européenne depuis le
1er janvier 1999, date de l’introduction de l’euro comme monnaie unique [2] dans les pays
participants (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal depuis 1999 ; Grèce depuis 2001 ; Slovénie depuis le 1er
janvier 2007). La zone euro compte à ce jour 312,7 millions d’habitants et représente 22% du
PIB mondial, derrière les Etats-Unis (28%).
Son objectif prioritaire, fixé par le traité sur l’Union européenne (article 105) 10, est de
préserver la stabilité des prix dans la zone euro. Celle-ci a été définie par le Conseil des
gouverneurs comme une inflation annuelle inférieure à 2% mais suffisamment proche de ce
seuil pour éviter tout risque de déflation.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%