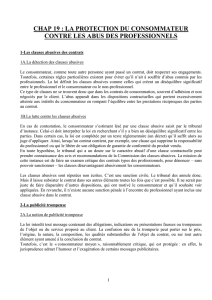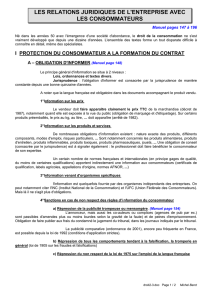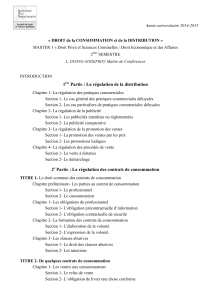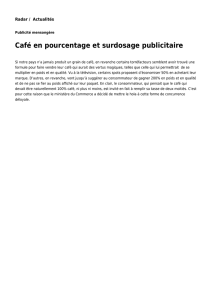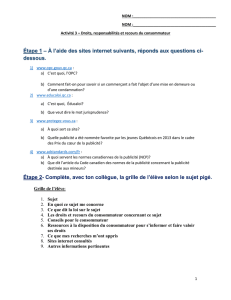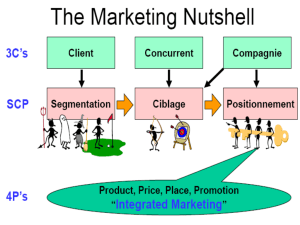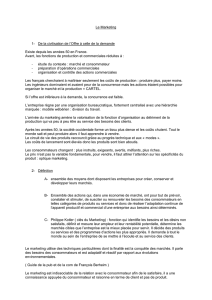INTRODUCTION

INTRODUCTION
L’entreprise entretien des relations diverses avec son environnement. Certaines sont vitales comme
les relations qu’elle entretient avec les particuliers qui se fournissent auprès d’elle. Ces particuliers
sont des consommateurs.
De tout temps, la prise en compte des intérêts du consommateur a été une préoccupation pour les
pouvoirs publics. Ainsi, déjà au Moyen Age la dilution du lait est réprimée.
Néanmoins la protection du consommateur n’a pas été la seule raison d’intervention des pouvoirs
publics. Il y aussi la nécessité de contrôler les prix. En effet, la hausse excessive de prix ont toujours
été de très mauvaise augure pour les gouvernements qui redoutent d’en faire les frais dans les urnes.
L’émergence du mouvement consumériste dans les années 70 à offert au législateur l’occasion de
compenser l’inégalité entre les professionnels et les consommateurs. Les consommateurs étant
réputés non initiés et isolés. Par ailleurs, dans une économie de marché, une entreprise n’est pas
seule à proposer des offres de produits ou de services à des acheteurs potentiels. Elle se trouve en
situation de concurrence avec d’autres entreprises proposant des biens ou des services destinés à
satisfaire les mêmes besoins des consommateurs.
La concurrence en elle-même est une situation normale et saine puisqu’elle permet la régulation des
échanges économiques, mais encore faut-il qu’elle ne soit pas dévoyée par des procédés déloyaux.
S’il va de soi que la réglementation des relations entre professionnels est destinée à protéger ceux-ci
les uns des autres, il ne demeure pas moins que la concurrence à aussi pour but, et c’est même son
but ultime, un ajustement des prix au niveau économique, le plus raisonnable dans l’intérêt du
consommateur.
Inversement, les règles qui gouvernent les rapports entre un distributeur et ses clients protège
d’abord ses clients mais aussi pas contre coup (« ou par ricochet »), indirectement, les distributeurs
loyaux. Il y a donc une interaction qu’on peut qualifier de naturel entre le droit de la concurrence et
celui de la consommation.
Le législateur vient d’ailleurs d’en prendre acte par la loi du 4 Août 2008 dite loi LME (Loi de
Modernisation Economique), d’une part en étendant au bénéfice des professionnels, les dispositions
du code de la consommation relative aux pratiques commerciales trompeuses ; et d’autre part en
instituant une action au bénéfice des consommateurs sur le fondement de la confusion (infraction
commerciale. Ex/ fait de présenter ses produits de manière à profiter de la notoriété d’une autre
marque) alors que celle-ci était jusqu’alors réservée.
Ces dispositions qui sont particulièrement protectrices pour les consommateurs servent
indirectement les distributeurs. On a d’un autre côté les règles qui régissent le bon fonctionnement
du marché et donc la protection des distributeurs et indirectement la protection des
consommateurs. C’est pourquoi on parle d’interaction.

TITRE 1 : LES RAPPORTS DE L’ENTREPRISE DE
DISTRIBUTION AVEC LES CONSOMMATEURS
Les relations que le distributeur entretien avec d’autres professionnels sont réglés par les droit
commun, c'est-à-dire le droit civil ou le droit commercial. En revanche les contrats qu’il passe avec
les particuliers sont placés sous surveillance.
En effet, le droit moderne a donné statut spécial au client dans ses relations avec le professionnel.
On parle alors de consommateur, lequel est définit comme étant un acquéreur non professionnel de
bien de consommation et de service destiné à son usage personnel (ou domestique).
Le client tel que nous l’entendons est un cocontractant de l’entreprise au regard du droit commun,
mais est un consommateur au regard du droit spécial de la consommation.
Le code de la consommation institué en 1003 regroupe l’ensemble des textes inspirés par le souci
d’assurer la défense des intérêts des consommateurs face aux professionnels.
L’idée générale qui sous tend ce code réside dans le fait que le consommateur de trouve dans ses
rapports avec les professionnels en situation de triple infériorité.
D’abord parce que du point de vue technique le professionnel connait ses produits et ses services
alors que le consommateur les ignore ou les connait mal.
Deuxièmement il y a une infériorité économique. Le professionnel dispose d’une puissance
économique supérieure à celle du consommateur.
Troisièmement il y a une infériorité juridique. Le consommateur n’a pas à sa disposition les
ressources lui permettant de négocier les termes du contrat qu’il souscrit avec le professionnel.
D’ailleurs, la plupart des contrats que souscrivent les consommateurs sont des contrats d’adhésion
(on ne fait que signer et on ne négocie pas).
Il fallait donc remédier à ce déséquilibre par l’instauration d’un équilibre juridique de sens contraire.
Quel est le principe qui fonde la théorie générale des obligations ? Il faut un niveau d’égalité entre les
parties au contrat. Personne ne peut m’obliger pour quelque chose si je ne suis pas consentant.
Le droit de la consommation est un droit par essence égalitaire dont la philosophie est très éloignée
du code civil et du décrêt d’Allarde (C’est ce décrêt qui a institué la liberté de commerce et de
l’industrie).
Le droit de la consommation apport d’importantes limites à la liberté d’action du professionnel. Il fait
le pari qu’un consommateur est insuffisamment renseigné pour défendre ses intérêts. Il impose une
information exacte du consommateur, mais comme c’est un pari risqué il prend un certain nombre
de mesure tendant à garantir en toute hypothèse la protection du consommateur.

CHAPITRE 1 – L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR
PAR LE DISTRIBUTEUR
Introduction
L’information du consommateur doit précéder la conclusion du contrat. Cette exigence est certes
portée par les dispositions du code civil relatives aux 4 conditions de validité du contrat :
-le consentement qui doit être libre et éclairé
-la cause qui doit être réelle
-l’objet qui doit être licite
-la capacité
Le code civil n’autorise qu’une sanction à posteriori consistant dans l’annulation du contrat ou dans
la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle. Aussi bien l’annulation du contrat que
l’engagement de la responsabilité du professionnel ne peuvent être prononcés que par la décision
d’un juge. Il faut donc que le consommateur prenne l’initiative de la saisine du juge.
La plupart du temps le consommateur hésitera en raison non seulement du coût mais aussi de la
lourdeur et des tracas de l’appareil judiciaire. Les sanctions de droit communs paraissent donc
inappropriées pour prémunir et le cas échéant protéger le consommateur.
C’est pourquoi le droit de la consommation préfère une intervention en amont par une
réglementation a priori de l’information pour éclairer le consommateur. Cette exigence
d’information ne se limite pas à la période précédent immédiatement la signature du contrat.
L’information par la publicité commerciale est réglementée au même titre que l’information pré
contractuelle proprement dite.
Section 1 : L’information générale du consommateur : la publicité commerciale
Une annonce publicitaire ne doit pas être trompeuse, elle ne doit pas être non plus de nature à
induire en erreur.
La violation de ces exigences est constitutive d’une infraction sanctionnée par le régime des
pratiques commerciales trompeuses.
Des règles spéciales sont par ailleurs prescrites pour les messages portants sur certains produits ou
services (ex/pub tabac interdit).
1) Régime général de la répression de la publicité commerciale trompeuse
Depuis la loi du 3 Janv 2008, dite loi Chatel, complétée par celle du 4 Août 2008, dite loi LME a
transposé en droit interne la directive dite « Protection du consommateur : pub et communication
commerciale ». La disposition du code de la consommation relative à la publicité commerciale
trompeuse ont perdu leur autonomie. Elles font désormais d’une sous section du code de la

consommation consacrée aux pratiques commerciales trompeuses dont la publicité commerciale ne
constitue qu’une modalité.
A) Elément matériel
Il s’agit d’une part de la notion de la pub commerciale et d’autre part du caractère trompeur de cette
pub.
1- La notion de publicité
La loi n’a pas donné de définition de la publicité commerciale. C’est donc à la jurisprudence qu’on
doit se référer. Elle considère comme message publicitaire : « Tout moyen d’information destiné à
permettre à ses clients potentiels de se faire une opinion sur les caractéristiques du bien ou du
service qui lui est proposé ».
Pour la jurisprudence il apporte peu que le message ait pour objet de venter les mérites d’un bien ou
d’un service ou qu’il se veuille une simple description objective et factuelle.
De même, il est indifférent que ce produit soit adressé à une personne ou une catégorie de
personnes.
S’agissant du support, l’acception qu’en a la jurisprudence est très large. A son sens une simple
étiquette, une offre ou un document précontractuel, constituent une publicité au même titre que les
affiches, prospectus ou les annonces publiées dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision.
Si la loi ne donne pas de définition de la publicité commerciale, elle donne en revanche son contenu.
Ainsi, outre certaines obligations générales à l’obligation de langue française, la loi exige notamment
par l’Art. L121-1, II, al 2° : « Toute annonce publicitaire doit mentionner les caractéristiques
principales du bien ou du service mentionnée, l’identité ou l’adresse de l’annonceur, le prix toute
taxe comprise, les frais de livraison ou leur mode de calcul qi ils ne peuvent être établis à l’avance,
les modalités de paiement ou de livraison, d’exécution, de traitement et de réclamation en cas de
différence avec celles habituellement pratiquées dans le secteur d’activité concerné. »
La loi dit également de manière explicite en quoi une annonce pub peut être qualifiée de trompeuse.
2- Caractère trompeur de la publicité
Une annonce publicitaire devient une pratique commerciale trompeuse si elle porte sur les
caractéristiques substantielles d’un produit ou d’un service et repose sur des allégations, indications,
ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Dans son interprétation de la définition, la
jurisprudence considère qu’une simple allusion ou suggestion peut constituer une telle infraction dés
lors qu’elle est de nature à tromper le consommateur moyen.
Le consommateur qui est en état par exemple de connaître les minimums qu’on puisse exiger des
consommateurs. Ce n’est ni le consommateur avertit ni le consommateur benêt.
Le fait de laisser entendre qu’une entreprise dirigée par une femme est plus apte à servir une
clientèle féminine est une publicité trompeuse. Autrement dit les femmes n’ont pas le monopole de
la compréhension des besoins de la clientèle féminine.

En revanche échappe à cette qualification la publicité hyperbolique. C’est celle dont l’outrance ou
l’exagération est suffisamment apparente pour exclure tout risque d’erreur. C’est le cas par exemple
d’une publicité télévisée ou une valise sors intacte d’un match de foot entre bulldozers.
La loi donne donc une énumération exhaustive des éléments sur lesquels une allégation, une
présentation ou une indication fausse ou de nature à induire en erreur peut constituer une publicité
commerciale trompeuse. Il s’agit de ceux précédemment évoqués mais également :
- de l’existence ou de la disponibilité du bien ou service proposé
-de leurs caractéristiques essentielles
-du caractère promotionnel du prix
-du service après vente
-de la portée des engagements de l’annonceur
-de la nature, du procédé ou du motif de vente (ex : liquidation)
-l’identité, les qualités de l’annonceur et ses droits
Il faut entendre par caractéristiques essentielles : les qualités substantielles, la composition, les
accessoires, l’origine, le mode et la date de fabrication, les conditions de fabrication, d’utilisation,
aptitude à l’utilisation, le résultat attendu de l’utilisation, les résultats des tests et contrôles sur les
principales caractéristiques.
Au delà de ces éléments la loi dit également que la pratique commerciale sera trompeuse lorsqu’elle
omet, dissimule ou fournit une information soit inintelligible ou ambiguë, soit à contre temps portant
sur un élément essentiel ou encore lorsque le professionnel dissimule sa véritable intention
commerciale.
B) Elément moral
Initialement la loi limitait la répression de la publicité trompeuse à la publicité faite de mauvaise fois
et comportant des allégations mensongères précises. Jusqu’à une date encore récente, la pub était
réprimée que si il y avait une volonté manifeste de l’annonceur d’enfreindre la loi.
Cette double exigence conduisait à soustraire à la sanction les auteurs d’allégations imprudentes ou
allusives alors qu’ils ne sont pas moins dangereux ou blâmables.
L’incrimination a donc considérablement été élargie par une loi de 1973 codifiée par la suite à l’Art
L121-1 du code de la consommation. Le texte actuel ne fait plus référence à la mauvaise foi du
professionnel. En d’autres termes, l’annonceur des pratiques trompeuses peut être sanctionné alors
même qu’il n’a pas la volonté de tromper. L’infraction peut donc être retenue qu’il y ait simple
manquement de la diligence professionnelle ou mauvaise foi caractérisée de la part du professionnel.
De même, la publicité trompeuse n’est pas une infraction de résultat. Il suffit qu’elle soit susceptible
d’induire en erreur et d’altérer le comportement économique du consommateur pour être
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
1
/
63
100%