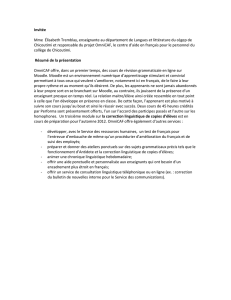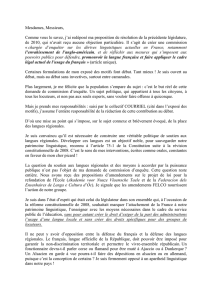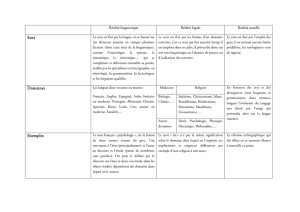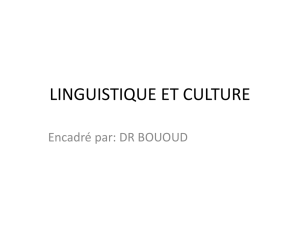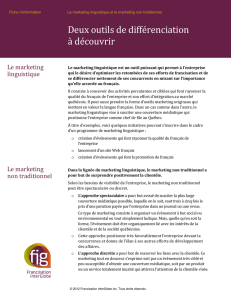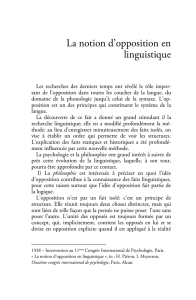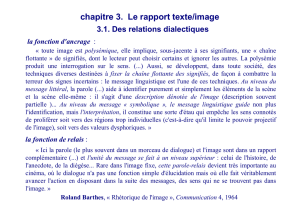Limites des analyses conversationnelles dans les usages du web

1
Limites des analyses conversationnelles dans les usages du web.
Des risques d'une naturalisation des technologies
Résume
L'utilisation des technologies dites du web 2.0. dans les organisations suscite des
transformations qu'on peut observer à deux niveaux. Le premier niveau est celui de la
structure de la communication en réseau. Il peut être approché selon une analyse qui
prendra en charge les dimensions sémiotiques et techniques. Un autre niveau à
prendre en compte est celui des discours qui décrivent cette communication.
L'expression même de Web 2.0., mais aussi les métaphores spatiales (du village à
l'horizontalité) comme les représentations du message, de l'inscription sur la page
d'écran, ou des actions que réaliseraient les usagers, renvoient à des discours
d'accompagnement, porteurs de représentations idéologiques du réseau comme de
l'organisation et de la communication. A cet égard, la reprise de schémas et concepts
théoriques issus de l'analyse linguistique, qu'on parle d'interactions, d'identités,
d'énonciation, de performativité ou de conversations sur les réseaux, porte en elle le
risque de relever moins de l'analyse communicationnelle que des discours
d'accompagnement des technologies. Ce texte revient sur des concepts de
l'anthropologie de la communication, de la pragmatique et de l'analyse
conversationnelle pour montrer les risques de leur utilisation sans précautions dans
l'analyse de communications électroniques.
Bruno Ollivier, Professeur en Sciences de l'Information et de la communication
Université des Antilles et de la Guyane,
UFR LSH
BP 7209
97220 Schoelcher
France

2
Introduction
Si la recherche en communication relève d'une interdiscipline, cette nature pose deux
types de questions. La première touche à la définition des champs disciplinaires et
aux frontières qui les séparent et à leurs validations respectives (Ollivier 2002). La
seconde est celle de la validité scientifique des importations de concepts d'un champ
à un autre. Le concept de champ est ainsi passé de la physique des particules à la
sociologie, celui de flux de la physique, de l'économie et des mathématiques à
l'informatique, et la question sera posée ici de l'importation de concepts d'origine
linguistique, liés à la performativité, dans le champ de la communication des
organisations.
Ce texte vise à attirer l'attention sur les risques que peuvent représenter des
importations de concepts qui à première vue semblent s'appliquer aussi bien dans en
linguistitique qu'en communication, à propos des échanges présentiels comme avec
internet alors que leur transposition relève plus d'un effet d'analogie que d'une
approche scientifique précise.
Dans ce domaine, l'approximation scientifique est facilitée par la puissance
médiatique et dans les milieux professionnels des discours d'escorte des TIC, qui ne
visent pas une étude rigoureuse, mais l'acceptation d'idées simples et présentées
comme indiscutables pour étudier les TIC.
Le développement des technologies dans les organisations et les relations
interindividuelles est souvent approché selon le modèle implicite de ces discours
d'escorte, qui suggèrent une continuité dans la nature des actions de communication,
quel que soit le type de médiation, du corps à l'ordinateur, la technologie ne faisant
qu'offrir de nouvelles possibilités pour réaliser des actions, voire des actes de
langage. Le courrier électronique est ainsi représenté à travers l'analogie avec le
courrier écrit, le chat et les commentaires sur les blogs ou autres pages de type
Facebook à travers l'analogie avec les conversations, l'écriture sur des pages de
forums informatiques comme ne s'il s'agissait que d'une nouvelle dimension offerte à
l'échange, au débat, voire à la démocratie.
Dès lors qu'on accepte l'idée (fausse) de cette continuité et la pertinence de ces
analogies, il est tentant d'utiliser les concepts et théories développés dans la seconde
moitié du XXe siècle à propos des interactions langagières entre êtres humains pour
décrire la communication électronique et l'écriture sur un document informatique
partagé, ce que sont une page Facebook ou un blog.
On voudrait ici rappeler quelques jalons de l'histoire de l'anthropologie de la
communication, de la philosophie du langage et de l'analyse de conversations, avant

3
de les confronter aux conditions réelles de production et de circulation de messages
informatisés sur les réseaux et de marquer les limites d'une transposition de leurs
concepts au Web contemporain, dans les organisations et ailleurs.
Retour sur trois courants en linguistique et anthropologie de la communication.
On s'attache ici à trois courants théoriques dont le vocabulaire est souvent repris,
parfois sans renvoi précis aux écrits originaux, pour analyser la communication
électronique.
La première est l'anthropologie de la communication telle que la résume Dell Hymes
(1927-2009) dans son modèle SPEAKING (1974, pp. 54-72).
La seconde est l'école analytique d'Oxford qui développe la théorie des actes de
langage avec Austin (1911-1960) puis Searle (1932-…).
La troisième est l'école de l'analyse conversationnelle, née dans les années 1960 dans
un contexte épistémologique marqué par la proximité avec l'ethnométhodologie, et
développée par Harvey Sacks (1935-1975), Claire Blanche-Benveniste (1935-2010)
et à sa manière Paul Grice (1913-1988).
Dell Hymes et l'anthropologie de la communication
L'apport de Dell Hymes tient à sa position, au confluent entre la sociolinguistique,
l'ethnométhodologie et la linguistique à la fois structurale et chomskyenne, et à sa
lecture particulière de la relation entre compétence langagière et performance in situ.
On sait que le modèle Speaking propose d'aborder les situations de communication
en prenant en compte le cadre et la scène (Setting and Scene), les participants à
l'action de communication (P), les finalités de l'action (Ends), la séquence des actions
(Act sequence), les clés pour l'interprétation (Keys), qui renvoient à l'esprit de la
communication (à la solennité ou à l'humour par exemple) et interdisent une pure
interprétation littérale des messages
1
), les outils (Instrumentalities) que sont les
manières d'utiliser le langage en situation, les normes de l'échange (Norms) et le type
d'échange (Genre). Il offre une grille issue de l'approche ethnographique et associe
des catégories linguistiques, sociologiques et pragmatiques. Un des acquis
fondamentaux des travaux de Hymes est d'expliquer comment fonctionnent des
communautés linguistiques, qui se fondent à partir d'une même compétence de
communication.
L'école d'Oxford
Complétant l'analyse linguistique classique qui se structure en trois niveaux
syntaxique, phonétique et lexico-sémantique, et proposant un quatrième niveau
1
Renvoyant par là à l'opposition proposée par Watzlawick (Watzlawick et al.1972) entre contenu et
relation dans la communication, la seconde seule permettant d'interpréter le premier.

4
pragmatique, l'approche d'origine plus philosophique d'Austin (1955/1970) et Searle
(1969/1972) insiste sur le rôle du langage comme moyen d'agir sur la réalité, en
opposant les fonctions du constatif et du performatif. La distinction entre niveaux
locutoire, illocutoire et perlocutoire de la communication en situation, ainsi que les
différentes catégories d'actes de parole (assertifs, directifs, promissifs, expressifs et
déclaratifs) complètent ces analyses, proche de celles de Goffman, et forment la base
de l'analyse pragmatique classique.
Analyse conversationnelle
L'analyse de conversation apparaît paradoxalement assez tard dans l'histoire de la
linguistique, qui a longtemps pensé exclusivement le langage à partir des formes
écrites de ses manifestations (Ollivier 1980). Dans les travaux de Sacks (1992)
comme ceux de Blanche-Benveniste se voit soulevée la question de l'articulation des
niveaux micro (interaction hic et nunc entre inter-locuteurs) et macro (sociologique
et institutionnel). Mondada (2006) rappelle le lien originel entre l'ethnométhodologie
et l'analyse conversationnelle, qui s'organise autour de la prise en compte de
l'indexicalité et du contexte d'énonciation. Celle-ci questionne finalement la relation
entre la forme linguistique et le pouvoir à partir de l'étude de l'interaction enregistrée.
L'observation de l'oral enregistré montre que des catégories centrales dans l'écrit,
comme la phrase, n'y existent pas, alors que les marqueurs de prise de parole,
l'organisation de la circulation de la parole, les redites, les implicites énonciatifs, la
lutte pour l'énonciation, bref les structures de micro interactions revêtent un rôle
central (Cadiot et al. 1979). L'Analyse de conversation s'appuie sur des
enregistrements et questionne d'un point de vue ethnométhodologique la manière
dont le pouvoir et l'institution se construisent au cours des interactions. Le contexte
de l'énonciation est ici fondamental pour analyser la production langagière. Mondada
(2006) précise que « Toute pratique est irrémédiablement indexicale : l’action
s’ajuste au contexte tout en le configurant par sa manière même de l’interpréter et de
le prendre en considération. Elle est donc à la fois structurée par le contexte (context-
shaped) et structurante pour lui (context-renewing) ».
Finalement, comme le notent Dumoulin et Licoppe (2007), « l’analyse de
conversation (AC) pointe les limites d’une approche analytique centrée sur l’énoncé
isolé davantage que sur la manière dont celui-ci s’inscrit dans un contexte que son
énonciation contribue à renouveler. [Elle] s’intéresse à l’analyse systématique des
méthodes permettant aux acteurs de collaborer à produire en situation un tel acte de
langage de manière reconnaissable et séquentiellement pertinente ». Mais, pas plus
que l'analyse de Bourdieu (1982) pour qui la performativité n'est que la conséquence

5
des effets de la domination symbolique, elle ne peut rendre compte des arrangements
sociaux et techniques en jeu dans une communication médiatée par les réseaux.
Les trois théories ici rappelées trouvent leurs limites dès qu'on sort d'un contexte
interactionnel présentiel, enregistrable et observable. En ce sens, on va voir que la
technique et la performativité langagière s'avèrent irréductibles l'une à l'autre sauf à
entrer dans le cadre de discours d'escorte soigneusement distillés.
Les limites de ces théories face à la communication électronique
Les concepts élaborés par ces trois courants ne sauraient en effet s'appliquer à la
communication électronique qu'au prix d'approximations hasardeuses.
L'inadéquation dee propositions de Hymes à la communication électronique.
L'espace virtuel, le temps partagé, le village électronique, l'identité sur les réseaux,
l'existence de communautés de communication, ne sont que des métaphores des
discours d'accompagnement qui ne résistent pas aux exigences de l'analyse
ethnographique. Les méthodes de l'anthropologie ne s'adaptent pas ipso facto aux
machines. Que deviennent les catégories du modèle SPEAKING dans la
communication par ordinateurs ?
Le cadre de la communication " refers to the time and place of a speech act
and, in general, to the physical circumstances". "Setting refers to the time and
place of a speech act and, in general, to the physical circumstances". Le cadre
réel est toujours celui d'individus devant leur clavier et leur écran. Mais il
implique aussi, dans le cas de la communication informatisée, l'existence
physique du fournisseur d'accès, qui peut verrouiller des sites, du propriétaire
des sites (forum, Facebook, intranet d'entreprise etc.) qui gardera la trace
numérique de tous les échanges, celles du système d'exploitation, des
logiciels utilisés, de l'interface graphique qui formatent la communication, et
les paramètres techniques (bande passante, taille et qualité de l'écran et du
clavier…) qui conditionnent toute la communication. Avant d'être social, le
cadre réel de la communication est technique.
Les Participants sont pour Hymes l'énonciateur et l'audience. A supposer que
celui qui écrit un texte à l'écran soit assimilé à un énonciateur, ce qu'on
discutera plus loin, il est impossible de déterminer une audience ni dans le
temps ni dans l'espace, faute de savoir qui aura accès au message, quand cet
accès se produit, ni dans quelles conditions de délais. La mémoire en est en
revanche intégralement gardée par le système et les lectures futures sont
imprévisibles.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%