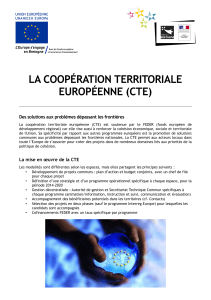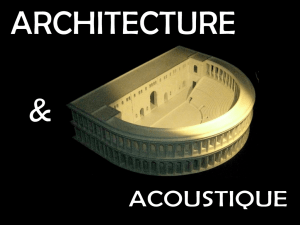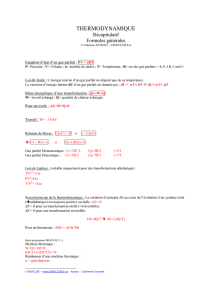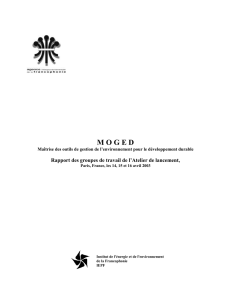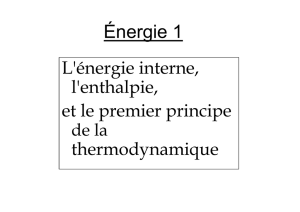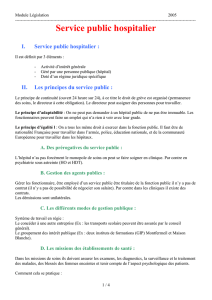Questions théoriques autour de l`efficacité environnementale des CTE

Questions théoriques autour de l'efficacité environnementale
des Contrats Territoriaux d’Exploitation
Laurent GRIMAL, Charilaos KEPHALIACOS, Patrice ROBIN
1
INTRODUCTION
La promulgation en 1999 de la Loi d'Orientation Agricole traduit la volonté des
pouvoirs publics français de mettre en place une politique environnementale
ambitieuse dans un secteur d'activité qui fait l'objet depuis longtemps d'une
régulation sectorielle spécifique
2
. A cet effet, un dispositif nouveau, le contrat
territorial d'exploitation (CTE) a été mis en place en France depuis fin 1999
3
. La
justification mise en avant est la promotion d'une agriculture multifonctionnelle
contribuant au développement durable des territoires. La mise en œuvre de cette
politique se fait sous plusieurs contraintes : l'atteinte d'objectifs environnementaux
(une certaine qualité de l'environnement), l'atteinte d'objectifs économiques et
sociaux pour le secteur productif agricole (un certain niveau de production et de
revenu) et le respect de contraintes internationales (compatibilité avec les règles
de l'Organisation Mondiale du Commerce et celles de l'Union Européenne).
Parallèlement aux difficultés de sa mise en œuvre
4
, le CTE suscite des débats
quant à l'adéquation du dispositif au plan national, mais également pour ce qui est
de la légitimité de ce type d'intervention dans le contexte européen et
international.
1
Respectivement Maître de conférences en Sciences Economiques, Laboratoire Intelligence des Organisations,
Université de Haute Alsace, Département Universitaire de Colmar, 32, rue du Grillenbreit, 68 008 Colmar, : +
Professeur en Sciences Economiques, Laboratoire Dynamiques Rurales, UMR/ENFA-UTM-ENSAT, Ecole
Nationale de Formation Agronomique, BP 87, 31326 Castanet-Tolosan, : + 561753264 / Fax : + 561750309 /
Doctorant, Laboratoire Dynamiques Rurales, UMR/ENFA-UTM-ENSAT, Adresse postale : Fédération
Régionale des CIVAM Midi-Pyrénées, 122, allée de Barcelone, 31000 Toulouse, : + 562271687 / Fax : +
561224828 / : [email protected]m
2
“La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture
et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable”, loi d'orientation agricole du 9
juillet 1999, article 1er.
3
“Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet
économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi…”, loi
d'orientation agricole du 9 juillet 1999, article 4.
4
Au 31 décembre 2000, environ 4 000 CTE avaient été agréés, alors que l'objectif officiellement annoncé était
de 50 000. En avril 2002, le nombre de CTE signé était passé à 24 018.

Laurent Grimal, Charilaos Kephaliacos, Patrice Robin
2
L'objet de l’article est d'apporter une contribution à ces débats en cherchant à
dégager, à partir des caractéristiques propres aux CTE, les outils économiques
mobilisables pour analyser l'efficacité du dispositif pour l'atteinte d'objectifs
environnementaux. Par efficacité, nous entendons la capacité à atteindre les
objectifs en question. Mais, le dispositif du CTE doit également être évalué en
terme de coût pour la société en regard des résultats obtenus et, éventuellement, en
comparaison avec d'autres dispositifs. De plus, la question de l'efficacité des CTE,
en tant que politique publique, renvoie également à la capacité de ce dispositif à
construire durablement sa propre légitimité au plan national et international
(Godard, 1989).
Dans une première partie, nous restituons les enjeux économiques autour des
CTE. Nous proposons dans une deuxième partie un cadre d'analyse permettant de
traiter la question de l'efficacité environnementale des CTE. Nous articulons pour
cela deux courants théoriques, à savoir l'économie néo-institutionnelle et
l'économie écologique.
1 - CONTRAINTES INSTITUTIONNELLES ET ENJEUX ECONOMIQUES
AUTOUR DES CTE
Le CTE peut être replacé dans l'histoire des dispositifs nationaux français visant à
réguler les effets de l'agriculture sur l'environnement. La mise en évidence
d'impacts jugés négatifs de l'agriculture sur l'environnement a progressivement
amené les pouvoirs publics et les Organisations Professionnelles Agricoles à
envisager les moyens d'y remédier. Ainsi, les pouvoirs publics français ont pris un
certain nombre d'initiatives réglementaires ou incitatives, visant notamment à
réduire la pollution des eaux par l'activité agricole (création du Comité
d'orientation pour la réduction des pollutions des eaux par les nitrates, les
phosphates et les produits phytosanitaires provenant des activités agricoles en
1984, mise en place des actions Fertimieux et Phytomieux, mise en œuvre du
Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole en 1992, etc.). Mais, le
véritable élan va venir des évolutions du contexte européen, puisque la
Communauté Européenne, dès 1985, permettait aux États membres de mettre en
œuvre “un régime d'aides aux exploitations agricoles dans les zones sensibles du
point de vue de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ainsi
que du point de vue du maintien de l'espace naturel et des paysages”
5
. Cette
disposition a ouvert la voie à une justification politique de mesures de protection
de l'environnement, qui, bien que concernant des acteurs économiques
principalement soumis à une régulation marchande, n'étaient pas, a priori,
considérées comme générant des distorsions de concurrence excessives entre
5
Article 19 du réglement européen 797/85.

Questions théoriques autour de l’efficacité environnementale des CTE
3
exploitations
6
. Depuis cette période, les relations contractuelles dans le domaine
des interactions agriculture-environnement se sont développées (Mesures agri-
environnementales (MAE), Plans de développement durable, etc.), conformément
à l'évolution contemporaine des formes d'intervention des pouvoirs publics
(Lascoumes et Valluy, 1996). La volonté de réduire les effets polluants de
l'agriculture (externalités négatives) et de promouvoir les pratiques générant des
aménités (externalités positives, telles que l'entretien de l'espace, la protection de
la biodiversité, la prévention des risques…) se retrouve à la fin des années 90, à
travers les négociations sur l'Agenda 2000 et surtout du Règlement
Développement Rural adopté en juillet 1999. Ce règlement intègre les MAE et des
mesures visant le développement des zones rurales. Il appelle des modalités
d'application propres à chaque État membre. C'est dans ce cadre que la France a
conçu le Contrat Territorial d'Exploitation.
Le CTE, à la différence des MAE, vise conjointement des objectifs économiques
et sociaux et des objectifs environnementaux. En effet, un agriculteur signant un
CTE doit prendre des engagements sur le volet "Économie-Emploi" et sur le volet
"Environnement-Territoire". De ce fait, le CTE pose des problèmes de légitimité,
que ce soit sur le plan national (les agriculteurs et leurs organisations ne vont-ils
pas chercher à limiter les exigences en matière d'environnement tout en profitant
des aides sur le volet économique ?), européen (la Commission européenne
acceptera-t-elle indéfinimment que les actions agri-environnementales soient
essentiellement entreprises dans le cadre des CTE ?) ou international (cet
amarrage entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux au nom de
la multifonctionnalité sera-t-il compatible avec les règlements de l'OMC ?).
Sur ce dernier point, la question du soutien public à l'agriculture avait été intégrée
aux négociations de l'Uruguay Round conclues en 1994. Elles ont abouti à un
classement des interventions, en instituant une “boîte verte” contenant des
mesures visant la protection de l'environnement, sous différentes conditions. Elles
doivent, d’une part, selon le principe de découplage, perturber le moins possible
les conditions de la concurrence. Mais comment apprécier ce "moins possible" ?
D'autre part, les mesures doivent donner lieu au versement de subventions qui sont
calculées sur la base des surcoûts supportés par l'agriculteur dans leur mise en
œuvre. Outre le fait que ce principe arbitre de facto entre le "droit du pollueur" et
le "droit du pollué" au détriment de ce dernier, un tel mode de calcul ne convient
pas nécessairement pour établir la rémunération des services collectifs (aménités
positives) rendus par l'agriculteur à la société. Pour ce type de soutien, les critères
permettant d'en juger la légitimité du point de vue de l'OMC restent à définir
(Vasavada et Warmerdam, 1998). La définition du contenu de cette “boîte verte”
reste donc l’objet de négociations actuelles et futures au sein de l'OMC,
négociations dont l'issue ne sera pas sans conséquences sur un dispositif tel que le
6
Par rapport à ce point, la question du contrôle de l'application des mesures est primordiale, puisqu'un contrôle
insuffisant peut se traduire uniquement par des effets-revenu purs équivalents aux aides reçues par l'agriculteur.

Laurent Grimal, Charilaos Kephaliacos, Patrice Robin
4
CTE (Petit, 1999). D'autre part, la question des relations entre la poursuite
d'objectifs marchands et la poursuite d'objectifs non marchands par des firmes
reste l'objet de controverses internationales. Il s'agit là de la définition du concept
de multifonctionnalité et des domaines de sa légitimité quand elle fait l'objet du
soutien public. On peut d'ailleurs s'interroger sur la compatibilité entre la
conception du découplage et le principe de la multifonctionnalité. Celle-ci devrait
être envisagée comme découlant de l’intégration des systèmes économique social
et écologique (Passet, 1996). Or, le découplage relève d’une dissociation entre ce
qui est marchand et ce qui a trait à l'équité et à la production de biens publics -
dont l'environnement - (Larrère et Vermersch, 2000).
En définitive, depuis quelques années, la régulation de l'agriculture fait l'objet de
changements institutionnels à plusieurs échelles, ces échelles s'emboîtant les unes
dans les autres. Les États, et la France en particulier, doivent être en mesure de
produire un discours cohérent quant à la justification de la poursuite d'un soutien
public dans le secteur de l'agriculture. Le rôle joué par cette activité dans le
développement des espaces ruraux est un argument souvent mis en avant. Justifier
un tel soutien signifiera argumenter les objectifs poursuivis et leur cohérence mais
aussi la manière dont ils sont poursuivis.
2 - QUELS SONT LES OUTILS ECONOMIQUES MOBILISABLES POUR
ANALYSER L'EFFICACITE ENVIRONNEMENTALE DES CTE ?
Les instruments de gestion de l'environnement sont généralement présentés en
deux grands ensembles : d'une part, des instruments "purement" économiques,
taxes, redevances, permis négociables, subventions et, d'autre part, des normes,
permis, réglementations, “deux approches (…) désormais tenues pour
complémentaires et nullement opposées” (Barde, 1991).
En règle générale, la conception et la mise en œuvre des différentes mesures d'une
politique économique prennent appui sur des références théoriques particulières.
Pour évaluer d'un point de vue scientifique l'impact de ces mesures, il convient
donc de mobiliser ces références. Par exemple, afin de réduire les impacts négatifs
des produits phytosanitaires sur la qualité de l’eau, les pouvoirs publics peuvent
mettre en place une taxe grevant les prix de ces produits. L’impact de cette
taxation sur la diminution des effluents sera alors théoriquement évalué en terme
de baisse des externalités produites (hausse du surplus des agents pollués) et en
terme de désavantages pécuniers (baisse du surplus des agents pollueurs). Le cadre
théorique de référence, dans ce cas, est l'approche pigouvienne de la taxation des
agents pollueurs. Rappelons toutefois que l'approche coasienne, que nous
développerons plus loin, propose de son côté une vision et donc une évaluation
différente de cette même mesure dans un cadre théorique plus large (Coase, 1960).
Le dispositif des CTE mobilise plusieurs des instruments évoqués ci-dessus. Dans
son analyse, nous pourrons donc être amenés à appréhender ces instruments en

Questions théoriques autour de l’efficacité environnementale des CTE
5
faisant éventuellement référence à plusieurs approches théoriques. Sur le plan
méthodologique, nous nous posons la question de la possibilité de proposer un
cadre théorique le plus englobant possible pour traiter un dispositif aussi novateur.
Dans un premier temps, nous dégageons les principales caractéristiques des CTE
en tant que contrats individuels entre l'État et les agriculteurs. Ensuite, nous
indiquons différents cadres analytiques que nous pouvons mobiliser pour prendre
en compte ces caractéristiques.
2.1 - Caractéristiques des CTE
Le CTE est d'abord un contrat entre deux parties. D'un côté une firme, une
exploitation agricole, et de l'autre l'État en la personne du Préfet du département
concerné. Toutefois, il n’est pas possible de s'arrêter à une description
apparemment aussi simple de la relation contractuelle et donc de la transaction
dont elle est le siège
7
. La présence de l'État est justifiée par les objectifs qui
concernent la sauvegarde ou la production de biens publics que ce soit par la
réduction d'externalités négatives ou par la production d'aménités, la frontière
entre ces deux catégories étant parfois difficile à tracer (Thiébaut, 1996). Mais,
d'un point de vue institutionnel, cette relation agriculteur - État est médiatisée par
l'intervention d'autres acteurs : chambres d'agriculture, associations,
administrations départementales et régionales, collectivités territoriales, etc. Cette
intervention se concrétise notamment par la définition des mesures-types et
contrats-types à l'échelle départementale ou à l'échelle de projets collectifs.
L'agriculteur demeure toutefois le seul à pouvoir contractualiser un CTE, alors
même que s’agissant de biens publics ou de ressources naturelles dans l'espace
rural, il n’en est pas le seul gestionnaire
8
. On peut alors se demander comment le
dispositif des CTE peut permettre d'atteindre des objectifs nécessitant une forte
coordination entre des acteurs qui ne sont pas nécessairement tous agriculteurs. Ce
problème a déjà été soulevé à propos des Opérations Locales Agri-
Environnementales (Thannberger, 1997).
Le contrat comporte une série d'engagements. Pour la partie environnementale, ces
engagements reposent sur la modification ou l'introduction d'actions techniques. Il
s'agit là de prendre en compte une caractéristique propre aux activités agricoles
dont les relations avec le milieu naturel sont complexes. En effet, les actes
productifs destinés à la fourniture de biens marchands permettent en même temps
la production de biens - ou de maux - publics environnementaux. Le bien
environnemental peut en effet être lié au bien marchand selon deux modalités.
7
Nous définirons la transaction comme une "expérience vécue en confiance de transfert de promesses avec
matérialisation par un contrat respectant des règles et créant des obligations et des dettes" (Baslé M., 2000,
reprenant Commons).
8
Au sens donné par Mermet qui définit la "gestion effective" d'un milieu comme l'ensemble des actions qui
génèrent un effet sur ce milieu, quel que soit l'acteur à l'origine de ces actions et que ces actions soient ou ne
soient pas conscientes ou voulues (Mermet, 1991)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%