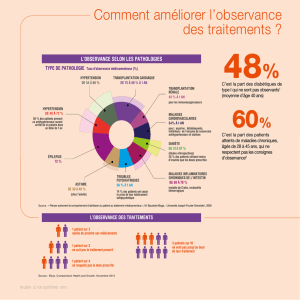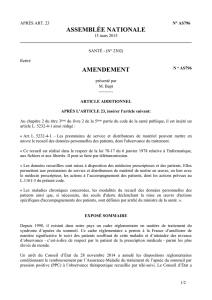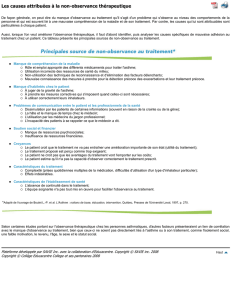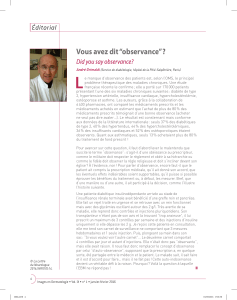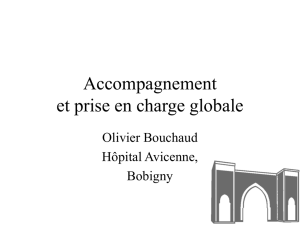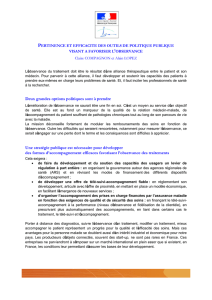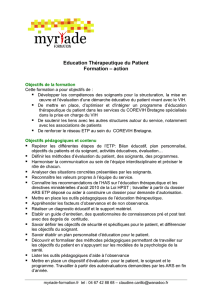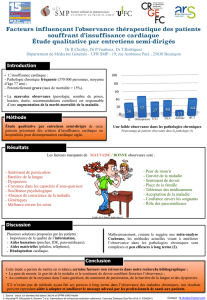rapport

Inspection générale
des affaires sociales
Alain LOPEZ et Claire COMPAGNON
Membres de l’Inspection générale des affaires sociales
PERTINENCE ET EFFICACITE DES OUTILS DE
POLITIQUE PUBLIQUE VISANT A FAVORISER
L'OBSERVANCE
Établi par
RAPPORT
- Juillet 2015 -
2015-037R

2 IGAS, RAPPORT N°2015-037R

IGAS, RAPPORT N°2015-037R 3
SYNTHESE
Si, à en croire Hippocrate, le malade ment à son médecin depuis la nuit des temps, ce n’est
sans doute pas sans bonnes raisons. Le célèbre savant les ignore. La prescription médicale est le
verdict de la science. Aussi s’affirme-telle comme incontestable. Dans ces conditions, la non-
observance du traitement est considérée comme le résultat au mieux d’une négligence, au pire
d’une incohérence.
La définition du bon niveau d’observance d’un traitement relève de plusieurs acteurs : celle
de l’industriel producteur du médicament, du médecin traitant, du patient. Industriels, médecins,
malades, à partir de positions différentes, partagent en fait un même objectif : la santé. Pourtant ils
peuvent ne pas s’entendre. Alors, il faut chercher les voies de la conciliation entre des points de vue
divers. C’est la seule façon d’échapper à une confrontation sans issue entre ces différentes
perceptions de l’observance. La notion d’observance donne raison au prescripteur, plus ou moins
fidèle aux consignes du producteur du médicament. Elle entend que le patient se soumette à ce qui
est affirmé avec autorité comme étant son intérêt. Nous sommes loin avec elle de cet esprit de
conciliation qui exige de faire une place aux raisons de chacun. Aussi fait-elle l’objet de
controverses entre ceux qui ne reconnaissent que le savoir médical et ceux qui affirment la capacité
d’expertise de la personne sur le mal dont elle souffre, entre ceux qui font de la prescription du
médecin un absolu et ceux qui veulent voir le patient considéré en sujet de ses soins.
Après tout, un patient est d’abord responsable de ses choix devant lui-même. C’est sa vie qui
est en jeu. Libre à lui de suivre ou pas les recommandations de son médecin, à ses risques et périls.
Mises à part les situations où par ses comportements ou la transmission d’un agent microbien il
mettrait en danger les autres, un patient n’a pas à se voir imposer un traitement qu’il n’entend pas
prendre pour des raisons qui lui appartiennent. Le seul devoir du médecin est alors de l’informer de
façon complète sur sa pathologie et sur les moyens de la traiter. Au patient ensuite de prendre sa
décision en toutes connaissances de cause. La loi du 4 mars 2002 a clairement affirmé les droits des
patients et les devoirs des soignants sur ces sujets.
Les choix individuels ont cependant des conséquences collectives. Un patient non-observant
rendra vaine une dépense publique consacrée à l’amélioration de sa santé. Mal soigné, il souffrira
plus tard de complications exigeant des soins coûteux. Le patient non-observant prend des risques
pour lui-même, mais par les dépenses évitables qu’il entraîne, il ampute une part d’une ressource
publique limitée, qui fera défaut pour répondre aux besoins de santé de la population. Quelques
évaluations de ces dépenses inutiles et évitables ont été faites par diverses études en France et dans
des pays étrangers. Aux Etats-Unis, le "Council for Affordable Healthcare"1a calculé que la non-
observance entraîne des coûts supplémentaires globaux de 290 Mds$ par an et est responsable de
125 000 décès. En France, l’étude récente IMS Health estime les dépenses dues à une non-
observance à 9 Mds€ par an. Et un travail effectué par Jalma évalue à 12 000 le nombre de morts
évitables par an. Peu importe la réalité exacte de ces chiffres. Ils sont toujours élevés.
L’action publique en santé s’est donc emparée de cette question de l’observance des
traitements, au vu des conséquences pour les malades et sous la pression grandissante des
contraintes budgétaires. Mais les difficultés commencent dès la mesure d’une non-observance et de
ses conséquences. Les résultats sont peu fiables. Et les conséquences sur la santé sont souvent
tellement lointaines pour être toutes enregistrées avec exactitude. Quant aux causes de la non-
observance, elles sont nombreuses et difficiles à toujours bien identifier. Ces imprécisions
n’empêchent pas d’agir, mais elles ne sont pas sans incidence sur les dispositions susceptibles
d’être prises.
1 Liz Tierney, « Patient non-adherence costs underestimated | Packaging World ».

4 IGAS, RAPPORT N°2015-037R
De prime abord, la volonté d’une personne malade est plutôt de soulager sa souffrance,
d’échapper au danger qui la menace. Aussi le plus logique est, a priori, d’apporter au patient toutes
les connaissances sur sa situation médicale lui permettant de prendre les décisions les plus
adaptées, de le soutenir tout au long de son parcours de soins pour l’aider à supporter les
contraintes de son traitement. La loi HPST du 21 juillet 2009 a donné un cadre légal à cette
approche, en définissant trois moyens – l’éducation thérapeutique du patient (ETP),
l’accompagnement, l’apprentissage – tous conçus pour développer et soutenir les capacités des
usagers. Mais notre politique publique est restée au milieu du gué. Les programmes d’ETP
progressent en nombre, mais surtout au profit de la prise en charge de quelques pathologies
(diabète, maladies respiratoires, maladies cardio-vasculaires), et leur mise en œuvre est inégale sur
les territoires. Mises à part les actions conduites par l’assurance maladie, les programmes
d’accompagnement sont peu développés. Quant aux programmes d’apprentissage, ils deviennent
rares. Les pharmaciens d’officine s’impliquent de plus en plus dans des actions de conciliation
médicamenteuse et d’accompagnement des patients, dans la préparation des doses administrées,
mais leur rôle est encore modeste. Les associations d’usagers, qui ont une vocation naturelle à
servir d’opérateur pour mettre en œuvre de telles interventions, ont de la peine à porter des
programmes d’ETP ou d’accompagnement, parce qu’elles n’ont pas toujours les forces suffisantes
pour le faire, parce que les financements restent faibles au regard des besoins, parce que les
promoteurs de projets hospitaliers se sont imposés.
Le développement et le soutien des capacités des usagers pour prendre en charge leur
pathologie, en s’appuyant sur l’ETP, l’accompagnement, l’apprentissage, apparaît en France
comme une approche encore très marginale, quand en 2003 l’OMS considérait qu’ « améliorer
l’adhésion du patient à un traitement chronique devrait s’avérer plus bénéfique que n’importe
quelle découverte biomédicale2 », quand la nécessité de promouvoir les logiques
« d’empowerment » et les programmes de « disease management » est affirmée avec toujours plus
de force. Bien des conditions font aujourd’hui défaut pour qu’il puisse en être autrement. Le
pilotage de ces actions est dispersé entre plusieurs autorités publiques et n’assure pas d’une
stratégie efficiente. Ayant engagé fort justement des actions d’accompagnement innovantes et
intéressantes, l’assurance maladie, installée aujourd’hui dans une double position de financeur et
d’opérateur, ne facilite pas la promotion d’une offre associative suffisamment diversifiée et solide
pour porter le développement de ces programmes. Quant aux financements, ils sont modestes et
précaires.
Cependant, l’accompagnement de patients, pour notamment favoriser la bonne observance
des traitements, est en train de prendre des formes totalement nouvelles. La production des objets
connectés les plus divers est en plein essor. Ils peuvent transmettre des données de plus en plus
nombreuses, sur les comportements, les constantes biologiques, les caractéristiques physiques et
physiologiques des patients, à des services d’accompagnement apportant conseils et orientations.
Une offre de services de « télé-suivi-accompagnement » est en plein développement. Il faut en
clarifier les objectifs et les contenus, préciser les principes auxquels leur organisation et leur
fonctionnement doivent obéir, définir le modèle économique capable d’en assurer la viabilité. Ces
dispositifs de télé-suivi-accompagnement auront à s’intégrer au sein du réseau des offreurs de soins
de proximité.
2Organisation Mondiale de la Santé – Adherence to longterm therapies. Evidence for action. 2003.
http://www.who.int/chronic_conditions/adherencereport/en/

IGAS, RAPPORT N°2015-037R 5
La télésurveillance inquiète. Le télé-suivi rassure. Préférer la seconde formulation à la
première peut n’être qu’un jeu de dupes, quand le suivi est fait bien sûr de surveillance. Quel que
soit le vocabulaire employé, le patient peut devenir l’objet d’une inquisition permanente
susceptible de dévoiler ses secrets les plus personnels. Un pas de plus et les données transmises,
objectivant enfin le niveau d’observance du traitement, pourraient faciliter la mise en œuvre de
mesures plus ou moins coercitives cherchant à remettre le « déviant » dans le droit chemin, en
poursuivant les objectifs les plus louables.
Selon certaines critiques, cette orientation a débuté avec la réforme récente de la tarification
des appareils à pression positive continue (PPC) prescrits pour traiter les patients souffrants
d’apnées du sommeil. A partir des données télétransmises sur l’observance, il s’agissait de moduler
le tarif rémunérant les activités du prestataire de service à domicile, en fonction du niveau
d’observance obtenu, pris comme marqueur de la qualité de l’accompagnement. Dans un second
temps, l’appareil à PPC pouvait être retiré. Ce retrait, considéré comme une sanction de la personne
malade, a masqué la disposition précédente et a paru donner tout son sens à la réforme.
Se plaindre de l’injustice de ces critiques empêcherait de tirer les leçons de cette expérience.
Lier la prise en charge financée par l’assurance maladie à l’observance ne saurait se concevoir sans
engager un débat public sur le principe, sans procéder aux consultations nécessaires de toutes les
parties prenantes. En second lieu, l’objectif de santé poursuivi doit être premier, sinon l’action
publique se trouve limitée à la seule recherche d’une bonne observance, qui n’est qu’un moyen de
traiter les personnes souffrant d’apnées du sommeil, négligeant la prévention et l’examen de la
pertinence des prescriptions. Enfin, le seuil d’observance retenu, quand il est rendu opposable au
patient, doit être incontestable sur le plan scientifique. Ce n’était pas le cas. Dans ces conditions,
améliorer la santé des personnes souffrant d’apnées du sommeil, objectif soutenu par la réforme,
est apparu servir d’alibi à la recherche d’économies immédiates. La contradiction irréductible entre
ces deux objectifs (une meilleure observance ne permet pas de faire des économies immédiates) n’a
pas su être gérée et dépassée. Aussi, les pouvoirs publics ont été accusés de dureté (laisser une
personne malade sans traitement), quand ils se voulaient protecteurs.
Il est difficile, impossible, d’échapper au reproche de vouloir sanctionner la personne malade
désobéissant, en conditionnant sa prise en charge au niveau d’observance du traitement constaté.
Le patient, déjà victime de sa maladie, devient, par un moindre remboursement de ses soins ou par
un arrêt du financement de sa prise en charge, puni d’une faute, celle de n’avoir pas respecté
correctement les prescriptions médicales. Ce ne peut être vécu que comme une double peine.
D’autant plus que le patient, a priori soucieux au premier chef de sa santé, a ses raisons pour s’être
montré non-observant, et parmi elles il peut y avoir la mauvaise qualité de la relation entre lui et
son médecin, un accompagnement insuffisant et parfois la dureté des traitements. Au bout du
compte, ce sont les plus faibles qui se trouveraient mis en face de responsabilités qu’ils étaient en
peine d’assumer, qui verraient se dresser devant eux une barrière financière compliquant l’accès
aux soins.
Pour autant, les raisons d’être non-observant ne sont pas toutes excellentes, par principe. La
non-observance est un comportement à risque adopté dans bien des cas en toute connaissance de
cause. L’apparition d’une maladie n’impose pas silence aux différentes aspirations qui donnent
toute sa valeur à une vie humaine. La nécessité de respecter les contraintes d’un traitement n’efface
pas les obligations et aspirations qui forment l’armature d’une existence. Mais cette prise de risque
intéresse l’individu. Jusqu’où la collectivité doit-elle supporter les conséquences d’une prise de
risque relevant de l’exercice d’une liberté individuelle ? Prétendre répondre à une telle question
conduit à s’engager sur une pente dont le terme est indiscernable. Aucun argument définitif ne
saurait parvenir à limiter la liste des comportements à risque, entraînant un moindre concours de la
solidarité collective.
La mission recommande de ne pas s’engager sur cette voie, et donc de ne pas lier le
remboursement des soins à l’observance du traitement, même pour une faible part.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
1
/
161
100%