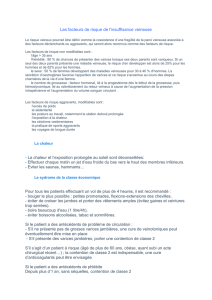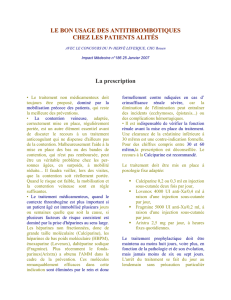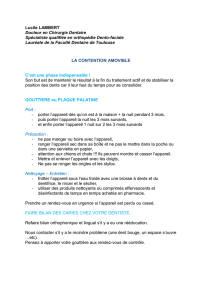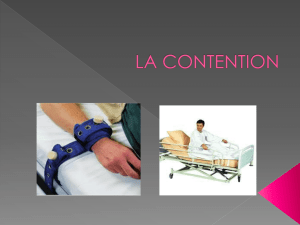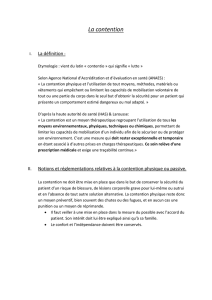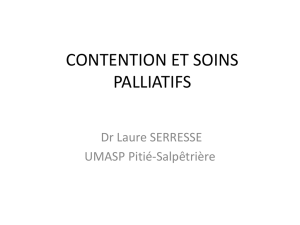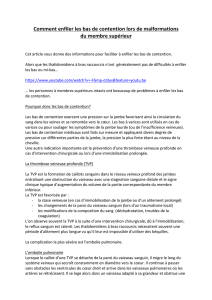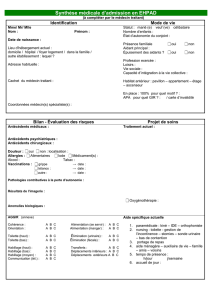AK1984_11_10_439-442

Ann. Kinésithér., 1984, t. 11, nO 10, pp. 439-442
©Masson, Paris, 1984
La contention élastique et la prévention
des thromboses veineuses profondes
MÉMOIRE
J.Y. BOUCHET (1) (2), C. RICHAUD (1), A. FRANCO (1)
(1) Service d'Angiologie (Pr. Ag. A. Franco), (2) École de massa-kinésithérapie, CHR U, F38043 Grenoble Cedex.
1
,
Introduction
La prophylaxie de la maladie thrombo-
embolique utilise des moyens mécaniques et
médicamenteux (5) (6). Au niveau des membres
inférieurs, les moyens mécaniques (2) luttent
contre la stase veineuse, principal facteur pa-
thogénique de la thrombose veineuse pro-
fonde (TVP) chez le sujet alité. L'efficacité de
ces techniques est améliorée par la sommation
et la répétition des méthodes mises en œuvre.
La kinésithérapie et ses moyens mécaniques
Déjà développés par ailleurs (1), ils sont ici rappelés.
L'INSTALLATION EN DÉCLIVE
Le patient est placé, les membres inférieurs surélevés
de 10 à 15 cm, en discrète flexion, abduction, rotation
externe de hanche et en légère flexion de genoux. La
pesanteur accélère le flux veineux, la position du malade
évite la compression des veines entre l'aponévrose et les
reliefs osseux sous-jacents ..
LES EXERCICES RESPIRATOIRES
Ils favorisent d'une part la vis-a-fronte, c'est-à-dire
l'aspiration du sang veineux par le jeu thoraco-diaphrag-
matique (8) ; d'autre part, une phléboconstriction globale
synchrone des mouvements inspiratoires. Les mouvements
respiratoires amples et non forcés sont enseignés au patient
pour qu'il puisse les répéter seul tout au long de la journée.
Les auteurs remercient les laboratoires Thuasne de leur avoir
. fourni gracieusement le matériel de contention.
Tirés à part: J.Y. BOUCHET, à l'adresse ci-dessus.
LES MOBILISATIONS
Au niveau des tibio-tarsiennes, le but est de vider les
sinus des soléaires. Les flexions plantaires actives mettent
. enjeu la pompe musculo-veineuse du mollet et provoquent
une accélération de la vidange qui se manifeste par une
diminution des pressions veineuses. La flexion dorsale
passive ou active provoque un étirement de l'aponévrose
surale qui comprime le triceps. Grâce à la présence des
valvules, le sang est envoyé vers la racine du membre.
Ces deux techniques sont efficaces (8). Le rythme adopté
est lent. Le malade répète l'exercice pendant une dizaine
de minutes toutes les heures.
A un niveau plus global, le but est d'accélérer le flux
sanguin dans tout le système circulatoire et d'augmenter
l'activité des enzymes fibrinolytiques par l'exercice du plus
grand volume musculaire possible.
Lorsque le patient est incapable d'assurer des contrac-
tions actives, des moyens passifs comme l'électro-
stimulation (2), les mobilisations mécaniques (2) ou la
compression pneumatique intermittente (3) peuvent être
utilisés. C'est le cas notamment des malades non
coopérants, inconscients ou paralysés.
LE LEVER PRÉCOCE
Il reste l'une des meilleures méthodes lorsqu'elle peut
être utilisée. Le lever et la marche immédiate sont du
domaine de la prescription médicale.
LA CONTENTION
Elle complète cet arsenal thérapeutique et doit faire
l'objet d'une attention particulière.
La contention élastique
LES OBJECTIFS DE LA CONTENTION
Il s'agit d'exercer une pression externe contrô-
lable qui, ajoutée àcelle des tissus, s'oppose à

1
L
440 Ann. Kinésithér., 1984, t. II, n° 10
la pression hydrostatique veineuse et limite ainsi
la distensibilité des parois. Le calibre des veines
diminue, ce qui provoque une augmentation de
la vitesse circulatoire.
Ainsi l'amélioration de la continence valvu-
laire par le rapprochement des parois permet un
meilleur rendement de la pompe musculo-
veineuse du mollet.
Il faut observer un gradient de pression de
la distalité vers la proximalité. Il est estimé de
18 à 10 mmHg pour le segment jambier chez
le patient alité (7). L'effet garrot, inconvénient
majeur de la contention élastique, survient
lorsque la somme des pressions externes et
tissulaires dépasse la pression hydrostatique
veineuse. La stase est alors augmentée, ce qui
va à l'encontre de l'effet recherché.
Dans les zones à fort rayon de courbure,
comme le mollet, la pression exercée est plus
faible. Au contraire, un faible rayon de courbure
correspond à des zones de surpression comme
la crête tibiale, les malléoles ou le tendon
d'Achille.
Ceci impose de la rigueur dans le choix de
la contention, dans sa mise en place et dans sa
surveillance.
LES MÉTHODES DE ÇONTENTION
Le choix entre les divers procédés actuelle-
.ment proposés reste ouvert : bas, contention
tubulaire ou bandes élastiques sont disponibles.
La contention par bas
Elle est esthétique et confortable. Son applica-
tion par l'équipe soignante, le malade ou sa
famille, est aisée. La bonne mise en place n'est
pas remise en cause par les mouvements ou
mobilisations du patient tout au long de la
journée. Les segments jambiers des Orteils
jusqu'au creux poplité ou les membres inférieurs
dans leur totalité sont recouverts. Il existe de
nombreux modèles en taille et en longueur. Il
faut donc disposer d'un échantillonnage large
pour pouvoir adapter la contention à la morpho-
logie du patient. Mais en pratique l'ajustement
n'est pas toujours parfait, ce qui rend plus
douteuse l'efficacité du procédé même si, sur un
sujet idéal, les gradients des pressions obtenus
correspondent aux normes recherchées. Enfin la
survenue d'une thrombose impose le recours à
une contention plus adaptée et doit faire
abandonner les bas.
La contention tubulaire
. Elle se présente sous forme d'un tube de
coton +viscose de longueur de 1 à 10 mètres,
sans couture longitudinale et transversalement
élastique. L'élasticité est assurée par un fil de
caoutchouc unique et spiralé .coulissant dans sa
gaine et permettant une certaine adaptation aux
formes du membre à contenir. Il existe de
nombreux diamètres qui sont choisis en fonction
de la circonférence du membre et de la pression
recherchée. Les valeurs de pressions considérées
sur le ruban de mesure de la circonférence,
fourni par le fabricant, correspondent à la
superposition de deux épaisseurs du bandage. La
zone recouverte se limite au segment jambier
dans la plupart des cas car, pour s'étendre
jusqu'à la racine du membre, il est nécessaire
de rajouter une deuxième portion de tube d'un
diamètre supérieur. La zone de jonction devient
un secteur critique et on peut observer soit une
surpression par accumulation de plusieurs épais-
seurs, soit une absence de recouvrement de la
région du genou après quelques mouvements.
Il faut de toute façon surveiller les extrémités
de la contention pour éviter l'enroulement du
tube sur lui-même..
Les modalités usuelles de mise en place de
ce type de contention 'càmmencent par la mesure
du plus grand périmètre du mollet qui détermine
la largeur du tube. L'utilisateur coupe ensuite
une longueur double de celle du segment à
contenir. IlIa met en place afin de recouvrir la
zone choisie et replie la demi-longueur restée
libre en l'inversant. La ligne de réflexion située
au pied laisse les orteils libres.
De faible coût, cette contention est générale-
ment très bien tolérée par les patients mais elle
nécessite une vérification régulière de sa bonne
application. En cas de modification rapide du
volume du. membre contenu, un nouveau tube
est adapté.
La contention par bandes
Elles sont élastiques dans le sens de la
longueur et pour certaines dites «bi-élasti-

----..-."
a
b
Fig. 1. - Mise en place d'une contention par bande biélastique.
Ici une bande Biflex (R) avec son artifice graphique. L'étirement
de 30 %transforme le rectangle en carré. a -et la triple
épaisseur le cachera totalement. b -pour l'obtention d'une
contention moyenne de 10 à20 mmHg.
ques »également en largeur. Les bandes biélas-
tiques sont préférées car elles permettent une
meilleure adaptabilité aux reliefs et aux morpho-
logies particulières. La pression exercée sous la
contention dépend du degré d'allongement de
la bande et du nombre de couches superposées
les unes sur les autres. La mise en place débute
à la racine des orteils, puis recouvre le segment
jambier, talon compris, jusqu'au creux poplité.
On peut remonter jusqu'à la racine du membre
avec une longue bande de 5 m ou une deuxième
bande; mais, là encore, la zone du genou est
difficile à· recouvrir et le risque de mauvaise
application augmente. Cet inconvénient incite
le plus souvent, en prophylaxie, à limiter la
contention au-dessous du genou, le mollet
représentant la zone d'élection des TVP. Il est,
même dans ce cas, impératif de surveiller la
bonne mise en place de la contention et de
renouveler son application toutes les six ou huit
heures. Elle est portée jour et nuit.
Il importe de déterminer avec précision la
longueur de la bande choisie (3,5 ou 4 ou
. 5 mètres) en fonction de la morphologie du
segment de membre considéré. On évite ainsi
Ann. Kinésithér., 1984, t. 11, n° 10 441
l'accumulation d'épaisseurs en fin d'application
si la bande est trop longue ou, un étirement plus
important si elle est trop courte.
Ainsi avec la bande Biflex +N' 16(R) utilisée
par notre équipe (fig. 1), on obtient une pression
de 10 à 20 mmHg lors d'un étirement de 30 %
et une superposition de 3 épaisseurs. La quantifi-
cation de l'allongement et la précision du
nombre de couches sont en partie résolues par
un artifice surajouté à la bande. De petits
rectangles imprimés sur le tiers'moyen de cette
bande se déforment et deviennént carrés lorsque
l'allongement atteint les 30 % requis. Pour
obtenir 3 épaisseurs de bandage, on recouvre à
chaque tour les carrés du tour précédent,
c'est-à-dire les 2/3 de la largeur. L'artifice des
rectangles surajoutés permet une meilleure
fiabilité des pressions exercées. Pour une bande
très extensible comme la Biflex N' 16, la tolé-
rance dans les variations de l'étirement est
relativement large pour l'obtention de la pres-
sion de contention désirée. Par contre, le nombre
d'épaisseurs doit être respecté car la pression-
réalisée lui est directement proportionnelle (4).
Depuis quatre ans, nous utilisons ce type de
bande étalonnée. L'apprentissage de la pose de
la contention par des personnes non initiées
(étudiants, patients, entourage familial) est
grandement facilité. Les pressions vérifiées sous
la contention n'ont ainsi jamais mis,en évidence
de valeurs dépassant 40 mmHg qui puissent faire
craindre un effet de garrot'·veineux.
Indications et contre-indications
Les indications sont déterminées par la
présence d'un risque thrombo-embolique et en
particulier d'un risque de stase veineuse.
Les contre-indications sont limitées. Ainsi,
une artériopathie sévère des membres inférieurs
contre-indique la déclive et la contention qui
risquent de réduire une perfusion artérielle déjà
inférieure.à 70 mmHg.
Le traitement orthopédique interdit parfois les
mobilisations ou la contention .
Dans ce cas, les autres moyens disponibles
sont d'autant plus utilisés.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
442 Ann. Kinésithér., 1984, t. JI, nO10
Conclusion
La prévention des thromboses veineuses pro-
fondes représente un souci permanent, en
particulier en milieu hospitalier. Son efficacité
dépend de sa précocité et de l'assiduité de sa
mise en œuvre par l'équipe soignante et le
patient lui-même. La contention portée en
permanence pendant la période de risque doit
faire l'objet d'une attention particulière afin d'en
garantir l'efficacité et l'inocuité.
Bibliographie
1. BOUCHET J.-Y., RICHAUD C., VERNET J.-M., DE ANGE-
LIS M.-P., FRANCO A. - Les phases de la rééducation au
cours des thromboses veineuses profondes des membres.
Journée de médecine physique et de rééducation. Expansion
scientifique française, édit. 1983, 277-281.
Pour classer
et conserver
votre coUection
de fascicules
Une reliure mobile - sans perforation, sans
collage - qui permet d'inclure et de retirer
chaque numéro sans le détériorer.
Ellese présente comme un livre relié grenat
avec tifre en lettres dorées.
2. BROWSE N.L. - The prevention ofvenous thrombo-embo/ism
by mechanical methods. ln : Bergari J.J., Yao I.S.T. Venous
problems. Year book medical publishers, edit., Chicago, 1978,
563-569.
3. COTTON L.-T., ROBERTS V.-c. - The prevention of post-
operative deep venous thrombosis by intermittent compression
of the legs. ln : Bergan J.J., Yao I.S.T. Venous problems.
Year book medical publishers, edit., Chicago, 1978,553-557.
4. METTE F., Hopp M. - Dosage de la contention élastique
dans l'œdème traumatique. Synth. Méd., 1983, 14-16.
5. SAMAMA M., KHER A. - Mécanismes de la thrombose
veineuse. Déductions thérapeutiques sur la prophylaxie. Rev.
Prat., 1977, 27, 1282-1288.
6. SERRADIMIGNI A., CHICHE G. -. La maladie thrombo-
embolique post-opératoire. Encycl. Med. Chir., Paris, 1983,
Anesthésie réanimation, fasc. 36827 A-3D.
7. SIGEL B., EDELSTEIN A.-L., SAVITCH L., HASTY J.-H.,
FELIX R. - Type of compression for reducing venous stasis.
A study of lower extremities during inactive recumbency.
Arch. Surg., 1975, 10, 171.
8. THEYS S., SCHOEVAERDTS J.-c., CLERIN M., BILLY V. -
Résultats préliminaires de l'effet de certaines manœuvres
kinésithérapiques sur la circulation veineuse. Rev. Semin.
Belges Réadap., 31-41, 1, 1979.
Adressez vos commandes à :
Sté Moreau et Cie
37, rue de l'Abbé-Grégoire, 75006 PARIS
Tél. 548.50.21 - CCP Paris 852577
Joindre règlement àla commande
125 Fies 3 reliures TTC. franco de port
opar chèque bancaire
opar C.C.P. (tr"ois volets)
opar mandat-lettre
en précisant «Annales de Kinésithérapie»
1
/
4
100%