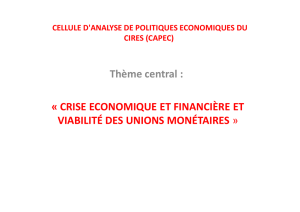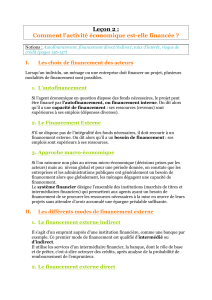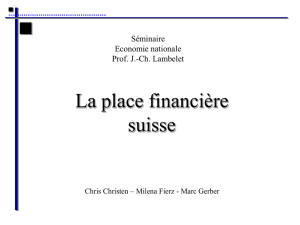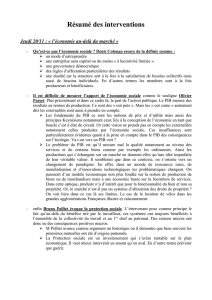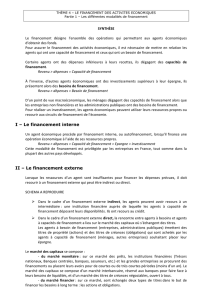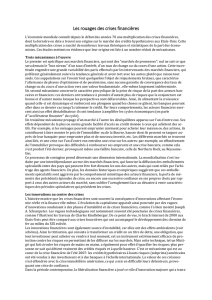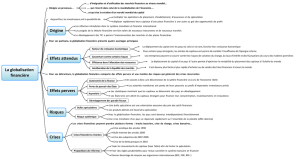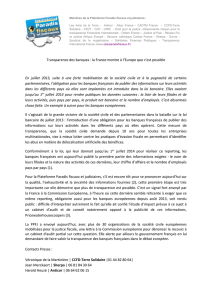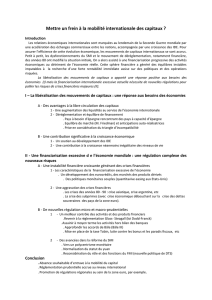La crise de 1929 et ses enseignements

1
La crise de 1929 et ses enseignements
Article pour le volume Crises financières
dirigé par J. Gravereau et J. Trauman, Economica, 2001
Pierre-Cyrille Hautcœur
La crise de 1929 est souvent symbolisée par le krach boursier de Wall Street. Pourtant, la
gravité de celui-ci n’est pas ce qui rend cette crise unique : la chute du cours des actions qui a
lieu en octobre 1929 a été dépassée auparavant et depuis. La spécificité des années 1930 est
que la crise financière est suivie d’une récession qui s’aggrave durant plusieurs années,
conduisant au phénomène unique d'une "grande dépression" qui s'étend sur près d'une
décennie. Cette dépression mondiale, d'une ampleur sans précédent (baisse d'un tiers de la
production industrielle mondiale), est-elle d’abord la conséquence d'une crise financière, ou
d’autres explications sont elles plus importantes ? Nous tenterons de répondre à cette
question, qui conditionne les enseignements que l'on peut prétendre tirer de cette époque, en
examinant d'abord la crise financière américaine qui est au cœur de la dépression ; nous
chercherons ensuite à nuancer le rôle central de la crise financière dans l'enchaînement fatal
des années 1929-1933 en examinant les causes non financières de la dépression, et en
soulignant les conditions internationales spécifiques de son déclenchement. Nous montrerons
au fur et à mesure quels enseignements ont été tirés de la crise et tenterons de juger de leur
pertinence actuelle.
I. Une crise du système financier américain
La crise se manifesta en octobre 1929 par une chute brutale des cours des actions à Wall
Street. En un mois, tous les gains de la phase spéculative depuis le début de l'année furent
perdus. Malgré quelques brèves reprises, cette baisse se prolongea jusqu'à 1932 où elle
dépassa les 80%. Le krach ne fut pas sans répercussions sur le système financier américain :
comme le développement de l'achat de titres à crédit avait activé la hausse des cours, la baisse

2
de ceux-ci mit les emprunteurs en difficulté, et conduisit à la faillite certains de leurs
créanciers, brokers ou banques trop engagées. Cependant, un soutien rapide de la Banque de
réserve fédérale de New-York évita une panique.
Au delà du krach boursier, les crises financières se succédèrent dans les années 1930-1933.
Plusieurs vagues de faillites bancaires eurent lieu en 1930 et surtout 1931 et 1933. En trois ans
disparurent 9000 banques, représentant 15% des dépôts du système bancaire. La gravité de
ces vagues s'explique largement par le phénomène de "dominos" qui conduisit des banques à
faire faillite du seul fait de la chute d'autres banques leurs débitrices, et par les runs qui
conduisirent les déposants paniqués à retirer en masse leurs dépôts, amenant les banques à la
crise de liquidités. Le surendettement de certaines emprunteurs (spécialement les fermiers du
middle-west) et la chute d’autres marchés d'actifs (fonciers et immobiliers) jouèrent également
un rôle initiateur non négligeable. Quoi qu’il en soit, au printemps 1933, la panique atteignit
un tel degré qu’une fermeture de plusieurs jours de l’ensemble du système bancaire fut
nécessaire pour ramener le calme.
Cet ensemble de crises financières fut-il à l'origine de la crise économique sans précédent que
connurent les Etats-Unis alors ? (la production industrielle baissa de 50%, le PIB d'un tiers en
termes réels et l'investissement disparut tandis que le taux de chômage atteignait 25%, la
reprise se faisant attendre puisque le niveau de production de 1929 ne fut atteint qu'en 1936).
Si tel est le cas, quelles réformes du système financier auraient-elles permis d'éviter une telle
crise ou sa transmission à l'économie ? Les économistes ont proposé un grand nombre de
réponses à ces questions essentielles.
Les années 1920 avaient été une décennie de prospérité et de hausse, souvent rapide, des
cours des actions. L'éventualité même d'une récession était écartée par ceux, nombreux, qui
croyaient que le développement des nouvelles technologies ouvrait un avenir définitivement
radieux de croissance et de progrès (la radio en particulier éveilla les mêmes fantasmes sur
l'abolition de la distance et sur la communication universelle que l'internet). Le choc
psychologique du krach de Wall Street fut donc d'autant plus considérable. Ceci ne suffit
cependant pas pour affirmer que ses conséquences réelles furent importantes, nombre
d’économistes considérant au contraire que la bourse reflète la situation économique plus
qu’elle ne l’influence.
Certes, toute chute brutale de prix conduit à des pertes. Avant la bourse, les marchés de
produits primaires avaient déjà subi de fortes baisses de prix, affectés d’ailleurs par des

3
mécanismes de transmission analogues à ceux des marchés d'actifs: des stocks importants de
matières premières, spécialement agricoles, s’étaient constitués dans les années 1925-1929
alors que la production augmentait et que les prix baissaient (les produits primaires non-
alimentaires virent leurs prix baisser de plus de 25% par rapport aux prix industriels entre
1925 et 1929). La crise financière amena la révision des anticipations et la liquidation des
positions sur ces marchés, ce qui accéléra la chute des prix et la crise agricole aux Etats-Unis
et ailleurs. Etant donné le poids des fermiers dans l'économie, ceci joua sans doute un rôle
important dans le démarrage de la crise (chute de la demande des fermiers et chute de la
production du fait de faillites nombreuses). Des mécanismes similaires touchèrent nombre de
secteurs industriels où, devant des débouchés décroissants, les entreprises virent leurs stocks
augmenter, durent baisser leurs prix, et se trouvèrent en faillite même si leurs coûts variables
baissaient, dans la mesure où leurs coûts financiers restaient stables.
En théorie cependant, une crise de ce type ne peut pas durer longtemps du fait de l’existence
de mécanismes spontanés de retour vers la pleine activité, de sorte qu’à long terme les faillites
redistribuent de la richesse mais affectent peu le revenu national: un fermier qui fait faillite
ruine éventuellement ses créanciers, mais ceci ne l'empêche pas de recommencer à travailler,
éventuellement comme salarié agricole, avec une productivité identique : ni sa force physique
ni sa compétence ne sont affectées, de même que les machines et les terres n'ont pas disparues
ni ne sont devenues moins productives. Si certaines activités sont devenues durablement
moins rentables (par exemple, à la fin des années 1920, l'agriculture connaissait une
surproduction), les prix y baissent relativement à ceux des autres secteurs, ce qui réduit les
revenus et donc incite certains travailleurs à se tourner vers d'autres activités où ils seront
mieux rémunérés (et certains capitalistes à investir ailleurs leurs capitaux). De cette manière,
le plein emploi est vite rétabli.
Néanmoins, on constata dans les années 1930 un chômage massif. L'explication classique
consiste à dire que les salaires étaient rigides, c'est-à-dire que les travailleurs refusèrent la
baisse de salaire ou la mobilité vers une autre activité, ce qui les conduisit au chômage.
Keynes suggéra cependant que la baisse des salaires n’était pas une solution car,
indépendamment de ses coûts sociaux élevés, elle conduirait à une baisse de la demande qui
renforcerait la chute de la production, enclenchant un cercle vicieux de baisse du revenu et de
la production. Cette chute de la consommation pouvait selon lui être déclenchée par une
réaction des individus à un krach boursier selon un mécanisme d’effet de richesse : se
considérant comme plus pauvres, les détenteurs d'actifs financiers auraient cherché à
reconstituer leurs patrimoines en épargnant, ce qui aurait provoqué une baisse de leur

4
consommation (à revenu inchangé), donc de la demande, d'où la chute des ventes de nombre
de produits, spécialement des biens chers tels qu'automobile ou équipement ménager qui
tiraient spécialement la croissance des années antérieures et dont l'achat pouvait souvent être
différé (surtout dans le cas de renouvellements). En outre, en l'absence de systèmes de
retraites développés, les retraités qui comptaient sur la liquidation progressive de leur épargne
financière pour vivre virent leur pouvoir d'achat s'effondrer. Selon certaines études un tiers du
recul de la consommation résulta de cet effet de richesse. Nombre d'économistes doutent
cependant de l'importance de cet effet pour expliquer autre chose qu'un recul de court terme
de la demande et du revenu, et soulignent que la concentration de la détention d'actions dans
une petite partie de la population américaine rendait impossible un effet aussi généralisé de
baisse de la consommation.
Une manière plus indirecte de considérer un impact du krach boursier consiste à considérer
que les individus, détenteurs ou non d’actifs financiers, regardent les cours boursiers comme
un simple indicateur de l'évolution future de l'activité économique. Plus que la perte de leur
patrimoine, c'est alors l'incertitude sur l'évolution future de leur revenu, qui s'affichait dans la
forte volatilité du marché financier des années de crise, qui aurait conduit les individus à
reporter leur consommation, ce phénomène étant aggravé par leur endettement élevé (les
années 1920 furent celles du crédit à la consommation pour l’acquisition des biens durables
qui envahirent alors les foyers américains, de la machine à laver à l’automobile).
Dans les deux cas, la transformation de la crise financière en dépression résulta de l'incapacité
de l'économie à s'adapter spontanément à cette chute de la consommation des ménages. Même
en considérant celle-ci comme acquise, on pourrait imaginer une autre forme d’adaptation, qui
passerait par une augmentation de l'investissement, elle-même facilitée par la baisse du taux
de l'intérêt due à l'augmentation de l'épargne (qui dit consommation d'une moindre part du
revenu dit augmentation de l'épargne). Cependant, il semble que les entreprises hésitèrent à
investir du fait de la baisse de la demande (effet de « myopie »), ou parce qu’en période de
baisse des prix les salaires réels comme les taux d’intérêt réels leur semblaient élevés malgré
des baisses nominales. Ceci conduisit Keynes à suggérer des dépenses publiques pour recréer
une demande qui devrait inciter les entreprises à investir et faire "repartir la machine"
économique.
Dans toutes ces interprétations, qu’elles soient fondamentalement « réelles » ou
« financières », des imperfections du marché et des mécanismes auto-régulateurs de
l'économie justifiaient une intervention publique correctrice, dont le retard conduisit à
l’aggravation de la crise.

5
Une interprétation opposée considère non plus que l'économie s'adapta mal à la crise mais au
contraire que c'est la politique du gouvernement qui empêcha l'adaptation spontanée qui aurait
permis une reprise rapide. Cette interprétation, proposée par Milton Friedman, met également
la crise financière à l'origine de la dépression, mais cette fois dans sa composante bancaire
plus que boursière. Selon cet auteur, c'est la politique monétaire restrictive de la Banque
fédérale de réserve américaine qui fut à l'origine non seulement du krach boursier mais, plus
gravement, des crises bancaires. En négligeant d'abord de prêter largement à taux bas, puis
d'intervenir comme prêteur en dernier ressort pour sauver les banques en péril au milieu de
crises qui n'étaient pas imputables à leur mauvaise gestion, la Banque centrale se serait rendu
responsable des crises bancaires et de la chute de la masse monétaire qui en résulta. Ces crises
auraient été la vraie cause de la dépression dans la mesure où la réalisation des échanges
aurait été freinée et parfois bloquée par l'absence de monnaie, et où le coût excessif ou
l'impossibilité de recourir au crédit auraient empêché les entreprises non seulement d'investir
mais même de fonctionner (renouveler leurs stocks de consommations intermédiaires ou de
biens à vendre). Cependant, cette interprétation quantitative un peu mécanique reste contestée
tant que le lien entre baisse de la masse monétaire et baisse de l'activité économique est
davantage une corrélation macro-économique constatée qu’une causalité micro-économique
fondée sur les comportements des agents économiques.
Cette lacune a conduit à une réinterprétation de la crise qui en est actuellement l'explication la
plus largement acceptée. L'impact macro-économique des crises bancaires résulte selon cette
interprétation de la disparition de la fonction d'intermédiation que fournissent les banques,
fonction essentielle à la bonne allocation des ressources financières de l'économie. Plus
précisément, cette nouvelle explication repose sur l'asymétrie d'information qui existe dans
toute relation de crédit: le prêteur ne connaît pas précisément la situation financière de son
emprunteur, ni la qualité de l'emploi qu'il veut faire de son argent. Dans cette situation, on
peut montrer qu'une augmentation de l'incertitude ou du nombre de faillites peut conduire à un
cercle vicieux dans lequel la méfiance des prêteurs (déposants envers leurs banques, banques
envers leurs débiteurs) augmente à mesure que la situation des emprunteurs se détériore,
tandis que cette détérioration résulte elle-même de la suppression des crédits que refusent
désormais des prêteurs à la recherche de davantage de liquidité. Une étude détaillée sur les
opérations des banques américaines durant les années 1930 a montré la validité de cette
interprétation en observant que les craintes de ruées sur les dépôts conduisaient les banques à
tenter de faire rembourser leurs crédits passés, à diminuer leurs nouveaux crédits et à
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%