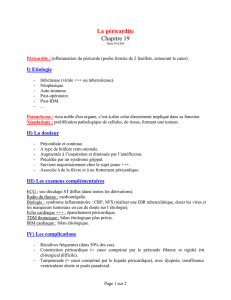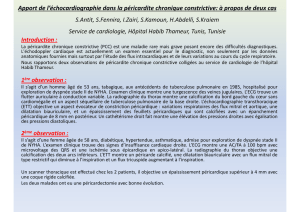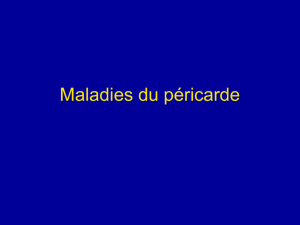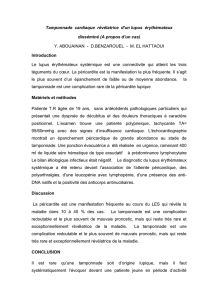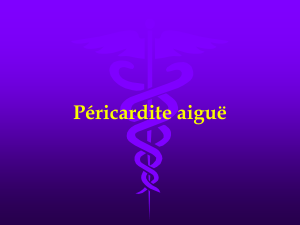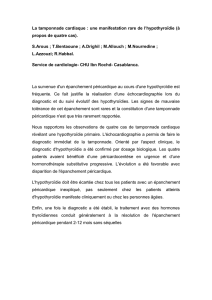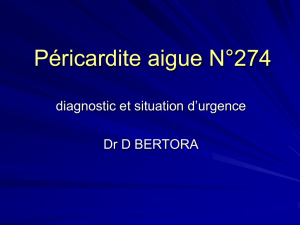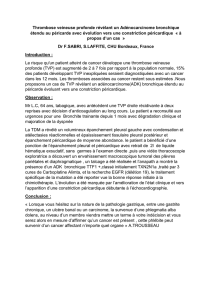Chapitre 16 - Précis d`anesthésie cardiaque

Précis d’Anesthésie Cardiaque 2012 – 16 Péricarde 1
CHAPITRE 16
ANESTHESIE ET
PATHOLOGIES
PERICARDIQUES
Mise à jour: Février 2012
Précis d’Anesthésie Cardiaque
PAC
•

Précis d’Anesthésie Cardiaque 2012 – 16 Péricarde 2
Table des matières
Physiopathologie 2
Pression péricardique 2
Couplage des cavités 3
Constriction péricardique 4
Interactions cardio-respiratoires 9
Péricardite constrictive 14
Manifestations cliniques 14
Pouls paradoxal et signe de Kussmaul 14
Péricardite e& cardiomyop restrictive 16
Epanchement péricardique 18
Manifestations cliniques 18
Echocardiographie 19
Tamponnade postopératoire 23
Indication au drainage 24
Anesthésie et tamponnade 27
Prise en charge 27
Choix du mode ventilatoire 28
Induction et maintien 28
Décompression péricardique 30
Anesthésie péricardite constrictive 30
Conclusions 31
Bibliographie 32
Auteur 33
Physiopathologie
Les pathologies péricardiques modifient les conditions de remplissage et les régimes de pression des
cavités cardiaques de manière dramatique. Pour adapter adéquatement la technique d’anesthésie, il est
donc primordial d’en comprendre les mécanismes physiopathologiques.
Pression péricardique
Le péricarde, épais de moins de 2 mm, est inextensible et contient moins de 30 ml d’un ultrafiltrat du
plasma. Il enveloppe tout le coeur et se prolonge autour des veines caves et pulmonaires, autour de
l’aorte ascendante sur 5-6 cm, et autour de l’artère pulmonaire jusqu’à sa bifurcation. Il transmet
intégralement la pression intrathoracique. Le péricarde n'est pas distensible de manière aiguë, mais il
se dilate progressivement en cas d'augmentation lente du volume cardiaque. Son rôle est double:
Contention mécanique : il prévient le déplacement ou la torsion du coeur lors des changements
de position du corps.
Limitation de l'expansion des cavités cardiaques : il fonctionne comme une butée lors de
l’augmentation du volume télédiastolique ; la courbe de compliance se redresse verticalement
lorsque les ventricules sont au contact du péricarde (Figure 16.1) ; il interfère donc avec la
phase de distension télédiastolique, non avec la phase de relaxation protodiastolique.
Lorsqu’une constriction péricardique (péricardite) ou un épanchement sous pression (tamponnade)
diminuent le volume diastolique des ventricules, la courbe de compliance se déplace vers de plus
petits volumes et se redresse plus tôt (Figure 16.1A). Sur cette partie verticalisée de la courbe, de
petites variations de volume se traduisent par de très grandes variations de pression. Cette situation
explique que la soustraction de quelques dizaines de millilitres à un épanchement massif suffit à
décomprimer les cavités cardiaques et à rétablir l’hémodynamique. A l’inverse, la décompensation
hémodynamique peut survenir très brusquement après une période de relative stabilité chez un malade
qui saigne dans son péricarde parce que le genou de la courbe de compliance a été dépassé et que les
ventricules sont sur la partie verticale de celle-ci [43]. La boucle pression-volume est très rétrécie,
parce qu’elle est pincée entre la pente d’élastance maximale normale (contractilité maintenue) et la
courbe de compliance ventriculaire déplacée vers le haut et vers la gauche (Figure 16.1B). Le volume
systolique est faible ; le débit cardiaque est momentanément compensé par la tachycardie.

Précis d’Anesthésie Cardiaque 2012 – 16 Péricarde 3
La très faible pression qui règne dans le péricarde (0.2-3 mmHg) influence peu la pression des cavités
cardiaques quand le remplissage est normal [15]. Lorsque la pression télédiastolique (Ptd) du VG est
de 8 mmHg, la pression de contact avec le péricarde est nulle. Mais lorsque la Ptd du VG est > 20
mmHg et celle du VD > 15 mmHg, les parois ventriculaires sont en butée contre le péricarde et cet
effet compte pour moitié dans la pression qui règne à l’intérieur des ventricules [3,41]. Cet effet de
contrainte survient déjà à bas volume lorsque l’espace se rétrécit lors de péricardite constrictive ou
d’accumulation liquidienne intrapéricardique. Lors d'un épanchement péricardique non-compressif, la
pression intrapéricardique est de 10-15 mmHg ; elle monte à 20-30 mm Hg lors de tamponnade [52].
Figure 16.1: A. Courbe de compliance ventriculaire. La courbe normale (en bleu) est quasi-plate à volume
physiologique, mais devient brusquement presque verticale lorsque le ventricule rempli bute contre le péricarde
inextensible ; le genou de la courbe correspond au volume télédiastolique physiologique maximal. Le péricarde
peut tolérer de grands volumes à basse pression à la condition que la dilatation soit progressive. La courbe d'une
restriction par péricardite ou tamponnade (en rouge) est déplacée vers la gauche; le ventricule bute contre le
péricarde déjà à bas volume. Au-delà du genou de la courbe (partie verticale), une faible variation de volume
(ΔV) se traduit par une forte variation de pression (ΔP) ; ainsi, il suffit de ponctionner 50 mL pour décomprimer
une tamponnade, quand bien même le péricarde contient 500-800 mL au total [43]. B. Courbe pression-volume
ventriculaire en cas de restriction péricardique. La courbe de compliance (en bleu) est déplacée vers le haut et
vers la gauche ; la contractilité, représentée par la ligne de l’élastance maximale (Emax), est normale. La boucle
pression / volume (violet) démontre la diminution du volume systolique (VS) et l’élévation des pressions de
remplissages pour les mêmes volumes diastoliques. La courbe de compliance normale est représentée en
pointillé bleu. La boucle pression / volume normale est représentée en gris.
Couplage des cavités
Normalement, le couplage interventriculaire est de 1/5 : une élévation de la pression dans l'un des
ventricules se traduit par une variation de pression cinq fois plus faible dans l'autre. Mais lorsqu’elles
sont en surcharge de volume (hypervolémie, insuffisance ventriculaire congestive), les cavités
cardiaques touchent le péricarde et ne peuvent plus s’expandre vers l’extérieur. Elles deviennent
interdépendantes : toute variation de volume d’une chambre cardiaque retentit sur celui des autres ; le
couplage de pression est alors de 1/1 [31]. Le même effet se rencontre lorsque l'espace à disposition
diminue (constriction péricardique). Cette notion d’interdépendance se définit selon deux axes [4] :
20
10
Constriction
péricardique
Compliance
normale
Pression
(mm Hg)
50
100
ΔP
ΔV
Pression
Volume
Compliance
Emax
VS ↓
A
B
Volume
(ml)
Restriction
péricardique
© Chassot 2012

Précis d’Anesthésie Cardiaque 2012 – 16 Péricarde 4
Interdépendance horizontale entre les deux oreillettes ou les deux ventricules;
Interdépendance verticale entre une oreillette et le ventricule correspondant.
Le couplage horizontal est important entre les ventricules ; cette interdépendance présente plusieurs
caractéristiques.
Lors d’une surcharge de volume ou de pression à droite, le septum interventriculaire bombe
dans la cavité gauche en diastole (effet Bernheim) ; la compliance du VG en est diminuée
d’autant. Par ce couplage diastolique, l’agrandissement d’un ventricule se fait au détriment de
l’autre. En clinique, un couplage de ce type se rencontre lors d'embolie pulmonaire, d'infarctus
droit, d'hypertension pulmonaire, ou de PEEP élevée (> 15 cm H2O).
Le couplage systolique permet à l’éjection du VD d’être renforcée par la contraction plus
puissante du VG, qui contribue pour 30-40% à la force éjectionnelle droite ; la présence du
péricarde renforce cette interaction positive.
L’absence de péricarde autorise les ventricules à se dilater lors d’une surcharge de volume, ce
qui leur permet de bénéficier davantage de l’effet Franck-Starling en augmentant leur tension
de paroi ; ceci est particulièrement marqué pour le VD.
Le péricarde
Le péricarde empêche une torsion ou un déplacement du coeur
Il représente une butée à l’expansion des cavités cardiaques, mais n’exerce pas de pression
significative en normovolémie
Lors de dilatation ventriculaire, la contrainte exercée par le péricarde rend les pressions des cavités
cardiaques interdépendantes (couplage)
Constriction péricardique
Qu’elle soit due à une péricardite ou à un épanchement, la constriction péricardique se caractérise par
trois phénomènes fondamentaux [31,47] :
Restriction diastolique au remplissage ;
Couplage des cavités cardiaques entre elles ;
Isolation des cavités cardiaques par rapport aux variations de la pression intrathoracique.
Restriction au remplissage
La courbe de Frank-Starling conserve une pente normale, car la fonction systolique est maintenue,
mais elle s’arrête brusquement lorsque le volume maximal est atteint (Figure 16.2). Le genou de la
courbe a lieu à un volume télédiastolique (Vtd) beaucoup plus faible que normalement [20]. Les
variations de précharge ont un effet marqué sur le volume systolique et le débit cardiaque jusqu’à ce
point maximal, mais n’en n’ont plus au-delà, même si la pression télédiastolique continue à s’élever.
Comme le genou de la courbe est atteint à un bas volume, le remplissage n’améliore pas le débit
cardiaque en-dehors de l’hypovolémie sévère. Les variations respiratoires du volume systolique et de
la pression artérielle en ventilation en pression positive sont donc peu marquées ou absentes, sauf si le
patient est très hypovolémique.
Dans la péricardite constrictive, les oreillettes ne peuvent pas s'expandre à cause de la gangue rigide
qui les entoure. Le seul moment où elles peuvent se remplir est pendant la diastole des ventricules,
lorsqu’elles se vident dans ces derniers. Les courbes de pressions auriculaires présentent un profil

Précis d’Anesthésie Cardiaque 2012 – 16 Péricarde 5
particulier : la descente systolique "x" est minime, alors que la descente diastolique "y" est
prédominante (Figure 16.3). Dans les veines caves et pulmonaires, le flux diastolique "D" est
beaucoup plus important que le flux systolique "S" qui est mineur : S << D [33,53]. Ce profil
particulier ("xY" et "sD") s’explique par le fait que la pression auriculaire ne peut baisser que pendant
la diastole lorsque l’oreillette se vide dans le ventricule. Dans le ventricule, la pression descend
brusquement en début de diastole (phase de relaxation normale), mais se stabilise rapidement jusqu’en
télédiastole parce que la paroi bute contre le péricarde qui en restreint l’expansion (pas de
distensibilité possible) : c’est l’aspect dip-and-plateau.
© Chassot 2012
Vtd ou
Ptd
Courbe de Frank-
Starling normale
50
25
Volume systolique
(ml)
50
100
Constriction péricardique
A
B
Figure 16.2: Courbe de Frank-Starling.
Comparée à la courbe normale (bleue), celle
d’une constriction péricardique (rouge) est
abaissée et comprimée, avec une pente normale ;
elle ressemble à celle d’une hypovolémie, mais
s’arrête brusquement lorsque le volume maximal
est atteint, ce qui correspond aux 40-50% du
volume télédiastolique (Vtd) normal. Les
variations de remplissage diastolique ont un effet
marqué sur le volume systolique et le débit
cardiaque jusqu’à ce point maximal (genou de la
courbe), mais n’en n’ont plus au-delà. Si l’on
remplace l’échelle de volume par une échelle de
pression (Ptd), la courbe prend une forme aplatie
(en pointillé), illustrant le fait que l’augmentation
du remplissage conduit à une augmentation de la
pression télédiastolique mais ne se traduit plus par
une augmentation de la performance systolique.
Cette courbe délimite une zone A (en pointillé)
dans laquelle les variations de précharge se
traduisent par d’importantes variations du volume
systolique et de la pression artérielle (hypo-
volémie), et une zone B dans laquelle les varia-
tions de la pression artérielle sont absentes, lors
des variations ventilatoires de la précharge.
Figure 16.3 : Courbes de
pression en cas de péricardite
constrictive. Dans l’oreillette, la
descente de pression x est faible
ou inexistante, alors que la
descente y est prédominante
(aspect xY). Dans les veines
pulmonaires, le flux diastolique
D prédomine (aspect sD). Dans
le ventricule, la courbe de
pression présente un aspect dip-
and-plateau pendant la
diastole : après une relaxation
protodiastolique normale (dip),
la paroi ventriculaire bute
contre le péricarde et le
remplissage cesse, la pression
ne se modifiant plus (plateau).
Le pointillé bleu indique les
courbes normales [24].
Courbe de
pression
auriculaire
Flux
veineux
pulmonaire
a
v
D
x
y
Courbe de
pression
intraventriculaire
© Chassot 2012
S
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%