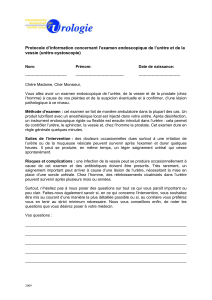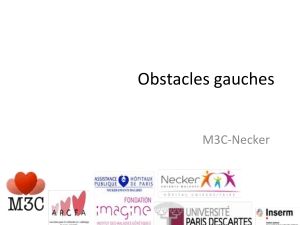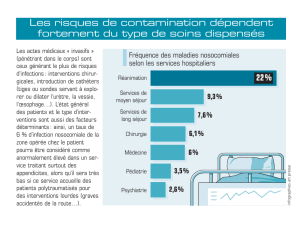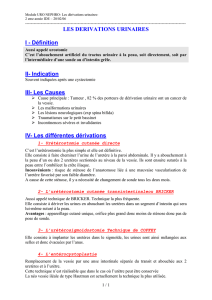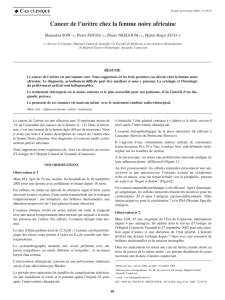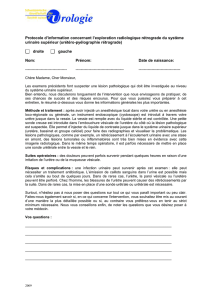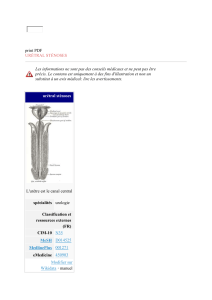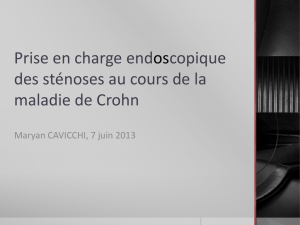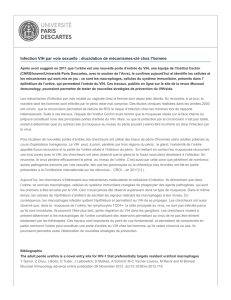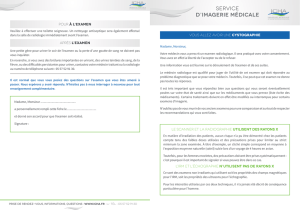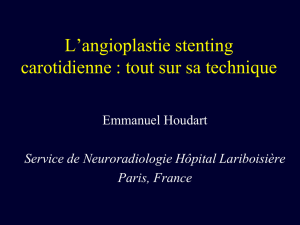Urétroplastie par greffe cutanée

ARTICLE ORIGINAL Progrès en Urologie (1999), 9, 112-117
112
Urétroplastie par greffe cutanée
Nicolas GASCHIGNARD, Denis PRUNET, Nicolas VASSE, Jean-Marie BUZELIN, Olivier BOUCHOT
Clinique Urologique, Hôtel-Dieu, Nantes, France
La sténose de l’urètre est une pathologie fréquente chez
l’homme, dont l’incidence augmente avec la multiplici-
té des gestes endoscopiques. Elle pose toujours un pro-
blème de choix thérapeutique.
L’urétrotomie optique, technique endoscopique de pre-
mière intention, en dehors des cas de dilatation des sté-
noses rétro-méatiques précoces après résection trans-
urétrale, présente un taux d’échec à distance supérieur
à 50%. Sa répétition pourrait, de plus, être préjudiciable
aux résultats des urétroplasties proposées de deuxième
intention [7].
Le risque de récidive d’une sténose de l’urètre est
essentiellement lié à l’importance du cal fibreux péri-
sténotique. Ainsi, ce cal est responsable des échecs
après traitement endoscopique, mais également après
urétrorraphie termino-terminale, proposée en cas de
sténose courte en urétrographie.
Les urétroplasties trouvent ainsi leurs indications en
cas d’échec des traitements endoscopiques, de sténoses
supérieures à 2 cm, ou en cas de cal fibreux important.
Les techniques d’urétroplasties sont nombreuses, en un
ou deux temps, avec utilisation de greffes ou de lam-
beaux. L’urétroplastie par greffe, décrite par PRESMAN
et GREENFIELD en 1953 [21] et popularisée par DEVINE
[11] est une option thérapeutique.
Le but de cette étude est de présenter notre expérience
de l’urétroplastie par greffe.
PATIENTS ET METHODES
Depuis 1986, 28 patients, d’âge moyen initial de 54,5
ans (compris entre 9 et 86 ans), présentant une sténose
de l’urètre, ont été traités par une urétroplastie avec
greffe cutanée (UGC). Les urétroplasties sur hypospa-
dias ou épispadias ont été exclues de l’étude.
L’étiologie de la sténose a été traumatique dans 7 cas,
infectieuse dans 2 cas, iatrogène dans 9 cas, et non
connue dans 10 cas.
Les traitements antérieurs ont été multiples chez 26
Manuscrit reçu : mai 1998, accepté : octobre 1998.
Adresse pour correspondance : Dr. N. Gaschignard, Clinique Urologique, Hôtel-
Dieu, BP 1005, 44093 Nantes Cedex.
RESUME
Buts : Evaluer les résultats de l'urétroplastie par greffe cutanée (UGC) dans la prise
en charge des sténoses de l'urètre.
Matériel et Méthodes : Vingt huit patients, d'âge moyen de 54 ans, traités par UGC
ont été revus avec un recul moyen de 24,5 mois (extrêmes : 1-66). Le matériel utilisé
pour la greffe a été le prépuce de première intention; en son absence, la peau pénien-
ne ou du bras a été utilisée.
Résultats : Cette étude a montré un résultat satisfaisant (absence de signes cliniques,
débit maximum ≥ 15 ml/s, absence de chirurgie de rattrapage) dans 67,9% des cas.
Si les complications précoces ont été faibles, 8 sténoses ont été observées au cours de
la surveillance, dont 3 ont nécessité une réintervention chirurgicale ouverte. Les
autres récidives ont été traitées par une urétrotomie interne ou par hétéro ou auto-
dilatations. Cette étude a montré que la stérilité des urines au moment de la chirur-
gie était déterminante.
Conclusion : L'indication préférentielle de ce type d'urétroplastie reste la sténose de
l'urètre bulbaire à urines stériles. Par contre l'étiologie et la longueur de la sténose ne
sont pas des facteurs discriminants.
Mots clés : Urètre, sténose, urétroplastie, greffe cutanée.

113
patients (Tableau 1) : urétrotomie endoscopique (1 à 3
gestes) dans 78% des cas, dilatation par bougie gomme
dans 50% des cas, et urétrorraphie termino-terminale
ou urétroplastie par lambeau pédiculé dans 28,5% des
cas. Le délai moyen entre le premier geste et l’ UGC a
été de 9 ans. Une UGC a été réalisée de première
intention chez 2 patients du fait de la longueur radio-
graphique de la sténose.
L’indication de l’UGC a été posée devant la présence
d’une dysurie (n=20), d’une ou plusieurs infections uri-
naires (n=3), d’une rétention aiguë (n=5) nécessitant la
pause d'un cathéter sus-pubien. Pour les patients
(n=17) ayant une débitmétrie interprétable (volume
uriné supérieur à 150 ml), le débit maximum moyen a
été de 6,1 ml/s (compris entre 2 et 10).
La réalisation d’une urétrographie mictionnelle et
rétrograde a permis, outre de confirmer la sténose uré-
trale, d’en visualiser son siège et sa longueur. Le siège
de la sténose a été l’urèthre membraneux dans 8 cas,
bulbaire dans 16 cas, et pénien dans 3 cas. Dans 1 cas,
la sténose s’étendait de l’urètre membraneux jusqu’à
l’urètre pénien. La longueur moyenne a été de 2,4 cm
(compris entre 1 et 13). La sténose a été unique dans 25
cas, multiple dans 3 cas.
L’intervention chirurgicale a été menée sous antibio-
prophylaxie systématique (céphalosporines de premiè-
re génération) en cas d’examen cytobactériologique
négatif. En cas d’infection urinaire prouvée, une anti-
biothérapie adaptée et efficace a été instituée pendant
plusieurs jours avant l’intervention.
L’incision, fonction du siège de la sténose, a été : périco-
ronale en cas de sténose de l’urètre pénien, périnéale en
cas de sténose bulbo-membraneuse, associant les 2 voies
d’abord en cas de sténose étendue de l’urètre antérieur.
Le greffon utilisé a été prélevé au niveau du prépuce
(n = 25), du fourreau pénien (n=l) et de la face interne
du bras (n=2). La graisse sous-cutanée et l’hypoderme
ont été enlevés, afin de permettre une revascularisation
précoce du greffon. L’urétrotomie chirurgicale a été
faite au niveau de la sténose, la débordant en amont et
en aval d’au moins un centimètre. Les sutures ont été
réalisées par des surjets de fils à résorption lente (PDS
dec 0,7), sous couvert d’une sonde urétrale souple 18
Ch. Le drainage urinaire a été maintenu 18 jours en
moyenne (compris entre 10 et 28). A l’ablation de la
sonde urétrale, une urétrographie mictionnelle a été
réalisée afin de vérifier l’absence d’extravasation du
produit de contraste.
Les résultats à distance ont été interprétés par la clinique
et la débitmétrie. Aucune endoscopie ou urétrographie
n'ont été réalisées de principe si le débit maximum a été
supérieur ou égal à 15 ml/sec pour un volume uriné supé-
rieur à 150 ml, et en l’absence d’infection urinaire
(absence de signes irritatifs et bandelette négative).
Le résultat a été jugé :
•satisfaisant en l’absence de signes cliniques irritatifs
et obstructifs, avec un débit maximum supérieur ou
égal à 15 ml/sec, et en l’absence de chirurgie de rattra-
page;
•moyen en présence de signes cliniques d’obstruction
et/ou un débit maximum inférieur à 15 ml/sec ou
nécessité d’une urétrotomie ou plusieurs dilatations
pour obtenir une résultat satisfaisant à distance;
•mauvais en cas d’infection urinaire liée à la récidive
de la sténose, de réintervention chirurgicale ou nécessi-
té de plusieurs urétrotomies endoscopiques pour obte-
nir une résultat satisfaisant, voire en cas de réalisation
d’un autre mode de dérivation urinaire.
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logi-
ciel Stat View 4.5, par les tests de Fisher et ANOVA
pour les critères qualitatifs, à partir des moyennes pour
les critères quantitatifs, selon la méthode de Kaplan-
Meier pour la survie sans récidive.
RESULTATS
Les complications précoces
Elles ont été au nombre de 9, survenant durant les 30
premiers jours post-opératoires:
- six complications infectieuses : 2 épididymites, une
prostatite, et 3 infections urinaires asymptomatiques.
- 2 fistules, visualisées lors de la cystographie miction-
nelle. Si le sondage prolongé (40 jours) a permis la cica-
trisation dans un cas, un deuxième geste chirurgicale a
été nécessaire chez le 2ème patient. Secondairement, ces
2 patients ont récidivé leur sténose.
- une incontinence urinaire pré-existante après résec-
tion trans-urétrale de la prostate a été aggravée par
l’UGC.
Résultats à distance
Avec un recul moyen de 24,5 mois (extrêmes : 1-66,
médiane : 23,9), les résultats ont été:
N. Gaschignard et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 112-117
Tableau 1. Traitements antérieurs de la sténose (26 patients).
Gestes effectués Nombre de gestes
0 1 2-3 > 3
Uréthrotomie endoscopique 610 7 5
Dilatation 14 4 1 9
Urétroplastie/urétrorraphie 20 7 1

-Satisfaisants dans 67,9% des cas, soit 19 patients;
-Moyens dans 10,7% des cas, soit 3 patients;
-Mauvais dans 21,4% des cas, soit 6 patients.
Parmi les 20 patients ayant une débitmétrie interpré-
table, le débit maximum moyen a été de 15,5 ml/s.
Aucune urétrocèle n'a été retrouvée. Les résultats en
fonction du type de gref
fon et du site de la sténose sont
résumés dans les Tableaux 2 et 3.
Les 3 résultats moyens ont concerné un patient nécessi-
tant des autodilatations urétrales périodiques, un patient
ayant une récidive traitée par une urétrotomie endosco-
pique, et un patient ayant un débit maximum à 9 ml /s
mais sans sténose radiographique.
Huit sténoses récidivantes (28,5%) ont été observées
dans un délai moyen de 15 mois (compris entre 1 et
55). Le greffon a été d'origine préputiale dans tous les
cas. L’ECBU pré-opératoire avait été positif chez 1
patient. Le traitement de ces récidives a été :
- endoscopique par urétrotomie pour des sténoses
courtes en amont de l’urétroplastie dans 3 cas;
- chirurgical dans 3 cas : 2 urétrorraphies termino-ter-
minales au niveau de l’urètre bulbaire, 1 urétroplastie
par lambeau suivie d'une urétrostomie définitive;
- une dilatation pour sténose rétroméatique, dans un
cas, avec un bon résultat final;
- une auto-dilatation pour récidive pénienne dans un
cas.
La probabilité de retraitement d’une UGC dans le temps
a été étudiée selon la méthode de Kaplan-Meier. Par
définition, la survie du greffon cutané correspondait au
temps pendant lequel aucun traitement complémentaire
n'a été nécessaire. A 50 mois, la survie cumulée des
greffons était de 60% avec un taux d'erreur standard de
± 11% (Figure 1). Le test ANOVA a été utilisé pour
comparer 2 groupes : les bons résultats d'un côté et les
moyens et mauvais résultats de l'autre. Il n'existait pas
de différence significative entre ces 2 groupes en ce qui
concerne l'âge (p=0,37), le délai par rapport au premier
traitement (p=0,32). De même, le test de Fisher, utilisé
pour comparer le résultat en fonction de l'étiologie trau-
matique ou non, était non significatif (p=0,8).
DISCUSSION
Avec un recul moyen de 24 mois, 67,9 % de résultats
satisfaisants ont été obtenus de première intention par
l'UGC. Comparés à la littérature, ces résultats appa-
raissent modestes (Tableau 4). Plusieurs points méri-
tent d’être discutés pour comprendre les différences.
114
Figure 1. Probabilité de retraitement des greffons (n=28).
Tableau 2. Distribution des résultats en fonction du type de
greffon.
Greffon Résultat Résultat Résultat
satisfaisant moyen mauvais
Prépuce 17 2 6
Peau pénienne 0 1 0
Bras 2 0 0
Tableau 3. Répartition des résultats en fonction du siège de la
lésion.
Résultat Résultat moyen
Siège de la sténose satisfaisant ou mauvais
Membraneux 7 1
Bulbaire 9 7
Pénien 2 1
Etendue à l’urètre 1 0
antérieur
Tableau 4. Résultats de l’urétroplastie par greffe libre dans la
littérature.
Auteurs Nombre de Succès Recul
patients (%) (années)
Brannan [5] 66 80 > 1
Devine [10] 60 87 > 1
Blum [3] 11 80 > 5
Boccon-Gibod [4] 29 72 > 1
Webster [23] 34 85 ?
L’Hermite [16] 18 77 > 5
Roehrborn [22] 49 63 ?
Barbagli [1] 12 66 > 1
Wessels [26] 35 86 > 3 mois
Notre série 28 67,9 2
N. Gaschignard et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 112-117

Les antécédents des patients
Dans notre série, chez 26 des 28 patients, les traite-
ments antérieurs ont été nombreux, variables, parfois
multiples. Ces antériorités diminuent le pourcentage de
bons résultats; ainsi, BARBAGLI a rapporté 66% de suc-
cès à 12 mois chez 12 patients traités antérieurement
par chirurgie ouverte [1]. ROEHRBORN a observé un
pourcentage de succès significativement différent en
comparant les patients ayant eu une UGC de première
intention (85,7%) et les patients ayant déjà eu des dila-
tations (72,4%) ou une chirurgie (68,4%) [22]. Par
contre, WEBSTER a obtenu 85% de bons résultats chez
des patients n’ayant jamais eu de chirurgie ouverte
(urétrorraphie ou urétroplastie) [23].
Ainsi, DEVINE, en 1996, conseille l’urétroplastie par
greffon cutané pour des patients dont la sténose atteint
uniquement l’urètre ou lorsque la fibrose reste superfi-
cielle au niveau du tissu érectile du corps spongieux.
Par contre, les patients avec une sténose épaisse, ayant
eu de nombreuses dilatations, urétrotomies internes, ou
des antécédents de chirurgie ouverte, ne sont pas de
bons candidats à l’UGC [8].
Le siège de la sténose
L’urètre bulbaire est le siège de choix pour l’UGC. La
présence du bulbe spongieux permet la couverture du
g r e ffon, lui assurant une revascularisation précoce, initia-
lement par imbibition puis par néo-angiogénèse [15, 23].
Au niveau de l’urètre membraneux, en cas de sténoses
post-traumatiques, l’urétrorraphie termino-terminale
doit être envisagée de première intention, car les sté-
noses sont courtes, et les résultats excellents (95% de
succès) [24]. Mais en cas de mobilisation insuffisante
de l’urètre membraneux, l’UGC peut être utile. Dans
cette indication, nous avons obtenu 87% de résultats
satisfaisants. Sa limite est liée à la présence d’une
fibrose trop importante compromettant la revasculari-
sation, qui risque d’être tardive et insuffisante. La
crainte de cette fibrose fait préférer, pour la plupart des
auteurs, l’urétroplastie par lambeau scrotal ou périnéal
[15,23]. Ce type d’urétroplastie par lambeau expose,
néanmoins, à certains problèmes : mauvaise tolérance à
l'urine, repousse des poils [25].
L’urètre pénien est plus rarement en cause dans les sté-
noses de l’urètre [23]. La technique utilisée pour l’uré-
troplastie doit tenir compte de l’allongement de l'urètre
pénien lors des érections. Sa longueur et son élasticité
doivent donc être conservées. C'est la raison pour
laquelle une urétrorraphie termino-terminale ne peut
que très rarement être employée sous peine de voir
apparaître une corde ventrale lors des érections. Ce
phénomène a aussi été constaté après réalisation d'une
UGC [23]. La perte d'élasticité des greffons au cours de
la cicatrisation permet d'expliquer ce phénomène.
Aussi de nombreux auteurs préfèrent utiliser une uré-
troplastie par lambeau au niveau de l’urètre pénien, de
type Orandi pour l'urètre pénien antérieur ou Quartey
pour l’urètre pénien postérieur [4,15,25].
L’analyse des résultats
Les éléments de surveillance et d’appréciation des résul-
tats après UGC ont été variables selon les études. Pour
notre part, seuls des critères cliniques et débitmétriques
ont été utilisés de première intention. Une exploration
radiologique ou endoscopique de l’urètre n’a été réalisée
qu’en cas d’anomalie d’un de ces 2 éléments. D
E V I N E
,
sur des critères identiques, a rapporté 87% de succès
chez 60 patients avec un recul supérieur à 12 mois [10].
L’addition d’une urétrographie mictionnelle, indispen-
sable pour certains, ne semble pas diminuer les pour-
centages de succès, allant de 66 à 85% dans différentes
séries [1, 4, 16, 23]. GRISE a proposé de classer les
images d’urétrographie en urètre normal, sténose
modérée, et sténose serrée [14].
DEVINE a proposé récemment de remplacer l’urétrogra-
phie mictionnelle par une fibroscopie urétrale, réalisée
à 6 et 12 mois [8]. A ce terme, en l’absence de récidi-
ve, cet auteur considère que le risque de récidive est
très faible, et une surveillance ultérieure n’est pas
nécessaire. Cette attitude reste discutable, même si
dans notre série, le délai moyen d’apparition de la réci-
dive a été de 15 mois, car trois patients ont eu une réci-
dive au delà de la 2ème année, dont un 55 mois après
la chirurgie.
D’autres facteurs sont plus consensuels dans la littéra-
ture :
-L’absence d’infection urinaire au moment de la chi -
rurgie
La stérilité des urines, en pré, per et post-opératoire, est
un facteur essentiel du succès de cette chirurgie. Dans
notre série, 50 % des patients ayant présenté une sté-
nose récidivante ont eu une infection urinaire à un
moment donné. Pour BOCCON-GIBOD, il s’agit du fac-
teur essentiel du choix du type d’urétroplastie; en effet,
il semble que le lambeau présente une meilleure résis-
tance à l’infection [4].
-Les résultats fonction de l’étiologie de la sténose
Dans notre série, les sténoses post-traumatiques n’ont
pas eu de résultats significativement différents des
autres étiologies (infectieuse, iatrogène). Seules la qua-
lité du lit receveur et la fibrose péri-sténotique sont
importantes. Il apparaît essentiel de préparer le site de
la greffe en excisant au maximum la fibrose, favorisant
ainsi une revascularisation précoce de la plastie.
-La longueur de la sténose
L'UGC peut être utilisée pour traiter des sténoses éten-
115
N. Gaschignard et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 112-117

dues. Dans notre série, la longueur maximale a été de
13 cm avec un greffon de la face interne du bras. Dans
une série de 40 patients, WESSELS a utilisé des greffons
de longueur maximale de 17 cm pour la muqueuse
buccale (en 3 greffons), de 11 cm pour la muqueuse
vésicale, de 9 cm pour la peau pénienne et de 8 cm
pour le prépuce [26]. Pour DEVINE, il n'y a pas de limi-
te pour la longueur d'un greffon [12]. DESYa utilisé un
greffon préputial spiralé permettant de traiter des sté-
noses de l’urètre de plus de 20 cm [6], confirmant l’af-
firmation de DE V I N E. Cependant, l’utilisation de
l’UGC pour des sténoses supérieures à 10 cm exposent
à un pourcentage de récidive plus élevé [25].
-La technique chirurgicale
L'UGC nécessite le respect de principes afin de ne pas
compromettre le résultat à long terme. Lors de l'abord
de l'urètre, la dissection doit se faire plan par plan afin
de ménager l'intégrité des tissus de couverture qui
seront à l'origine de la vascularisation du greffon [6].
L'incision de la sténose doit être prolongée au delà de
la jonction muqueuse saine - muqueuse pathologique.
Afin de prévenir les urétrocèles et les fistules,
BARBAGLI préconise de placer le greffon sur la face
dorsale de l'urètre, plaqué contre les corps caverneux
[2]. Pour cela, ils mobilisent complètement le corps
spongieux afin de le faire tourner de 180°. Le greffon
est suturé sur les corps caverneux puis il est suturé par
2 hémi-surjets à l'urétrotomie.
De même, la bonne couverture du greffon, outre ses
effets bénéfiques sur la vascularisation, permet une
bonne application du greffon sur la sonde urétrale et
évite la survenue d'une urétrocèle. L'hémostase de ce
plan de couverture doit être soigneuse [6]. En effet, la
survenue d'un hématome peut compromettre la prise
du greffon. Cela justifie la réalisation d'un pansement
légèrement compressif en fin d'intervention.
-Le matériel de greffe
Parmi les différents greffons utilisables, le prépuce,
tissu glabre, fin et souple, reste le plus simple, offrant
des résultats superposables aux greffons de sites extra-
génitaux. Son faible coefficient de rétraction (< 15%)
permet un ajustement simple sur le segment à ponter
[9,25]. En cas d'antécédent de circoncision ou de fistu-
le urétro-cutanée, il peut être nécessaire de se tourner
vers un autre site de prélèvement :
* La peau pénienne offre les mêmes avantages que le
prépuce. Par contre, elle ne permet pas de fournir de
grande longueur.
* La peau de la face interne du bras permet des prélè-
vements de grande longueur sur une peau quasiment
glabre. Son accès est simple et la cicatrisation du site
de prélèvement rapide. Cependant, il s'agit d'une peau
épaisse, d'un maniement moins aisé d'autant plus que
l'indice de rétraction est supérieur par rapport au pré-
puce (entre 15 et 25%) [9,25]. Notre série rapporte 2
bons résultats sur 2 utilisations.
* La muqueuse vésicale est utilisée régulièrement dans
la prise en charge des hypospadias [18]. Elle offre
l'avantage de pouvoir fournir une grande longueur et
d'être naturellement destinée à être au contact de l'uri-
ne. Son indice de rétraction est similaire à celui du pré-
puce (5 à 15%) [9]. JORDAN et DEVINE réservent ce type
de greffon aux cas où un abord vésical est nécessaire
pour une autre raison [15]. MONTFORTa rapporté une
série de 8 sténoses de l’urètre de l'enfant avec 6 bons
résultats à 19 mois [17].
* la muqueuse buccale offre les mêmes avantages que
la muqueuse vésicale. Une intervention en double équi-
pe permet de diminuer le temps opératoire [19]. Le
greffon doit être dégraissé comme le prépuce, préservé
du dessèchement par une conservation dans du liquide
physiologique auquel certains ajoutent un antibiotique
[13, 18]. Les différentes séries donnent entre 90 et
100% de résultats excellents, mais les suivis restent
courts (entre 11 et 18 mois) [13, 20, 26]. MOREY,
depuis 1996, utilise de principe ce site de prélèvement
pour les urétroplasties bulbaires [20].
CONCLUSION
La prise en charge des sténoses de l’urètre nécessite la
connaissance des différentes techniques afin de pou-
voir adapter le traitement aux caractéristiques de la
lésion ainsi qu'aux différentes contraintes associées
(antécédents, siège de la sténose). L’urétroplastie par
greffe cutanée permet une réparation en un temps avec
des résultats satisfaisants préférentiellement au niveau
de l’urètre bulbaire. Le prépuce et la peau pénienne
donnent les lambeaux permettant d'obtenir les
meilleurs résultats du fait de leur qualité. Au vue de la
littérature, la muqueuse buccale semble être une solu-
tion de rechange satisfaisante. Dans tous les cas, une
surveillance prolongée est nécessaire afin de dépister
une récidive.
REFERENCES
1. BARBAGLI G., SELLI C., TO S TO A. Reoperative surgery for recurrent
strictures of the penile and bulbous urethra. J. Urol., 1996, 156, 76-77.
2. BARBAGLI G., SELLI C., TOSTO A., PALMINTERI E. Dorsal free
graft urethroplasty. J. Urol., 1996, 155, 123-126.
3. BLUM J.A., FEENEY M.J., HOWE G.E., STEEL J.F. Skin patch
urethroplasty : 5-year followup. J. Urol. 1982, 127, 909.
4. BOCCON-GIBOD L., LE PORTZ B. One-stage urethroplasty for
urethral stricture. Eur. Urol., 1984, 10, 32-35.
5. BRANNAN W., OCHSNER M.G., FUSELIER H.A., GOODLET
J.S. Free full thickness skin graft urethroplasty for urethral stricture:
experience with 66 patients. J. Urol., 1976, 115, 677-680.
116
N. Gaschignard et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 112-117
 6
6
1
/
6
100%