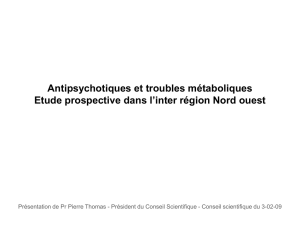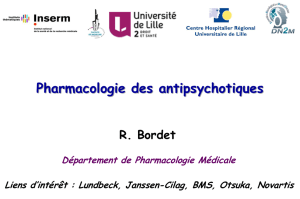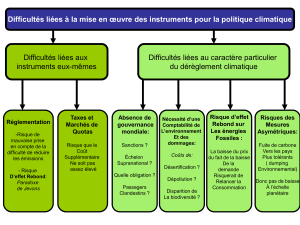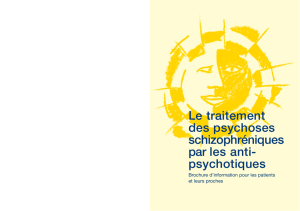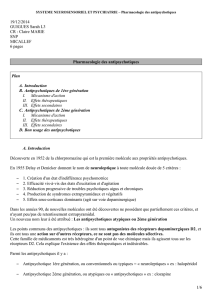Enjeux cliniques du passage d`un

L’Encéphale
(2013)
39,
439—444
Disponible
en
ligne
sur
www.sciencedirect.com
ScienceDirect
journal
homepage:
www.em-consulte.com/produit/ENCEP
THÉRAPEUTIQUE
Enjeux
cliniques
du
passage
d’un
antipsychotique
à
l’autre
Clinical
stakes
when
switching
from
one
antipsychotic
to
another
É.
Constant
Service
de
psychiatrie
adulte,
cliniques
universitaires
Saint-Luc,
institute
of
neurosciences,
IoNS,
10,
avenue
Hippocrate,
1200
Bruxelles,
Belgique
Rec¸u
le
1er juillet
2013
;
accepté
le
13
septembre
2013
Disponible
sur
Internet
le
13
novembre
2013
MOTS
CLÉS
Antipsychotiques
;
Switch
;
Effet
rebond
;
Symptômes
de
discontinuation
;
Psychose
d’hypersensibilité
Résumé
Le
passage
d’un
antipsychotique
à
un
autre
est
de
plus
en
plus
habituel
dans
notre
pratique
clinique.
Plusieurs
raisons
peuvent
expliquer
cette
constatation.
Nous
avons,
à
notre
disposition,
de
plus
en
plus
d’antipsychotiques
disponibles
avec
des
profils
réceptologiques
différents
et
également
des
profils
de
tolérance
différents.
D’habitude,
les
raisons
du
pas-
sage
d’un
antipsychotique
à
l’autre
sont
les
suivantes
:
efficacité
insuffisante
ou
problème
de
tolérance
(prise
de
poids,
désordres
métaboliques,
symptômes
extrapyramidaux,
hyperprolac-
tinémie,
sédation,
troubles
sexuels).
De
manière
à
ce
que
ce
passage
se
déroule
sans
trop
de
complications,
il
est
capital
pour
le
clinicien
de
bien
connaître,
à
la
fois,
le
profil
réceptolo-
gique
et
la
demi-vie
des
antipsychotiques
en
question.
Le
clinicien
doit
s’attendre
à
un
effet
rebond
dopaminergique
lorsqu’il
introduit
un
antipsychotique
qui
a
une
plus
faible
affinité
pour
le
récepteur
dopaminergique
D2
que
celui
qui
est
arrêté
ou
qu’il
s’agit
d’un
agoniste
partiel
avec
une
demi-vie
particulièrement
longue.
D’un
autre
côté,
un
effet
rebond
histaminergique
ou
cholinergique
est
à
craindre
si
le
nouvel
antipsychotique
introduit
possède
une
affinité
plus
faible
pour
ces
deux
récepteurs.
Dans
tous
ces
cas,
un
schéma
de
passage
en
«
plateau
»
est
souvent
recommandé.
Si,
par
contre,
un
passage
d’un
antipsychotique
à
l’autre
plus
rapide
est
impératif,
diverses
stratégies
médicamenteuses
existent
pour
essayer
de
diminuer
l’impact
de
ces
effets
rebonds.
©
L’Encéphale,
Paris,
2013.
KEYWORDS
Antipsychotics;
Switch;
Rebound
effect;
Summary
Switching
antipsychotics
is
more
and
more
common
in
our
clinical
practice.
Several
reasons
can
explain
this
observation.
We
have
more
and
more
antipsychotics
available
on
the
market
with
different
receptor
binding
profiles
and
also
different
tolerability
issues.
Usually,
the
reasons
of
the
switch
are
the
following:
insufficient
efficacy
or
problems
of
tolerance
(weight
gain,
metabolic
disorders,
extrapyramidal
symptoms,
hyperprolactinemia,
sedation,
sexual
dys-
function).
So
that
the
switch
takes
place
without
complications,
it
is
essential
for
the
clinician
Adresse
e-mail
:
0013-7006/$
—
see
front
matter
©
L’Encéphale,
Paris,
2013.
http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2013.10.001

440
É.
Constant
Withdrawal
symptoms;
Hypersensitivity
psychosis
to
have
full
knowledge
of
both
the
receptor
binding
profiles
of
the
antipsychotics
in
question
and
their
half-life.
The
clinician
has
to
expect
a
dopaminergic
rebound
when
the
introduced
antipsychotic
has
a
lesser
affinity
for
the
dopaminergic
D2
receptor
than
that
which
is
withdrawn
or
if
it
is
a
partial
agonist
with
a
particularly
long
half-life.
On
the
other
hand,
a
histaminergic
or
cholinergic
rebound
can
be
expected
if
the
new
antipsychotic
has
a
lesser
affinity
for
these
two
receptors.
In
all
these
scenarios,
a
‘‘plateau’’
switch
will
often
be
recommended.
Now,
if
a
faster
switch
is
imperative,
various
medication
strategies
exist
to
try
to
decrease
the
impact
of
the
rebound
effects.
©
L’Encéphale,
Paris,
2013.
Introduction
Ces
dernières
années,
une
multitude
d’antipsychotiques
atypiques
sont
arrivés
sur
le
marché.
L’enjeu
important
d’arriver
aux
résultats
optimaux
dans
le
traitement
de
nos
patients,
sur
le
plan
clinique,
avec
les
médicaments
dispo-
nibles,
est
encore
compliqué
par
l’interaction
de
plusieurs
facteurs,
comme
des
variables
liées
au
patient,
la
relation
clinicien-patient,
ainsi
que
l’environnement
dans
lequel
ce
traitement
est
pris.
Tout
ceci
a
engendré
des
changements
d’antipsychotiques
de
plus
en
plus
fréquents
chez
nos
patients
en
cas
d’effets
secondaires
mais
aussi
en
cas
d’efficacité
insuffisante.
Le
fait
que
la
santé
physique
des
patients
schizophrènes
suscite
de
plus
en
plus
d’attention
(suite
notamment
aux
effets
métaboliques
probléma-
tiques
de
certains
antipsychotiques
atypiques),
n’a
fait
qu’accentuer
la
tendance
au
remplacement
d’un
antipsy-
chotique
par
un
autre.
La
littérature
relative
aux
essais
cliniques
suggère
que,
sur
une
période
d’un
an,
environ
30
%
des
patients
schizophrènes
changent
d’antipsychotiques
[1].
De
plus,
le
changement
d’un
antipsychotique
typique
vers
un
atypique
semble
plus
risqué
que
le
changement
d’un
antipsychotique
atypique
vers
un
autre
[2].
N’oublions
pas
que
si
tous
les
antipsychotiques
atypiques
font
partie
d’une
même
classe,
nous
avons
affaire
à
des
molécules
très
différentes
l’une
de
l’autre
sur
le
plan
récep-
tologique.
Par
conséquent,
passer
d’une
molécule
à
l’autre
pourra
avoir
des
conséquences
sur
le
plan
réceptologique
qui
se
traduiront
sur
le
plan
clinique.
Les
principaux
effets
des
antipsychotiques
atypiques
font
intervenir
les
voies
dopaminergiques,
sérotoninergiques,
cholinergiques,
histaminergiques
et
adrénergiques.
Les
symptômes
associés
à
la
discontinuation
d’un
anti-
psychotique
peuvent
être
classés
en
différents
types
:
•
les
symptômes
de
retrait
:
comme
l’hyperthermie
induite
après
arrêt
de
la
clozapine
[3]
;
•
les
phénomènes
rebonds
sérotoninergiques,
histaminer-
giques,
cholinergiques
[4]
;
•
les
syndromes
d’hypersensitivité
comme
une
psychose
d’installation
rapide
d’hypersensibilité
[5].
Dans
la
plupart
des
cas,
ces
symptômes
sont
interpré-
tés
par
le
clinicien
comme
résultant
du
nouveau
traitement
antipsychotique
prescrit,
alors
qu’ils
sont,
en
fait,
dus
au
retrait
du
traitement
antipsychotique
antérieur
!
Cela
conduit
souvent
à
l’arrêt
du
nouveau
traitement
puisqu’il
est
interprété
comme
ne
convenant
pas.
.
.
C’est
la
raison
pour
laquelle
une
bonne
connaissance
des
symptômes
de
retrait
est
essentielle
lorsque
le
clinicien
veut
utiliser
des
straté-
gies
de
passage
d’un
antipsychotique
à
l’autre.
Au
niveau
de
la
littérature
également,
nombreuses
sont
les
publica-
tions
rapportant
un
effet
secondaire
lors
de
l’introduction
d’un
nouvel
antipsychotique
(par
ex
:
nausées,
insomnie,
vomissement,
diarrhée
lors
de
l’instauration
d’aripiprazole)
n’ayant
pas
été
mis
en
rapport
avec
un
rebond
cholinergique
lors
de
l’arrêt
(souvent
trop
brutal)
de
l’antipsychotique
précédent
(ex
:
clozapine)
[6—8].
Passons
en
revue
les
principaux
neurotransmetteurs
concernés
et
leurs
implications
dans
les
symptômes
de
retrait.
Principaux
neurotransmetteurs
concernés
Dopamine
Tous
les
antipsychotiques
bloquent
plus
ou
moins
fort
les
récepteurs
dopaminergiques
D2.
Le
parkinsonisme
parfois
observé
avec
les
antipsycho-
tiques
est
la
conséquence
d’une
réduction
en
dopamine
au
niveau
striatal.
La
dyskinésie
précoce
provient,
quant
à
elle,
d’un
relargage
de
dopamine
trop
important.
Les
mécanismes
pharmacologiques
précis
de
l’akathisie
restent
peu
clairs
à
ce
jour.
Les
dyskinésies
tardives
sont,
elles,
attribuées
à
une
hypersensibilité
des
récepteurs
striataux
post-synaptiques,
en
particulier
après
de
longues
périodes
d’antagonisme
D2
[9].
Il
est
généralement
admis,
que
dans
la
schizophrénie,
les
récepteurs
D2
ont
une
affinité
élevée,
ce
qui
rend
ces
sujets
supersensibles
à
la
dopamine
[10].
Après
une
discontinuation
brutale
d’antipsychotiques
ou
de
changement
brutal
d’un
antipsychotique
vers
la
quétia-
pine
ou
la
clozapine,
qui
présentent
une
liaison
au
récepteur
D2
seulement
pendant
une
brève
période
[11],
une
dyskiné-
sie
de
retrait
ou
une
akathisie
peut
survenir
[12].
Un
mécanisme
similaire
d’hypersensibilité
de
retrait
au
niveau
du
système
limbique
pourrait
conduire
à
une
psy-
chose
d’hypersensibilité
[13].
Et
le
clinicien
d’en
conclure
précipitamment
et
de
manière
erronée
que
le
nouveau
trai-
tement
(quétiapine
ou
clozapine)
ne
fonctionne
pas
!
Ainsi,
après
une
discontinuation
rapide
d’antagonistes
dopaminergiques,
une
psychose
de
rebond
(ou
psychose
d’hypersensibilité)
peut
se
développer
en
raison
de
la

Enjeux
cliniques
du
passage
d’un
antipsychotique
à
l’autre
441
sur-régulation
des
récepteurs
[5].
De
nombreuses
publi-
cations
ont
ainsi
rapporté
une
psychose
d’hypersensibilité
après
arrêt
de
clozapine
[14],
ou
encore
des
dysto-
nies
ou
dyskinésies
[15].
En
général,
cette
psychose
d’hypersensibilité
s’accompagne
aussi
d’autres
symptômes
de
retrait
dans
le
cas
de
la
clozapine,
comme
des
nausées,
vomissements,
insomnie,
diarrhée,
agitation,
céphalées,
sudation,
indicateurs
d’un
rebond
choliner-
gique
[3].
D’autres
études
ont
rapporté
des
psychoses
d’hypersensibilité
après
arrêt
de
l’olanzapine
et
de
la
qué-
tiapine
[16].
Cette
psychose
de
rebond
peut
survenir
en
général
dans
les
6
semaines
après
arrêt
d’une
médication
orale
ou
3
mois
après
une
médication
sous
forme
de
dépôt
[17].
Un
avantage
de
passer
d’un
traitement
à
blocage
D2
élevé
vers
un
autre
traitement
à
plus
faible
affinité
D2
ou
à
des
propriétés
d’agoniste
partiel,
est
de
favoriser
la
normalisa-
tion
des
taux
de
prolactine
et
de
la
fonction
sexuelle.
Sérotonine
Les
caractéristiques
atypiques
des
antipsychotiques
aty-
piques
sont
à
mettre
en
rapport
avec
la
stimulation
ou
le
blocage
de
sous-types
de
récepteurs
sérotoninergiques
[18].
L’hyperthermie
de
rebond
observée
après
arrêt
brutal
de
l’olanzapine
pourrait
impliquer
les
récepteurs
sérotoniner-
giques
[19].
Le
passage
d’un
antipsychotique
atypique
avec
une
affi-
nité
élevée
pour
le
récepteur
5HT2A
vers
un
antipsychotique
typique
(avec
une
moindre
affinité
pour
le
récepteur
5HT2A)
pourrait
se
solder
par
une
perte
de
l’effet
au
niveau
des
symptômes
négatifs
et
cognitifs.
Un
des
effets
bénéfiques
du
passage
de
la
clozapine
ou
l’olanzapine
vers
la
ripéridone
ou
l’aripiprazole,
peut
être
une
perte
de
poids,
consécutive
à
un
blocage
plus
faible
des
récepteurs
5HT2
C
sous
rispéridone
ou
aripiprazole.
Acétylcholine
À
ce
jour,
cinq
récepteurs
muscariniques
ont
été
retrouvés
chez
les
humains.
Les
récepteurs
M1
semblent
importants
pour
les
fonctions
cognitives
[20].
Ainsi,
certains
anti-
psychotiques
avec
une
forte
affinité
pour
les
récepteurs
muscariniques
peuvent
occasionner
des
atteintes
cognitives.
Arrêter
brutalement
un
antipsychotique
avec
une
forte
affinité
cholinergique
(olanzapine,
clozapine)
peut
entraî-
ner
un
rebond
cholinergique
:
nausées,
vomissements,
sudation,
insomnie,
symptômes
grippaux
[21].
Histamine
Les
récepteurs
histaminergiques
H1
semblent
être
impor-
tants
pour
la
régulation
du
poids
[22].
De
plus,
les
récepteurs
histaminergiques
sont
impliqués
dans
les
processus
cognitifs
et
la
sédation.
En
conséquence,
passer
d’un
antipsychotique
à
forte
affinité
H1
(clozapine,
quétiapine,
olanzapine)
vers
un
anti-
psychotique
à
plus
faible
affinité
H1
(ex
:
rispéridone,
palipéridone)
peut
se
solder
par
un
effet
bénéfique
au
niveau
du
poids,
de
la
sédation,
mais
peut,
par
contre,
entraîner
une
insomnie
de
rebond
[23].
Adrénaline,
noradrénaline
L’antagonisme
adrénergique
alpha-2
agit
comme
sympatho-
mimétique.
Il
entraîne
un
flux
adrénergique
accru
dans
la
fente
synaptique,
pouvant
contribuer
à
une
amélioration
de
l’humeur
et
une
amélioration
des
fonctions
cognitives
[24].
Après
le
passage
vers
un
antipsychotique
avec
moins
de
propriétés
antagonistes
noradrénergiques,
une
réac-
tion
sympathotonique
temporaire
avec
augmentation
de
la
pression
sanguine
ou
de
l’anxiété
peut
surgir
[25].
L’hyperthermie
de
rebond
décrite
lors
de
l’arrêt
brutal
de
la
clozapine
pourrait
impliquer
les
récepteurs
adrénergiques
alpha-1
[3].
Raisons
du
changement
d’antipsychotique
En
pratique
clinique
courante,
il
existe
différentes
raisons
pour
passer
d’un
antipsychotique
à
l’autre,
principale-
ment
pour
une
raison
d’efficacité
insuffisante
ou
d’effet
secondaire
(prise
de
poids,
augmentation
de
prolactine,
dysfonction
sexuelle,
sédation
importante.
.
.).
Le
clini-
cien
devrait
toujours
bien
peser
le
pour
et
le
contre
du
changement
d’antipsychotique.
En
termes
d’efficacité,
rap-
pelons
que
la
fameuse
étude
CATIE
(Clinical
Antipsychotic
Trials
of
Intervention
Effectiveness)
n’a
pas
trouvé
de
dif-
férence
entre
les
patients
pour
lesquels
un
changement
d’antipsychotique
avait
été
opéré
et
ceux
qui
étaient
restés
avec
leur
antipsychotique
initial
[26].
Il
convient
donc
de
maximiser
le
traitement
antipsychotique
en
cours
avant
de
vouloir
opter
pour
le
changement,
qui
n’apporte
pas
tou-
jours
de
bénéfice
sur
le
plan
clinique
et
qui
implique
une
prise
de
risques.
Paramètres
à
prendre
en
considération
Lors
du
passage
d’un
antipsychotique
vers
un
autre,
deux
paramètres
importants
sont
à
prendre
en
considération
:
•
l’affinité
des
antipsychotiques
concernés
pour
les
divers
récepteurs
;
•
la
demi-vie
des
antipsychotiques.
Affinité
pour
les
divers
récepteurs
Le
but
du
traitement
dans
les
psychoses
ou
la
manie,
est
de
diminuer
l’hyperactivité
dopaminergique
de
la
voie
méso-
limbique,
hyperactive
dans
la
psychose
et
la
manie.
Étant
donné
que
les
antipsychotiques
varient
dans
leur
affinité
pour
les
récepteurs
dopaminergiques
D2,
le
blocage
dopami-
nergique
D2
efficace
sera
atteint
à
des
doses
très
différentes
d’un
antipsychotique
à
l’autre,
et
surtout,
il
sera
atteint
avant,
en
même
temps
ou
après
seulement
avoir
bloqué
d’autres
récepteurs.
Par
conséquent,
les
effets
secondaires
associés
au
blocage
de
ces
autres
récepteurs
surviendront
en
même
temps
que
l’effet
antipsychotique
recherché
(blocage
D2)
ou
non.
Considérons
l’affinité
relative
des
divers
antipsycho-
tiques
par
rapport
au
récepteur
D2
;
c’est-à-dire,
imaginons
un
instant
que
tous
les
antipsychotiques
typiques
et
aty-
piques
aient
la
même
affinité
pour
le
récepteur
D2.

442
É.
Constant
Examinons
alors
leur
affinité
relative
pour
les
autres
récep-
teurs
concernés.
Lorsque
l’affinité
relative
pour
un
autre
récepteur
est
plus
importante
que
pour
le
récepteur
D2,
nous
devons
nous
attendre
à
un
effet
secondaire
lié
à
l’occupation
de
ce
récepteur.
Nous
constaterons
que
cer-
tains
antipsychotiques
atypiques
(les
«
pines
»,
olanzapine,
quétiapine,
clozapine)
ont
une
affinité
relative
plus
impor-
tante
pour
les
récepteurs
muscariniques
et
histaminergiques
alors
que
d’autres
antipsychotiques
(les
«
ones
»,
rispéri-
done,
palipéridone,
mais
aussi
aripiprazole,
amisulpride,
haldol)
ont
une
affinité
relative
bien
plus
faible
pour
ces
mêmes
récepteurs.
Par
conséquent
les
«
pines
»
seront
responsables
d’effets
secondaires
muscariniques
et
histami-
nergiques
avant
d’atteindre
un
blocage
D2
suffisant
que
pour
exercer
une
action
antipsychotique
;
ce
qui
n’est
pas
le
cas
des
«
ones
».
Demi-vie
des
antipsychotiques
La
connaissance
sur
l’absorption
et
la
demi-vie
des
anti-
psychotiques
concernés
va
nous
aider
à
déterminer
quand
l’état
d’équilibre
sera
atteint
lorsqu’un
antipsychotique
est
introduit,
ou
quand
il
sera
éliminé
lorsqu’il
est
arrêté.
En
général,
il
faut
considérer
que
cela
prend
environ
4
à
5
fois
la
demi-vie
d’élimination
pour
qu’une
molécule
atteigne
l’état
d’équilibre
;
et
le
même
laps
de
temps
pour
que
la
molé-
cule
soit
éliminée
du
compartiment
plasmatique,
une
fois
arrêtée.
Nous
pouvons
regrouper
les
temps
de
demi-vie
de
la
manière
suivante
:
•
T
½
de
±
24
heures
:
amisulpride,
clozapine,
quétiapine
XR1,
halopéridol,
perphénazine,
rispéridone,
palipéri-
done
;
•
T
½
de
±
30
à
36
heures
:
olanzapine
;
•
T
½
de
72
heures
(3
jours)
:
aripiprazole.
Les
phénomènes
de
rebond
Les
phénomènes
de
rebond
risquent
d’être
particulièrement
problématiques
lorsque
les
deux
antipsychotiques
concernés
diffèrent
considérablement
dans
leur
profil
réceptologique
et
leur
demi-vie.
Ainsi,
des
phénomènes
de
rebond
peuvent
survenir
lorsque
l’on
passe
d’un
antipsychotique
avec
un
blocage
histaminergique
ou
muscarinique
relativement
important
(ex
:
chlorpromazine,
clozapine,
olanzapine,
quétiapine)
vers
un
antipsychotique
avec
un
blocage
plus
faible
pour
ces
récepteurs
(ex
:
aripiprazole,
halopéridol,
rispéridone,
palipéridone).
Le
rebond
histaminergique
se
caractérise
par
de
l’anxiété,
agitation,
insomnie,
symptômes
extrapyrami-
daux.
Le
rebond
cholinergique,
quant
à
lui,
se
caractérise
par
de
l’agitation,
confusion
et
des
symptômes
extrapyra-
midaux.
De
même,
un
rebond
dopaminergique
peut
se
dévelop-
per
lors
du
passage
d’un
antipsychotique
à
forte
affinité
D2
1Demi-vie
relative
dans
ce
cas
tenant
compte
de
l’absorption
progressive
de
quetiapine
XR.
(rispéridone,
palipéridone)
vers
un
antipsychotique
à
plus
faible
affinité
(clozapine,
quétiapine)
ou
vers
un
agoniste
partiel
D2
à
longue
demi-vie
(aripiprazole)
;
surtout
s’il
n’est
pas
administré
à
posologie
adéquate
(de
manière
à
obtenir
un
blocage
D2
suffisant
malgré
cette
affinité
plus
faible
ou
cet
agonisme
partiel).
Le
rebond
dopaminergique
va
se
caractériser
par
l’émergence
d’une
symptomatologie
psychotique,
voire
un
état
maniaque,
de
l’agitation,
agressivité,
akathisie.
Lorsque
l’antipsychotique
arrêté
a
une
demi-vie
plus
courte
que
l’antipsychotique
introduit
(ex
:
passage
de
rispéridone
vers
aripiprazole),
il
y
a
bien
un
risque
de
rebond
dopaminergique
car
les
récepteurs
D2,
qui
plus
est,
hypersensibles
du
fait
de
leur
blocage,
vont
être
libérés
rapidement
et
seront
réoccupés
plus
tardivement
!
Différents
types
de
stratégies
Il
existe
différentes
manières
de
procéder
au
passage
d’un
antipsychotique
vers
un
autre
:
•
le
passage
en
plateau
:
introduire
progressivement
le
nou-
vel
antipsychotique
à
dose
croissante
jusqu’à
la
dose
thérapeutique
et
ensuite
diminuer
doucement
les
doses
du
premier
antipsychotique
;
•
le
passage
direct
:
remplacer
de
manière
abrupte
un
anti-
psychotique
par
un
autre
sans
titration
;
•
le
passage
ascendant
:
introduire
progressivement
le
nou-
vel
antipsychotique
à
dose
croissante
et
arrêter
ensuite
brutalement
le
premier
antipsychotique
;
•
le
passage
descendant
:
diminuer
progressivement
le
premier
antipsychotique
et
introduire
le
nouvel
antipsy-
chotique
brutalement
à
dose
thérapeutique.
Plusieurs
facteurs
peuvent
intervenir
dans
le
type
de
schéma
choisi.
Parmi
ceux-ci,
la
demi-vie
des
antipsy-
chotiques
concernés
est
d’une
grande
importance.
En
effet,
un
passage
rapide
d’un
antipsychotique
vers
un
autre
pourra
être
choisi
et
sera
moins
problématique
si
l’antipsychotique
qui
doit
être
arrêté
possède
une
longue
demi-vie.
Par
contre,
il
conviendra
d’être
plus
prudent
si
l’antipsychotique
introduit
possède
une
longue
demi-vie.
Lorsque
ce
changement
d’antipsychotique
a
lieu
chez
un
patient
en
consultation
ambulatoire,
le
schéma
en
plateau
est
certainement
préférable
car
il
limite
les
phénomènes
de
rebond
[27].
Bien
entendu,
le
risque
potentiel
d’effets
secondaires
dus
à
la
prise
simultanée
de
deux
antipsycho-
tiques
(dans
le
schéma
en
plateau)
doit
être
mis
en
balance
avec
le
risque
de
phénomènes
de
rebond
plus
fréquent
si
on
n’opte
pas
pour
le
plateau
!
En
particulier,
le
risque
d’interactions
pharmacocinétiques
entre
antipsychotiques
doit
être
considéré.
Le
schéma
en
plateau
est
particulièrement
indiqué
dans
les
circonstances
suivantes
:
•
lors
du
passage
d’un
antipsychotique
à
fort
blocage
his-
taminergique
ou
cholinergique
vers
un
antipsychotique
à
faible
blocage
de
ces
deux
récepteurs
(ex
:
olanzapine,
quétiapine,
clozapine
vers
rispéridone,
palipéridone,
ari-
piprazole)
;

Enjeux
cliniques
du
passage
d’un
antipsychotique
à
l’autre
443
•
lors
du
passage
d’un
antipsychotique
à
courte
demi-vie
vers
un
autre
à
longue
demi-vie
(ex
:
quétiapine,
rispéri-
done,
palipéridone
vers
aripiprazole)
;
•
lors
du
passage
d’un
antipsychotique
à
forte
affinité
D2
vers
un
autre
à
moindre
affinité
D2
(haldol,
rispéri-
done,
palipéridone
vers
quétiapine,
clozapine)
ou
vers
un
agoniste
partiel
(aripiprazole).
Le
schéma
en
plateau
proposé
par
Correll
[4]
se
déroule
de
la
manière
suivante
:
après
ajout
du
nouvel
antipsycho-
tique
à
75
%—100
%
de
sa
posologie
finale
pendant
un
laps
de
temps
correspondant
à
4
à
5
fois
sa
demi-vie,
le
clinicien
commencera
seulement
à
diminuer
plus
ou
moins
rapide-
ment
l’ancien
antipsychotique
de
25
%
à
50
%
toutes
les
4
à
5
demi-vies.
Ce
schéma
en
plateau
est
particulièrement
pertinent
lorsqu’on
va
vers
l’ariprazole.
Pour
illustration,
lorsque
le
clinicien
veut
par
exemple
passer
de
l’olanzapine
à
l’aripiprazole,
il
y
a
des
risques
d’effet
rebond
tant
dopaminergique
qu’histaminergique
et
cholinergique
pour
2
raisons
:
•
l’aripiprazole
a
une
longue
demi-vie
(environ
3
jours)
;
•
l’olanzapine
a
une
affinité
bien
plus
grande
que
l’aripiprazole
pour
les
récepteurs
histaminergiques
et
cholinergiques.
Si
nous
appliquons
le
schéma
en
plateau
décrit
ci-dessus,
nous
allons
introduire
l’aripiprazole
et
garder
les
deux
antipsychotiques
pendant
environ
15
jours
(5
×
3
jours
de
demi-vie
pour
l’arpiprazole)
pour
éviter
le
rebond
dopa-
minergique
avant
de
commencer
à
diminuer
lentement
l’olanzapine
pour,
cette
fois,
éviter
un
rebond
histaminer-
gique
et
cholinergique
:
par
exemple
diminuer
sa
posologie
de
25
%
chaque
7
jours
(30
heures
de
demi-vie
×
5).
Stratégies
pour
diminuer
les
effets
rebonds
Plusieurs
stratégies
existent
pour
essayer
de
diminuer
l’importance
des
phénomènes
de
rebond,
par
exemple
en
cas
de
nécessité
d’arrêter
l’antipsychotique
précé-
dent
plus
rapidement
(ex
:
agranulocytose
sous
clozapine).
L’utilisation
de
substances
anticholinergiques
peut
aider
à
évider
le
rebond
cholinergique
[28].
Pour
diminuer
le
risque
d’insomnie
de
rebond
liée
à
l’arrêt
d’un
antipsy-
chotique
à
forte
affinité
histaminergique
H1,
l’addition
de
benzodiazépines
ou
d’autres
sédatifs
peut
être
une
straté-
gie
utile.
Encore
faut-il
bien
identifier
qu’il
s’agisse
d’une
insomnie
de
rebond
et
non
d’un
signe
de
rechute
psycho-
tique
!
Généralement
la
stratégie
du
schéma
en
plateau
est
le
meilleur
procédé
pour
essayer
d’éviter
les
phénomènes
de
rebond
[29].
Si
le
clinicien
prévoit,
qu’en
fonction
du
schéma
considéré,
du
profil
des
molécules
concernées
et
des
caractéristiques
de
son
patient,
que
ce
changement
risque
d’être
difficile
et
pourrait
s’accompagner
d’insomnie,
de
peur,
d’agitation,
il
pourrait
s’avérer
utile
d’hospitaliser
brièvement
le
patient
pour
le
suivre
de
près
et
adapter
son
traitement
régulièrement.
Au
vu
de
la
littérature,
le
risque
d’une
exacerbation
psy-
chotique
de
rebond,
telle
que
nous
l’avons
décrite,
est
le
plus
important
en
passant
de
la
clozapine
ou
olanzapine
vers
d’autres
antipsychotiques,
en
particulier
la
rispéri-
done
ou
l’aripiprazole
[6].
Il
convient
donc
d’effectuer
un
changement
très
graduel
pour
la
clozapine
(50
mg
par
semaine)
ou
l’olanzapine
vers
un
autre
antipsychotique
avec
moins
d’affinité
muscarinique.
L’utilisation
de
benzodia-
zépines
ou
d’anticholinergiques
peut
également
s’avérer
utile
dans
ce
cas.
Pour
la
clozapine,
si
la
raison
de
l’arrêt
est
l’agranulocytose,
il
est
préférable
d’instaurer
un
anti-
psychotique
avec
un
profil
réceptologique
différent
(éviter
l’olanzapine
et
la
quétiapine)
alors
que
si
la
raison
de
l’arrêt
est
une
autre
cause
que
l’agrannulocytose,
il
est
préférable
d’instaurer
un
antipsychotique
avec
le
même
profil
récep-
tologique
[30].
Les
effets
indésirables
du
changement
d’antipsychotique,
lorsqu’ils
surviennent,
n’apparaissent
pas
tous
en
même
temps.
Le
rebond
cholinergique
et
l’akathisie
rebond
surviennent
généralement
dans
les
pre-
miers
jours
après
le
changement
;
un
rebond
parkinsonien
apparaît
généralement
après
une
semaine
et
la
dyskinésie
rebond
peut
apparaître
après
un
mois.
Pour
être
certain
que
les
effets
observés
sont
bien
dus
au
changement,
une
épreuve
de
réintroduction
de
l’antipsychotique
arrêté
peut
être
tentée.
Elle
devra
dès
lors
se
solder
par
la
disparition
de
la
symptomatologie
observée.
Conclusion
Si
le
changement
d’un
antipsychotique
à
l’autre
est
souvent
motivé
par
de
bonnes
raisons
dans
notre
pratique
clinique
courante,
il
convient
de
prendre
conscience
des
risques
liés
à
cette
pratique.
Trop
souvent,
ils
sont
tout
simplement
ignorés
par
le
clinicien.
Une
bonne
connaissance
du
profil
des
molécules
utilisées
permettra
de
mieux
décider
de
la
stratégie
qui
minimise
les
risques
d’effets
de
rebond.
En
particulier,
en
cas
de
changement
vers
un
antipsychotique
avec
un
profil
réceptologique
assez
différent
de
celui
qui
est
arrêté,
un
schéma
en
plateau
sera
toujours
privilégié.
Déclaration
d’intérêts
L’auteur
déclare
avoir
perc¸u
des
honoraires
d’orateur
et/ou
d’Advisory
Board
de
différentes
firmes
pharmaceutiques:
AstraZeneca,
BMS,
Lilly,
Wyeth,
Servier,
Janssen
Cilag,
Pfi-
zer,
Lundbeck,
GSK.
Il
ne
détient
aucune
action
dans
ces
sociétés.
Références
[1]
Nyhuis
AW,
Faries
DE,
Ascher-Svanum
H,
et
al.
Pre-
dictors
of
switching
antipsychotics
medications
in
the
treatment
of
schizophrenia.
BMC
Psychiatry
2010:10—75,
http://dx.doi.org/10.1186/1471-244X-10-75.
[2]
Hugenholtz
GW,
Heerdink
ER,
Meijer
WE,
et
al.
Reasons
for
switching
between
antipsychotics
in
daily
clinical
practice.
Pharmacopsychiatry
2005;38:122—4.
[3]
Goudie
AJ,
Smith
JA,
Robertson
A,
et
al.
Clozapine
as
a
drug
of
dependence.
Psychopharmacology
(Berl)
1999;142(4):369—74.
[4]
Correll
CU.
From
receptor
pharmacology
to
improved
out-
comes:
individualising
the
selection,
dosing,
and
switching
of
antipsychotics.
Eur
Psychiatry
2010;25(Suppl.
2):S12—21.
[5]
Moncrieff
J.
Does
antipsychotic
withdrawal
provoke
psy-
chosis?
Review
of
the
literature
on
rapid
onset
psychosis
 6
6
1
/
6
100%