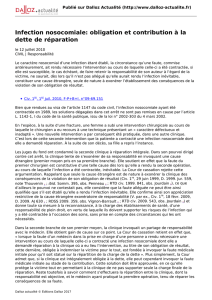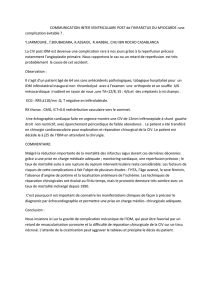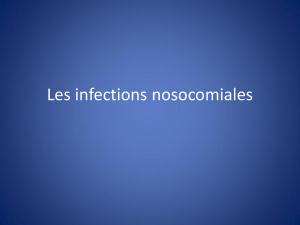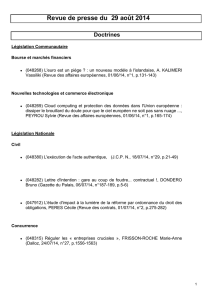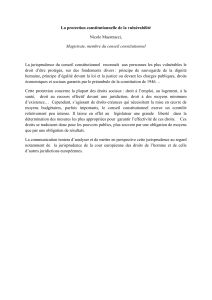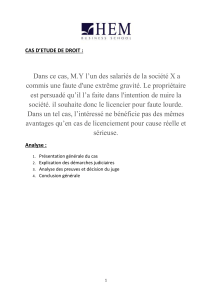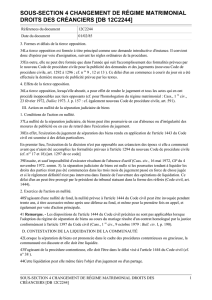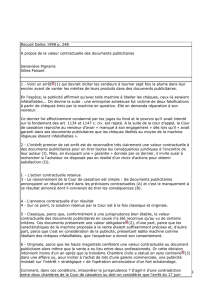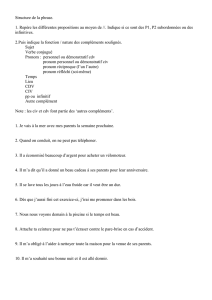Colloque de Sfax - Faculté de droit de Sfax

« LA RESPONSABILITE MEDICALE DU FAIT D’AUTRUI »
Christophe RADE
Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV
Vice-Président de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV
INTRODUCTION
La responsabilité médicale ne constituait pas, jusqu’à l’entrée en
vigueur de la loi française du 4 mars 2002 relative aux droits des patients,
une branche autonome du droit de la responsabilité civile, même si sa
spécificité était toutefois nettement affirmée. Depuis la réforme
intervenue en 2002, il est possible de soutenir qu’elle a acquis une marge
certaine d’autonomie.
Qu’on la considère ou non comme réellement autonome, la
particularité de la responsabilité médicale tient tout d’abord à l’objet
même de l’activité concernée ; le corps humain est en effet un sujet
d’attention qui échappe partiellement à toute certitude, les produits de
l’activité médicale, si avancée soit-elle sur un plan scientifique et
technique, ne pouvant être à coup sur garantis contre l’aléa. La
particularité de la matière tient aussi à la nature même des dommages
dont il est réclamé réparation ; s’il n’est pas exclu de rencontrer des
préjudices matériels ou économiques, l’essentiel des préjudices constatés
est corporel. Or l’intégrité physique des personnes est le sujet de toutes
les attentions, du législateur comme du juge.
Il faut d’ailleurs tout de suite signaler l’intrusion constante du
droit dans la médecine au cours du vingtième siècle, notamment depuis la
“découverte” de la nature contractuelle des relations entretenues par le
patient avec son médecin dans l’arrêt Mercier du 20 mai 1936. La part du
droit dans le règlement des différends médicaux a d’ailleurs trouvé dans
la diversification et les progrès réalisés dans l’art de soigner un terreau
des plus favorables.
57

La médecine française a évolué dans une double direction en
insistant non seulement sur le développement du secteur libéral mais
également en renforçant les moyens du secteur hospitalier. C’est surtout
dans ce cadre hospitalier que se pose la question de la responsabilité
médicale du fait d’autrui. Lorsqu’un patient entre en effet à l’hôpital,
qu’il soit public ou privé, des rapports se nouent certes avec
l’établissement mais également avec les praticiens chargés de réaliser les
actes médicaux nécessités par son état. Dans ce contexte, les hôpitaux
répondent naturellement des erreurs et des fautes commises par les
praticiens et le personnel médical, posant ainsi le problème de la
responsabilité des établissements du fait du personnel.
Jusqu’à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, la
jurisprudence judiciaire et administrative avait développé un certain
nombre de solutions visant à dégager le cadre de cette responsabilité du
fait d’autrui et soulignant la différence de situation des patients selon
qu’ils se trouvent au sein d’une clinique (privée) ou d’un hôpital (public).
Ces jurisprudences ont été partiellement remises en cause par la
loi du 4 mars 2002 qui dépasse le clivage traditionnel droit privé/droit
public pour imposer des règles uniformes1. L’entrée en vigueur de ce
texte nous imposera donc, à chaque fois que cela s’avèrera nécessaire, de
rappeler les solutions dégagées par la jurisprudence avant de présenter le
dispositif issu de la loi nouvelle.
La loi de 2002 réalise en premier lieu le souhait, maintes fois
formulé d’une unification des règles juridiques applicables aux
dommages médicaux2. Soustraites à l’influence du Code civil et de la
jurisprudence dont l’œuvre se trouve assez paradoxalement d’ailleurs
tantôt consacrée, tantôt remise en cause, la loi pose de nouveaux
principes applicables à toutes les victimes, quelles que soient les
1 Sur cette loi, notre étude « La réforme de la responsabilité médicale après la loi du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé »,
Resp. civ. et assur. 2002, chron. 7.
2 En ce sens notre chron. « L’harmonisation des jurisprudences judiciaires et
administratives en matière de responsabilité médicale : réflexions sur la
méthode », Resp. civ. et assur. 2000, chron. 17, et les réf. citées.
58

circonstances et les structures au sein desquelles elles sont soignées.
De ce point de vue, la loi du 4 mars 2002 met un terme à l’inégalité de
traitement entre victimes selon qu’elles relevaient du droit privé ou du
droit public, ce qui constitue un premier motif de satisfaction.
Le texte réalise en second lieu la conciliation du droit à réparation
des victimes, exigence de valeur constitutionnelle, et la protection des
acteurs de la santé qui supportaient jusque là seuls la montée en
puissance du courant victimologiste. Cette double exigence éthique
s’appuie sur une logique globale qui ne pourra qu’emporter l’adhésion
puisqu’en même temps que se trouve réaffirmé le principe d’une
responsabilité individuelle fondée principalement sur la faute, la loi du 4
mars 2002 offre aux victimes de dommages médicaux un régime de
solidarité qui dépersonnalise la dette de réparation et leur assure la prise
en charge effective de leur dommage.
Une partie des solutions traditionnelles survivra soit dans le cadre
tracé par le législateur, soit en marge de celui-ci dans la mesure où la loi
ne s’applique pas à l’ensemble des dommages médicaux. Singulièrement,
la loi du 4 mars 2002 s’est intéressée exclusivement aux rapports
patients/établissements ou professionnels et n’a pas réglé la question des
actions que les patients pourraient engager directement contre les salariés
des établissements, ni la question, liée à la précédente, des recours
exercés par ces établissements contre leurs salariés. Même si ces
solutions ne pourront plus, selon nous, être fondées comme c’était le cas
auparavant sur les règles propres au droit privé (contrat de soins) et
public (situation institutionnelle du patient, usager du service public
hospitalier), leur contenu ne devrait pas être finalement bouleversé, pour
des raisons que nous évoquerons au fur et à mesure.
Afin d’exposer les règles qui gouvernent la responsabilité du fait
d’autrui en matière de responsabilité médicale, nous envisagerons dans
un premier temps l’examen des règles relatives aux conditions de la
responsabilité médicale du fait d’autrui avant de nous intéresser à son
régime.
59

I – Les conditions de la responsabilité médicale du fait d’autrui
Certaines conditions tiennent tout d’abord à la personne du
responsable (A). D’autres tiennent à la personne de l’auteur du
dommage (B).
A – Les conditions tenant à la personne du responsable
Il nous ici exposer la situation antérieure à la réforme avant
d’envisager les conséquences de celle ci sur les solutions traditionnelles.
1) Situation antérieure à la loi du 4 mars 2002
Avant l’unification du droit de la responsabilité médicale, les
solutions différaient selon que l’on se situait dans le secteur privé ou
public.
a – Situation en droit privé
Depuis l’arrêt Mercier du 20 mai 1936, la responsabilité des
médecins et des établissements privés était classiquement fondée sur
l’existence d’un contrat médical. Ce fondement contractuel imposait à la
victime d’invoquer les règles de la responsabilité contractuelle (C. civ.,
art. 1147 et s. du Code civil) et lui interdisait d’invoquer le bénéfice de la
responsabilité extracontractuelle, en raison du principe dit du non-cumul
des responsabilités. Il existe toutefois un certain nombre de situations
dans lesquelles aucun contrat n’a pu être passé entre le patient et
l’établissement ou le professionnel. Dans cette hypothèse là, l’action
devait être engagée sur les règles de la responsabilité extracontractuelle.
2) Existence d’un contrat médical
Pour déterminer la personne responsable, il faut distinguer selon
que la victime est soignée par un professionnel exerçant à titre libéral ou
par un établissement.
60

Lorsque la victime est soignée dans le cadre de la médecine
ambulatoire, le contrat de soins est passé directement avec le
professionnel libéral3 et c’est lui qui sera responsable des dommages,
même s’ils ont été causés par des personnes qu’il emploie.
La situation peut se compliquer lorsque le patient est soigné dans
un établissement de soins car le régime applicable dépendra de la nature
du contrat qui unit les médecins à l’établissement.
Si les médecins exercent au sein de l’établissement à titre salarié,
le contrat de soins est passé avec l’établissement qui répondra des
conséquences d’une faute médicale4.
Lorsqu’en revanche le patient aura été soigné dans une clinique
par un médecin lié à cette dernière par un contrat d’exercice libéral, le
patient passera en réalité deux contrats distincts. Le contrat de soins
proprement dit sera conclu avec le praticien exerçant à titre libéral ; c’est
donc ce dernier qui sera responsable de l’échec des actes médicaux
entrepris. Mais parallèlement à ce premier contrat, la victime passera
également une autre convention avec l’établissement qui répondra alors
de la partie hôtelière du contrat mais également des soins courants pré et
post opératoires.
Cette juxtaposition de deux conventions pose un problème délicat
d’articulation des responsabilités. Le médecin exerçant au sein de
l’établissement à titre libéral utilise en effet la plupart du temps les
services de personnel médical salarié de l’établissement, ce qui pose un
problème lorsqu’un dommage a été causé précisément par ce personnel.
Dans cette hypothèse, la jurisprudence procède à un certain nombre de
distinctions fondées essentiellement sur un critère chronologique.
S’agissant des actes de soins réalisés par le personnel médical avant
3 Cass. 1ère civ., 26 mai 1999 ; Clinique Victor Pauchet de Butler c./ Reitzaum : D.
1999, jur. p. 7198, note E. Savatier.
4 Cass. 1ère civ., 4 juin 1991 ; Fondation Rotschield : JCP G. 1991, II, 21730, note
J. SAVATIER. – Cass. 1ère civ., 26 mai 1999 ; Sté clinique Victor Pauchet de
Butler : JCP G 1999, II, 10112, rapport P. Sargos ; RTD civ. 1999, p. 634, n° 6,
obs. P. Jourdain ; D. 1999, somm. p. 386, obs. J. Pennnau.
61
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%