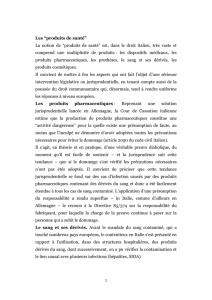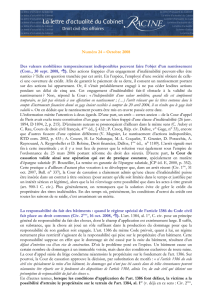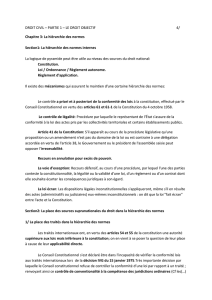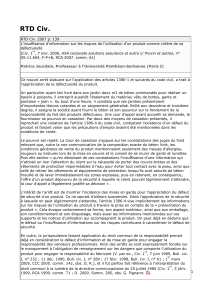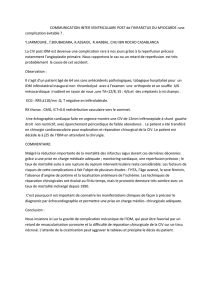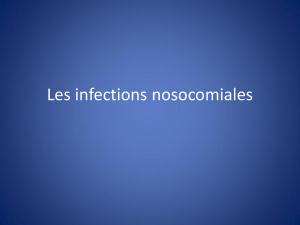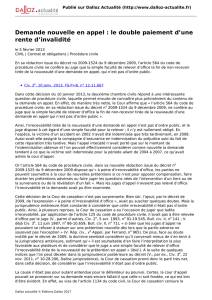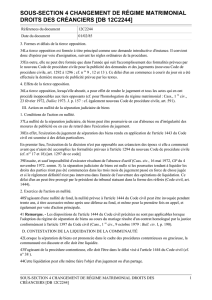Information du patient et responsabilité médicale

ARTICLE DE REVUE Progrès en Urologie (1998), 8, 487-491
487
Information du patient et responsabilité médicale
Yves CHARTIER
Agrégé des Facultés de droit, Conseiller à la Cour de Cassation
RESUME
Le devoir d’information envers son client, qui pèse
sur tout médecin, devoir dont la méconnaissance est
source de responsabilité, peut être essentiellement
envisagé sous les quatre angles suivants :
- un devoir d’information : pourquoi?
- un devoir d’information : quel devoir?
- un devoir d’information : comment?
- un devoir d’information : pour qui?
Mots clés : Information, responsabilité médicale, déontologie,
risque médical.
Progrès en Urologie (1998), 8, 487-491.
UN DEVOIR D’INFORMATION : POURQUOI?
La réponse appelle deux explications : l’une, de carac-
tère déontologique; l’autre qui relève, plus largement,
du droit des contrats.
L’obligation déontologique résulte d’abord de l’article
35 du Code de déontologie médicale, selon
lequel : «le médecin doit à la personne qu’il examine,
qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les investigations et les
soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient
compte de la personnalité du patient dans ses explica-
tions et veille à leur compréhension. «Devoir, par consé-
quent, qui oblige à une information reçue, comprise par
celui à qui elle s’adresse. D’autres textes abordent le
sujet, spécialement les articles 41 pour les interventions
mutilantes, et 64 sur lesquels je reviendrai.
La place qu’occupe un Code de déontologie dans les
sources du droit est discutée en doctrine. Mais la Cour
de cassation a donné sur ce point une réponse dénuée
de toute équivoque. Par un arrêt du 18 mars 1997 [1],
elle a en effet jugé «que la méconnaissance des dispo-
sitions du Code de déontologie médicale peut être
invoquée par une partie à l’appui d’une action en dom-
mages-intérêts contre un médecin, et qu’il n’appartient
qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de se prononcer
sur une telle action, à laquelle l’exercice d’une action
disciplinaire ne peut faire obstacle».
Au-delà de cet aspect déontologique, le devoir d’infor-
mation qui pèse sur le médecin a cependant une justifi-
cation plus large. Faut-il rappeler que les rapports entre
le médecin et son patient sont de nature contractuelle,
ce que la Cour de cassation énonce depuis le célèbre
arrêt Mercier du 20 mai 1936 [2]. Or, par une évolution
lente mais continue, la jurisprudence a mis à la charge
de certains contractants une obligation générale d’in-
formation, qu’elle soit qualifiée d’obligation de rensei-
gnement ou de conseil [3]. Ce mouvement s’explique,
dans le droit de la consommation, par la faiblesse du
consommateur par rapport à son partenaire. Laissant de
côté ce droit, encore que, dans une certaine mesure, le
patient est un consommateur, il faut ici plutôt se placer
sur un autre terrain, à savoir l’obligation particulière de
renseignement qui pèse sur tout professionnel. Le pro-
fessionnel, en effet, est celui qui sait. C’est précisément
en raison de sa science que le client l’a choisi: il lui
appartient donc, car lui seul peut le faire, de l’éclairer
sur les conséquences des actes qu’il va accomplir, des
traitements qu’il se propose de prescrire.
A cet égard, le devoir d’information du médecin n’est
pas d’une nature différente de celui qui pèse sur les autres
professions intellectuelles, comme par exemple sur celle
d’avocat. Et qu’il suffise ici de citer un arrêt de la 1ère
Chambre civile du 29 avril 1997 [4], par lequel il a été
jugé, à la suite de ce qui a été decidé pour les médecins,
«que l’avocat est tenu d’une obligation particulière d’in-
formation et de conseil vis-à-vis de son client et qu’il lui
importe de prouver qu’il a exécuté cette obligation».
Devoir de même nature que celui qui pèse sur les autres
professionnels, mais, faut-il ajouter néanmoins, devoir
d’une intensité particulière parce que l’acte médical
concerne le corps humain, touche à la vie. C’est en ce
sens qu’il a été jugé, par un arrêt du 28 janvier 1942
[5], «que, comme tout chirurgien, le chirurgien d’un
service hospitalier est tenu, sauf cas de force majeure,
d’obtenir le consentement du malade avant de prati-
quer une operation dont il apprécie, en pleine indépen-
dance, sous sa responsabilité, l’utilité, la nature et les
risques; qu’en violant cette obligation, imposée par le
respect de la personne humaine, il commet une attein-
te grave aux droits du malade, un manquement à ses
devoirs proprement médicaux...»
Communication présentée lors de la 2ème journée d’urologie du groupe Necker, 7
mars 1998, Paris.
Manuscrit reçu : mai 1998, accepté : mai 1998.
Adresse pour correspondance : Dr.E. Chartier-Kastler, Service d’Urologie, Hôpital
de la Pitié, 83, Boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris.

488
UN DEVOIR D’INFORMATION : QUEL DEVOIR?
Ce devoir, on l’a vu, est défini par le Code de déonto-
logie. Il est heureux que la Cour de cassation, afin de
ne pas laisser croire à une quelconque divergence d’ap-
préciation, se soit inspirée des mêmes termes. Par un
arrêt du 14 octobre 1997 [6], la 1ère Chambre civile a
en effet jugé «...que le médecin a la charge de prouver
qu’il a bien donné à son patient une information loya -
le, claire et appropriée sur les risques des investiga-
tions ou soins qu’il lui propose de façon à lui permettre
d’y donner un consentement ou un refus éclairé».
Il faut cependant mettre à part les cas d’urgence et de
danger immédiat, qui revêtent les caractéristiques de la
force majeure. Il est évident qu’il y a des hypothèses où
il est impossible d’informer le malade. Le devoir d’in-
formation peut se télescoper avec l’obligation de porter
assistance à une personne en danger. Ce devoir, me
semble-t-il, suppose d’avoir un certain temps, qui, dans
des circonstances particulières, peut faire défaut.
Sous cette réserve, le devoir d’information - qui peut
d’ailleurs éventuellement s’exercer envers le représen-
tant de la personne concernée, ainsi dans le cas d’un
mineur - revêt trois aspects qui se dégagent de la lectu-
re même de l’article 35 précité :
- d’abord, le patient doit être informé sur son état,
c’est-à-dire sur son état présent et l’évolution prévi -
sible de cet état.
- ensuite, il doit l’être sur les investigations et les soins
proposés, ce qui suppose, en matière chirurgicale, une
explication sur la nature de l’opération projetée, et les
conséquences normales de cette opération. Et c’est ici
que doit être cité l’article 41 du Code de déontologie
médicale, selon lequel «aucune intervention mutilante
ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux
et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de
l’intéressé et sans son consentement». Plus générale-
ment, par un arrêt du 19 mars 1997 [7], la 2ème
Chambre civile de la Cour de cassation a jugé «qu’il
résulte de l’article 16-3 du Code civil que nul ne peut
être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir
une intervention chirurgicale».
- enfin, et c’est ce qui fait le plus problème - on va
d'ailleurs retrouver la question à propos de la preuve -
le patient doit être informé sur les risques encourus à
l’occasion du traitement, des investigations, ou de
l’opération qui lui sont proposés. Risques, ou si l’on
préfère conséquences anormales, à distinguer des
conséquences normalement prévisibles de ces «soins»,
entendus au sens large.
Cette information sur les risques appelle elle-même
plusieurs observations :
1ère observation : il est certain qu’elle s’impose avec
une force toute spéciale lorsque l’opération, ou les
investigations, voire les soins, n’ont pas un caractère de
nécessité. C’est ce qui explique qu’il ait été jugé que,
en matière de chirurgie esthétique, «le chirurgien est
tenu d’une obligation d’information particulièrement
rigoureuse à l’égard de son client qu’il ne doit pas
exposer à un risque sans proportion avec les avantages
escomptés» [8].
2ème observation : de cette première remarque, il ne
résulte pas pour autant que là même où l’opération
apparaît nécessaire aux yeux du praticien, le client
puisse être laissé dans l’ignorance. Ce qu’on peut dire
seulement ici, c’est qu’alors que dans le premier cas, la
jurisprudence ne peut que tendre à refuser la moindre
exception, il est ici imaginable que, compte tenu des
particularités de tel ou tel cas d'espèce, le médecin
puisse éviter de se voir tenu pour responsable, sinon
d’un défaut d’information, du moins d’une information
qui se révélerait insuffisante.
On peut citer, en ce sens, de la jurisprudence ancienne.
Ainsi, par un arrêt du 20 janvier 1987 [9], il a été jugé,
à propos des risques inhérents à une intervention chi-
r u rgicale ou à une anesthésie, «que le praticien,
quoique tenu de recueillir le consentement éclairé du
malade, n’est pas obligé de (les) porter à sa connais-
sance s’ils sont de ceux qui ne se réalisent qu'excep-
tionnellement’’. Il reste cependant à savoir dans quelle
mesure cette jurisprudence est toujours d’actualité : or,
force est d’observer à cet égard que l’arrêt du 14
octobre 1997 ne fait pas de distinction selon les risques.
Aussi bien, la plus extrême prudence s’impose-t-elle.
Ce que je crois seulement, mais ce n’est qu’une opinion
personnelle, c’est que les tribunaux seront toujours
tiraillés entre deux considérations contraires. D’un
côté, l’idée que le patient est en droit d’être informé, en
toute hypothèse, de tout risque au moins grave, fût-il
rare. De l’autre, celle que le patient ne doit pas être
noyé sous le poids d’informations dont l’excès même
leur retirerait toute portée, spécialement d’informations
relatives à des risques à la fois exceptionnels et
mineurs.
Mais, la justice étant humaine, n’étant donc pas une
science exacte, mon propre devoir d’information est
d’encourager chacun à une prudence extrême.
3ème observation : des risques inhérents au traite-
ment, il convient de distinguer ceux qui sont propres
à la maladie elle-même. Le malade doit être éclairé
sur eux, ne serait-ce que pour lui permettre de com-
prendre l’enjeu des traitements qui lui sont propo-
sés. Autrement dit, il faut que le patient soit en
mesure de mettre en parallèle ou, si l’on préfère, en
balance, les inconvénients éventuels des soins qui
lui sont proposés, et ceux d’une attitude passive face
à la maladie.
Y. Chartier, Progrès en Urologie (1998), 8, 487-491

UN DEVOIR D’INFORMATION : COMMENT?
C’est ici rencontrer la question de la preuve que l’in-
formation a bien été donnée au patient. Le 25 février
1997 [10], il a été jugé «que le médecin est tenu d’une
obligation particulière d’information vis-à-vis de son
patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté
cette obligation».
Cet arrêt a fait, à juste titre, beaucoup de bruit. Il
opère en effet un revirement de la jurisprudence. Par
un important arrêt, du 29 mai 1951 [11], la Cour de
cassation avait jugé que c’était au patient qu’il
incombait de rapporter la preuve que le chirurg i e n
avait manqué à son obligation contractuelle d’obtenir
au préalable son assentiment - lequel suppose bien
entendu que l’information ait été donnée. Cette juris-
prudence a été suivie pendant près d’un demi-siècle
[12], malgré les réserves qu’elle avait, dès l’origine,
suscitées. Par rapport à elle, l’arrêt du 25 février 1997
opère une inversion de la charge de la preuve.
Désormais, c’est au praticien, lorsque ce point est
contesté, de prouver qu’il a bien informé le client.
Selon l’article 1315 du Code civil, «celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver». Se fon-
dant sur ce texte, la 1ère Chambre civile en a déduit,
non sans une logique certaine, que «celui qui est léga-
lement ou contractuellement tenu d’une obligation
particulière d’information doit rapporter la preuve de
l’exécution de cette obligation».
A la suite de cet arrêt, une opinion doctrinale [13] a été
avancée, qui voudrait que, par une nouvelle évolution
de la jurisprudence, la charge de la preuve incombât
aux deux parties, le juge se faisant une opinion au vu
des éléments apportés par chacune d’elles. Mais je ne
pense pas, pour ma part, qu’il faille s’attendre à un
autre changement. La règle selon laquelle la charge de
la preuve de l’information incombe au praticien me
semble au contraire solidement assise, non seulement
parce qu’elle est parfaitement fondée en droit, mais
aussi parce qu’elle répond à la tendance générale, déjà
évoquée, à apprécier les obligations qui pèsent sur les
professionnels avec une plus grande rigueur. On doit
au surplus avoir la franchise de dire que le système
antérieur avait pour résultat de rendre très difficile
l’action des victimes : il leur fallait en effet établir une
preuve négative de l’absence d’information par leur
médecin; or, une preuve négative est le plus souvent
impossible.
Mais reste alors à déterminer la nature des précautions
que doit prendre le praticien pour pouvoir, le moment
venu, en cas de litige, prouver qu’il avait, au moment
voulu, satisfait à son devoir d’information. Le sujet
relève pour une large part des instances profession-
nelles, et je crois savoir que toutes les autorités de la
profession médicale, l’Ordre des médecins en tête, y
réfléchissent. Pour m’en tenir à l’aspect purement juri-
dique, je ferai deux remarques :
- la p r e m i è r e est inspirée par l’arrêt précité du 14
octobre 1997. Il résulte en effet de cette décision que
«la preuve de (l’)information peut être faite par tous
moyens». Il s’agissait en l’espèce d’une femme qui,
ne parvenant pas à avoir un deuxième enfant, s’était
vu proposer une coelioscopie destinée à rechercher si
elle ne présentait pas une étiologie ovarienne expli-
quant sa stérilité. Au cours de l’intervention, est sur-
venue une embolie gazeuse mortelle par migration du
gaz d’insufflation dans les vaisseaux cérébraux. Le
mari et l’enfant ont été déboutés de leur action enga-
gée pour un défaut d’information sur le risque encou-
ru. La Cour de cassation, pour rejeter le pourvoi
formé contre l’arrêt d’appel qui avait refusé de faire
droit à la demande, a jugé que la cour d’appel, avait
souverainement «constaté qu’il résultait des pièces
produites que (la victime), qui exerçait la profession
de laborantine titulaire dans le centre hospitalier où
avait lieu la coelioscopie, avait eu divers entretiens
avec son médecin, pris sa décision après un temps de
réflexion très long et manifesté de l’hésitation et de
l’anxiété avant l'opération». Ainsi, a considéré la
Cour de cassation, y avait-il là un ensemble de pré-
somptions au sens de l’article 1353 du Code civil, qui
démontrait que la gynécologue avait informé sa
p a t i e n t e .
Que, en l’occurrence, la preuve de l’information ait été
considérée comme ayant été suffisamment rapportée,
relève d’une appréciation subjective, et, sur ce point,
l’arrêt n’a pas fait l’unanimité [l4]. Qu’il ait été admis
que la preuve pouvait être faite par tous moyens, est en
revanche à l’abri de toute critique : la solution est juri-
diquement impeccable, puisque, en droit français, la
preuve d'un fait - en l'occurrence le fait de l'information
- est libre.
Mais, et c'est ma seconde remarque, malgré cet arrêt,
je suis personnellement convaincu que la prudence
voudrait que le praticien fasse signer par son patient un
document établissant qu'il était pleinement informé, ce
qui suppose donc de lui fournir des indications pré-
cises. Certes, la relation médecin-client y perd-elle une
partie du climat de confiance qui doit naturellement
exister entre eux, non pas dans un sens, mais dans les
deux sens. La tranquillité des médecins me semble
cependant être à ce prix. J'ajouterai d'ailleurs que le
recours aux présomptions semble s'expliquer, au moins
en partie, par 1'idée que, jusqu'à l'arrêt de 1997, les
médecins n'avaient pas les mêmes raisons de se pré-
constituer une preuve : or, la jurisprudence aura, pen-
dant des années, à connaître d'accidents antérieurs à
cette époque. Mais, au fil des temps, sinon le principe,
du moins l'appréciation des preuves non écrites, risque
de se durcir.
489
Y. Chartier, Progrès en Urologie (1998), 8, 487-491

UN DEVOIR D’INFORMATION :
A LA CHARGE DE QUI?
La question peut surprendre : le devoir d'information
du médecin lui est en effet personnel. Elle s'explique
cependant par la fait que, dès lors qu'il s'agit de
choses sérieuses, le médecin est rarement un homme
s e u l .
Elle est très largement réglée par l'article 64 du Code de
déontologie médicale. Celui-ci énonce en effet que
"lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou
au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuelle-
ment informés; chacun des praticiens assume ses res-
ponsabilités personnelles et veille à l'information du
malade". Le devoir d'information prend donc ici une
plus ample dimension, puisqu'il doit s'exercer non seu-
lement envers le patient, mais aussi envers les confrères
qui ont à lui prodiguer des soins.
La jurisprudence s'est toujours prononcée dans le même
sens. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle eu à connaître
du cas d'un enfant atteint d'une paraplégie à la suite
d'une aortographie exécutée par un radiologiste confor-
mément à la prescription du médecin de l'enfant. Par un
arrêt du 29 mai 1984 [15], elle a approuvé la cour d'ap-
pel d'avoir jugé que "le radiologue... n'était pas tenu par
les prescriptions de son confrère, qu'il disposait, de par
sa qualité et ses fonctions, d'un droit de contrôle sur la
prescription et avait également l'obligation d'éclairer les
parents du malade sur les risques de l'intervention qu'il
devait pratiquer". En l'occurrence, les deux médecins
ont ainsi été jugés responsables, et condamnés solidai-
rement. L'arrêt du 14 octobre 1997 énonce de son côté
que "le devoir d'information pèse aussi bien sur le
médecin prescripteur que sur celui qui réalise la pres-
cription".
L'information donnée par chaque intervenant doit-elle
être identique? Sans doute faut-il tenir compte de ce
qu'il incombe à chacun, en fonction de sa compétence
propre, de donner l'information qu'il est en mesure de
fournir. Ce qui veut dire que, pour une opération, il y
aura au moins deux informations distinctes: celle qui
est inhérente au risque opératoire, et celle qui tient à
l'anesthésie. Mais on peut aussi concevoir que la même
information soit à la charge de deux personnes diffé-
rentes : c’est le cas, comme on vient de le voir, de
l’examen qui est ordonné par l’un et exécuté par
l’autre. Et il est, me semble-t-il, difficile de considérer
que le chirurgien puisse ignorer les risques inhérents à
l’anesthésie.
On retrouve ici encore, la principale difficulté du
sujet : édicter des règles générales dans une matière qui,
au-delà du droit et de la médecine, relève des sciences
humaines, et d’abord de la psychologie.
REFERENCES
1. Cass., 1ère civ., Bull. civ., I, n 99, p. 65.
2. D, 1936, 1, 88, concl. Matter.
3. M. Fabre-Magnan, L'obligation d'information dans les contrats.G.D.J.,
1 9 7 2 .
4. Bull. civ., I, n 132, p. 88. V. aussi, pour un notaire : Cass., 1ère civ.,
25 juin 1991, Bull. civ., I, n 212, p. 139.
5. Cass. Reg., 28 janv. 1942, DC, 1942, p. 63.
6. JCP, éd. G., I, 22942, rapport Sargos.
7. Bull. civ., II, n° 86, p. 48.
8. Cass., 1ère civ., 22 sept. 1981, Bull. civ., I, n° 268, p. 223.
9. Bull. Civ., I, n° 19, p. 14.
10. Cass., 1ère civ., Bull. civ., I, n 75, p. 49; RTD civ., 1997, p. 434, n.
P. Jourdain.
11. Cass. civ., sect. civ., D, 1952, p. 53, n. R. Savatier; JCP, 1951, II,
6421, n. R. Perrot; RTD civ., 1951, p. 508, obs. H. et L. Mazeaud.
12. V. encore Cass., 1ère civ., 4 avr. 1995, Bull. civ., I, n 154, p. 114.
13. G. Viney, JCP, 1997, I, 4068, n° 10.
14. V. obs. G. Viney, préc. L'auteur écrit que "à vrai dire, on peut s'éton-
ner que des preuves aussi légères aient eté jugées déterminantes...".
15. Bull. civ., I, n 178, p. 151.
Commentaire de B. Glorion, Président du Conseil National
de l’Ordre des Médecins
La notion d’information envers nos malades a évolué en fonc-
tion de deux facteurs essentiels : le progrès scientifique et l’évo -
lution des mentalités au sein de notre société. Le progrès scien-
tifique a modifié profondément la relation du médecin avec son
malade. Avant la révolution thérapeutique, le médecin avait peu
de choses à dire, la révélation d’un diagnostic bien souvent
incertain, un programme thérapeutique limité par des connais-
sances qui correspondaient aux «données actuelles de la scien -
ce». Le dialogue se limitait souvent à de bonnes paroles plus
empreintes de compassion que d’information. La confiance et le
respect pour le médecin ne laissaient que peu de place aux
reproches et aux réclamations.
Le médecin, détenteur du savoir et conscient de son pouvoir,
considérait facilement que son patient n’était pas en mesure de
recevoir une information et il n’attribuait pas une grande impor-
tance à son consentement. Cette époque que l’on a volontiers
appelée celle du pouvoir médical est révolue. Beaucoup de
médecins n’ont pas perçu ce changement radical des mentalités
et n’ont pas compris cette émergence des reproches et des pro-
cès. Ce devoir d’information n’apparaissait pas comme une
nécessité, et celle-ci restait fragmentaire, rapide, parfois inexpli-
quée.
Conscient de cette obligation et des conditions de sa réalisation,
l’Ordre des Médecins a introduit dans la dernière version du
Code de Déontologie, des précisions et des affirmations qui sont
un des fondements essentiels de la relation médecin/patient.
Cette obligation déontologique, trop souvent méconnue, est
reprise abondamment dans les arrêts de la Cour de Cassation qu
en soulignent avec précision les modalités et l’importance.
Il n’est donc pas douteux que le renversement de la charge de la
490
Y. Chartier, Progrès en Urologie (1998), 8, 487-491

preuve de cette information est non seulement une modalité juri-
dique relevant du Code Civil, mais aussi une façon de rappeler
qu’elle est intégrée dans la réalisation complète de l’acte médi-
cal.
Il importe alors, pour nous médecins, non seulement de réaliser
cette information nécessaire au consentement du patient, mais
aussi d’en apporter la preuve.
Bien que la relation du médecin avec son patient soit d’ordre
contractuel, il a toujours été admis que ce contrat est un contrat
tacite qui impose des engagements qui relèvent pour le médecin
de sa responsabilité.
Pour apporter la preuve de cette information, il n’est possible de
justifier de cette démarche que devant témoin, par présomption
ou par un document écrit. Certes, en terme de droit, la troisième
modalité est celle qui a reçu l’aval de la plupart des juristes car la
plus simple, la moins contestable et la plus valable.
Cette démarche, qui se conçoit dans la plupart des relations
contractuelles entre un prestataire de service et un usager, intro-
duit dans cette relation avec le patient une dimension formelle
contraire à la conception humaine, intuitive, très personnalisée
qui consacre la rencontre librement consentie du patient qui choi-
sit son médecin.
C’est la raison pour laquelle il nous semble que pour conserver
une dimension humaniste à cette relation, il faut insister pour
qu’elle soit basée, avant tout, sur la confiance.
Une information bien faite, réalisée dans des conditions parfaite-
ment identifiables où l’un et l’autre se souvienne du jour du lieu;
une information répétée, commentée, ne s’oublie pas et fait par-
tie de ce moment important pour le patient où lui sont fournis
tous les éléments de la décision qu’il devra prendre avec son
médecin.
Ce contrat de confiance ne sera renforcé et plus solide que par le
simple échange, au bas d’un document écrit, d’une signature
attestant qu’une information a été donnée.
Quant à son contenu, il doit répondre aux critères formulés dans
le Code de Déontologie : information «loyale, claire et appror -
piée à l’état du patient».
Toute tentative d’information exhuastive est vaine et la démarche
prescrite dans les arrêts de la Cour de Cassation ne concerne pas
l’exhaustivité mais plutôt le caractère grave et exceptionnel.
Ceci est un argument de plus pour que cette information soit
nuancée, mais surtout loyale et sincère, suffisante pour que le
patient, qui est en état de le faire, puisse formuler, en toute
connaissance de cause, son consentement. Dans l’état actuel de
la réflexion et compte tenu des jugements formulés par la Cour
de Cassation, on ne peut s’opposer à la rédaction d’un document
écrit, mais il ne faut pas se dissimuler que la pratique médicale
s’oriente alors vers un formalisme excessif et surtout contraire à
la qualité de la relation humaine qui est l’essence même de notre
profession. C’est la raison pour laquelle nous restons très réser-
vés sur le développement de cette modalité nouvelle.
Commentaire de A. Haertig, Service d’Urologie, Hôpital de
la Pitié, Paris, France.
Cet article écrit par un éminent Professeur de Droit et Haut
Conseiller à la Cour de Cassation, rappelle de façon claire et
concise les quatre devoirs d’information qui s’imposent désor-
mais aux médecins comme ils s’imposaient déjà aux experts-
comptables, géomètres, garagistes...
En effet, si le code de déontologie exprimait ce devoir d’infor-
mation, la haute juridiction, assimilant le médecin à un presta-
taire de service et le patient à un consommateur, reconnait ce
devoir d’information comme étant de nature particulière, lié au
caractère même de la maladie.
Si ce devoir est maintenant connu du corps médical, l’auteur pré-
cise comment, pour les magistrats, cette information doit être
comprise dans l’administration de la preuve.
L’auteur recommande la signature par le patient d’un document
établissant qu’il est pleinement informé, mais là encore magistrat
ou avocat se garde bien de traiter du contenu de cette information:
quelle est la hiérarchie des complications à donner au patient?
____________________
SUMMARY
Patient information and medical responsibility.
The duty of every physician to inform his patient, the failure of
which can engage his responsibility, can be essentially conside -
red from the following four angles :
- a duty to inform : why?
- a duty to inform : what duty?
- a duty to inform : how?
- a duty to inform : for whom?
Key-words : Information, medical responsibility, professional
ethics, medical risk.
491
Y. Chartier, Progrès en Urologie (1998), 8, 487-491
____________________
1
/
5
100%