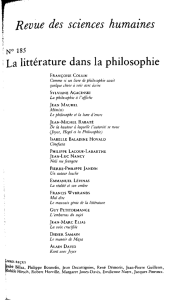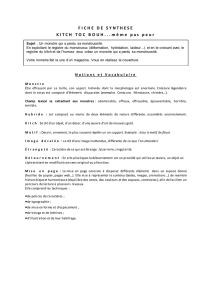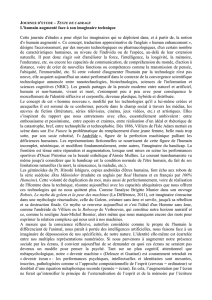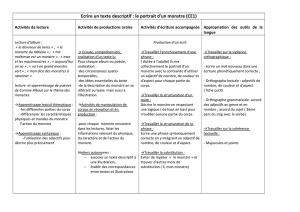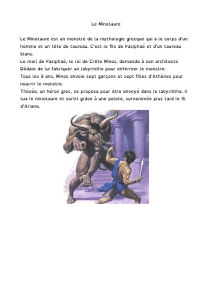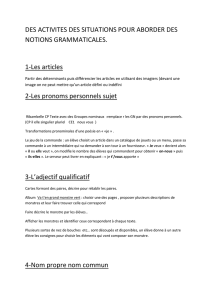La princesse, le monstre, le héros

REFLEXION CLINIQUE / CLINICAL REFLECTIONS
La princesse, le monstre, le héros
The princess, the monster and the hero
D. Gros
Reçu le 6 janvier 2011 ; accepté le 24 janvier 2011
© Springer-Verlag France 2011
Résumé L’homme symbolise comme il respire. Il crée des
images qui l’aident à saisir la vérité. Son imaginaire est un
outil perceptif, tout comme les sens ou les émotions. Cet
imaginaire est structuré et rationnel, cohérent, même s’il
s’exprime par des voies détournées et parfois obscures.
Il se nourrit du réel. Le cancer n’échappe pas à cette règle
de la symbolisation. Il induit dans la collectivité des images,
des mythes, un langage. Classé dans la rubrique des repré-
sentations sociales, cet imaginaire du cancer est le plus sou-
vent déclaré archaïque et accusé de favoriser le tabou attaché
à la maladie. Pourtant, il prend racine dans les réalités de la
maladie elle-même. L’imaginaire n’est pas une chose
mentale irrationnelle. Concernant le cancer, il n’y a pas,
d’un côté, fantasmes, irrationnel, représentations sociales,
ignorance et, de l’autre, raison, savoir, vérité. La frontière
est poreuse. Science et imaginaire collectif expriment l’un
et l’autre les vérités de la maladie, mais usent de langages
différents. La connaissance du langage de cet imaginaire du
cancer est utile autant aux médecins qu’aux infirmières
ou aux psychologues impliqués dans les équipes de cancéro-
logie. Elle permet de mieux comprendre le sujet malade, de
mieux dialoguer avec lui, de mieux l’accompagner dans sa
traversée du cancer. Ajoutons que tout soignant lui-même
véhicule un imaginaire du cancer construit à partir de son
histoire, sa culture, son parcours, sa pratique quotidienne.
Il n’est pas inutile qu’il en soit conscient. Pour citer cette
revue : Psycho-Oncol. □□ (□□□□).
Mots clés Cancer · Sein · Imaginaire · Monstre
Abstract Man employs symbols as readily as he breathes.
He creates images which help him to grasp the truth. His
imagination is as much a tool of perception as are his senses
and his emotions. It is structured and rational; it remains
coherent even as it expresses itself in sometimes obscure
and roundabout ways. It feeds on reality. Cancer is not
immune from this practice of symbolisation. It gives rise to
collective images, myths and a language. This imaginary
construct of cancer is classed as a collective representation
and is often said to be archaic and accused of encouraging
the taboos which are associated with the disease. However, it
is rooted in the reality of the illness itself. What is imagined
is not an irrational creation of the mind. With cancer we do
not have fantasies, irrationality, collective consciousness and
ignorance on one side, and reason, knowledge and truth on
the other. The boundaries are porous. Science and the collec-
tive imagination each express truths about the disease, but
they employ different languages to do so. An understanding
of this language of the imagination in relation to cancer is
equally useful to the doctors, the nurses and the psycholo-
gists of the cancer medicine team. It helps us to understand
the patient and communicate with him better and it makes it
easier to be close to him in his pathway through the disease.
We should recall that every carer also possesses an imagi-
nary world of cancer built up from his own history, culture,
experience in life and daily practice. It behoves him to
be conscious of it. To cite this journal: Psycho-Oncol.
□□ (□□□□).
Keywords Cancer · Breast · Imaginaire · Monster
« Pierre de Craon. –J’ai reconnu à mon flanc le mal
affreux.
Violaine. –Le mal, dites-vous ? Quel mal ? […]
Pierre de Craon. –Il est de nature telle que celui qui
l’a conçu dans toute sa malice doit être mis à part
aussitôt…»
Paul Claudel, L’annonce faite à Marie
D. Gros (*)
e-mail : [email protected]
Ce texte a été écrit en prolongement de la conférence donnée par
l’auteur à l’Unesco, le 16 décembre 2010, à l’occasion du congrès
de l’association Paroles d’enfants (www.parole.be), Fantômes,
monstres et autres passagers clandestins.
Psycho-Oncol.
DOI 10.1007/s11839-011-0312-8

« T1 N+ (4/15) SBRM 3/5 Rec–HER2+ M0 »
À chaque fois que je regarde une œuvre du Caravage, je suis
saisi par l’aspect des personnages. On dirait qu’ils sont sta-
tufiés, figés pour l’éternité. Pourtant, leurs visages expriment
une vie et des émotions aussi intenses que diverses. Ainsi en
est-il de l’Arrestation du Christ, à la National Gallery de
Dublin. Un groupe d’hommes serrés, enchevêtrés, se noie
dans un mélange de lumière et de noirceur. Toute la vérité
du moment de cette arrestation éclate : cri d’épouvante d’un
disciple qui fuit, cupidité et veulerie de Judas, joie sadique
du soldat romain, angoisse désespérée de Jésus. Sur la droite,
comme à l’écart et en dehors du drame qui se noue, se tient
un autre personnage. Une lanterne à la main, il éclaire la
scène. Le visage de cet homme silencieux et attentif a les
traits du Caravage lui-même. C’est l’artiste : il prend du
recul, il se situe en dehors du drame qui se noue. Il ne juge
pas, il ne se prononce pas. Il donne à voir et peut-être à
comprendre le Mal, le Mensonge, la Souffrance, la Peur.
Il incarne le Neutre.
Neutralité ? Songeant à mon métier, je m’interroge. Un
médecin peut-il être neutre ? Face à une femme affectée
d’un cancer du sein, est-ce que j’observe son drame avec
neutralité ? Je veux dire, sans prendre parti, sans juger.
Devant ses larmes, sa révolte ou son angoisse, suis-je affran-
chi de tout jugement moral ? Dépouillé de mon affectivité,
délivré de mes monstres intérieurs ? Je sais bien que non. Je
vois son cancer à travers le prisme de mon inconscient, de
mon surmoi, de mon ça —comme aurait dit Groddeck. Tout
scientifique que je suis, mon regard sur sa maladie porte
l’empreinte de ce que je suis. Il fleure ma propre histoire, il
réfléchit ma conception de la vie. Les mots que je choisis
pour lui annoncer son cancer disent des choses de moi. Ma
façon d’écouter ou de toucher cette femme traduit mon
rapport au féminin, au sein, au cancer. Rien de neutre dans
tout ça.
Ma subjectivité me colle à la peau, c’est évident. Pourtant,
naïvement ou orgueilleusement, je me crois protégé contre
son parasitage par mon statut de médecin. J’ai ma blouse
blanche, mon bureau, mon air docte, mon jargon, mon auto-
rité. Et surtout, j’ai mes précieux outils : microscope, image-
rie, biologie, immunologie…Grâce à eux, je peux définir le
mal cancéreux. Sans ces moyens, en effet, pas de savoir
médical, pas de traitement, pas de guérison, pas de progrès.
Ils me garantissent la vérité. Ils conditionnent la rigueur
scientifique, cette composante de l’éthique médicale.
Voici peu, j’ai revu Jocelyne. « J’ai presque eu envie
de vous consoler », m’a-t-elle dit en se remémorant ce
difficile moment où, assise devant moi, elle attendait mes
paroles —mon verdict. En réalité, avant même que je ne
parle, Jocelyne avait deviné, elle savait, elle se l’était déjà
annoncé à elle-même. Qu’est-ce que ça pouvait être d’autre ?
Cette tache blanche étoilée sur la mammographie, la ponc-
tion, la gêne de la technicienne…Et surtout, mon air embar-
rassé. Le diagnostic de cancer était inscrit sur ma figure et
Jocelyne savait lire.
Fort de tous mes outils médicaux, j’avais fait mon travail
de médecin, j’avais détecté son cancer. Mieux, je l’avais
identifié : T1 N+ (4/15) SBRM 3/5 Rec–HER2+ M0.
Avec cette formule, le cancer était classé, mesuré, catalogué,
contrôlé. Pour le saisir scientifiquement, j’en avais fait un
élément indépendant de la malade, désincarné, abstrait :
une maladie. C’est ainsi que nous procédons, nous autres
médecins. Du coup, préoccupé par l’objet cancer, j’en
oubliais le sujet Jocelyne. C’était ça la déshumanisation,
quand on regardait le malade comme une maladie. J’avais
enlevé à cette femme ce qui faisait qu’elle était Jocelyne.
À mon insu, un glissement sémantique s’était opéré. Joce-
lyne n’avait pas un cancer, elle était un cancer. J’en faisais le
membre d’une équation : « Jocelyne = T1 N+ (4/15) SBRM
3/5…».
Toute la difficulté de l’acte médical était là, depuis tou-
jours et pour toujours : traiter le malade comme un objet de
science et le regarder comme un sujet de soin. D’un côté,
l’observer froidement, calmement, objectivement ; de
l’autre, le saisir comme être libre, pensant, agissant, vivant.
Deux démarches mentalement contraires, opposées structu-
rellement, qu’il fallait pourtant faire vivre ensemble et se
côtoyer en permanence, sous peine de soigner un objet,
une chose, une maladie et non une personne.
Une manière de voir
Lors de nos premiers entretiens, Jocelyne s’était d’emblée
informée : « Quel est le stade de mon cancer ? », « Vous
n’allez pas me retirer le sein », « Y aura-il une chimio-
thérapie ? », « Quelles sont mes chances de guérison »…
Tout ce savoir rationnel, elle l’avait partagé avec moi, et
moi avec elle. Pourtant, à travers ses réactions et ses propos,
j’avais bien remarqué que sa définition du cancer n’avait rien
à voir avec la mienne.
Jocelyne et moi, nous avions chacun notre manière de
voir le cancer. Méconnaître cette réalité risquait d’induire
des incompréhensions, des malentendus, voire des conflits.
L’une et l’autre approche étaient justes, mais reflétaient des
différences de sens donnés à la maladie et des perceptions
distinctes. Ce n’était pas une affaire de savoir, savant et
scientifique d’un côté et profane ou populaire de l’autre.
D’ailleurs, je n’aime pas cette distinction trop souvent faite
qui place le médecin dans la lumière et rejette le malade dans
l’obscurité. Entre voir un cancer et avoir un cancer, qui
observe le mieux la maladie ? Avoir donne du savoir. La
légitimité est des deux côtés, même si les mots utilisés
pour en parler ne sont pas les mêmes.
2 Psycho-Oncol.

Pour Jocelyne, son cancer était d’abord un événement
existentiel, soudain, violent, injuste. Il était tout sauf une
abstraction. Il existait. Il s’incarnait dans son intimité bio-
logique. Cette grosseur qu’elle avait palpée dans son sein
et qu’elle n’osait plus toucher, c’était lui. Il vivait avec elle
et en elle. Tantôt, son cancer lui apparaissait comme un
clone, une espèce de figure du même. Il venait de ses propres
cellules. Il était né d’elle, elle l’avait porté. Le destin l’avait
engrossée d’une grossesse diabolique. Tantôt, ce cancer était
une figure de l’autre —distinct, autonome, libre de se dépla-
cer dans son corps. Un alien, cette horrible « chose vivante,
dans une autre chose vivante ».
D’emblée, elle avait personnifié son cancer. Elle lui avait
donné une origine, une histoire, une figure. Et même, un
nom. Elle ne disait pas cancer, mais l’appelait l’Ennemi.
Tout comme d’autres le baptisaient ça,pas de chance,saleté
ou bien Marcel,lepetit teigneux,Jack le squatter…C’était
aussi une façon de rendre sa peur supportable que de donner
un visage à son mal. Par moments, Jocelyne remerciait son
cancer —secrètement, car les autres n’auraient pas compris
cette folie. Là, ce n’était plus l’ennemi, celui qui épuise et
brise, mais l’allié, celui qui rend fort « Le cancer m’envoie
des messages. Il me dit de changer ma vie ».
Toutes ces images et ces symboles étaient pour Jocelyne
autant de vrais visages de sa maladie. Quand je prononçais
les mots tumeur,ganglion ou métastase, elle entendait souf-
france,solitude ou mort.Quoi de plus rationnel que cette
réaction, quoi de plus logique ? Par définition, un cancer
est susceptible de faire souffrir, d’induire le sentiment
d’abandon ou même de faire mourir. Quand elle lisait sur
son dossier médical envahissant,prolifération ou évolutif,
elle sentait une force inconnue la déposséder de son corps.
Par une sorte de contagion magique, elle prenait les attributs
du cancer : laideur, mal, mort. Une peau prématurément
flétrie, un sein en moins, un vagin tout sec…Et des ovaires
devenus stériles. Castrée, osaient dire tous ces médecins
mâles qui se croyaient virils ! Même leurs collègues fémi-
nins usaient de cette expression, c’était à désespérer. Son
miroir lui renvoyait l’image d’une autre. Elle ne se sentait
plus ni une femme ni une mère ni une épouse. Jocelyne était
devenue une cancéreuse.
D’autres femmes vivaient leur cancer du sein très diffé-
remment, moins douloureusement, plus paisiblement. Joce-
lyne le savait, mais qu’importe ! Pour elle, c’était ça. « Plutôt
que de répéter qu’il n’y avait pas un cancer, mais des cancers
tous différents, se disait-elle, les médecins feraient bien de ne
pas oublier qu’il n’y avait pas une cancéreuse, mais des
cancéreuses. Toutes différentes ».
Imaginaire du cancer
Depuis qu’elle était malade, Jocelyne avait plusieurs fois fait
le même mauvais rêve. La nuit, elle se réveillait en sueur,
terrifiée. Une espèce de monstre l’étouffait en la serrant
dans ses tentacules. Il ne fallait pas être grand clerc pour
comprendre le rapport avec sa maladie. À cette occasion,
elle s’était rappelé cette fameuse gravure de Goya intitulée :
« Le sommeil de la raison engendre des monstres ». On y
voit un homme affalé et endormi, survolé par des créatures
inquiétantes. Lui étaient aussi revenues en mémoire des
histoires qu’elle avait lues, enfant. Notamment, Hercule et
l’hydre de Lerne. Il y était question d’un affreux animal doté
de sept têtes qui repoussaient aussitôt qu’on les coupait.
Armé d’un tison enflammé, Hercule avait cautérisé les
cous à mesure qu’il les coupait, empêchant ainsi toute
repousse —toute récidive. Pendant qu’il combattait, un
crabe géant l’avait pincé au pied, mais Hercule avait écrasé
l’animal du talon. Transformé en constellation par les dieux,
ce crabe était devenu l’un des 12 signes du Zodiaque, sous le
nom de Cancer.
Le crabe ? Jusque-là, Jocelyne avait cru comme beaucoup
d’autres que cette association entre l’animal marin et le
cancer était de l’ordre de l’imaginaire, une histoire mytho-
logique, une chose mentale, sans trop de rapport avec la
réalité. D’ailleurs, elle pensait qu’il fallait démystifier le
cancer et en finir avec le tabou. Maintenant qu’elle était
malade, elle comprenait que derrière la mythologie ou les
contes et légendes, il y avait le réel de la vie.
Dans toutes les langues indo-européennes, il en était
ainsi : krebs,Cancro,rak…signifiaient à la fois crabe et
cancer. En arabe aussi : saratan. En tahitien ou en basque,
idem. Pourquoi tant de peuples du monde ont-ils choisi
d’associer cet animal à cette maladie ? Finalement, la réponse
était simple, évidente : crabe et cancer, c’est pareil. L’un et
l’autre surgissent inopinément, sans prévenir. Ils vous attra-
pent et ne vous lâchent pas facilement. De leur corps, s’éten-
dent des prolongements, des pattes, faites pour saisir et qui
peuvent repousser, même coupées. L’un et l’autre grignotent
les chairs. Ils savent demeurer immobiles, marcher de
travers, avancer lentement ou au contraire très vite. C’est
sa parfaite adéquation avec le cancer qui fait le succès et la
pérennité du crabe pour signifier la maladie.
S’étonner de ces images, vouloir les supprimer, c’est
oublier une activité inhérente à l’humain : la symbolisation.
L’homme symbolise comme il respire. Il crée des images qui
l’aident à saisir la vérité. Son imaginaire est un outil percep-
tif, tout comme les sens ou les émotions. Cet imaginaire est
structuré et rationnel, cohérent, même s’il s’exprime par des
voies détournées et un langage parfois obscur. Il se nourrit
du réel. Il est une matière première. Il possède une dyna-
mique propre et autonome. C’est l’imaginaire des hommes
qui crée et façonne la mythologie, non le contraire.
« Vous avez dit imaginaire ? » Dans le monde médical,
parler de l’imaginaire du cancer n’est pas considéré
comme très sérieux. C’est bon pour les sociologues ou les
psychologues en quête de sujets de recherche. À quoi cela
Psycho-Oncol. 3

pourrait-il servir en cancérologie ? C’est non mesurable, donc
non scientifique, donc inutile. D’ailleurs, l’imaginaire, c’est
ce qui n’existe pas. Les représentations sociales attachées à
cette maladie sont déclarées archaïques et indignes du sujet
postmoderne. Elles sont même jugées néfastes, accusées de
favoriser la perpétuation du tabou attaché à cette maladie.
Pourtant, ce n’est pas vouloir humilier la raison que de
reconnaître à l’imaginaire sa puissance, ses exigences et sa
légitimité. C’est tout simplement demeurer clairvoyant. À
vouloir tout rationaliser, on court le risque de compromettre
l’exercice même de la raison en ignorant les aspects les plus
obscurs du psychisme. À vouloir éliminer ces représenta-
tions dites archaïques du cancer, on nie aux malades leur
liberté tout autant que les réalités de la maladie cancéreuse.
Pour parler de son cancer, le malade cancéreux use du lan-
gage des mythes et des symboles. Il dit le vrai autrement
qu’avec le langage médical.
Concernant le cancer, il n’y a pas, d’un côté, fantasmes,
irrationnel, représentations sociales, ignorance, et de l’autre,
raison, savoir, vérité. Science et imaginaire collectif expri-
ment l’un et l’autre les vérités de la maladie.
Cancer, figure du monstre
Pour approcher cet imaginaire du cancer, il suffit d’écouter la
parole des malades. Cette parole est devenue aujourd’hui
accessible à tous. Point n’est besoin d’être médecin, socio-
logue, psychologue ou conjoint de malade cancéreux. Pas un
mois ne passe sans que paraissent récits, témoignages,
romans, autobiographies. La plupart de ces textes concernent
le cancer du sein et sont écrits par des femmes. Sans oublier
l’immense production artistique —peinture, dessins, sculp-
ture —créée par des malades du cancer dans le contexte de
l’art thérapie. La science, l’art et l’imaginaire ne sont pas
éloignés les uns des autres.
À cette littérature sur papier s’ajoutent les innombrables
blogs, forums Internet ou romans communautaires, nés avec
la culture numérique. Le Web et les univers virtuels ont par-
ticipé à donner au cancer une plus grande visibilité. Ces
modes d’échanges court-circuitent les médiations verticales
propres au monde médical. Ils créent de l’horizontalité dans
le dialogue et sont porteurs de liberté d’expression. D’où la
richesse du matériau pour quiconque s’intéresse à l’imagi-
naire du cancer.
En voyageant dans cet univers du cancer et à lire entre les
lignes, on découvre une figure familière du monde de la
mythologie : le monstre. Cette thématique sous-jacente et
protéiforme parcourt les témoignages des malades. Au pre-
mier chef, voici Méduse. Quiconque regardait ce monstre
était aussitôt transformé en statue de pierre. Que disent les
femmes de leur rencontre avec le cancer du sein ? Séisme :
« La vie s’arrête », « Tout bascule ». Stupéfaction, torpeur,
paralysie, sidération. Voir le cancer méduse, pétrifie. Com-
bien de fois ai-je observé cette pétrification à l’annonce du
diagnostic ! Au moment où une femme réalise qu’il est là,
que c’est bien lui, tout son corps devient immobile. Son
visage et ses traits se figent, ses yeux sont fixes. On dirait
une statue ; silence, mutisme. Même, la pensée s’interrompt.
Plus rien ne bouge, plus rien ne vit.
Puis, survient le Sphinx et avec lui le temps des énigmes :
« Pourquoi moi ? Qui suis-je ? Qu’ai-je fait ?…». Pour la
plupart, les malades s’inventent une réponse, viscéralement
persuadés de sa justesse. Quelques-uns supportent vaillam-
ment l’ignorance. Quant aux médecins, beaucoup font
semblant de savoir. Quelquefois, je songe à ces deux cancé-
rologues qui se rencontrent. L’un demande : « Finalement, tu
y comprends quelque chose, toi, au cancer ? ». Et l’autre
répond : « Attends, je vais t’expliquer ». Mais le premier
reprend : « Non, non, expliquer ce n’est pas difficile, moi
aussi je suis cancérologue. Non, ce que je te demande,
c’est si tu comprends ? ».
«Qu’est-ce que le cancer ? », me fait penser à la célèbre
interrogation de Saint-Augustin sur le temps au livre XI de
ses Confessions : « Qui saurait en donner avec aisance et
brièveté une définition ? Si personne ne me pose la question,
je le sais ; si quelqu’un me demande et que je veuille
expliquer, je ne sais plus ». Comme le Sphinx, le cancer
symbolise le mystère. Sur la route de Thèbes, ce monstre
interrogeait les voyageurs. « Qu’est-ce que l’homme ? », leur
demandait-il et devant l’absence de réponse, il les dévorait.
En résolvant l’énigme, Œdipe offre la seule réponse qui peut
libérer la ville du mal qui la ronge. Comme le Sphinx, le
cancer pose à l’homme l’interrogation métaphysique par
excellence, il le questionne sur le sens de la vie et lui révèle
qu’il est dans l’ignorance de son identité profonde.
Malignité ?C’est un autre nom du cancer. Malin jusqu’à
l’hypocrisie, la fourberie, la perfidie. Le cancer n’est-il pas
tout cela, lui qui ne cesse de mentir et tromper ? Il sait pren-
dre le visage du bénin. Il sait se rendre impalpable dans un
sein ou invisible sur une mammographie. Il sait faire croire
que ce n’est pas lui, alors qu’il est déjà là, se déplace, migre,
métastase dans le foie, le poumon, les os ou ailleurs. Chez les
uns, le cancer s’endort, se réveille, se rendort à nouveau, puis
se réveille encore. On le croit vaincu depuis des années, et le
voilà qui réapparaît. Quelquefois, il revient à l’endroit même
où le bistouri du chirurgien l’avait pourtant coupé, enlevé,
extirpé. Chez d’autres, le cancer part définitivement. Il les
quitte pour toujours. Même si beaucoup de femmes guéris-
sent complètement de leur cancer du sein, les médecins
n’osent pas prononcer le mot guérison. De crainte de se
tromper pour un certain nombre, ils préfèrent parler de
rémission à toutes. À tout jamais, même guéri, même sans
cancer, le malade demeure un cancéreux sous le regard
médical et social.
4 Psycho-Oncol.

Tout comme le dragon de la mythologie, le mal cancéreux
incarne les obstacles à franchir pour accéder à un trésor
enfoui au fond d’une grotte obscure. En pénétrant au pays
du cancer, le malade découvre un secret qui vaut plus que de
l’or. Il découvre que la santé est un bienfait des dieux et
qu’elle n’est jamais aussi précieuse que lorsqu’on l’a perdue.
Que richesse ou pouvoir sont des pièges et ne donnent
jamais ce qu’ils promettent. Que la vie a du goût et du sel,
loin des insignifiances, des affrontements et des guerres inu-
tiles. Que l’herbe de longue vie n’existe pas. Le cancéreux
sait désormais ce que le bien-portant ignore, oublie ou ne
veut pas savoir, emporté par la Nef des fous sur le torrent
de ses agitations fébriles et vaines. Son combat contre le
cancer équivaut à un rite initiatique. De son voyage, le can-
céreux revient plus pauvre en espérance, mais plus riche de
lucidité et de sens ; plus fragile physiquement, mais plus fort
moralement. Il revient plus gourmand de vie, car il sait
maintenant qu’il n’est pas immortel. Il est devenu un autre.
Cancer et métamorphose…
Et le mot cancer, quel rapport avec le thème du monstre ?
La plupart des malades n’aiment pas le prononcer. « Je
n’aime pas cancer, je préfère dire tumeur ». Il est Celui que
l’on ne nomme pas ou que l’on appelle autrement. Qui, dans
son enfance, n’a pas eu peur de quelque créature fantastique ?
On ne disait son nom qu’à voix basse de crainte qu’elle
n’entende, se croie appelée et surgisse. D’autres, font un
choix différent : « Moi je dis cancer, puisque j’ai un cancer ».
Ils le nomment à satiété comme pour l’apprivoiser ou lui
faire croire qu’ils ne le craignent pas. Et les médecins ?
Eux disent néo, processus évolutif, mitose, épithélioma…
Sur les dossiers, ils écrivent K.
« Suis-je monstrueuse ? »
Comment dire à autrui : « J’ai un cancer du sein » ? Comment
l’annoncer à mon mari, à mon amie, à ma mère, à mon frère ?
Dans ces moments-là, on aimerait ne pas les faire souffrir. On
aimerait simplement qu’ils nous aiment. On aimerait juste
profiter de leur tendresse et de leur chaleur. On voudrait pou-
voir leur dire la vérité sans provoquer des réactions qui s’ajou-
tent à notre souffrance : larmes rentrées, silences, soupirs,
balbutiements, formules convenues, regards effrayés, pitié…
Pitié ? Quoique socialement synonyme de grandeur
d’âme, ce sentiment n’est finalement qu’un subtil mélange
de mépris, de colère et de peur. Exciter la pitié du bien-
portant, c’est dans la nature du malade du cancer, porteur
d’une horrible maladie. Aucune nouveauté dans cette
affaire. Témoin, le récit d’Ambroise Paré. Intitulé Imposture
d’une belistresse feignant avoir un cancer à la mamelle,il
figure au chapitre 22 de son livre Des monstres et prodiges.
Année 1583, « Un mien frère nommé Jehan Paré, chirur-
gien demeurant à Vitré, ville de Bretagne, vit une grosse et
potelée mendiante demandant l’aumône un dimanche à la
porte d’un temple. Elle feignait (faisait semblant) avoir un
cancer à la mamelle, qui était chose fort hideuse à voir, à
cause d’une grande quantité d’humeur putride qui semblait
en couler sur un linge qu’elle avait devant soi.
Mon frère examina son visage, qui était bien sain, et les
parties autour de son cancer ulcéré lesquelles étaient blan-
ches et de bonne couleur. Quant au reste de son corps, celui-
ci paraissait en bon état. Il jugea en lui-même que cette garce
ne pouvait pas avoir un cancer, étant ainsi grasse et potelée,
persuadé que c’était une imposture. Il la dénonça au magis-
trat, lequel permit à mon frère de la faire mener en son logis
pour connaître plus certainement l’imposture. Celle-ci étant
arrivée, il lui découvrit toute sa poitrine, et trouva qu’elle
avait sous son aisselle une éponge trempée et imbibée de
sang de bête et de lait mêlés ensemble ; par un petit tuyau
de sureau, cette mixtion était conduite par de faux trous de
son cancer ulcéré vers le linge qu’elle avait devant soi.
Par cela, il sut avec certitude que le cancer était artificiel.
Alors, il prit de l’eau chaude, frotta la mamelle et l’ayant
humectée, enleva plusieurs peaux de grenouilles noires,
vertes, et jaunâtres ; celles-ci étaient mises les unes sur les
autres, et collées avec de l’argile, du blanc d’œuf et de la
farine, ce que l’on apprit par sa confession. Ayant tout
enlevé, on trouva le tétin sain et entier, et en aussi bonne
santé que l’autre. Cette imposture découverte, le magistrat
la fit constituer prisonnière.
Interrogée, elle avoua l’imposture. […] Le magistrat
condamna la pute à avoir le fouet et être bannie hors du
pays. Auparavant, elle fut bien étrillée à coups de fouet de
cordes nouées, ainsi qu’on faisait en ce temps-là ».
Année 2010, Hélène a subi une ablation du sein pour
cancer. Même trois ans après, se voir dans un miroir lui
demeure toujours impossible. « Je suis si laide avec cette
horrible cicatrice ! ». Du jour au lendemain, sa vie sexuelle
a été réduite à néant : plus rien. « Dès qu’il a su que j’étais
malade, mon mari ne m’a plus touchée ». Lequel mari l’a
rapidement quittée pour une autre femme affublée de seins
énormes qu’elle ne cesse d’exhiber. Les amis ne se sont pas
beaucoup manifestés depuis son opération ; on dirait qu’ils la
fuient. « L’autre jour, une voisine a tourné les talons en me
voyant arriver ». En revenant au travail dans son entreprise,
Hélène a d’emblée perçu des changements. Ses collègues
ne la regardaient plus comme avant, elles l’évitaient, elles
chuchotaient dans son dos ; chez certaines, elle lisait même
de la pitié dans leurs yeux. Le poste qui lui était destiné avant
sa maladie avait été attribué par son patron à une autre, une
espèce de coquette inexpérimentée et arrogante. Sa banque
lui a refusé l’emprunt qu’elle souhaitait. En sus de tous ces
événements, sa fille de 16 ans est devenue terriblement
agressive et ne cesse de lui reprocher d’être malade. « J’ai
l’impression d’être devenue un monstre. Plus personne ne
m’approche ».
Psycho-Oncol. 5
 6
6
 7
7
1
/
7
100%