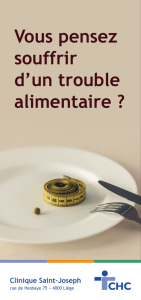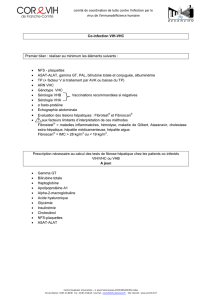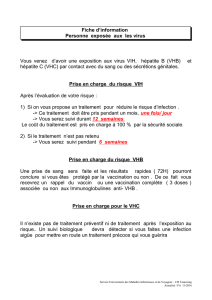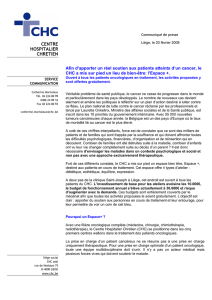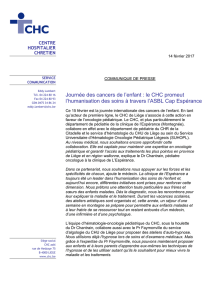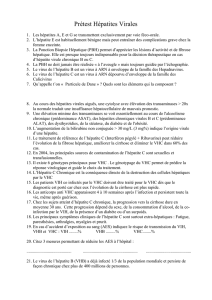Lire l`article complet

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 2 - avril-mai-juin 2013
86
Virus et cancers
dossier thématique
Infections virales et cancer du foie
Viral infections and liver cancer
Victor Virlogeux1, 2, Fabien Zoulim1, 3, Romain Parent1
1. Inserm U1052, Lyon.
2. ENS de Lyon.
3. Service d’hépato-gastro-
entérologie, hôpital de la
Croix-Rousse, Lyon.
RÉSUMÉ
Summary
»
Chaque année sont diagnostiqués 500 000 nouveaux cas
d’hépatocarcinomes dans le monde. C’est le huitième cancer par
ordre de prévalence. Il touche davantage les hommes, avec un âge
moyen de diagnostic autour de 60 ans. Les hépatocarcinomes viro-
induits, les plus fréquents, sont associés aux infections par le virus
de l’hépatite B (VHB), associé ou non au virus de l’hépatite D (VHD),
et par le virus de l’hépatite C (VHC). Les patients infectés par ces
virus sont la plupart du temps asymptomatiques, bien que ceux-ci
induisent, au niveau hépatique, inflammation et stress oxydatif,
favorisant ainsi la progression de la fibrose. Ils entraînent également,
par des mécanismes plus directs, de la mutagenèse insertionnelle
ainsi que la transactivation de gènes contrôlant le cycle cellulaire
dans le cas du VHB, de l’insulinorésistance et de la stéatose dans
le cas du VHC et, point important, de la prolifération cellulaire du
fait du renouvellement parenchymal sous pression immunitaire
cytotoxique chronique. Tous ces facteurs favorisent la tumorigenèse.
Le diagnostic précoce de l’hépatocarcinome reste difficile à
mettre en place au niveau clinique, même si des combinaisons
de biomarqueurs sériques de cette maladie sont en voie de
développement. Les enjeux thérapeutiques actuels concernent
les traitements à visée curative (hadronthérapie et traitements
anti-angiogéniques) ainsi que la médecine personnalisée grâce
au développement plus abouti d’une classification moléculaire
des tumeurs hépatiques.
Mots-clés : Carcinome hépatocellulaire − Hépatite B – Hépatite C −
Inflammation − Oncogenèse virale.
Each year, 500,000 new cases of hepatocellular carcinoma
are diagnosed worldwide. It is the eighth most common
cancer. Men are more particularly afflicted by this disease,
with a mean age at diagnosis of around 60. Most frequently,
hepatocellular carcinomas are associated with, on the
one hand, the hepatitis B virus (HBV) within or without a
co-infection setting with the hepatitis delta virus (HDV) and,
on the second hand, with hepatitis C virus (HCV) infection.
Patients infected by one of these viruses are for the major
part asymptomatic, although they display intrahepatic
inflammation and oxidative stress leading to fibrosis.
Moreover, these viruses enhance carcinogenesis susceptibility
through direct mechanisms such as insertional mutagenesis
and gene transactivation, which in turn modulate cell cycle
progression for HBV, insulino-resistance and steatosis for HCV,
and cell proliferation for both viruses, because of the necessary
hepatocytic compensation of immune-mediated infected
cells’ death. Although combinations of serum biomarkers
for early liver cancer diagnosis are being progressively
identified, clinical implementation is currently challenging.
Hence, current therapeutic strategies focus also on curative
treatments (hadrontherapy and antiangiogenic therapy)
and on personalized medicine, in particular through the
improvement of tumor classifications.
Keywords : Hepatocellular carcinoma − Hepatitis B − Hepatitis
C − Inflammation − Viral oncogenesis.
L
e carcinome hépatocellulaire (CHC) est, selon le
Centre international de la recherche sur le cancer,
le cinquième cancer en termes de fréquence chez
l’homme dans le monde (523 000 cas/an, soit 7,9 % des
cancers) et le septième chez la femme (226 000 cas/
an, soit 6,5 % des cancers). La plupart des cancers du
foie sont associés à une cirrhose (90 %), qui peut être
induite par une infection chronique due au virus de
l’hépatite B (VHB) ou C (VHC), mais également par
l’alcool ou la stéatose hépatique non alcoolique. Le
CHC est actuellement un problème majeur de santé
publique dans les pays développés et dans les pays où
l’infection au VHB/VHC est endémique. Les stratégies
actuelles de recherche s’orientent principalement vers
une prévention des risques de développement de cette
maladie (vaccin contre le VHB, traitements à visée sup-
pressive pour le VHB ou curative pour le VHC) et vers un
diagnostic plus précoce du CHC, qui est très souvent
décelé tardivement. Les traitements curatifs actuels
(chimiothérapies non spécifiques ou ciblées) ne sont
pas assez efficaces ; des taux de rechutes élevés sont
en effet observés à la fin des traitements.

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 2 - avril-mai-juin 2013
87
Infections virales et cancer du foie
Épidémiologie des cancers associés
auxinfections et des cancers hépatiques
Épidémiologie
Les cancers du foie, une part majeure des 16 % de can-
cers attribués à des agents infectieux, sont présents en
particulier dans les pays en voie de développement, en
Chine et en Europe du Sud (85 %) :
✓
en Afrique subsaharienne et en Asie de l’Est (> 80 %
des CHC dans le monde, avec 20 cas pour 100 000 per-
sonnes) ;
✓
en Europe du Sud (10 à 20 cas pour 100 000 per-
sonnes) ;
✓
en Amérique (Nord et Sud), en Europe du Nord et
en Océanie (< 5 cas pour 100 000 personnes).
L’âge moyen au diagnostic est de 55 à 59 ans en Chine
et de 63 à 65 ans en Europe et en Amérique du Nord.
Les CHC sont plus présents chez les hommes que chez
les femmes (ratio > 3 en général) du fait de facteurs hor-
monaux et d’une plus grande proportion d’infections
chroniques par le VHB/VHC (1).
Origine des cancers du foie
On distingue, parmi les cancers du foie, les cancers
viro-induits et ceux qui ne le sont pas.
✓
Les cancers non viro-induits ont des origines assez
diverses : maladie alcoolique du foie, stéatose hépa-
tique non alcoolique, hémochromatose, déficit en
α1-antitrypsine, hépatite auto-immune, porphyrie ou
maladie de Wilson (2). Ils ne seront pas abordés plus
en détails ici.
✓
Les cancers viro-induits sont liés aux infections par le
VHB, associé ou non avec le virus de l’hépatite D (VHD),
ou par le VHC.
•
Le VHB infecte chroniquement 250 millions de per-
sonnes (5 % de la population mondiale), dont 75 %
d’Asiatiques. Ces personnes présentent un risque de
développer un CHC qui est 5 à 100 fois plus important
que chez des individus sains 15 à 20 ans après l’infection.
Les facteurs qui augmentent le risque de cancer du foie
chez ces individus sont nombreux :
– les facteurs démographiques comme le sexe, l’âge
de l’individu, l’origine ethnique (le cancer du foie est
plus fréquent chez les Asiatiques et les Africains), et les
antécédents familiaux de CHC ;
–
les facteurs viraux, avec le taux élevé de réplication,
le génotype (le génotype C en Asie et le D en Europe
et en Amérique du Nord), la durée d’infection, l’exis-
tence d’une co-infection VHC/VIH/VHD, la présence
d’une cirrhose ;
–
les facteurs environnementaux (aflatoxine, alcool et
tabac) [1]. Les CHC peuvent également se développer
en l’absence de cirrhose dans 30 à 40 % des cas [3].
•
Le VHD est présent chez 15 à 20 millions de per-
sonnes dans le monde. Il est uniquement présent chez
des personnes co-infectées par le VHB (virus satellite) :
l’entrée du VHD dans l’hépatocyte se fait grâce aux
protéines d’enveloppe du VHB. Ce virus favorise forte-
ment l’évolution vers la cirrhose, mais aucune relation
directe n’a été montrée entre l’infection au VHD et une
augmentation du risque de CHC (4-6).
•
Le VHC est présent chez 180 millions de personnes
(soit 5 % de la population mondiale). Le risque de déve-
lopper un CHC chez ces individus est 15 à 20 fois plus
important que chez des individus sains. De nombreux
facteurs augmentent également le risque : le stade de
fibrose hépatique, la virémie élevée, le sexe (le VHC
est plus fréquent chez les hommes), le génotype (plus
fréquent pour le génotype 1b), l’alcool, l’âge, le diabète
et l’obésité (probablement du fait des processus de
lipoperoxydation hépatocytaire).
D’autres facteurs indépendants plus rares peuvent aug-
menter le risque de CHC : le polymorphisme TNFα-308
GG et certains variants de la glutathion S transférase
(GST), GSTM1 et GSTT1, non protecteurs contre le stress
oxydatif endogène (1).
Traitements
Il existe une diversité de traitements palliatifs ou cura-
tifs du CHC. En relation avec la fonction hépatique et
le stade du cancer, de nombreuses recommandations
pour la sélection d’un traitement existent (tableau,
p. 88). Le “Barcelona Clinic Liver Cancer” (BCLC guidelines)
est le plus répandu (7) : il fait intervenir les caractéris-
tiques du patient, le nombre et la taille des nodules, les
symptômes de la maladie, et les fonctions hépatiques
qui sont déterminées grâce au score de Child-Pugh.
Ce score s’appuie sur 5 données cliniques (grade de
l’encéphalopathie, ascite, bilirubinémie et albuminémie,
taux de prothrombine) et permet, le cas échéant, de
définir une cirrhose décompensée.
Historique et caractéristiques générales
du VHB
Historique et caractéristiques structurales
Le VHB a été découvert en 1963 par Baruch Blumberg,
un généticien qui travaillait au Fox Chase Cancer Center
à Philadelphie. Il reçu le prix Nobel de médecine en
1976 (9).
L’hépatite B est un virus à ADN qui fait partie de la
famille des hépadnavirus et comporte 8 génotypes dif-
férents (10). La particule virale est sphérique, composée

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 2 - avril-mai-juin 2013
88
dossier thématique
Virus et cancers
d’une bicouche lipidique associée à 3 glycoprotéines
d’enveloppe, dont l’antigène (Ag) HBs, ainsi que d’un
capside constituée de 240 copies d’une protéine unique
appelée “core”. Le génome est composé d’ADN circu-
laire (3 200 nucléotides environ) double brin. Dans le
sang, il existe 3 types de particules : les particules de
Dane (particules virales complètes et infectieuses) et des
sphères et tubules composés uniquement de l’Ag HBs.
Il existe 4 cadres ouverts de lecture (P, C, S et X), qui
codent pour des protéines virales différentes :
✓
les 3 protéines d’enveloppe HBs de 24 kDa, M de
34 kDa et L de 39 kDa (S) ;
✓la protéine de capside p22c de 22 kDa et une pro-
téine non structurale, HBe, de 17 kDa (C) ;
✓
l’ADN polymérase de 82 kDa (P), qui possède une
activité de transcriptase inverse et RNAseH ;
✓
une protéine transactivatrice oncogénique (X), aux
fonctions longuement débattues (11).
Histoire naturelle du VHB
Évolution de l’infection
Dans 95 % des cas, les infections primaires chez les
adultes sont éliminées. Dans les autres cas, on observe
tout d’abord une phase d’immunotolérance caractérisée
par la présence de l’Ag HBs, de l’Ag HBe et de l’ADN
viral dans le sang. Cette phase représente la période
d’incubation consécutive à une infection aiguë qui
dure de 2 à 4 semaines (les porteurs dits “immuno-
tolérants” sont en général infectés congénitalement,
très virémiques, et n’évoluent que très lentement dans
la maladie). Une phase immunoactive lui succède, avec
une décroissance de l’ADN viral et une augmentation
de la concentration en ALAT représentant ainsi la lyse
des hépatocytes infectés grâce au système immunitaire.
L’Ag HBe peut disparaître du sang spontanément à un
moment donné et, quelques semaines plus tard, des
anticorps anti-HBe apparaissent. Cette séroconversion
HBe reflète l’évolution de la maladie vers l’état de “por-
teur inactif” avirémique (ADN viral qui diminue très
fortement lors de cette période) et vers la guérison
dans seulement 4 à 12 % des cas par an. Toutefois, une
réactivation virale avec une augmentation spontanée
de la quantité d’ADN viral et des ALAT peut apparaître.
Ces épisodes peuvent être multiples et entraînent à
chaque fois des dommages importants favorisant la
fibrose. Certaines personnes éliminent l’Ag HBs spon-
tanément et développent des anticorps anti-HBs, ce qui
caractérise une guérison. Ce phénomène a lieu chez 1 à
2 % des individus par an dans les pays occidentaux. Le
CHC se développe préférentiellement chez les patients
en phase immunoactive au stade de cirrhose, mais peut
aussi survenir chez des immunotolérants et chez des
porteurs inactifs. La cirrhose se développe chez environ
20 % des malades chroniquement infectés (12).
Carcinogenèse
Le VHB présente la particularité de pouvoir s’intégrer
directement dans le génome de l’hôte de façon aléa-
toire, ce qui se traduit par une instabilité du génome
et de probables délétions et transpositions. Cette ins-
tabilité génétique est également favorisée par l’action
de différentes protéines virales, protéine X et protéines
de surface qui vont entraîner une activation de gènes
cellulaires impliqués dans le cycle cellulaire mais aussi
du stress oxydatif et une prolifération cellulaire (méca-
nismes détaillés dans la figure 1) [13].
Le VHB entraîne également une inflammation et une
régénération hépatocytaire liée à la réaction du sys-
tème immunitaire de l’hôte, événement associé à de
nombreux cancers. On observe, en parallèle de cette
réaction immunitaire, l’apparition d’hépatocytes par
expansion clonale résistant à l’infection par le VHB (ils
ne présentent pas d’antigènes viraux). Cette population
d’hépatocytes mutants favorise le risque de développer
un CHC (14).
Tableau. Les différents traitements du CHC.
Stade du CHC Caractéristiques Traitements recommandés
Précoce - Difficiles à déceler
– Maladie asymptomatique,
lésion < 2 cm de diamètre, sans
métastase vasculaire ou distale
– Injection percutanée d’éthanol (taux
de survie de 41 % sur 5ans)
– Résection chirurgicale (taux
de survie de 50 % sur 5 ans)
– Transplantation (taux de survie
de75 % sur 5 ans). Critères d’éligibilité :
le score de MELD (Model for End-Stage
Liver Disease) ainsi que les critères
deMilan
– Ablation par radiofréquence (RFA).
Letaux de rechute sur 5 ans est de 70 %.
Intermédiaire – Cirrhose compensée
asymptomatique
– Pas d’invasion vasculaire, mais
de larges lésions multifocales
– Chimio-embolisation transartérielle
(TACE) [taux de survie sur 2ans de 20
à25 %] : embolisation par billes coatées
à la doxorubicine ou à l’épirubicine (8)
– Radio-embolisation transartérielle
(TARE) : technique qui fait intervenir
des billes sur lesquelles sont fixés des
composés émettant un rayonnement
radio
Avancé – Symptomatique
– Invasion vasculaire
– Chimiothérapie antiangiogénique
parvoie orale : le sorafénib
Terminal – Patient en insuffisance
hépatique
– Vascularisation importante
dela tumeur
– Métastases
– Aucun des traitements cités ici
dufait du faible taux de survie sur 1 an
(moins de 10 %).

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 2 - avril-mai-juin 2013
89
Infections virales et cancer du foie
Le virus de l’hépatite D est présent uniquement chez les
personnes déjà infectées par le VHB. Ce virus enveloppé
à petit ARN circulaire, sans lien phylogénétique clair
avec aucun des virus pathogènes humains, favorise
la progression de la fibrose et l’évolution vers un état
cirrhotique, ce qui augmente indirectement le risque
de développer un CHC (15).
Historique et caractéristiques générales
du VHC
Historique et caractéristiques structurales
Le virus a été identifié en 1989 grâce à des techniques de
clonage moléculaire par l’équipe de Michael Houghton
chez Chiron (16).
Le virus de l’hépatite C (VHC) est un virus à ARN simple
brin de polarité positive enveloppé appartenant à la
famille des Flaviviridae et de 9 600 nucléotides. Il existe
6 génotypes différents. Le génome code pour une poly-
protéine unique, d’environ 3 000 acides aminés. Celle-ci
est clivée pour former au total 10 protéines distinctes :
les protéines structurales (protéines de capside, gly-
coprotéines d’enveloppes E1/E2, viroporine p7) et les
protéines non structurales (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A,
NS5B) qui assurent les fonctions enzymatiques (pro-
téase, polymérase, etc.) lors du cycle de réplication (11).
Histoire naturelle de l’hépatite C
Évolution de l’infection
L’hépatite C est la cause majeure des maladies chro-
niques du foie, incluant la cirrhose et le CHC, respon-
sables de la majorité des transplantations hépatiques
dans les pays occidentaux, au Japon mais aussi en
Égypte. Environ 75 à 85 % des personnes infectées
développent une hépatite chronique et ses compli-
cations associées, dont le CHC, dans 5 à 10 % des cas.
De nombreux facteurs accélèrent l’évolution vers la
cirrhose (co-infection [VIH, VHB], alcool, résistance à
l’insuline, stéatose, hémochromatose), qui constitue
le facteur de risque majeur pour le développement
du CHC.
Figure 1. Bases cellulaires et moléculaires d’induction du CHC par le VHB.
Infection VHB
Stress oxydatif :
– Accumulation de protéines de surface du VHB
Unfolded Protein Response
Mutagenèse
insertionnelle (85-90 %
des CHC/VHB) :
Immortalisation (h TERT)
Prolifération (MAPK-1,
cycline A)
Viabilité cellulaire
(TRAF-1)
Inflammation :
Prolifération cellulaire :
Transactivation
de gènes cellulaires :
Protéine X : Mécanisme de
réparation de l’ADN
Contrôle de l’apoptose
induction transition G0-G1
– Protéines de surface M et L
prolifération (cycline A)
+
+
Perturbation
Activation
Cytokines
prolifératives et
fibrogéniques :
IL-6, IL-10, TGF-β,
EGF, VEGF CHC
Cirrhose
(dans 60 à 70 %
des cas)
– Instabilité
génomique
– Mort cellulaire/
régénération
– Dommages
sur l’ADN

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 2 - avril-mai-juin 2013
90
dossier thématique
Virus et cancers
Carcinogenèse
Le développement d’un hépatocarcinome dans le cadre
d’une hépatite C chronique fait intervenir de nombreux
facteurs directs et indirects du fait de la non-intégra-
tion du génome viral. Certaines protéines du virus VHC
auraient des effets oncogéniques et réguleraient les
processus de mitose (protéine Core, NS5A et NS3A)
[figure 2]. Le processus d’inflammation et de régénéra-
tion lié à l’infection virale par le VHC contribue également
au risque de développer un CHC (17).
Caractéristiques des cancers du foie
L’histoire naturelle de l’hépatocarcinome se divise en
3 grandes phases : une phase “moléculaire” (altérations
du génome des cellules et transformation en cellules
cancéreuses), une phase préclinique (tumeur détectable
mais asymptomatique, ou trop petite pour être détec-
tée) et une phase clinique symptomatique (hépatomé-
galie, ascite, jaunisse/ictère, et inconfort abdominal).
De manière plus détaillée, on observe tout d’abord un
nodule de plus de 2 cm, qui peut être histologiquement
détectable (hypervascularisé, pseudocapsule qui se
forme autour de la tumeur) ou non (texture similaire à
celle du tissu cirrhotique, hypovascularisé). Au cours de
la croissance, la différenciation s’estompe, la vasculari-
sation artérielle pour assurer l’apport en sang oxygéné
prend le dessus sur la vascularisation portale, le risque
de métastases intra- et extrahépatiques et d’invasions
vasculaires augmente.
Les études génomiques ont suggéré un développement
en plusieurs étapes : des mutations caractéristiques ont
pu être identifiées à chaque étape (lésion cirrhotique :
Notch/Toll-like receptor, nodule dysplasique : Jak/STAT,
CHC précoce : Myc). Cependant, étant donné la diver-
sité génétique des CHC, des techniques de microarray
permettent de déterminer des profils génétiques indi-
viduels, combinés aux paramètres cliniques du cancer
et aux données anatomopathologiques de l’individu
dans le but, à l’avenir, de personnaliser le traitement
et le pronostic.
Par ailleurs, l’origine des cellules cancéreuses est hété-
rogène : les hépatocytes aux différents stades de leur
différenciation (cellule souche, précurseur, intermédiaire,
mature) peuvent se transformer en cellules cancéreuses
Figure 2. Bases cellulaires et moléculaires d’induction du CHC par le VHC.
Infection VHB
Stress oxydatif :
Insulinorésistance :
– Core + Hsp60, p53, p73 et pRb
ROS
– Core
dégradation
IRS-1 et 2 par SOC et
PI3K/Akt/mTOR
– Core
Inactivation
d’IRS-1 par TGF-α et
PI3K/Akt
Activation des voies STAT-3, PI3K, et NF-κB
Accumulation β-catérine
Inflammation :
Stéatose :
Prolifération cellulaire :
Core inhibiteurs CDK et p21/Waf
–
+
–
Perturbation
Inhibition
Activation
CHC
Cirrhose
– Instabilité
génomique
– Mort cellulaire/
régénération
– Dommages
sur l’ADN
Régulation transcriptionnelle p21
– NS5A : Homéostasie Ca2+
Sécrétion de VLDL
Accumulation d’acides gras
Oxydation d’acides gras
NS3A-NS5A : p53 p21 effet
antagoniste de la réponse immunitaire
innée (via IRF-3 et NF-кB)
+
 6
6
 7
7
1
/
7
100%