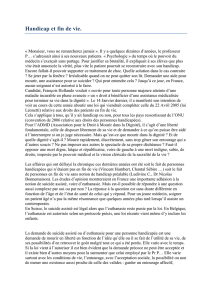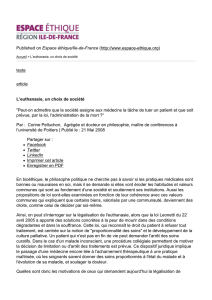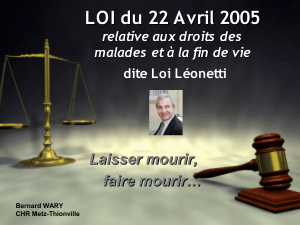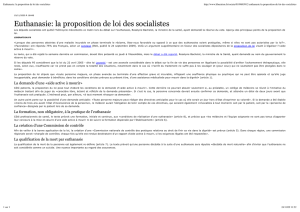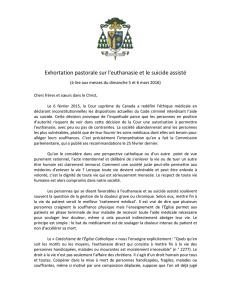Déclaration - Centre Catholique des Médecins Français

LE SOIN DES MALADES EN FIN DE VIE
Déclaration commune juive-catholique
Poursuivant le dialogue entre juifs et catholiques entamé
depuis la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican
II, la Commission pour les Relations avec les Autres
Religions du Consistoire de Paris (CRAR) et le Service
des Relations avec le Judaïsme du Diocèse de Paris
(SRJ) ont constitué un groupe de réflexion sur les
questions touchant à la fin de la vie humaine. Ce
groupe s'est attaché à faire une lecture commune de la
loi du 22 avril 2005, dite « Loi Leonetti », relative aux
droits des malades et à la fin de vie.
Ayant recueilli le résultat de ce travail, nous estimons
utile d'apporter la contribution de ce groupe à la
réflexion sur ce sujet qui touche une question
essentielle: le respect de la vie humaine et l'attention
que les bien portantsdoivent aux mourants ou à ceux
qui sont gravement malades.
1. Juifs et catholiques, nous reconnaissons le droit et le
devoir de toute personne de prendre un soin raisonnable
de sa santé et de sa vie, et le devoir corrélatif de la
famille et des soignants de prodiguer à un malade les
soins nécessaires, dans la mesure de leurs moyens ou
des ressources mises à leur disposition par la société.
Le développement incessant des sciences médicales et
des moyens utilisés pour le diagnostic et le traitement
des maladies rend cependant nécessaire de nos jours de
s'interroger sur le devoir d'y recourir, sur les
circonstances qui légitiment l'abstention de certains de
ces moyens, et, d'une manière générale, sur les soins
dus aux malades parvenus au terme de leur vie.
2. Le commandement biblique: « Tu ne tueras pas » exige
de la famille et des soignants de ne pas chercher à hâter
la mort du malade, et des malades de ne pas attenter à
leurs jours, ni de demander l'aide d'autrui dans cet
objectif. En nous appuyant sur ce commandement nous
exprimons une opposition très ferme à toute forme
d'assistance au suicide et à tout acte d'euthanasie, celle-
ci étant comprise comme tout comportement, action ou
omission, dont l'objectif est de donner la mort à une
personne pour mettre ainsi fin à ses souffrances.
3. Pour nous. la sollicitude due à nos frères et soeurs
gravement malades ou même agonisants. « en phase
avancée ou terminale d'une affection grave et incurable »
selon les termes de la loi, exige de s'employer à porter
remède à leurs souffrances. Tel est l'objectif majeur des
soins palliatifs tels qu'ils sont officiellement définis.
Nous ne pouvons donc que nous réjouir de ce que la loi
invite à les développer dans tous les hôpitaux et les
établissements médico-sociaux.
4. L'article 2 de la loi du 22 avril 2005 prévoit
explicitement que le médecin applique « un traitement
qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger la vie »
lorsque c'est le seul moyen de « soulager la souffrance
d'une personne en phase avancée ou terminale d'une
affection grave et incurable ». Nous jugeons que le
recours à un tel traitement est légitime à certaines
conditions: qu'il y ait des raisons graves d'agir ainsi, des
souffrances intenses qui ne peuvent être soulagées
autrement, et que l'éventuel effet secondaire
d'abrègement de la vie ne soit en aucune façon
recherché. L'objectif poursuivi en administrant ce
traitement est alors uniquement de soulager de fortes
souffrances, non pas d'accélérer la mort. Des «
recommandations de bonne pratique médicale »
destinées à vérifier que les conditions précédentes sont
remplies ont déjà été formulées par des institutions
compétentes. Il importe que ces recommandations
soient régulièrement mises à jour, ratifiées par la Haute
Autorité de Santé et observées dans la pratique.
5. Sans rien renier de nos convictions religieuses et du
respect dû à toute vie humaine, il nous paraît juste, après
les démarches requises, de ne pas entreprendre des
traitements médicaux qui ne pourraient améliorer l'état
de santé du malade, ou n'obtiendraient un maintien de la
vie qu'au prix de contraintes ou de souffrances
disproportionnées, ou dans une situation extrême. En ce
sens, nous approuvons le principe général formulé par
la loi: les actes médicaux « ne doivent pas être
poursuivis par une obstination déraisonnable ».
6. Le fait de ne pas entreprendre (ou de ne pas maintenir),
pour un malade déterminé, tel ou tel traitement médical,
ne dispense pas du devoir de continuer à prendre soin
de lui. Juifs et catholiques, nous jugeons qu'il est de la
plus haute importance de chercher le moyen et la
manière les plus adéquats d'alimenter le malade, en
privilégiant dans toute la mesure du possible la voie
naturelle, et en ne recourant à des voies artificielles
qu'en cas de nécessité.
7. Il apparaît clairement, dans nos traditions respectives,
que l'apport d'eau et de nutriments destinés à entretenir
la vie répond à un besoin élémentaire du malade.
L'alimentation et l'hydratation par la voie naturelle
doivent donc toujours être maintenues aussi longtemps
que possible.
En cas de véritable impossibilité, ou de risques de «
fausse route» mettant en danger la vie du malade, il
convient de recourir à une voie artificielle. Seules des
raisons graves dûment reconnues (non assimilation des
nutriments par l'organisme, souffrance disproportionnée
entraînée par l'apport de ceux-ci, mise en danger de la
vie du malade du fait de risques d'infections ou de
régurgitation) peuvent conduire dans certains cas à
limiter voire suspendre l'apport de nutriments. Une telle
limitation ou abstention ne doit jamais devenir un
moyen d'abréger la vie.
Juifs et catholiques, nous jugeons donc que, en ce qui
concerne l'apport de nutriments, la loi du 22 avril
présente une réelle ambiguïté. Il n'y est pas précisé que
pour les malades chroniques hors d'état d'exprimer leur
volonté l'alimentation et l'hydratation par voie naturelle
ou artificielle doivent être maintenues, même lorsque la
décision a été prise de limiter les traitements médicaux
proprement dits. Il convient que les instances
compétentes favorisent et garantissent cette
interprétation de la loi.
C'est à son attitude à l'égard des plus faibles, parmi

lesquelles les personnes en fin de vie ont une place
toute particulière, qu'une société manifeste son
degré d'humanité. La véritable compassion ne
peut se traduire par le fait de provoquer
délibérément la mort d'autrui. Notre société, si
sensible à la souffrance des personnes en fin de
vie, se doit d'apporter à tous ceux qui en ont
besoin les moyens d'accompagnement et de soins
palliatifs qui respectent la vie humaine. Ce respect
constitue l'un des fondements de toute civilisation
qui se veut humaine.
Paris, le 26 mars 2007
Mgr André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris
David MESSAS, Grand Rabbin de Paris
____________________________________________
http://www.espace-ethique.org/fr/editorial.php
EUTHANASIE: LA NAUSÉE DES SOIGNANTS
Pr Louis Puybasset
Médecin anesthésiste-réanimateur, Groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière, AP-HP
Comment peut-on décemment proposer aux malades
d’arrêter leur cœur pour soulager leur souffrance en ce
début de XXIe siècle ? Comment cette revendication
pourrait être portée par la patrie des droits de l’homme
et des Lumières ? Comment un des grands partis
politiques français a-t-il pu valider officiellement cette
option d’un autre âge ? Pourquoi certains candidats à
l’investiture suprême sont-ils rentrés dans une telle
logique ? Nous, soignants, qui vivons dans notre
quotidien la souffrance et la mort et qui avons fait de
nos vies professionnelles un engagement de solidarité
en avons la nausée.
Légaliser l’euthanasie serait inutile car la loi du 22
avril 2005 relative au droits des malades en fin de vie
apporte des réponses pour la résolution de la très
grande majorité des difficultés rencontrées en fin de vie.
Elle impartit aux médecins de respecter les choix de la
personne malade et de l'informer des conséquences de
ses décisions. En interdisant toute forme d'acharnement
thérapeutique et en imposant une prise en charge de la
souffrance tant psychique que physique par
l'administration de soins et de traitements appropriés -
même au prix d'un raccourcissement de la durée de la
vie - elle s’attaque aux vrais problèmes. En exigeant du
corps soignant, pour le cas où le malade serait devenu
incapable d’exprimer sa volonté, de prendre en compte
ses souhaits exprimés dans ses « directives anticipées »
ou par sa « personne de confiance », en imposant une
décision collégiale, un second avis médical et la
transparence de la décision ainsi que son inscription
dans le dossier médical avec ses motifs, la loi institue
une nouvelle forme d’éthique de la responsabilité
médicale, tout en ne tombant pas dans le piège d’une
procédure qui aurait culpabilisé les proches.
Légaliser l’euthanasie serait dangereux pour
différentes raisons. D’abord, un dispositif qui
procurerait la force de la loi à l'un pour tuer l'autre, fût-
ce à sa demande, porte en lui-même des dérives
inéluctables. L'examen de la situation des pays
européens qui ont légalisé l'euthanasie met déjà
largement en évidence ces dérives: mise à disposition de
« kit euthanasie » en pharmacie et euthanasie de patients
dépressifs en Belgique; suicide assisté de
schizophrènes ou de patients victimes d’une erreur
diagnostique et dérives mercantiles en Suisse; volonté
d'élargir l'euthanasie aux patients « souffrants de la vie
» et pratiques d’euthanasies en dehors de toute
demande aux Pays-Bas. Pourquoi la France éviterait-
elle ce que ces pays ne sont pas parvenus à contrôler ?
Comment peut-on être assez naïf pour croire que des
critères dits de « minutie » pourraient nous prémunir de
ces dérives, surtout lorsque l’on sait que ces critères ne
sont vérifiés qu’une fois que le patient est décédé, c'est-
à-dire tragiquement trop tard. Banaliser le suicide
représenterait ensuite une erreur magistrale sur le plan
de l'histoire familiale qui façonne chacun d'entre nous.
Cette erreur se payera dans une ou deux générations par
une augmentation des suicides réussis chez les jeunes,
tant sont puissants les phénomènes de répétition
transgénérationnelle dans le psychisme humain. Ce
débat accentue d’ailleurs immanquablement la charge
morbide qui règne dans notre société. On peut sans
doute en observer déjà les effets par la progression de 6
% du nombre des suicides réussis que l’on constate
dans la tranche des 30-60 ans depuis 2001. Enfin, ces
options renforcent la vulnérabilité des plus faibles et
mettent en danger les valeurs les plus essentielles du
soin. Pour finir, ce discours est probablement déjà
obsolète. On peut dès maintenant faire l’hypothèse que
les trois pays européens qui ont légalisé ou dépénalisé
l’euthanasie sous une forme ou sous une autre feront
marche arrière dans les dix ans qui viennent. On en sent
déjà les prémisses dans le débat public aux Pays-Bas
où l’on prend conscience des glissements progressifs
qui s’opèrent depuis la mise en place de la loi.
Comment a-t-on pu en arriver là ? Apporter une réponse à
cette question n’est pas chose aisée. Pourquoi ce
mouvement est-il né en Europe occidentale ? Pourquoi
en revanche ces questions n’ont jamais été posées sous
cette forme, ni des réponses aussi simplistes proposées
dans d'autres cultures que la nôtre: en Amérique du
Sud, en Asie ou dans le Maghreb par exemple ? Il
faudrait aussi sans doute s’interroger sur les relations
profondes, qui existent entre la revendication actuelle
d’une légalisation de l’euthanasie et l’histoire
génocidaire de l’Europe pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Le fait que la première légalisation de
l’euthanasie soit intervenue aux Pays-Bas et que 80 %
des actes d’euthanasie pratiqués en Belgique le soient
chez les Flamands n’est sûrement pas neutre. Ceci
renvoie à la psychopathologie et à l’histoire des
peuples, et justifierait l’engagement de recherches
approfondies.
Pour ce concerne notre expertise, on peut proposer la
conjonction de trois phénomènes: la disparition quasi
complète de la représentation de la mort de notre
société, l’orchestration diabolique d’une
instrumentalisation aux multiples visages et des arrières
pensées économiques nauséabondes.

Il ne fait plus bon mourir dans notre société. Mourir est
devenu indécent. Mourir doit se passer dans un milieu
confiné, à l’hôpital, dissimulé au regard de l’autre,
comme si la mort devait être niée. La grande majorité
des jeunes n’ont jamais vu un mort. La plupart des
jeunes n’ont jamais accompagné un mourant. Les
malades meurent souvent seuls dans l’anonymat de
l’hôpital. Comment nos concitoyens peuvent-ils encore
appréhender ce sujet difficile en de telles conditions ?
Dans ce contexte, la proposition qu’il leur est fait de «
zapper » cet épisode douloureux au plus vite leur
apparaît sans doute comme une alternative crédible. Est-
ce là vraiment un chemin de vie ?
L’instrumentalisation aux multiples visages que l’on a
évoquée saute aux yeux, même pour les observateurs les
plus condescendants. Elle est le fait d’organismes
disposant de très importants moyens financiers. Une
association comme l’Association pour le droit de
mourir dans la dignité France (ADMD) emploie 7
personnes à temps plein pour faire la promotion de ses
thèses !
Instrumentalisation de la détresse des malades d’abord,
puisque l’on cache une revendication qui a pour objet
essentiel de créer un droit à la mort derrière une soit
disant solution au problème de la souffrance. Cette
forme d’instrumentalisation a été portée jusqu’à la
caricature par la « manipulation » dont Vincent
Humbert et sa mère ont été les victimes. Comment ne
pas tenir compte du témoignage de la mère de Vincent,
publié par Le Parisien du 6 mars 2007, qui affirme que
Jean Cohen, ancien président de l’ADMD, lui a donnée
des « conseils » lorsqu’elle était à Berck-sur-mer ?
Médicalement, on s’interroge. Comment ce jeune
homme, victime d’un traumatisme crânien sévère et
ayant fait plusieurs mois de coma, porteur de séquelles
qui telles que décrites dans son livre ressemblent à un
atteinte motrice sévère et bilatérale d’origine centrale
associé à une cécité corticale, a-t-il pu écrire un livre qui
reprend tout des thèses de l’ADMD ? En pathologie
traumatique crânienne, ce type de séquelles est toujours
associé à une dysfonction cognitive plus ou moins
sévère. Comment expliquer que ce livre ait été mis en
librairie le 25 septembre 2003, le lendemain de l’acte
d’euthanasie pratiqué par sa mère, 3 ans jour pour jour
après son accident ? Pourquoi Vincent a-t-il toujours été
présenté comme tétraplégique aux yeux du grand public
alors qu’il n’a jamais eu de lésion médullaire ?
Comment ne pas penser, même avec la plus grande
bienveillance, qu’il n’y a pas eu là finalement
instrumentalisation d’une détresse ? Cette enquête
aurait pu relever de la justice si la juge qui instruisait
cette affaire en avait mieux compris les tenants et
aboutissants. Elle reste à faire et est maintenant du
ressort du journalisme d’investigation car la vérité est
due aux Français qui se sont fortement investis
émotionnellement et à juste titre dans cette histoire
tragique.
Instrumentalisation de l’opinion, lorsque l’on produit en
permanence des sondages falsifiés et de surcroit
financés par ses partisans pour justifier la revendication
euthanasique. Il ne faut pas demander aux Français
s’ils veulent mourir sans souffrance. Qui ne répondrait
pas « oui » à une telle question ? Il faut demander aux
Français s’ils préfèrent mourir brutalement d’une
injection létale, à l’heure qui conviendra le mieux à ceux
qui restent, avec le risque que cette mort finisse pas leur
être imposée ou s’ils préfèrent mourir tranquillement
entourés des leurs et soulagés de leurs souffrances, à
une heure qui n’est par essence déterminée par aucune
considération pratique.
Instrumentalisation de l’opinion publique quand la
remise du Livre blanc de l’ADMD et la publication
d’un manifeste ont été programmés quelques jours
avant le procès de Saint-Astier (à Périgueux), dont les
défenseurs de l’euthanasie voulaient faire une tribune et
qui a finalement tourné en fiasco médiatique pour eux.
Fiasco car il a clairement mis en évidence que c’est la
détresse et la solitude des soignants, qui ont conduit à
l’acte d’euthanasie faisant l’objet du délit pénal. Fiasco
aussi car ce procès d’assises a mis en exergue la
sagesse du jury populaire, représentant du peuple, ce
peuple dont les défenseurs de l’euthanasie se réclament
et qui pourtant a fait le choix le plus équilibré que l’on
pouvait attendre. Instrumentalisation de l’opinion
publique encore quand on présente la légalisation
comme la solution à la souffrance extrême, alors que
tous ceux qui défendent cette option savent
pertinemment que l’injection létale, censée être
salvatrice, n’est réalisée dans tous les pays qui ont
légalisé ou dépénalisé l’euthanasie qu’après des délais
de rétraction d’une quinzaine de jours, incompatibles
avec le traitement de cette même souffrance.
Mensonge par omission, quand on oublie de parler ou
même d’évoquer la misère de certains conflits familiaux
et la petitesse de l’homme dans certaines circonstances.
Omission fatale quand on ne dit pas que les actes
d’euthanasie créent invariablement des deuils
pathologiques chez les survivants. Oubli tragique quand
personne n’évoque la détresse et les traumatismes que
ces actes d’euthanasie entraînent sur ceux qui les
pratiquent. Manipulation encore, quand on ne met pas
en avant le fait que la loi du 22 avril 2005 aurait donné
raison à Piergiorgio Welby en Italie ou plus récemment
à Inmaculada Echevarria en Espagne dans leur demande
d’arrêt du respirateur qui les maintenait en vie.
Manipulation toujours, quand on fait croire au peuple
qu’une loi légalisant l’euthanasie serait de nature à
renforcer sa liberté, alors que dans la réalité, une telle loi
dérivera inéluctablement, même avec les meilleures
garanties possibles, vers des euthanasies non choisies,
non demandées et qui seront utilisées comme vecteurs
de régulation économique.
Instrumentalisation de celles et de ceux qui en ont fait de
la légalisation de l’avortement leur combat quand la
stratégie délibérément choisie est de mettre en parallèle
l’euthanasie et l’avortement. Ce sont deux domaines
qui n’ont pourtant strictement rien à voir. Qui peut
décemment soutenir que la légalisation de l’euthanasie
est un enjeu de santé publique comme l’étaient les

conséquences des avortements clandestins avant 1974 ?
Va-t-on avoir le culot de nous expliquer que le mal-
mourir est du à l’absence de légalisation de l’euthanasie
? Va-t-on avoir l’indécence de nous affirmer que
l’euthanasie est la solution à la solitude de la fin de la
vie ?
Instrumentalisation de la place du soignant, quand on veut
lui faire réaliser l’injection létale. Mise en position
d’abus de pouvoir potentiel évident, quand on veut,
s’agissant d’une décision aussi radicale et irréversible,
qu’il concentre entre ses mains toute la chaîne
décisionnelle, du recueil du témoignage jusqu’à l’action
elle-même. Ceci serait l’équivalent d’une justice où
l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction et le
magistrat ne seraient qu’une seule et même personne.
Qui voudrait d’une telle procédure ?
Aux politiques, nous demandons de garder la tête froide.
Vous êtes en charge de fixer la norme sociale qui régit
la vie en société. La loi a pour vocation de poser des
règles générales et non de résoudre des situations
singulières, extrêmes et exceptionnelles. Vous ne
pouvez ni ne devez vous substituer à l’intimité et à la
singularité de la relation médecin-malade. Vous ne
devez pas légiférer à chaud, sous l’impulsion d’affaires
aux fortes connotations émotives et affectives. Vous
n’avez pas le droit, dans la position que vous occupez,
d’avoir la naïveté de penser que vous contrôlerez la
pratique et l’usage d’une telle loi par des formulaires
administratifs dont on remplirait après coup les cases
par « oui » ou par « non ». C’est bien mal connaître les
réalités humaines. Ne vous laissez pas abuser par ceux
qui tentent de vous faire croire que cela fait moderne
que d’être pour la mise en place d’un suicide
légalement assisté. Quelle sera la réaction du corps
social, lorsqu’il sera devenu évident qu’il ne s’agissait
finalement que d’organiser la distribution de pilules
mortifères ? Quelle serait votre propre réaction si cette
procédure devait être organisée dans vos mairies ou
dans vos permanences électorales plutôt que par
l’intermédiaire des professionnels de santé ? Ne vous
laissez pas abuser par la dictature de sondages
d’opinions manipulatoires.
À nos concitoyens, nous disons qu’une loi légalisant
l’euthanasie irait contre la défense de leurs intérêts.
Nous répétons qu’il s’agit d’un combat dogmatique
d’arrière garde. Les enjeux modernes de la prise en
charge de la fin de vie sont ceux de l’accompagnement
et de la proportionnalité des soins. Nous affirmons que
ce n’est pas d’une nouvelle loi dont nous avons besoin
mais d’un changement de culture médicale qu’impose
dorénavant la loi du 22 avril 2005. Nous affirmons que
jamais nous, soignants, ne vous abandonnerons au seuil
de votre vie.
Aux médecins, nous recommandons de s’interroger sur
la notion d’abus de pouvoir auquel notre profession est
constamment exposée. Nous leur demandons de se
souvenir des dérives tragiques que la médecine
européenne a connues dans l’Allemagne Hitlérienne.
Nous rappelons que le programme Aktion T4, qui a
conduit au massacre de 75 000 handicapés sévères
après le début de la guerre, a été coordonné et exécuté
par des médecins zélés qui avaient fini par se croire
investis d’une mission de purification raciale. Nous
rappelons aussi que les procédures d’extermination
massive par les gaz ont été mises au point par ces
mêmes médecins avant de servir à la Solution Finale.
Plus proche de notre époque, nous vous demandons de
vous souvenir que la stérilisation forcée de femmes
handicapées a été menée par des médecins Suédois
jusqu’en 1976 ! Vous, comme nous, savez que nous
agissons sur l’homme dans son intimité et que ceci
nous donne des devoirs qui engagent le sens même de
notre action.
Aux adhérents de l’ADMD, nous demandons
d’approfondir leur réflexion s’agissant de leur soutien
à cette association. Aux quelques irréductibles qui
revendiquent que la société leur fournisse les moyens
de se suicider, nous répétons que tuer n’est pas un acte
médical et n’en requiert aucune compétence. Allez
jusqu’au bout de votre démarche et exigez de vos élus
qu’ils vous fournissent les pilules mortelles que vous
revendiquez ! Pour la majorité silencieuse, qui redoute
plus que tout de mal mourir, nous recommandons
d’obtenir un changement des statuts et des objectifs de
votre association ou de fuir ces dirigeants qui vous
trompent, lorsqu’ils revendiquent en votre nom un droit
à mourir. Ceci n’est pas votre combat. Ouvrez les yeux.
Exigez de votre association qu’elle milite pour
qu’ensemble nous puissions trouver un meilleur
ajustement de l’intensité des soins, pour qu’ensemble
nous puissions développer une meilleure expertise du
pronostic des pathologies neurologiques, pour
qu’ensemble nous puissions donner corps au concept
de proportionnalité des soins, qui est l’enjeu médical le
plus important du monde occidental pour ce siècle qui
débute.
___________________________________________
MEURTRE COMPASSIONNEL
OU SOLIDARITÉ EN FIN DE VIE
Emmanuel Hirsch
Directeur de l’Espace éthique
Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
professeur d’éthique médicale, Université Paris-Sud XI
L’évolution d’une maladie qui affecte l’autonomie de la
personne, sa liberté même, les conditions de son
devenir, peut susciter des réflexions fort
compréhensibles: certains estiment la mort anticipée
plus acceptable qu’une vie éprouvée comme une défaite
et une souffrance sans issue. La mort en deviendrait
ainsi « préférable » à la persistance ou à la préservation
d’une existence considérée, dès lors, dépourvue de la
moindre signification.
Il conviendrait d’être plus attentif à la complexité de ce
qu’expriment les personnes sollicitant de notre part un
suicide médicalement assisté, voire une euthanasie: une
forme d’« assistance à la mort ». Ne nous demandent-
elles pas si nous leur reconnaissons toujours une place
parmi nous, et si nous sommes encore disposés à leur

témoigner considération, respect et solidarité sociale ?
Ce que, dans trop de circonstances, on leur conteste.
L’éthique du soin en fin de vie doit être assumée dans sa
dimension d’exception. Les débats récurrents relatifs à
l’euthanasie ne me semblent que rarement à la hauteur
d’enjeux d’humanité. Ne pas délaisser la personne, ne
pas l’abandonner à sa solitude dans le huis clos d’une
confrontation à sa mort, sans la moindre ouverture, c’est
affirmer que nous avons comme devoir de l’assister
dans ses derniers instants parmi nous, conscients que
leur valeur s’avère d’autant plus inestimable qu’ils sont
comptés. Nous sommes personnellement responsables
de ce temps à vivre et donc à respecter ensemble.
Comment des soignants confrontés à une demande
sociale prenant la forme d'une revendication d'aide au
suicide, doivent-ils concevoir une question comme celle
de la valeur de la vie ? Qui est en mesure d'évaluer une
existence à l'instant même où est éprouvé son plus
grand péril ? Peut-on véritablement anticiper une
décision et considérer comme relevant d'un droit, qu'une
personne désignée obtempère à un choix de mort dans
des circonstances où le suicide ne pourrait être
directement pratiqué ? Qu’en est-il d’une revendication
de la mort proclamée comme l’expression absolue de la
liberté ? Comment envisager une réponse compatible
avec le sens même de l'engagement soignant ?
L'observation de l'usage et de l'interprétation des notions
de respect, dignité, et autonomie nous incite à la plus
grande prudence, voire à un surcroît de vigilance. Pour
certains, le respect et la dignité engagent à revendiquer
le droit à la mort. Pour d'autres, au contraire, et selon
des considérations fondées sur ces mêmes valeurs, rien
ne doit se faire en dehors d'un cadre qui préserve les
droits de la vie. La réduction de principes moraux à
l'état d'arguments exploités à des fins idéologiques,
voire utilitaristes, constitue parfois une dérive
inquiétante. Une telle évolution dans la controverse
masque ou dénature les véritables enjeux. Elle accentue
la détresse des plus vulnérables parmi nous, plus
exposés que d’autres aux conséquences de nos
renoncements.
On comprend le besoin, exprimé par certaines personnes
malades, d'être reconnues dans leur liberté. Face à des
pouvoirs ressentis comme arbitraires et démesurés, elles
souhaitent rétablir un équilibre procédant
nécessairement du droit de refuser des traitements
injustifiés, disproportionnés, parfois perçus dans leur
inhumanité. À l’extrême, la personne peut se trouver
acculée à ne plus solliciter du médecin que son
assistance à la mort ! Les pratiques du soin sont alors
remises en cause dans leurs fondements et
justifications, comme dans leurs procédures et finalités.
L'engagement soignant ne peut, en effet, se comprendre
que dans une relation d'accompagnement qui reconnaît
une valeur inconditionnelle au respect et à la dignité
d'une existence. Il ne s'agit pas d'idéaliser les
circonstances ou de les ramener à des considérations
indues. Mais, au contraire, d'être conscient d'enjeux
délicats et douloureux qui déjouent bien souvent les
stratégies du soin. Les décisions touchent alors au
degré supérieur de la fonction soignante. Dès lors que
le projet d’un soin adéquat, mesuré, constamment ajusté
dans le cadre d’une concertation, conforte la personne
dans ses attentes, ses attachements et sa volonté, nul ne
saurait désinvestir les intervenants du sens profond de
leurs missions. Entre l'obstination thérapeutique, la
neutralité indifférente ou le meurtre compassionnel, un
champ de responsabilité s'impose aux professionnels de
santé, seul conforme aux repères et principes qui
légitiment leurs interventions.
Quand nos décisions concernent un être humain dans son
existence, comment caractériser les libertés du point de
vue des responsabilités qu’elles engagent ? Comment
respecter l’autonomie de l'autre quand un certain
nombre de facteurs accentuent sa dépendance ? La
liberté agit-elle encore dans une conscience intense de la
mort prochaine ou de la mort désirée ? Qu’en est-il de
l'indépendance ainsi visée, de la notion de choix dans
une revendication de la mort ? Que signifie un « droit à
la mort » dans l'exigence d'un soin qui ne saurait que
s’y conformer ?
Un soignant a-t-il la faculté de se refuser à ce qui lui est
demandé - un acte de mort -, quand il est engagé dans
une relation dont l'achèvement peut correspondre, pour
la personne malade, au respect de sa dernière volonté ?
Il assume une responsabilité à la fois personnelle,
professionnelle et sociale qui lui confère l'obligation de
ramener constamment ses pratiques aux devoirs
prescris à l'homme qui soigne. Cette rigueur même est
garante de son autonomie et de celle des personnes qui
s'en remettent à lui. Nos savoirs et nos éventuels
pouvoirs doivent être ramenés à l'expression et
l'exercice de nos obligations humaines dans la décence,
le discernement, la prudence et la retenue.
La prise en considération de l’autonomie impose d’être à
l'écoute de la parole qui nous est adressée et d’y
répondre, y compris lors d’une sollicitation d'assistance
à la mort exprimée à un moment donné. Cela ne veut en
aucun cas dire qu’il convienne d’accéder à cette
demande, renonçant dès lors à mieux comprendre ce
qui doit faire sens dans la réponse dont nous sommes
redevables. Il est indispensable d’approfondir ce qui
motive cette revendication. Elle révèle trop souvent
l'échec de nos stratégies de vie, de notre capacité d'être
l'ami, le proche dont l'autre éprouve encore le véritable et
irremplaçable besoin.
La force et la valeur du soin tiennent dans la formulation
d’une promesse: se focaliser moins sur la mort à venir
que sur les conditions de la vie - fût-elle ténue et
incertaine - qui la précède toujours. Un signe ou un
geste, un mot, un regard qui ne se détourne pas,
repoussent la solitude quand le possible semble si
diminué. Reconnaître la souffrance pour ce qu'elle est -
un cri d'existence -, accepter les mille et une formes de
la dignité en ces circonstances, voilà simplement des
actes de vie qui justifient d'eux-mêmes d'être "encore
là". Se crée dès lors, d'humain à humain, une présence
 6
6
1
/
6
100%