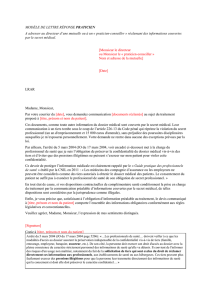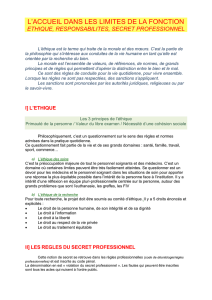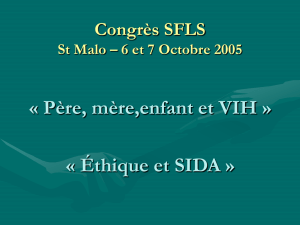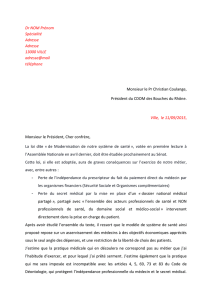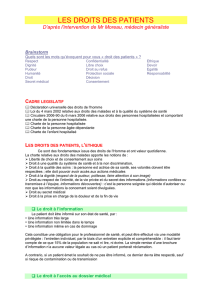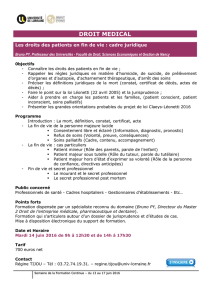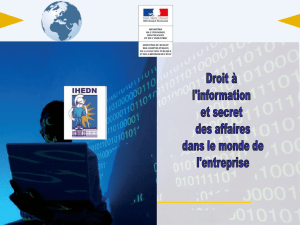Partager le secret médical en équipe

doi:10.1684/hma.2013.0831
Hématologie
vol. 19 nº 4, juillet-août 2013 285
T ribune de réflexion éthique
Partager le secret médical
en équipe
Sharing the medical
secrecy within the care
team
Chantal Bauchetet
Cadre de santé. Comité d’éthique de la
SFH
L es services d’hématologie
reçoivent des personnes qui dé-
couvrent très brutalement leur maladie,
leur fragilité et, possiblement, leur fi ni-
tude. Déjà grandement bouleversées
par le diagnostic et ses implications,
tant du point de vue de leur santé que
sur le plan psychosocial, elles n’ont pas
anticipé la quasi-obligation de partager
des éléments de leur vie, et notamment
des secrets intimes. Or, la gravité des
pathologies, voire le pronostic annoncé
ou craint, vont les y contraindre, avec
une certaine violence, sans qu’elles
aient pu y réfl échir de façon posée. De
nombreuses questions se posent alors.
Que dire, que taire ? Avec qui partag-
er ? Quelles conséquences sur le futur
auront ces éléments qu’on envisage de
taire ? Lesquels de ces éléments sont-ils
fondamentaux dans la prise en charge
thérapeutique ?
La question du secret et de la con-
fi dentialité est donc prégnante et
doit particulièrement interroger les
équipes dans ces services.
Nature du secret
Le secret professionnel enjoint
aux membres de certains corps
de métier de ne divulguer aucun
renseignement confi dentiel concer-
nant leur activité ou leurs clients.
Il s’apparente à la confi dentialité.
Il s’applique dans de nombreus-
es professions (banque, justice,
administrations, etc.)
Le secret médical défi nit le droit
d’un patient au respect de sa vie
privée et à sa liberté quant aux infor-
mations le concernant comme per-
sonne humaine et non simplement
comme personne malade. Il s’impose
à tout professionnel de santé ainsi
qu’à tout professionnel intervenant
dans le système de santé.
Les frontières entre les deux sont
poreuses et parfois diffi ciles à défi nir
et à évaluer.
Par secret, on entend « ce qui doit
être tenu caché des autres » (Le
Robert). Mais de quel secret parle-t-
on ici ? Si l’on se réfère à la défi nition
précitée, « ce qui doit être tenu ca-
ché », l’existence du secret implique-
t-elle qu’il faut que rien ne soit jamais
dit ? Il n’est alors plus question de
partage, puisque l’on ne peut part-
ager ce qui n’est pas énoncé. Dans
Hématologie
Tirés à part : C. Bauchetet
T ribune de réflexion éthique
Le fondement juridique de
l’échange et du partage entre
professionnels de santé est posé
à l’article L1110-4 du code de la
santé publique. « Le secret profes-
sionnel, institué dans l’intérêt des
patients, s’impose à tout médecin
dans les conditions établies par la
loi. Il couvre tout ce qui est venu
à sa connaissance dans l’exercice
de sa profession, c’est-à-dire non
seulement ce qui lui a été confi é,
mais aussi ce qu’il a vu, entendu
ou compris. »
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

286 Hématologie
vol. 19 nº 4, juillet-août 2013
un contexte de médicalisation, une personne malade, de-
mandeuse de soins, va livrer des éléments d’information
sur elle-même, parmi lesquels certains serviront à orienter
vers une pathologie ou à en découvrir l’étiologie, d’autres
informeront sur ses conditions de vie, ses craintes et ses
souhaits. De nombreux faisceaux s’entrecroisent entre in-
formations médicales, psychosociales, socioéconomiques
mais aussi informations du domaine privé, plus secrètes.
Parlons alors de confi dentialité, qui fait référence à ce qui est
confi é à un confi dent de plus grande proximité et qui peut
être partagé (ou pas) selon la nature de l’information.
Où commence et où fi nit l’information permettant à
l’équipe de comprendre la maladie et de mettre en œu-
vre les moyens permettant de la combattre ? Certains élé-
ments vont inévitablement être partagés pour faciliter une
prise en charge globale.
Le patient est le premier vecteur d’informations : ce qu’il
veut bien dire de lui-même, de ses symptômes, de son his-
toire de vie, des pathologies présentes dans sa famille, voire
de ses négligences ou des comportements favorisant des pa-
thologies ou ayant infl ué sur sa vie. Il est parfois bien diffi cile
pour lui de donner ces informations alors qu’il préférerait ne
rien livrer de lui-même, surtout à des personnes qui lui sont
étrangères et à qui il n’a pas forcément envie de se confi er.
De ce point de vue, il est pour lui d’une grande violence
d’être ainsi dans l’obligation de se livrer. Il est fondamental
de le rassurer quant à la discrétion de l’équipe, et de recueil-
lir son accord pour le partage ultérieur. L’écoute sans juge-
ment qui lui sera apportée va ouvrir un espace de confi ance
dans la relation duelle du colloque singulier. Les informations
devront ensuite circuler dans un périmètre élargi, et c’est à
ce niveau que les questions du partage se posent. Quoi dire,
à qui et comment le dire afi n qu’aucune stigmatisation ni
jugement n’entachent les processus relationnels ?
Qu’est ce qu’une information à caractère secret ? Doit-
on considérer que le secret s’arrête aux éléments concernant
la maladie, et pour cela réduire le patient à sa pathologie ?
Or, une personne ne peut se limiter à sa pathologie : sa
vie est un faisceau d’éléments complexes, qui tous ont leur
importance dans une prise en soin globale. Les limites de ce
qui peut être partagé en équipe doivent être fi xées par le
patient lui-même, en consultation médicale ou en consulta-
tion d’annonce IDE dans une négociation accord/opposi-
tion qu’il faudra respecter au plus près. La communauté
soignante pourra ainsi déployer tous ses moyens d’action
relatifs au traitement et aux aides complémentaires.
Concernant l’équipe : si son adhésion au projet nécessite
un même niveau de connaissances de l’ensemble des ac-
teurs de soin, certaines informations peuvent cependant en-
traîner des jugements et des confl its de valeur défavorables
au patient. A contrario, s’il n’est que partiel, le partage des
informations peut restreindre un projet de soin puisque, tous
les éléments n’étant pas exposés, des malentendus et des
incompréhensions risquent de se faire jour. Une réfl exion
éthique doit être menée si le cas de fi gure se présente afi n
que le patient bénéfi cie de la même attention qu’un autre
ne présentant pas cette singularité.
Les lieux de confi dentialité : Qui n’a jamais enten-
du, dans un ascenseur, une cafétéria d’hôpital ou dans
un couloir du service, des professionnels parler de M. X
ou Mme Y, de ses problématiques et de celles posées à
l’équipe ? Faut-il rappeler que ces espaces ouverts ne sont
pas des lieux de débat sur les personnes confi ées aux soi-
gnants ? On peut s’interroger également sur ces lieux de
consultation ou d’imagerie où les noms des patients sont
clamés à tue-tête sans respect de la discrétion.
Les personnes publiques sont un cas particulier, qu’elles
viennent du spectacle, de la politique ou de tout autre
monde où elles se trouvent exposées. Qu’elles soient con-
nues rend-il envisageable qu’elles n’aient pas droit à la
même discrétion ? Le secret professionnel prend ici aussi
tout son sens. D’une façon analogue, lorsqu’il advient
qu’une personne travaillant dans une structure de soin,
avec le statut de soignant ou d’administratif, endosse le
statut de « soigné » au sein de cette institution, la con-
fi dentialité est mise à l’épreuve dans tous les modes de
transmission, depuis l’oralité jusqu’au dossier informa-
tique en passant par l’écrit, via les comptes rendus tapés
par les secrétariats ou les prescriptions sur des feuilles dites
« bons d’examen », voyageant sans enveloppe d’un ser-
vice à l’autre avec un diagnostic rédigé en clair…
Un autre domaine mérite qu’on s’y arrête : il s’agit des
technologies modernes de communication. Elles facilitent
en effet le partage des informations entre l’hôpital et les
professionnels de ville, mais elles demandent une réfl exion
approfondie sur la qualité des éléments à partager et sur
les modalités de sécurité de cette communication, compte
tenu du plus grand nombre de professionnels dépositaires
de ces échanges.
La mise en application des dossiers communicants de can-
cérologie interroge également le partage d’informations :
s’il existe des restrictions à ce partage, peut-on penser que
le patient subira une perte de chance ? Où placer les limites
de ce qu’il conviendrait de partager ou pas ? Quelles plac-
es sont respectivement dévolues aux informations jugées
nécessaires à la prise en charge et à l’éthique relative à la
confi dentialité ? Est-il licite d’élargir le secret partagé à tous
les professionnels de santé prenant en charge le patient
à son retour à domicile, en dehors du médecin traitant ?
Comment recommander une prise en charge pluriprofes-
sionnelle si le niveau d’information concernant le diagnos-
tic, les traitements, les attentes du patient ou son histoire
familiale ne sont connues que de quelques-uns ? Quelle est
la pertinence d’une prise en charge en réseau ou déclinée,
impliquant le pharmacien et l’infi rmière libérale, s’ils n’ont
pas accès aux données du patient, alors que leur rôle sera
essentiel dans l'accompagnement à domicile ? Comment
le médecin, le psychologue ou l’infi rmière, détenteur d’un
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Hématologie
vol. 19 nº 4, juillet-août 2013 287
Partager le secret médical en équipe
secret de vie, pourra-t-il choisir le niveau d’information à
donner aux autres soignants afi n d’en tenir compte dans
l’organisation des soins, sans trahir le malade, ni s’arroger
le pouvoir décisionnel ? Le questionnement est à la fois
interprofessionnel, général – voire sociétal – et individuel,
interpellant l’éthique de la relation à l’autre.
Dans la relation patient-proche, si la personne malade
choisit de ne pas divulguer – ou tout au moins pas totale-
ment – à son compagnon ou à certains de ses proches des
informations détenues par d’autres proches en fonction
des problématiques familiales, les soignants s’interrogent :
comment respecter ce choix sans trahir un secret partagé
sans inclure le proche ? Il se crée alors des relations de
niveaux différents entre patient/soignant et proche/soi-
gnant, mettant les professionnels mal à l’aise, leur vigi-
lance à garder le secret risquant de modifi er leur compor-
tement car ils se trouvent alors dépositaires d’informations
qu’ils craignent de trahir malgré eux. (e.g. : un patient a
une double vie, et le dévoile à un soignant, le mettant
dans la position de confi dent privilégié, rôle diffi cile à as-
sumer seul et qui doit pourtant le rester.)
La question des transmissions écrites infi rmières ou des
observations médicales pose un autre problème de confi den-
tialité : Que faut-il transmettre ? Selon quelles modalités ? Cer-
taines informations seront inutiles à la prise en charge : faut-il
qu’elles soient livrées au plus grand nombre ? Par ailleurs, il est
fréquent que le dossier médical soit réclamé par les familles,
en cas de décès ou pour solliciter un autre avis. Des informa-
tions que le patient aurait jugées confi dentielles doivent-elles
y fi gurer au risque de le faire juger « a priori » par une autre
équipe ou post mortem par les membres de sa famille ? [1].
Les psychologues sont souvent confrontés à cette problé-
matique de secret partagé ; leurs fonctions spécifi ques
les amènent à recevoir des informations intimes diffi ciles
à faire connaître à tous sans alimenter le « voyeurisme »
du groupe et sans éprouver un sentiment de trahison.
Reproche leur en est souvent fait, les équipes soignantes
ayant le sentiment d’être alors des interlocuteurs de « sec-
onde main » à qui la confi ance ne serait pas accordée.
Des psychologues investis travaillent cette question pour
tenter de défi nir le niveau et la qualité des informations à
transmettre, et identifi er celles qui doivent rester du do-
maine de la relation de confi ance entre deux personnes. Il
s’agit là d’un travail délicat et parfois mal compris par les
équipes. Or, il s’agit là d’un même respect de la confi den-
tialité des révélations faites par le patient.
Des exceptions au secret médical existent : elles con-
cernent certaines maladies à déclaration obligatoire ou
encore la maltraitance sur enfants. Hormis ces cas de fi g-
ure, les informations données par le patient lui apparti-
ennent en propre, il est donc seul juge pour décider ce
qu’il veut partager ou pas. D’une manière générale les in-
formations pouvant infl uer favorablement sur sa prise en
charge globale posent peu de problèmes d’expression aux
patients, à l’inverse celles qui font référence à sa vie privée
seront peut-être dévoilées de façon plus partielle, ou tues.
Le partage d’informations en équipe ne doit servir que
la globalité et la continuité du soin dans le seul intérêt du
patient et en aucun cas alimenter une critique au nom de
valeurs différentes. Être soignant, c’est accepter de recevoir
ce que les patients disent d’eux-mêmes sans jugement ni a
priori, et élaborer ensemble le meilleur projet de soin avec les
éléments dont on dispose. Une réfl exion globale doit être en-
gagée comme postulat de respect et de confi dentialité et ses
principes doivent être intangibles. Cette notion de discrétion
doit être également étendue aux proches des patients sur
lesquels l’équipe peut détenir des informations. De même,
elle doit s’appliquer entre les membres de l’équipe qui méri-
tent le même respect dans leur vie professionnelle et privée.
Comme on le voit, le secret partagé revêt de multi-
ples formes, il serait vain d’en dresser une liste. Peut-être
faudrait-il simplement se rappeler que :
– l’information appartient à la personne concernée et ne
peut être divulguée qu’avec son accord,
– tous les acteurs du périmètre de soin sont tenus à la
même discrétion,
– l’alliance thérapeutique ne peut se créer qu’en relation
de confi ance,
– il y a nécessité à toujours s’interroger sur le bénéfi ce
pour le patient avant de partager une information.
Les processus d’enseignement aux plus jeunes impli-
quent très souvent l’utilisation d’exemples. Or ces exemples
sont issus d’histoires de vie. Aussi le concept de confi denti-
alité doit-il être enseigné très tôt dans les différents cursus
de formation comme principe infrangible à la fois dans les
pratiques quotidiennes et, plus largement, via les technolo-
gies de communication que l’on sait fort prisées actuelle-
ment. L’existence de réunions de concertation pluriprofes-
sionnelles ou de groupes de réfl exion éthique est l’une des
assurances de qualité de la circulation des informations. Les
pouvoirs d’exemplarité de ce principe absolu doivent ainsi
guider les réfl exions et la pratique en équipe pluriprofession-
nelle, il s’agit là de poser des bases de communication dans
le respect de la liberté et de l’autonomie permettant un soin
global sans jamais empiéter sur le domaine privé que sou-
haite protéger la personne malade. L’application stricte de
ces principes va refl éter la capacité pour une équipe d’être
cohérente et fi dèle aux valeurs absolues du soin.
Confl its d’intérêt : Aucun.
Référence
1. Barruel F, Dauchy S, Charles C, Le Bihan A, Lombard. Transmission des infor-
mations en psychooncologie. La Lettre du Cancérologue 2012, 21 : 334-9.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
1
/
3
100%