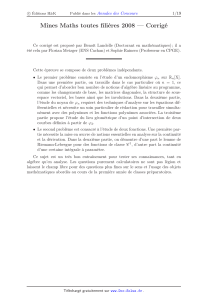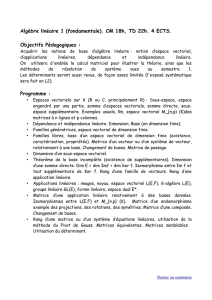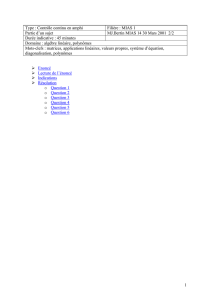Algèbre - Alain Troesch

Lycée Louis-Le-Grand, Paris Année 2014/2015
Cours de mathématiques
Partie III – Algèbre
MPSI 4
Alain TROESCH
Version du:
13 février 2016


Table des matières
16 Fang cheng, ou l’élimination de Gauss-Jordan... 7
I Position du problème et reformulation matricielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I.1 Position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I.2 Rappels sur les matrices et transcription matricielle du système . . . . . . . . . . . 8
I.3 Structure de l’ensemble des solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
II Échelonnement d’une matrice par la méthode du pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
II.1 Opérations sur les lignes d’une matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
II.2 Échelonnement de la matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
III Résolution d’un système échelonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
III.1 Inconnues principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
III.2 Recherche d’une solution particulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
III.3 Recherche de la solution générale de l’équation homogène associée . . . . . . . . . 15
17 Structures algébriques 17
I Lois de composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I.1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I.2 Propriétés d’une loi de composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
I.3 Ensembles munis de plusieurs lois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
I.4 Stabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
II Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
II.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
II.2 Morphismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
II.3 Catégories (HP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
III Groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
III.1 Axiomatique de la structure groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
III.2 Exemples importants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
III.3 Sous-groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
III.4 Les groupes Z/nZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
III.5 Congruences modulo un sous-groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
III.6 Ordre d’un élément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
IV Anneaux et corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
IV.1 Axiomatiques des structures d’anneaux et de corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
IV.2 Sous-anneaux, sous-corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
IV.3 Calculs dans un anneau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
IV.4 Éléments inversibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2 Table des matières
IV.5 Idéaux (HP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
18 Arithmétique des entiers 41
I Divisibilité, nombres premiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
I.1 Notion de divisibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
I.2 Congruences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
I.3 Nombres premiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
II Décomposition primaire d’un entier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
II.1 Décomposition primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
II.2 Valuations p-adique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
III PGCD et PPCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
III.1 PGCD et PPCM d’un couple d’entiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
III.2 Identité de Bézout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
III.3 PGCD et PPCM d’une famille finie d’entiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
III.4 PGCD et PPCM vus sous l’angle de la décomposition primaire . . . . . . . . . . . 53
IV Entiers premiers entre eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
IV.1 Couple d’entiers premiers entre eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
IV.2 Famille finie d’entiers premiers entre eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
IV.3 Fonction indicatrice d’Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
V Théorème des restes chinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
V.1 Cas de modulo premiers entre eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
V.2 Résolution d’un système quelconque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
19 Polynômes et fractions rationnelles 59
I Polynômes à coefficients dans un anneau commutatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
I.1 Polynômes formels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
I.2 Opérations arithmétiques sur les polynômes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
I.3 Indéterminée formelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
I.4 Dérivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
I.5 Degré et valuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
II Arithmétique dans K[X]..................................... 66
II.1 Division euclidienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
II.2 Idéaux de K[X]...................................... 66
II.3 Divisibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
II.4 PGCD et PPCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
II.5 Polynômes premiers entre eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
II.6 Décomposition en facteurs irréductibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
III Racines d’un polynôme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
III.1 Spécialisation, évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
III.2 Racines et multiplicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
III.3 Majoration du nombre de racines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
III.4 Interpolation de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
III.5 Polynômes scindés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
IV Polynômes irréductibles dans C[X]et R[X].......................... 77
IV.1 Factorisations dans C[X]................................ 77
IV.2 Facteurs irréductibles dans R[X]............................ 78
V Fractions rationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
V.1 Définition des fractions rationnelles formelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
V.2 Degré, racines, pôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
V.3 Décomposition en éléments simples dans C(X). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
V.4 Décomposition en éléments simples dans R[X]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
VI Primitivation de fractions rationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Table des matières 3
20 Espaces vectoriels 85
I Notion d’espace vectoriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
I.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
I.2 Combinaisons linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
I.3 Un exemple important : espace de fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
I.4 Produits d’espaces vectoriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
I.5 Sous-espaces vectoriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
I.6 Intersections de sev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
I.7 Sous-espace vectoriel engendré par un sous-ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
I.8 Sommes de sev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
I.9 Sommes directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
II Familles de vecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
II.1 Familles libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
II.2 Familles génératrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
II.3 Bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
III Espaces vectoriels de dimension finie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
III.1 Notion de dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
III.2 Dimension, liberté et rang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
III.3 Dimension de sous-espaces et de sommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
21 Applications linéaires 101
I Généralités sur les applications linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
I.1 Définitions et propriétés de stabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
I.2 Image et noyau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
I.3 Endomorphismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
I.4 Automorphisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
I.5 Projecteurs et symétries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
II Applications linéaires et familles de vecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
II.1 Détermination d’une application linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
II.2 Caractérisations de l’injectivité et de la surjectivité par l’image de bases . . . . . . 111
II.3 Recollements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
III Applications linéaires en dimension finie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
III.1 Rang d’une application linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
III.2 Théorème du rang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
IV Formes linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
IV.1 Formes linéaires, espace dual, hyperplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
IV.2 Qu’est-ce que le principe de dualité ? (hors-programme) . . . . . . . . . . . . . . . 116
22 Matrices 119
I Matrice d’une application linéaire et opérations matricielles . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
I.1 L’ensemble des matrices de type (n, p). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
I.2 Matrice d’une application linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
I.3 Structure d’espace vectoriel de Mn,p(K). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
I.4 Définition du produit matriciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
I.5 Expression matricielle de l’évaluation d’une AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
I.6 Transposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
I.7 Produit matriciel revisité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
II Matrices carrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
II.1 L’algèbre Mn(K). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
II.2 Matrices triangulaires et diagonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
II.3 Matrices symétriques et antisymétriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
II.4 Matrices inversibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
1
/
200
100%