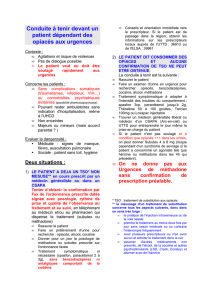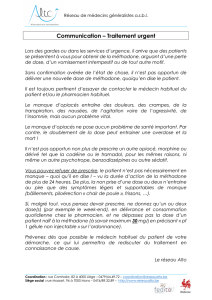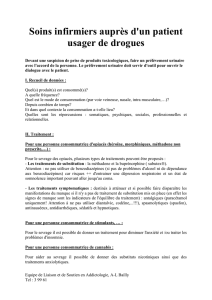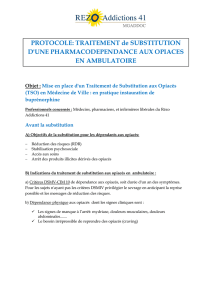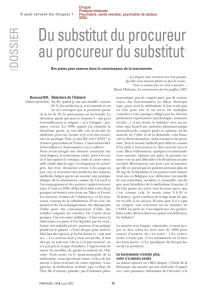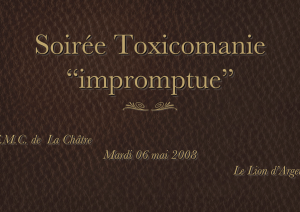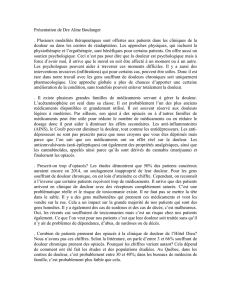L`addiction aux opiacés. Entre traitement de substitution et parole

DOI : 10.1684/med.2014.1078
STRATÉGIES
Catherine Herbert
CSAPA (Centre
de Soins
d’Accompagnement
et de Prévention
en Addictologie
spécialisé de Caen) ;
45 rue de Bretagne,
Caen
Mots clés :
addiction ; centres
de soins,
d’accompagnement
et de prévention
en addictologie ;
traitement
de substitution
aux opiacés ;
troubles liés
à une substance
Stratégies thérapeutiques
Les approches actuelles du concept d’addiction non psychanalytiques proposent, à
partir d’une méthode très descriptive utilisant le DSM-IV, un nouveau regroupement
transnosographique. Ce regroupement ne cesse de s’élargir pour toucher divers do-
maines de la vie publique et quotidienne (addiction aux toxiques mais aussi au jeu, au
travail, au sexe, au sport, à l’amour, etc.). C’est dire la complexité de ce concept et du
mot même d’addiction qui vient non de l’anglo-saxon addiction mais du latin addictere,
«donner son corps en gage pour une dette impayée »[1 (p. 3, 5 et 6)]. Ceci peut
permettre d’éclairer la dimension pulsionnelle, la culpabilité et le rapport au corps qui
est en jeu dans toutes les addictions, sorte de contrainte de consommer ou d’agir, quel
que soit le produit ou l’activité, qui engage le corps.
Abstract: The addiction to opiates. Between replacement therapy and speech
Any addiction goes through three different steps, one of “honeymoon”, then misconduct and a deleterious loss
of control. The frameworks, limits and goals will be quite different according to the moment.
Addiction is a psychological and sometimes physical state resulting from the interaction between a living orga-
nism and one (or more) drug(s). This condition can occur with or without tolerance.
Buprenorphine and Suboxone®Méthadone®are used as substitution treatment following specific rules. All of
these resulted in abuses. An objective withdrawal can always be chosen by the patient or the doctor, but the
goal of replacement therapy is first to allow patients to leave the active consumption and start over a family,
love, social and professional life. The involvement in this clinical practice presupposes that the healthcare pro-
fessional accepts to invest an important emotional and psychological energy and some time.
Key words: Behavior, Addictive; Opiate Substitution Treatment; Substance Abuse Treatment Centers; Subs-
tance-Related Disorders
L'addiction aux opiacés
Entre traitement de substitution
et parole
Addiction et dépendance
Toute addiction passe par trois phases : 1) lune de
miel : la substance consommée ou l’activité vient ap-
porter plaisir ou sensation de soulagement au sujet ; la
personne contrôle ses actes et pense pouvoir arrêter
quand elle le souhaite ; 2) dérapage : le sujet sent déjà
une perte de contrôle soit dans les quantités, soit dans
les conséquences ; il doute de plus en plus mais peut
encore nier ou minimiser ; 3) phase délétère : la per-
sonne a perdu tout contrôle par rapport à son (ou ses)
addiction(s) et connaît déjà de nombreuses consé-
quences délétères sociales, familiales, sanitaires ou
judiciaires de son addiction. Lorsqu’arrive un patient
dans le soin, la prise en charge qui va être proposée
dépend beaucoup de la phase où il se trouve. Les ca-
dres, limites, objectifs seront bien différents.
Le concept de dépendance a été défini par l’OMS en
1969 : état psychique et quelquefois physique, résul-
tant de l’interaction entre un organisme vivant et une
drogue, se caractérisant par des modifications de
comportement et par d’autres réactions, qui compren-
nent toujours une pulsion à prendre le produit de façon
continue ou périodique afin de retrouver ses effets
psychiques et quelquefois d’éviter le malaise de la pri-
vation. Cet état peut s’accompagner ou non de tolé-
rance. Un même individu peut être dépendant de plu-
sieurs produits.
115mars 2014MÉDECINE
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Trois composantes sont clairement identifiées dans ce
concept : la dépendance psychique, la dépendance physique
et la tolérance [1 (p. 371-4)] :
– La dépendance psychique existe dans toutes les addic-
tions et pour toutes les substances consommées.
– La dépendance physique est seulement prouvée pour l’al-
cool et les opiacés, discutée pour quelques autres substan-
ces sans preuve scientifique pour le moment.
– La tolérance est ce phénomène qui oblige le sujet à aug-
menter les quantités pour obtenir les mêmes effets, sorte
d’escalade quasi incontournable dans toutes les addictions
[1 (p. 371-4)].
La dépendance physique est dangereuse (mortelle dans le cas
de l’alcool, d’où l’habituelle obligation d’hospitalisation pour le
sevrage) ; très douloureuse dans le cas des opiacés (l’hospitali-
sation n’est pas obligatoire pour le sevrage) mais est relative-
ment simple à soigner. Globalement, elle disparaît en 8 à
15 jours selon le toxique consommé. En revanche, la dépen-
dance psychique est longue (plusieurs années) à traiter, à enca-
drer, à canaliser, à soigner et la réadaptation à une vie quoti-
dienne plus normée se fera lentement avec des cadres, limites,
objectifs qui seront différents selon les désirs du patient.
L’installation de la dépendance psychique ou physique aux
opiacés est variable d’un individu à un autre. La dépendance
psychique s’installera d’autant plus vite que le sujet trouvera
à cette substance une fonction plus ou moins thérapeutique.
Le plus souvent, la dépendance physique s’installe en une
année à une année et demi de consommations d’abord irré-
gulières puis de plus en plus régulières et rapprochées
jusqu’à devenir quotidiennes. Les signes en sont principale-
ment des douleurs physiques à type de contractures mus-
culaires, de spasmes gastro-intestinaux, de diarrhées, de
nausées voire de vomissements, de rhinorrhées, de larmoie-
ments, de troubles du sommeil à type d’insomnies, accom-
pagnés de troubles anxio-dépressifs très importants.
À ce jour, les traitements de substitution aux opiacés ne sont
autorisés à être prescrits que lorsque la dépendance physi-
que est installée.
Les traitements de substitution
Buprénorphine
C’est une molécule agoniste-antagoniste ou agoniste partiel
aux récepteurs μdes opiacés. Du fait de cette propriété ago-
niste-antagoniste, il n’y a pas de risque d’overdose, sauf asso-
ciation à d’autres substances ou médicaments dépresseurs
respiratoires. Ce traitement est réservé aux adultes et enfants
de plus de 15 ans, volontaires pour recevoir un traitement de
substitution et dépendants physiquement aux opiacés. Plu-
sieurs génériques du Subutex®, médicament princeps, sont
maintenant commercialisés sous le nom de buprénorphine.
Quelles modalités de prescription ?
Ce traitement peut être prescrit par tous les médecins. Les
médecins généralistes sont le plus souvent prescripteurs.
L’ordonnance, limitée à 28 jours, note la posologie et les da-
tes de début et de fin de traitement en toutes lettres, avec
un fractionnement de la délivrance tous les 7 jours maximum
et précise le nom de la pharmacie qui délivrera le traitement.
Au début du traitement il est conseillé de fractionner le trai-
tement tous les jours puis tous les deux ou trois jours et de
revoir le patient plus souvent.
Quels dosages ?
Le Subutex®existe en 3 dosages (0, 4, 2 et 8 mg), les géné-
riques en dosages plus nombreux (0,4, 1, 3, 4, 6, 8 mg). Ces
molécules se prennent en sublingual pour leur plus grande
efficacité (il faut laisser totalement fondre le comprimé sous
la langue) en une seule fois par jour.
Associations médicamenteuses ?
La prise d’opiacés purs ou de médicaments morphiniques ou
de méthadone ou de médicaments à base morphinique est
contre-indiquée. La prise de naltrexone est contre-indiquée
(risque d’apparition brutale d’un syndrome de sevrage). La
prise d’alcool ou de benzodiazépines est fortement décon-
seillée (risque de décès dû à une dépression respiratoire).
Les IMAO et inhibiteurs du CYP3A4 sont déconseillés et en-
traînent des modifications de posologie.
Des dérives ont été observées
La prise en intraveineux ou intranasal entraîne une perte d’effi-
cacité de la substance. Les injections de génériques seraient
encore plus dangereuses que celles du Subutex®en raison de
la différence des excipients. Risques principaux des injec-
tions : abcès, scléroses veineuses et septicémies ; des prises
intranasales : infections et destructions de la cloison nasale.
Quand instaurer le traitement ?
Quand le sujet le demande et que la dépendance physique
aux opiacés est avérée (consommation quotidienne et signes
physiques de manque aux tentatives d’arrêt des consomma-
tions). Lorsque le traitement est débuté, le patient devient
dépendant du Subutex®ou de la buprénorphine.
Comment instaurer le traitement ?
Progressivement et à distance des dernières prises d’opia-
cés : 4 à 6 heures s’il s’agit d’héroïne, plus s’il s’agit de mé-
dicaments morphiniques, selon la demi-vie du médicament,
48 h s’il s’agit de méthadone. La posologie, d’environ 4 à
6 mg pour le premier jour, dépend de la quantité de produit
consommé par jour : globalement un gramme d’héroïne par
jour équivaut à 6 à 8 mg de buprénorphine par jour ; posolo-
gie à augmenter de 2 mg par paliers de 2 à 3 jours, tant qu’il
persiste des signes de manque, que la posologie ne couvre
pas les 24 h et qu’il y a encore beaucoup d’envies de consom-
mer. Une posologie maximale a été fixée à 16 mg au-delà de
laquelle il n’y a plus d’effet. La posologie moyenne est entre
8 et 12 mg par jour.
Comment diminuer le traitement et quand ?
Après une phase de stabilisation (de plusieurs années le plus
souvent), une diminution progressive pourra être proposée
par le médecin ou demandée par le patient. Elle se fait par
paliers de 2 mg sur plusieurs mois, avec interruption dès que
le patient sent que cela devient soit trop douloureux soit dan-
gereux car un retour des envies de consommer est présent.
Sur les derniers mg, il est conseillé de faire des diminutions de
0,4 mg. Lorsqu’il y a eu une interruption de traitement par
buprénorphine mais que les circonstances entraînent la re-
mise en place de ce traitement, il est très fortement
116 MÉDECINE mars 2014
STRATÉGIES
Stratégies thérapeutiques
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

recommandé de débuter à une posologie très basse (plutôt 1
ou 2 mg, maximum 4 mg) selon le schéma de mise en place du
traitement écrit plus haut : le patient devenu non dépendant
aux opiacés serait en danger avec une posologie plus élevée.
Chlorhydrate de méthadone
La méthadone ou chlorhydrate de méthadone est un ago-
niste pur aux récepteurs μdes opiacés. Du fait de cette pro-
priété, il y a risque d’overdose : si le patient n’est pas dépen-
dant physiquement aux opiacés, la dose létale est de
1 mg/kg) ; s’il est dépendant aux opiacés, l’overdose est pos-
sible si ce traitement est associé à d’autres substances ou
médicaments dépresseurs respiratoires. Ce traitement est
réservé aux adultes et enfants de plus de 15 ans, volontaires
pour recevoir un traitement de substitution et dépendants
physiquement aux opiacés.
Quelles modalités de prescription ?
Le traitement ne peut être prescrit que par les médecins exer-
çant dans les CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie) et par les médecins praticiens
hospitaliers exerçant en service hospitalier [2, 3]. Les services
d’accueil ou d’urgence des établissements hospitaliers ne sont
pas habilités à la prescription de méthadone. L’ordonnance est
limitée à 14 jours, note la posologie et les dates de début et de
fin de traitement en toutes lettres, avec un fractionnement de
la délivrance tous les 7 jours maximum, précise le nom de la
pharmacie qui délivrera le traitement. Au début du traitement,
il est conseillé de fractionner le traitement tous les jours puis
tous les deux ou trois jours et de revoir le patient plus souvent.
Après une stabilisation, une délégation de prescription peut
être faite au médecin généraliste du patient. Cette délégation
note le nom du médecin généraliste qui va prescrire et le nom
de la pharmacie qui va délivrer. Cette délégation peut être faite
pour une période précise ou pour une durée illimitée. Le méde-
cin généraliste doit avoir, pour pouvoir faire sa première ordon-
nance, cette délégation en toutes lettres dont le double sera
communiqué à la pharmacie qui délivrera le traitement. Si le
patient change de pharmacie ou de médecin généraliste, la
délégation doit être refaite par le médecin premier prescrip-
teur. Cette délégation n’est valable que pour un patient
concerné, pas pour d’autres patients. La délégation confère au
médecin généraliste le statut de prescripteur pour ce patient et
les posologies du traitement par méthadone peuvent être mo-
difiées par lui ; lors de ses vacances, son remplaçant est auto-
risé à prescrire sous sa responsabilité et sur les ordonnances
du médecin généraliste délégué. S’il n’y a pas de remplaçant, le
médecin généraliste ne peut pas adresser le patient à un autre
médecin généraliste. Il doit organiser le retour du patient au
médecin premier prescripteur (CSAPA ou service hospitalier).
Très exceptionnellement, si le patient doit s’absenter pour rai-
sons privées ou professionnelles, il pourra être stipulé sur l’or-
donnance une délivrance du traitement exceptionnelle en une
seule fois pour les 14 jours maximum [4].
Quelles galéniques et quels dosages ?
La méthadone existe en sirop et en gélules. La forme sirop
est obligatoire lors de la mise en place du traitement. La
forme gélule ne pourra être prescrite qu’après au moins un
an de traitement par sirop et stabilisation du patient sur le
plan addictologique.
La forme sirop existe en 5 dosages (5, 10, 20, 40 et 60 mg).
La forme gélule existe en 5 dosages (1, 5, 10, 20 et 40 mg).
Ce traitement, quelle que soit sa forme, se prend en une
seule fois par jour. Il y a une équivalence complète entre le
dosage sirop et le dosage gélule. En revanche, la forme gé-
lule est un peu plus longue à agir que la forme sirop
(3/4 d’heure à 1 heure au lieu d’1/2 heure).
La mise en place d’un traitement par gélule oblige à l’envoi
d’un protocole de soins (L. 324-1) qui stipule qui prescrit et
qui délivre le traitement à la Caisse Primaire d’Assurance-
Maladie du patient.
Si la délégation pour une prescription par un médecin géné-
raliste a été faite sous la forme sirop, elle doit être refaite,
après passage auprès du premier médecin prescripteur de
CSAPA ou de service hospitalier, pour la forme gélule selon
les mêmes modalités.
Associations médicamenteuses ?
La méthadone peut entraîner l’allongement du QT. Il est donc
déconseillé pour tous les patients présentant ce trouble. Un
électrocardiogramme doit être réalisé dès que la posologie
de méthadone atteint 120 mg par jour. Bien évidemment,
tous les traitements pouvant aussi entraîner un allongement
du QT seront maniés avec prudence.
La prise d’opiacés purs est déconseillée du fait du risque
d’overdose. La prise de médicaments morphiniques ou de
médicaments à base morphinique est déconseillée mais pas
contre-indiquée, et nécessite des précautions d’emploi im-
portantes (risque d’overdose d’opiacés par potentialisation
des effets dépresseurs centraux).
La prise d’alcool ou de benzodiazépines est fortement dé-
conseillée (risque de décès par dépression respiratoire).
La prise de buprénorphine, Suboxone®ou naltrexone est
contre-indiquée (risque d’apparition brutale d’un syndrome
de sevrage).
Plusieurs traitements sont déconseillés ou entraînent des
modifications de posologie (antiarythmiques, IMAO, bêtablo-
quant, cimétidine, antiH1, etc.).
Des dérives ont été observées
La prise en intraveineux ou en intranasal entraîne une perte
d’efficacité de la substance. Des essais d’injection du sirop
ou de la gélule ont été réalisés. Le plus souvent, il y a ob-
tention d’une pâte difficilement injectable. De même, une
prise en intranasal de la gélule est possible. Rapidement une
tolérance s’installe (augmentation de la posologie) et des brû-
lures nasales apparaissent.
Quand instaurer le traitement ?
Quand le sujet le demande et que la dépendance physique
aux opiacés est avérée (consommation quotidienne, signes
physiques de manque aux tentatives d’arrêt). Lorsque le trai-
tement est débuté, il devient dépendant de la méthadone.
Comment instaurer le traitement ?
Progressivement et à distance des dernières prises d’opia-
cés : 4 à 6 heures s’il s’agit d’héroïne, plus s’il s’agit de mé-
dicaments morphiniques (selon la demi-vie du médicament),
24 h s’il s’agit de buprénorphine.
La mise en place du traitement (ou induction méthadone) se fait
obligatoirement de façon progressive pour éviter les risques
d’overdose qui sont les plus importants dans les premières
117mars 2014MÉDECINE
STRATÉGIES
Stratégies thérapeutiques
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

semaines de traitement. Le premier jour, la posologie sera
comprise entre 20 mg et 40 mg installés de façon lente sur
toute une journée (en 4 ou 5 prises) selon la quantité de subs-
tance consommée habituellement (globalement un gramme
d’héroïne par jour équivaut à une posologie stable de 40 à 60 mg
de méthadone par jour). Le deuxième jour il sera possible d’aug-
menter de 5 ou 10 mg la posologie de la veille si des signes de
manque persistent et la prise se fera en une seule fois. Idem le
troisième jour. Puis il faut une stabilisation de la posologie pen-
dant 5 jours (car la méthadone est une molécule qui s’accumule
dans le corps). Ensuite par palier d’une semaine voire une quin-
zaine,laposologiepeutêtreaugmentéede5ou10mgselonla
persistance de signes de manque, d’une insuffisance de cou-
verture des 24 h et s’il y a encore beaucoup d’envies de
consommer. Il n’y a pas de posologie maximale. La posologie
moyenne est entre 60 et 80 mg par jour. La prise de ce traite-
ment se fait en une fois par jour.
Comment diminuer le traitement et quand ?
Après une phase de stabilisation (de plusieurs années le plus
souvent), une diminution progressive pourra être proposée par
le médecin ou demandée par le patient. Cette diminution se fera
par paliers de 5 ou 10 mg sur plusieurs mois, avec interruption
dès que le patient sent que cela devient soit trop douloureux soit
dangereux car un retour des envies de consommer est présent.
Sur les derniers mg, il est conseillé de faire des diminutions plus
petites (de 1 mg). Lorsqu’il y a eu une interruption de traitement
par méthadone mais que les circonstances entraînent la remise
en place de ce traitement, il est très fortement recommandé de
débuter à une posologie très basse (plutôt 10 ou 20 mg, maxi-
mum 40 mg) selon le schéma d’induction écrit plus haut. En
effet, le patient est alors devenu non dépendant aux opiacés et il
serait en danger avec une posologie plus élevée.
Suboxone®
D’apparition récente comme traitement de substitution, il a
exactement les mêmes propriétés que la buprénorphine,
donc les mêmes indications, contre-indications, règles de
prescription et précautions d’emploi. Il contient de la bupré-
norphine (agoniste-antagoniste) et de la naloxone (antago-
niste pur). Le but de cette association est d’empêcher l’in-
jection de la molécule. En effet, prise sous la langue, la
naloxone est dégradée par la salive et donc sans effet. Prise
en injection, la naloxone agit en premier, vide les récepteurs
des opiacés présents et provoque un état de manque.
Nous avons pour le moment peu de recul en France sur ce
traitement. Des études montreraient que les posologies de
buprénorphine ne sont pas tout à fait équivalentes entre la
buprénorphine seule (générique) et le Suboxone®[5]. Il serait
nécessaire de prescrire une posologie de Suboxone®plus
importante pour avoir les mêmes résultats peut-être sur une
période transitoire. Enfin ces études montreraient qu’il existe
des injections de Suboxone®. Cependant, il est une troisième
voie possible de thérapeutique qu’il ne faut pas négliger.
Pour ces trois traitements, buprénorphine, méthadone, Su-
boxone®, les professionnels observant un abus ou une dérive
du traitement prescrit, doivent en informer le Centre d’Ad-
dictovigilance (Centre d’Évaluation et d’Information sur la
Pharmacodépendance CEIP) dont ils dépendent [6].
Populations particulières
Les «métaboliseurs rapides »
Ils métabolisent trop rapidement la méthadone (ce n’est pas
démontré pour les patients sous buprénorphine). Ils doivent
donc prendre leur traitement obligatoirement en plusieurs pri-
ses par jour. Pour avoir une preuve de ce métabolisme trop
rapide, il faut faire une méthadonémie (dosage de la métha-
done à H3 et à H24 après la prise) et suivre les signes clini-
ques (malgré l’augmentation de la posologie, lorsque le pa-
tient prend en une seule fois son traitement, il persiste
toujours des signes de manque qui apparaissent avant la fin
des 24 heures et en revanche, s’installe une somnolence 3
à 4 heures après la prise).
Les femmes enceintes
Pour les femmes enceintes consommatrices et dépendantes
aux opiacés un traitement de substitution est obligatoire. Il
est possible de poursuivre un traitement de buprénorphine.
S’il s’agit d’héroïne, de médicaments morphiniques ou de
méthadone, un traitement par méthadone sera instauré ou
continué. Le risque essentiel est la perte de l’enfant dû au
manque et aux contractions utérines, soit au premier trimes-
tre par fausse-couche, soit au dernier trimestre par accou-
chement prématuré. La posologie du traitement, quel qu’il
soit, sera augmentée au cours des 9 mois de la grossesse
(le plus souvent vers 5 à 6 mois puis dans les deux derniers
mois). Cette augmentation se fera en moyenne de 2 à 4 mg
pour la buprénorphine et de 10 à 30 mg pour la méthadone.
Cette augmentation sera supprimée presque en totalité aus-
sitôt l’accouchement. Bien sûr le bébé sera dépendant aux
opiacés à sa naissance, et son sevrage sera organisé par le
service hospitalier qui accueillera la mère. Il est donc
conseillé que la future mère rencontre les professionnels qui
118 MÉDECINE mars 2014
STRATÉGIES
Stratégies thérapeutiques
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

la prendront en charge et prendront en charge son enfant
bien avant la naissance (vers le 6eou 7emois).
Les personnes ayant un traitement
pour une hépatite C
Les personnes consommatrices d’opiacés sont souvent por-
teuses du virus de l’hépatite C et de plus en plus d’entre
elles bénéficient d’un traitement contre ce virus. Ce traite-
ment est lourd et long. Lorsque ces patients ont, par ailleurs,
un traitement de substitution aux opiacés, il sera nécessaire
de revoir la posologie de ce traitement, le plus souvent dans
le sens d’une légère augmentation.
Les patients mineurs
Les traitements de substitution peuvent être prescrits entre
15 et 18 ans. Les conditions pour qu’un mineur puisse
consentir seul à des soins, hors autorisation de ses parents,
sont précises [7] :
1. il faut que le traitement s’impose pour sauvegarder sa
santé ;
2. il faut qu’il se soit expressément opposé à ce que ses
parents soient prévenus et souhaite conserver le secret sur
son état ;
3. le médecin doit tout mettre en œuvre pour tenter de le
convaincre d’informer ses parents et ce n’est qu’en cas
d’échec que les soins pourront être entrepris hors le consen-
tement de ceux-ci ;
4. le mineur devra impérativement se faire accompagner
d’une personne majeure de son choix sauf si, étant en rup-
ture complète avec sa famille, il bénéficie d’une couverture
sociale personnelle.
L’instauration de tels traitements rendant dépendant pour
très longtemps, doit donc être très réfléchie, notamment
pour les sujets mineurs. Lorsque les consommations de
substances opiacées ne sont pas très anciennes et que la
dépendance physique est récente, le sevrage reste le traite-
ment de première intention.
Le sevrage peut toujours être
choisi par le patient
ou par le médecin
Lorsque les consommations sont très peu anciennes avec
une dépendance physique de quelques mois, il est même
conseillé de commencer par le sevrage, qui peut se faire en
ambulatoire ou en hospitalier. En ambulatoire, il doit être ac-
compagné de nombreuses consultations de soutien et de
mises au point régulières. Le traitement se fera sur une quin-
zaine de jours, voire plus, selon les produits opiacés consom-
més (selon la demi-vie de la molécule).
Ce traitement contient des antalgiques de première généra-
tion (paracétamol et ibuprofène aux plus fortes posologies,
répartis sur toute la journée ; surtout pas de médicaments
antalgiques morphiniques ou de base morphiniques ou co-
déïnés) ; des antispasmodiques (Spasfon®aux plus fortes po-
sologies et répartis sur toute la journée) ; des antinauséeux
et/ou antidiarrhéiques ; des antispastiques (principalement le
Coltramyl®répartis sur la journée et pour la nuit) ; des anxio-
lytiques (si possible pas de benzodiazépine, de l’Atarax®et
du Tercian®en cp ou gouttes répartis sur la journée et pour
la nuit). Ce traitement au plus fort des posologies pendant
8 jours sera diminué progressivement jusqu’à 15 à 20 jours,
selon les signes de manque relatés par le patient.
Pluridisciplinarité obligatoire...
La première ligne d’intervention est représentée par les mé-
decins généralistes et les pharmaciens ; la deuxième par les
structures spécialisées et la troisième par les communautés
ou post-cures, le moment et l’histoire du sujet addict défi-
nissant le niveau d’intervention.
Ces traitements sont longs. Accepter de travailler dans le do-
maine des addictions est toujours, pour un professionnel du
soin, un engagement difficile. Cela suppose un investisse-
ment émotionnel et psychique important et du temps, à la fois
pour chaque séance et pour la prise en charge dans la durée
(comme pour toute pathologie chronique). Les résultats peu-
vent longtemps paraître médiocres par rapport à « la guéri-
son » attendue : il s’agit de suivre quelqu’un qui va sans cesse
se mettre en échec et mettre en échec le professionnel, très
souvent consommateur avant tout d’une demande de médi-
cament miracle, voire de « produit » miracle, avant de devenir
demandeur de soins. Il faut peu à peu travailler avec lui et
devenir un médecin ou pharmacien « médicaments ». Il y a
derrière ce comportement toujours une grande souffrance,
parfois une dépression grave. Il y a aussi souvent une très
grande immaturité (immédiateté, la substance chimique
comme panacée, absence de remise en cause, cadenassage
sur le présent avec impossibilité de se projeter, etc.), comme
si la personne était arrêtée à un stade de son éducation ou
n’en avait pas reçu les bases. Les produits sont alors comme
des béquilles pour vivre avec les autres. Cela nécessite tou-
jours une grande disponibilité psychique et temporelle de la
part des professionnels, ce qui n’empêche surtout pas de
savoir faire respecter le cadre qu’il faut poser ensemble
comme soignants travaillant en collaboration et ainsi se faire
respecter en tant qu’autre acceptant d’accompagner.
Ce qui se discute ou se négocie, ce sont les buts de ce cadre
que chacun s’engage à respecter et à tenir malgré les échecs et
la déception parfois : les limites que les soignants pensent pro-
tectrices d’abord pour la personne puis pour la société ; les
objectifs du soin qui peuvent se modifier au fur et à mesure du
parcours mais qui doivent toujours être précis et réalistes ; la
confiance entre les soignants et le patient car une relation d’aide
ne peut se fonder que sur une base de confiance partagée.
Intentionnellement, aucune distinction n’a été faite entre mé-
decins généralistes et pharmaciens. La pharmacie est aussi
un lieu de parole et d’écoute, parfois la première place où va
se dérouler, se dévoiler, un peu de vie du patient. La parole
quasi obligatoire avec le médecin peut faire peur ; avec le
médecin, il s’agit parfois seulement d’obtenir le médicament
miracle. Le pharmacien a souvent une place privilégiée pour
déceler les ruses mais aussi les soucis et les difficultés des
patients, soucis et difficultés que, parfois, ils n’osent pas dire
119mars 2014MÉDECINE
STRATÉGIES
Stratégies thérapeutiques
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
1
/
6
100%