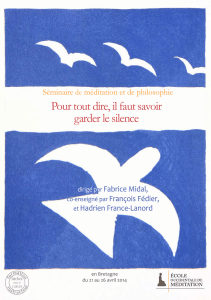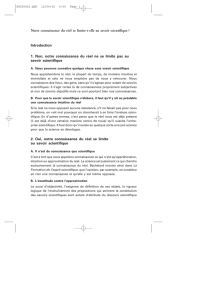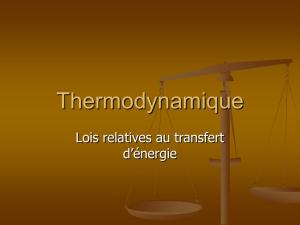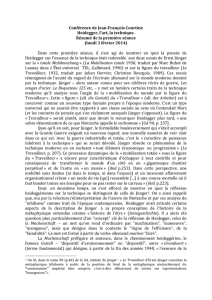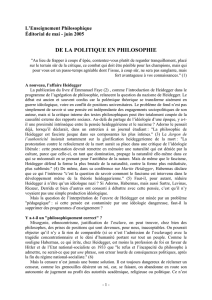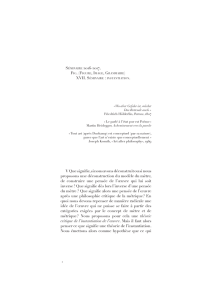Science et philosophie à l`époque du “tournant”

Science et philosophie à l’époque du “tournant”
Miguel de Beistegui
Le titre est, sinon polémique, du moins provocateur, et ce même s’il s’inspire
des propres paroles d’Heidegger. Le contexte dans lequel ces paroles s’inscrivent
n’est d’ailleurs pas neutre, et mériterait à lui seul une analyse détaillée, en ceci
qu’il établit de façon toute programmatique la nature d’un double rapport: celui,
tout d’abord – et c’est bien ce premier rapport qui nous occupera ici – de la
philosophie à la science ; et celui, ensuite, de la philosophie à l’art. Dans ses
leçons de 1929-30 intitulées Les Concepts fondamentaux de la métaphysique, soit
dans un texte qui précède le fameux « tournant », mais qui peut-être aussi
l’annonce, Heidegger nous enjoint de « simplement nous souvenir que l’art – qui
inclut aussi la poésie – est la sœur de la philosophie, tandis que toute science
n’est peut-être qu’au service (ein Dienstman) de la philosophie »1. S’il est vrai que
le ton de cette formule va peut-être plus loin que le fond de la pensée
d’Heidegger s’agissant du rapport de la pensée à la science à la fin des années
1920 (une pensée marquée, surtout dans le cours de 1929-30, par un esprit de
coopération avec la science, et la biologie en particulier2), il semble bien
annoncer ce qui fera une constante de la pensée du « tournant », la proximité, le
voisinage, voire les liens de consanguinité unissant la philosophie à l’art, et qui
contrastent tant avec la distance radicale, l’abîme infranchissable séparant la
pensée authentique de la science. Au-delà même de la position du seul Heidegger,
il faudrait évidemment s’interroger sur l’origine et les conséquences d’un tel
double rapport, sur ce qui lie une certaine phénoménologie à l’art et au Poétique,
et l’éloigne, sinon de la pensée ou de la Besinnung s’agissant de la science, du
moins de tout voisinage ou cousinage avec elle – fût-il à la mode de Bretagne. On
a parlé d’un tournant herméneutique de la pensée d’Heidegger et d’un tournant
théologique de la phénoménologie. Peut-être conviendrait-il de se poser aussi la
question de son tournant poétique, du moins de ce qui ressemble parfois fort à
un repli ou un recentrage de la phénoménologie sur le Poétique. N’est-ce pas trop
1. M. Heidegger, Die Grundbegirffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, Gesamtausgabe
Band 29/30, p. 7, trad. Daniel Panis, Les Concepts fondamentaux de la métaphysique. Monde –
Finitude – Solitude, Paris, Gallimard, 1992, p. 21.
2. S’agissant de cette question, on se reportera aux dernières pages de l’article de F. Dastur, ainsi qu’à
celui de Miguel de Beistegui consacré à « La philosophie et la biologie dans un esprit de
“coopération” ».

MIGUEL DE BEISTEGUI
46
vite qu’un tel repli a lieu, et ne convient-il pas de se demander si des possibilités
de pensée ne se tiennent pas en réserve dans la science elle-même ? Question à
notre sens déterminante, mais trop vaste pour être ici envisagée. Pour l’heure,
contentons-nous de cerner au plus près ce que Heidegger dit de la science à partir
des années 30, dans le sillage de ce qu’on appelle le « tournant » de sa pensée, en
prenant appui sur les textes contemporains de la pensée de la Technique. Est-ce
un hasard si le gros de cette réflexion s’agissant de la science, et des sciences de la
nature en particulier, se déploie sur fond de ce décor historico-destinal qu’est la
Technique ? C’est là que réside véritablement la singularité de cette pensée, ainsi
que sa force.
La science à la lumière de son essence
Dans la mesure où, sur notre chemin, les sciences doivent venir en question,
nous ne parlerons pas contre les sciences, mais pour elles, à savoir pour
élucider leur essence. Il y a là déjà la conviction que les sciences sont quelque
chose de positivement essentiel. Mais leur essence est d’autre sorte qu’on ne
veut le croire aujourd’hui encore dans nos Universités […], les sciences
aujourd’hui relèvent du seul domaine de l’essence de la technique1.
Cette citation décrit très précisément et de façon très ramassée la nature
fondamentale du rapport d’Heidegger aux sciences à partir du début des années
30. Il ne saurait s’agir pour la philosophie de « s’élever » au statut de science, et
cela signifie prendre pour modèle le paradigme physico-mathématique qui semble
avoir littéralement fasciné une si grande partie de la philosophie depuis Kant.
Même à l’époque où, dans le sillage de la philosophie comme science rigoureuse,
Heidegger se proposait de mettre au point une philosophie proprement
scientifique, à aucun moment l’ontologie phénoménologique n’était redevable de
sa scientificité aux sciences – fussent-elles naturelles ou humaines. Celle-ci devait
découler du but et de la méthode propres à la phénoménologie, et ne pouvait
être empruntée à des domaines qu’elle était censée fonder. Mais, comme
l’indique toujours très clairement notre citation, il n’est pas non plus question de
décréter que la philosophie n’a strictement rien à voir avec la science. Bien au
contraire. La philosophie, ou si l’on préfère la pensée au sens que lui donne
Heidegger, a tout à voir avec la science comprise comme événement et comme
phénomène, autrement dit comprise depuis son essence. Le sens du concept
d’essence est ici déterminant, et c’est bien lui qu’il va nous falloir cerner au plus
près, bien que progressivement. Si la philosophie se prononce au sujet de la
1. M. Heidegger, Was heisst denken?, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1954, p. 49, trad. Gérard
Granel. Qu’appelle-t-on penser ?, Paris, PUF, 1959, p. 87.

SCIENCE ET PHILOSOPHIE A L’EPOQUE DU « TOURNANT »
47
science, ce n’est pas contre elle, mais pour elle – et ce non à la manière de la
philosophie des sciences, qui parle peut-être en son nom et sous son autorité, et
qui tire son autorisation de pensée de la science elle-même, mais seulement dans
la mesure où elle et elle seule, en tant que pensée, peut se prononcer quant à
l’essence de la science. Parler pour la science, donc, ce n’est pas en parler pour la
défendre, ni pour la soutenir, c’est en parler afin d’en faire surgir ce qui, de soi-
même et au sein des sciences elles-mêmes jamais n’a droit de cité, à savoir son
essence, ou son être. C’est en parler précisément au moment où la science, elle,
est privée de mots, précisément afin de dévoiler ce qui, de la science, demeure
inaccessible à la science elle-même. Et c’est aussi et précisément dans ce
questionnement en direction de l’essence, que la pensée en tant que telle se
constitue. Autant dire, donc, que la science ne pense pas. C’est même cela qui fait
sa positivité, comme Heidegger le soulignait déjà dans ses travaux des années 20.
La pensée, elle, ne se soucie que d’essence, ne pénètre le domaine qui lui est
propre que dès lors que se pose la question de l’essence. Si la science est bien
capable – au prix d’une simple conversion que l’on appellera réflexion – de se
transformer en philosophie de la science, elle est impuissante, en tant que
science, à penser l’essence ou l’événement à partir duquel elle se déploie. Aussi, si
les sciences donnent matière à penser, et non simplement à débattre ou à
discuter, voire à clarifier ou critiquer ses concepts, si, autrement dit, elles
constituent un phénomène véritablement positif, c’est précisément dans la
mesure où elles ne pensent pas. Elles peuvent évidemment représenter, décrire,
mesurer, calculer, formaliser avec une précision extrême et toujours croissante.
Elles peuvent même se poser la question de leur propre fondement, et du bien-
fondé de leurs concepts, et devenir ainsi philosophie des sciences. Ce n’est pas
pour autant qu’elle pense, du moins au sens que Heidegger donne à ce terme.
Car la pensée, s’agissant de la science, n’intervient que dès lors que se pose la
question de son essence.
A ce stade, une objection semble s’imposer : cette essence, n’est-elle pas après
tout posée par la pensée, et ce en un geste aussi vieux que la philosophie elle-
même, et que, croyait-on, Nietzsche avait une fois pour toutes fait voler en éclat
en l’associant au fond même de la métaphysique nihiliste ? Ne reconnait-on pas,
dans l’entreprise heideggerienne, le fond de platonisme que Nietzsche s’évertua à
mettre en évidence et à combattre sa vie durant ? La pensée de l’essence ne
témoigne-t-elle pas de l’incapacité de la métaphysique à penser le devenir, et ne
parvient-elle pas à envisager celui-ci qu’en le niant ? L’essence n’introduit-elle pas
la fixité à la place du mouvant, l’identité à la place de la différence ? Et la
supériorité de la science vis-à-vis de la métaphysique ne réside-t-elle pas
précisément dans sa capacité à s’ouvrir à la complexité, l’évolution et l’extrême

MIGUEL DE BEISTEGUI
48
diversité de la nature et du vivant ? De telles objections seraient tout à fait
justifiées, si l’essence n’était pas chez Heidegger soumise à une refonte radicale,
et ne venait au bout du compte désigner la dimension même que son acception
classique semblait exclure, à savoir le devenir, l’événement, le déploiement. Par
Wesen, en effet, Heidegger n’entend pas tant la stabilité éidétique d’une quiddité
(Wassheit) que le comment (Wieheit) ou le mode d’être propre à un phénomène.
L’essence d’une chose, c’est avant tout l’horizon ou l’événement à partir duquel la
chose se déploie en son être, « l’envoi » depuis lequel la chose se trouve mise sur
sa lancée. Aussi, dès lors qu’il s’agit de penser la science en son essence, il ne
saurait être question d’en dégager une quiddité transhistorique à partir de
laquelle se dévoilerait son noyau éidétique. En tant que phénomène, la science a
un horizon événementiel irréductible dont elle provient et qui la dépasse, et
auquel Heidegger donne le nom de « vérité ».
Dans cette approche préliminaire de la science, une première conclusion
s’impose : l’essence de la science, dans la mesure où elle-même n’y a pas accès en
tant que science, n’est en elle-même rien de scientifique, et on ne saurait s’en
enquérir avec les moyens que fournit la science. Autant dire que la science
n’existe et ne se déploie qu’à partir d’un horizon qui reste résolument étranger
ou hétérogène à la pratique scientifique elle-même. Bref, il y a, au cœur même de
la science, quelque chose qui lui échappe en tant que science. Et c’est à ce
quelque chose que s’attache la pensée. Toute la difficulté, partant de là, est de
montrer comment un phénomène positif tel que celui de la science moderne
puise à la source d’un événement qui lui est hétérogène, dans le déploiement
duquel celui-ci s’efface tout en s’y abritant.
D’où la science moderne surgit-elle, donc, sinon d’une essence qui lui serait
donnée par avance, ou bien encore d’un passé vis-à-vis duquel elle constituerait
un progrès ? Où situer son essence, dès lors que celle-ci ne se laisse plus
confondre avec sa quiddité ? L’horizon événementiel auquel Heidegger reconduit
la science moderne comme à son essence est la Technique. Mais là encore, il ne
s’agit pas tant de la technique en tant qu’ensemble et histoire des techniques, ni
même de la technique en tant que phénomène global contemporain (la
technologie). Il s’agit de la technique en son essence. La naissance de la science
moderne n’est, aux yeux d’Heidegger, qu’un phénomène second et dérivé, dont
l’origine se cache dans l’essence de la technique qui, selon le propre dire
d’Heidegger, n’est elle-même nullement technique. Aussi, si la science est bien
fondamentalement techno-science, reste-t-il encore à dire ce qui fait la nécessité
d’un tel enchaînement. La science et la technique s’entr’appartiennent (gehören
zusammen), mais uniquement sur fond d’une essence qui leur est hétérogène,
c’est-à-dire qui ne leur ressemble pas, qui n’est en rien semblable à ce qu’elle

SCIENCE ET PHILOSOPHIE A L’EPOQUE DU « TOURNANT »
49
engendre. Entre l’essence et le phénomène, la condition et le conditionné, il y a
donc un rapport qui n’est pas d’identification, mais de différenciation : un rapport
différenciant et différencié. C’est le mouvement de cette différence qui constitue
le domaine propre à la pensée. La pensée pense depuis cette différence, et se
distingue de la science en ce que celle-ci déploie sa puissance d’intelligibilité
depuis le différencié, ou le conditionné, sans remonter jusqu’au différenciant de
et dans la différence. Autant dire que la science reste sourde à la différence en tant
que telle, et ce même si elle pense ce qui s’ouvre depuis et dans la différence,
qu’elle ne commence que là où s’achève, ou bien se résout, la différence. La
pensée est séparée de la science par l’abîme de l’essence, ou, si l’on veut, par la
puissance différenciante de la différence.
S’enquérir de l’essence de la science, c’est donc assumer un parcours,
effectuer un retour amont en direction non d’un moment ni d’un phénomène,
mais de ce qui, dans le phénomène ici en question, s’agite comme son envoi ou
son destin, comme sa dimension d’être qui, arrivant dans le phénomène, l’a
pourtant d’emblée dépassé, et y aboutissant, ne s’y réduit pourtant jamais. Un tel
programme suppose évidemment la transformation ou le tournant de la pensée
de l’être, qui voit son centre de gravité basculer du Dasein (et de son historicité)
vers une dimension proprement historiale de l’être lui-même, et en laquelle
l’homme se voit assigner une place et un rôle précis. Afin de suivre ce parcours,
reportons-nous tout d’abord à la conférence que Heidegger fit en 1938, et publiée
sous le titre « L’époque des conceptions du monde » (Die Zeit des Weltbildes).
« L’époque de l’image du monde » constituerait peut-être une traduction plus
fidèle, en ceci qu’elle soulignerait notre époque comme celle où le monde est
porté au statut d’image. Les toutes premières phrases de ce texte énoncent
clairement la communauté d’essence liant la science moderne à la technique :
Un phénomène essentiel des Temps Modernes est la science. Un phénomène
non moins important est la technique mécanisée (die Maschinentechnik). Il
ne faut pourtant pas mésinterpréter celle-ci, en le comprenant que comme
pure et simple application, dans la pratique (auf die Praxis), des sciences
mathématisées de la nature. La technique est au contraire elle-même une
transformation autonome de la pratique (Praxis), de telle sorte que c’est
plutôt elle, la pratique, qui requiert l’usage des sciences mathématiques de la
nature. La technique mécanisée reste jusqu’ici le prolongement le plus visible
de l’essence de la technique moderne, laquelle est identique à l’essence de la
métaphysique moderne1.
1. M. Heidegger, Holzwege, Frankfurt-am-Main, Vittorio Klostermann, 1950, p. 69, trad. Wolfgang
Brokmeier, Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962 , p. 99-100. Désormais Hw, suivi
de la pagination allemande et française.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%