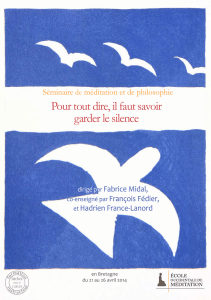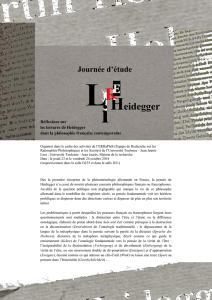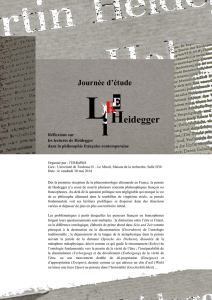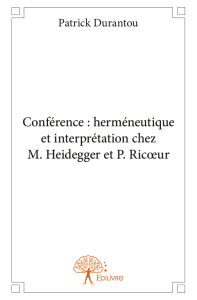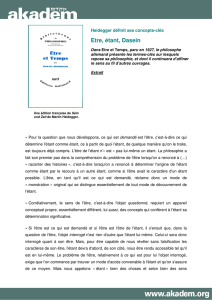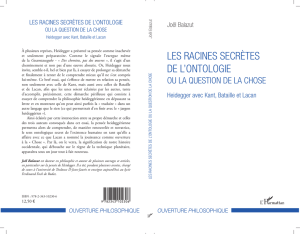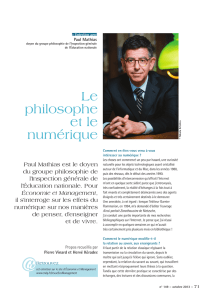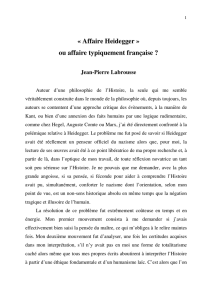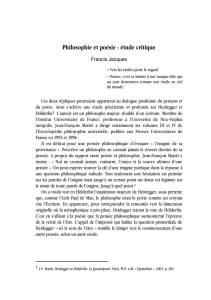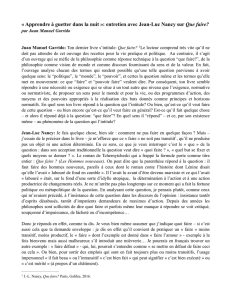de la politique en philosophie

- 1 -
L’Enseignement Philosophique
Éditorial de mai - juin 2005
DE LA POLITIQUE EN PHILOSOPHIE
"Au lieu de frapper à coups d’épée, contentez-vous plutôt de regarder tranquillement, placé
sur le terrain sûr de la critique, ce combat qui doit être pénible pour les champions, mais qui
pour vous est un passe-temps agréable dont l’issue, à coup sûr, ne sera pas sanglante, mais
fort avantageuse à vos connaissances." (1)
A nouveau, l’affaire Heidegger
La publication du livre d’Emmanuel Faye (2) , comme l’introduction de Heidegger dans le
programme de l’agrégation de philosophie, relancent la question du nazisme de Heidegger. Le
débat est ancien et souvent confus car la polémique théorique se transforme aisément en
guerre idéologique, voire en conflit de positions universitaires. Le problème de fond n’est pas
simplement de savoir si une pensée est indépendante des engagements sociopolitiques de son
auteur, mais si la critique interne des textes philosophiques peut être totalement coupée de la
causalité externe des rapports sociaux. Au-delà du partage de l’idéologie d’une époque, y a-t-
il une proximité intrinsèque entre la pensée heideggérienne et le nazisme ? Adorno le pensait
déjà, lorsqu’il déclarait, dans un entretien à un journal étudiant : "La philosophie de
Heidegger est fasciste jusque dans ses composantes les plus intimes." (3) Le Jargon de
l’authenticité insistait notamment sur la glorification heideggerienne de la mort : "La
protestation contre le refoulement de la mort aurait sa place dans une critique de l’idéologie
libérale : cette protestation devrait remettre en mémoire une naturalité qui est déniée par la
culture, parce que celle-ci, en tant que domination, propage la naturalité elle-même dans ce
qui se méconnaît en se prenant pour l’antithèse de la nature. Mais de même que le fascisme,
Heidegger défend la forme la plus brutale de la naturalité, contre la forme plus médiatisée,
plus sublimée." (4) De même, dans sa conférence sur Martin Heidegger, Habermas déclare
que ce qui l’intéresse "c’est la question de savoir comment le fascisme est intervenu dans le
développement même de la théorie heideggerienne." (5) Faut-il, pour autant, réduire
Heidegger à n’être qu’un idéologue nazi ? Si Adorno, Habermas, mais aussi Sartre, Levinas,
Ricœur, Derrida et bien d’autres ont consenti à débattre avec cette pensée, c’est qu’il n’y
voyaient pas une simple production idéologique.
Mais la question de l’interprétation de l’œuvre de Heidegger est minée par un problème
"pédagogique" : si cette pensée est contaminée par une idéologie dangereuse, faut-il la
supprimer des programmes d’enseignement ?
Y a-t-il un "philosophiquement correct" ?
Misogynie, ethnocentrisme, justification de l’esclave, on peut trouver, chez bien des
philosophes, des prises de positions qui sont devenues, pour nous, inacceptables. On pourrait
objecter qu’il n’y a là rien de comparable (si ce n’est l’admission de l’esclavage) avec la
tragédie concentrationnaire et le déni d’humanité portant sur tout un peuple. Comme le
souligne Habermas, ce qui irrite, chez Heidegger, est moins la profession de foi en faveur de
Hitler et de l’Etat national-socialiste en 1933 que "le refus et l’incapacité du philosophe à
admettre, ne serait-ce que par une phrase, son erreur lourde de conséquences politiques, après
la fin du régime national-socialiste." (6)
Mais la censure n’est jamais une bonne solution. Il est toujours dangereux de réclamer un
censeur, comme les grenouilles désirent un roi, car, se faisant, on abandonne en route son
autonomie de jugement au profit des autorités académique, religieuse ou politique. Ce n’est

- 2 -
pas en mettant à l’index l’œuvre de Heidegger que l’on se débarrassera du problème qu’elle
pose. A-t-on si peu confiance au jugement et à l’esprit critique des professeurs pour décider à
leur place si tel ou tel philosophe est correct pour les élèves ou les étudiants ? Il revient à
chaque enseignant d’assumer la responsabilité de l’usage de tel ou tel auteur qu’il souhaite le
plus approprié pour son cours. Si l’enseignement philosophique en classe terminale n’est pas
un enseignement d’histoire de la philosophie, le professeur ne peut se dispenser de faire
comprendre aux élèves les contextes d’une pensée et son enracinement temporel.
L’invitation de M. Faye par la régionale APPEP de Paris a semblé jeter un certain trouble.
Rappelons que demander à un auteur d’exposer ses travaux à des collègues, dans un débat
contradictoire, ne vaut pas adhésion à ses thèses. Il n’a jamais été question pour l’APPEP de
réclamer la suppression de Heidegger de la liste des auteurs du programme, mais
d’encourager plutôt tout débat de fond sur les enjeux de la pensée philosophique en se gardant
des invectives et des jeux de pouvoir. Toute velléité de censure de tel ou tel philosophe
s’apparenterait à une police de la pensée que l’APPEP ne saurait cautionner.
Edouard Aujaleu
Président de l’APPEP
Le 28 juin 2005
(1) Kant, Critique de la raison pure, PUF, p. 512
(2) Emmanuel Faye, l’introduction du nazisme dans la philosophie, Albin Michel
(3) Diskus, janvier 1963.
(4) Adorno, Jargon de l’authenticité, Payot, p. 149
(5) J. Habermas, Le discours philosophique de la modernité, Gallimard, p. 185
(6) Id. p. 184
1
/
2
100%