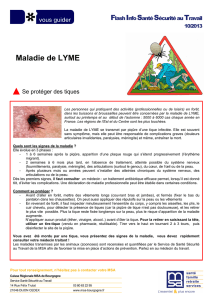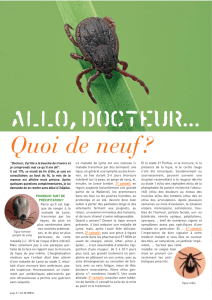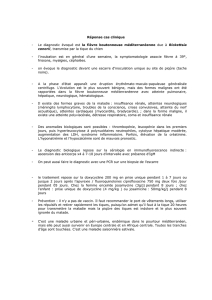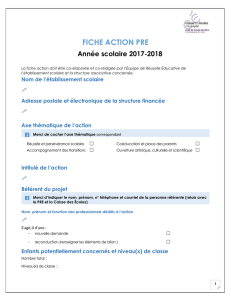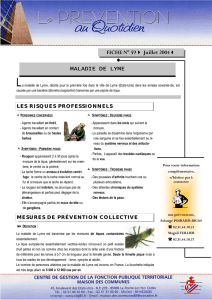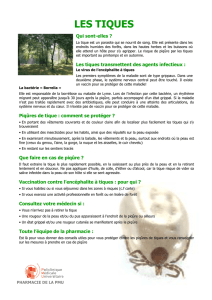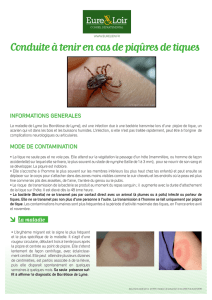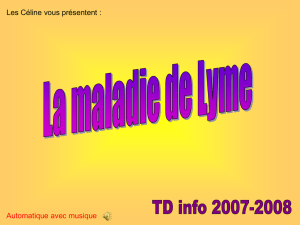Analyses génétiques des cancers héréditaires

ARTICLE ORIGINAL
Analyses ge
´ne
´tiques des cancers he
´re
´ditaires : aspects motivationnels
et psychopathologiques
Motivational and psychopathological aspects of genetic analyses of hereditary
cancers
C. Fantini J.-L. Pedinielli S. Manouvrier
Re
´sume
´:L’oncoge
´ne
´tiqueestunedisciplinere
´cente dont le
but est l’identification des pre
´dispositions ge
´ne
´tiques a
`
certaines formes de cancers. Elle s’adresse aux individus
symptomatiques pour lesquels se pose la question d’une
alte
´ration ge
´ne
´tique dont l’identification facilitera alors la
re
´alisation de diagnostics pre
´symptomatiques chez les pro-
positus. L’inte
´re
ˆt de ces diagnostics re
´side dans la surveillance a
`
proposer de
`s lors qu’une mutation familiale est identifie
´e. Si les
analyses ge
´ne
´tiques permettent d’anticiper le risque de
de
´velopper un cancer et de diminuer la mortalite
´par le recours
a
`des protocoles de surveillances spe
´cifiques, elles offrent
e
´galement la possibilite
´de se soustraire a
`ces examens lourds
tant physiquement que psychiquement.
Ces dernie
`res anne
´es ont vu s’ouvrir tout un pan de
recherches sur les de
´pistages des cancers he
´re
´ditaires dans
une de
´marche d’ame
´lioration des pratiques.
L’objectif de cet article est d’une part de proposer un tour
d’horizon des diffe
´rents travaux qui ont permis de mieux
comprendre les facteurs motivationnels, e
´motionnels, ainsi
que leurs concomitants pour, d’autre part, conclure sur les
aspects spe
´cifiques des consultations psychologiques au sein
des services d’oncoge
´ne
´tique.
Mots-cle
´s:De
´pistages ge
´ne
´tiques – Motivation – De
´tresse –
Cancers he
´re
´ditaires.
Abstract: Molecular analyses are new diagnoses in the field of
oncology, allowing identification of susceptibility genes for
hereditary cancer syndromes. Genetic advances have led to new
approaches to the assessment of cancer risk and prevention
recommendations for affected subjects and for currently
healthy individuals concerned by family cancer history.
Mutation detection provides carriers with the possibility of
adopting specific preventative strategies and alleviates non
carriers from medical examinations which are physically and
psychologically heavy.
This new procedure in oncology practice raises many
questions that are addressed in the growing literature in
this area.
Our purpose is first to draw up a general survey of the
various published studies about the motivational, emotio-
nal and concomitant factors underlying genetic testing and
secondly to address psychological practice in a medical
genetic service for hereditary cancer diagnoses.
Keywords: Genetic testing – Motivation – Distress – Anxiety –
Hereditary cancer.
Les diagnostics ge
´ne
´tiques impliquent invariablement un
retour sur la transmission et la filiation, transmission d’un
patrimoine ge
´ne
´tique mais aussi transmission d’une histoire,
d’un destin, fait de croyances, de rapprochements
Dossier :
«Oncoge
´ne
´tique »
Carole Fantini ()
Psychologue clinicienne, doctorante, universite
´de Provence.
UFR de psychologie, Laboratoire PsyCLe
´, psychologie de la connaissance,
du langage et de l’e
´motion,
Aix-en-Provence.
Ho
ˆpital Jeanne-de-Flandres
Service de ge
´ne
´tique clinique
CHRU Lille
59037 Lille Cedex
E-mail : cfantini@wanadoo.fr
J.-L. Pedinielli
Professeur de psychopathologie et clinique.
UFR de psychologie, Laboratoire PsyCLe
´, Psychologie de la connaissance,
du langage et de l’e
´motion,
Aix-en-Provence.
S. Manouvrier
Professeur de ge
´ne
´tique clinique. Ho
ˆpital Jeanne-de-Flandres. CHRU Lille.
Rev Francoph Psycho-Oncologie (2006) Nume
´ro 1: 27–33
©Springer 2006
DOI 10.1007/s10332-006-0118-2

Compte tenu de l’histoire familiale, les sujets suspectent
souvent la nature he
´re
´ditaire des cancers, l’identification d’un
ge
`ne familial apportant une information qui les conforte dans
leur croyance initiale. Ainsi, ces de
´marches sont complexes,
douloureuses et il importe d’identifier les me
´canismes qui
concourent a
`laprisedede
´cision quant a
`la re
´alisation d’un test
ge
´ne
´tique, ainsi que ceux qui sont inhe
´rents a
`l’adaptation a
`
court et long terme. Nous nous proposons ici de dresser un e
´tat
des travaux significatifs qui ont contribue
´a
`nous e
´clairer sur ces
pratiques re
´centes.
Les e
´tudes motivationnelles ont montre
´que les sujets
s’inscrivant dans une telle de
´marche visaient plusieurs
objectifs [9,19] qui sont :
1. Le besoin d’information pour la descendance ;
2. La ne
´cessite
´de re
´duire l’incertitude ;
3. Le besoin de prendre des de
´cisions quant au mariage
etautrestyledevie;
4. La modification e
´ventuelle des comportements en
lien avec la sante
´;
5. L’obtention d’informations pour re
´duire les surveil-
lances me
´dicales.
Outre les facteurs explicites de
´crits ci-dessus, la motivation
qui sous-tend l’inscription dans une de
´marche de recherche
ge
´ne
´tiquesemblee
´troitement lie
´ea
`des concomitants
implicites, de nature cognitive et/ou e
´motionnelle.
Le sentiment de vulne
´rabilite
´(ou susceptibilite
´) personnelle
face au cancer, les be
´ne
´fices, les barrie
`res perc¸ues a
`la re
´alisation
du test, de me
ˆmequelepessimismeontuneinfluencesurle
de
´sirdeparticipera
`un de
´pistage ge
´ne
´tique[7]. Ces variables
influent directement sur l’intention de consulter, me
´diatisent les
effets de l’a
ˆge et de l’histoire familiale de cancer. Si les sujets a
ˆge
´s
de50ansetplussemontrentplusenclinsa
`consulter, c’est en
raison d’une perception accrue de leur sentiment de vulne
´ra-
bilite
´personnelle,comptetenudeleurplusgrandeexposition
aux sujets atteints par la maladie dans la famille, alors que les
sujets plus jeunes tendent a
`mettre en avant l’importance d’une
de
´marche active vis-a
`-vis de l’information me
´dicale. Ne
´an-
moins, ces derniers se diffe
´rencient de leurs aı
ˆne
´s puisqu’ils ne
manifestent qu’un inte
´re
ˆt envers ces consultations, les sujets
a
ˆge
´s consultant effectivement [23], ce qui e
´taye la re
´alite
´du
de
´calage entre intention et re
´alisation effective.
L’investissement dans ces protocoles semble par ailleurs
tributaire de la perception du sujet quant a
`ses capacite
´sa
`faire
face a
`un mauvais re
´sultat d’une part, et, d’autre part, a
`la
perception des risques que les participants tendent a
`conside
´rer
comme e
´leve
´s [12]. Cette dernie
`re n’est cependant pas lie
´ea
`
l’importance de l’histoire familiale de cancer mais serait
fortement corre
´le
´ea
`la peur de la maladie, elle-me
ˆme influence
´e
par l’anxie
´te
´en tant que caracte
´ristique de personnalite
´[14]. De
me
ˆme, il semblerait que le fait d’e
ˆtre ce
´libataire ou divorce
´,sans
emploi et de niveau d’e
´ducation moindre soit des e
´le
´ments
de
´favorables a
`la poursuite d’un de
´pistage ge
´ne
´tique [1].
La prise en compte de l’ensemble des facteurs qui incitent a
`
consulter reste relativement complexe du fait de la multiplicite
´
des variables implique
´es. Toutefois, l’e
´tude des pre
´disposi-
tions ge
´ne
´tiques aux cancers he
´re
´ditaires renvoie invaria-
blement a
`la transmission familiale, transmission qui inte
´resse
un double registre : la transmission d’un patrimoine biolo-
gique d’une part mais aussi la transmission, la diffusion de
cette information dont on imagine combien elle peut s’ave
´rer
difficile tant pour l’informant que pour l’informe
´.Lamanie
`re
dont celle-ci est transmise [13], la position familiale de
l’individu qui informe ainsi que l’existence de liens biologi-
ques entre l’informant et l’informe
´vont augmenter la
signification personnelle de l’information de
´livre
´e et influer
sur le recours a
`une consultation [35].
Ces facteurs motivationnels sont lie
´sa
`l’histoire et aux
caracte
´ristiques personnelles des sujets qui consultent. Il est
inde
´niable que ces derniers, s’ils influencent le recours a
`ces
consultations, conditionnent indirectement les re
´ponses
adaptatives qui feront suite a
`l’annonce du re
´sultat ge
´ne
´tique.
Aspects e
´motionnels et implications des
consultations d’oncoge
´ne
´tique
Larencontreaveclege
´ne
´ticien est un moment peu ordinaire,
un rendez-vous avec l’histoire du sujet, avec l’histoire de sa
famille, frappe
´e par quelque obscur phe
´nome
`ne, affectant bon
nombre d’individus sur son passage. Cette consultation,
compte tenu de son objectif initial, impose au sujet de faire
un effort de reme
´moration douloureux qui peut faire effraction
avec ce que le sujet redoute, avec les repre
´sentations qu’il tente
de mettre a
`distance et de refouler. En effet, la construction de
l’arbre ge
´ne
´alogique renvoie immanquablement a
`sa propre
position dans la ligne
´e familiale. De fait, l’individu appartient-il
a
`la branche saine ou non ? Lorsque la consultation s’inscrit
non plus dans une vise
´epre
´dictive, elle vient alors confirmer
l’appartenance du sujet a
`une ligne
´e frappe
´e de malheur,
malchance ou male
´diction (la structure de l’arbre avec ses
symboles et ses figures noircies frappe d’emble
´elesujetqui,
selon l’importance des figures grise
´es,serendcomptedes
ravages produits par la maladie familiale), et rappelle la
possible transmission aux descendants.
L’explication de cette particularite
´familiale est rarement
envisage
´e comme le fruit du hasard. Les premie
`res inter-
pre
´tations sont certes souvent empreintes de notions
d’he
´re
´dite
´, mais elles viennent co
ˆtoyer d’autres interpre
´tations
pour le moins plus fantaisistes ou naı
¨ves [34], ce qui donne
une coloration particulie
`re au discours du sujet et a
`la
rencontre. Enfin, si la demande du sujet qui consulte semble
e
´vidente pour le ge
´ne
´ticien, a
`savoir la connaissance du statut
biologique et par voie de conse
´quence l’estimation du risque,
celle-ci n’est peut-e
ˆtre pas toujours aussi claire pour le sujet, ni
me
ˆme formule
´e en ces termes. Cet aspect des consultations
pose ainsi le proble
`me du sens re
´el de la de
´marche du sujet et
impose de savoir l’e
´couter, l’entendre et le reconnaı
ˆtre [21]. Le
re
´sultat ge
´ne
´tique ne peut e
ˆtre annule
´une fois de
´livre
´.Il
importe alors de reconnaı
ˆtre cette demande afin de ne pas
consentir a
`de
´livrer une information que le participant n’est
28

pas venu chercher, sa demande e
´tant ailleurs. La demande
manifeste (connaı
ˆtre son statut, le risque de transmission)
peut masquer une demande plus latente (quant a
`la culpabilite
´,
la mort, l’appartenance a
`une ligne
´e).
L’annonce du re
´sultat n’est jamais anodine et, ce, quelle
que soit la nature de celui-ci (favorable, de
´favorable ou non
informatif). Cette annonce vient achopper sur les diffe
´rentes
repre
´sentations du patient et engendrer un certain nombre
d’e
´motions lie
´es a
`ces repre
´sentations. Le diagnostic avance
´
impose un important remaniement dans la fac¸on de se
percevoir, de se projeter dans l’avenir avec un nouveau statut
«me
´dical ». Ce statut interpelle dans la mesure ou
`il inscrit le
sujet dans une nouvelle dimension, celle de l’e
ˆtre « a
`risque ».
D’ailleurs, bon nombre des consultants se conside
`rent « a
`
risque », eu e
´gard a
`leur histoire familiale. Celle-ci les pousse a
`
s’approprier ou pluto
ˆta
`de
´velopper des mode
`les personnels
d’explications (le stress, la pollution, l’alimentation, la
ressemblance physique et/ou psychologique, la proximite
´
avec le ou les malades). Ces mode
`les nous semblent
particulie
`rement importants dans la mesure ou
`ils peuvent
moduler les re
´actions e
´motionnelles des individus a
`l’annonce
du diagnostic. Une femme convaincue (de
´ni, de
´ne
´gation ?)
quelamaladienefrappequelaligne
´e masculine ne re
´agira
vraisemblablement pas a
`l’annonce de la pre
´sence d’une
mutation comme telle autre n’ayant pas e
´labore
´un mode
`le
explicatif fonde
´sur la diffe
´rence des sexes.
Les e
´tudes disponibles sur l’issue e
´motionnelle des cancers
he
´re
´ditaires sont ancre
´es dans une tradition me
´dicale plus que
dans une tentative d’interpre
´tation psychopathologique, du
fait de la jeunesse d’un domaine d’e
´tude qui laisse doucement
pe
´ne
´trer le savoir psychologique dans un univers biotechno-
logique de pointe.
Vernon [36] s’est inte
´resse
´e aux caracte
´ristiques psy-
chologiques des patients atteints de cancers colorectaux qui
se soumettaient a
`une analyse ge
´ne
´tique, donc en amont de
l’annonce des re
´sultats. La pre
´valence des troubles de
´pressifs
e
´tait de 24 % supe
´rieure a
`celle de sujets non institutionna-
lise
´s, mais ne
´anmoins infe
´rieure a
`celle qui est observe
´e chez
les patients somatiques. L’inte
´re
ˆt de ce travail re
´sidait en
outre dans l’identification des facteurs e
´troitement lie
´sa
`la
de
´tresse e
´motionnelle, a
`savoir un faible niveau d’e
´ducation
(lie
´a
`l’anxie
´te
´et a
`la de
´pression), et l’appartenance au sexe
fe
´minin (de
´pression). Les sujets de
´pressifs rapportaient un
support social moindre et une moindre satisfaction, sans que
l’on puisse toutefois affirmer que ces crite
`res soient des
pre
´dicteurs de la de
´pression dans la mesure ou
`ils font partie
de la constellation de
´pressive et sont donc ge
´ne
´ralement
significatifs dans ces populations. L’anxie
´te
´e
´tait e
´galement
lie
´ea
`la faiblesse du support social ainsi qu’a
`l’a
ˆge (les sujets
jeunes seraient plus enclins a
`manifester des re
´actions
anxieuses).
Ces associations sont importantes dans la mesure ou
`
des e
´tudes ont montre
´qu’un bas niveau d’e
´ducation et
l’existence de difficulte
´spsychologiquesavaientdeseffets
directs et indirects sur la compre
´hension de l’information
diagnostique, les recommandations en termes de suivi
ainsi que la motivation a
`se soumettre a
`une surveillance
relativement lourde [25, 27]. En effet, un niveau de de
´tresse
trop e
´leve
´ou trop faible peut conduire a
`un e
´vitement des
examens en rapport avec les cancers he
´re
´ditaires.
L’e
´tat e
´motionnel est un e
´le
´ment reconnu comme e
´tant
d’importance dans l’ajustement aux situations aversives,
tant au travers de la compre
´hension des informations que
de la mise en œuvre des me
´canismes d’ajustement. Or, les
niveaux de de
´tresse pre
´alables aux consultations sont
relativement e
´leve
´s, oscillant entre 15 et 28 %, ce qui pose
donc la question de l’assimilation du statut ge
´ne
´tique a
`
l’issue du test et ainsi de la qualite
´de vie [20,36].
Aktan-Collan [3], au cours d’une e
´tude prospective portant
sur les conse
´quences des tests pre
´dictifs, a note
´une e
´le
´vation
des scores d’anxie
´te
´a
`l’issue des re
´sultats chez les porteurs de la
mutation par comparaison a
`leur niveau initial. Cette majora-
tion de l’anxie
´te
´e
´tait surtout conse
´cutive a
`l’annonce du
re
´sultat, avec un retour au niveau de base environ un mois plus
tard. De me
ˆme, les sujets non porteurs voient leur niveau de
de
´tresse diminuer significativement a
`l’annonce du re
´sultat. Ces
re
´sultats sont conformes a
`ceux qui ont e
´te
´obtenus au cours
d’une pre
´ce
´dente recherche [1] et mettent en lumie
`re l’impact
e
´motionnel que la de
´marche en ge
´ne
´tique suscite, de me
ˆme que
l’effet anxioge
`ne de l’annonce d’un re
´sultat de
´favorable a
`court
terme, et ce d’autant que la plupart des sujets estiment avoir
besoin de soutien a
`ce moment. Me
ˆme si l’annonce d’un re
´sultat
positif entraı
ˆne ge
´ne
´ralement un accroissement de l’intensite
´de
l’anxie
´te
´ou de la de
´pression [14,31,33], certains auteurs
obtiennent des re
´sultats contradictoires. Il semblerait que les
tests pre
´dictifs profitent surtout aux sujets non porteurs de la
mutation, en termes de diminution de l’intensite
´des affects [30]
alors que les porteurs ne se caracte
´risent pas toujours par une
e
´le
´vation de leur de
´tresse [9], ce qui contraste avec d’autres
e
´tudes mene
´es jusqu’alors [3].
L’absence d’effet de
´montre
´du statut ge
´ne
´tique a incite
´
certains chercheurs a
`allerplusloindansl’explicationdes
re
´actions de
´le
´te
`res observe
´es chez certains sujets. En effet,
il nous semble rapide de conclure que les de
´pistages
ge
´ne
´tiques ne soule
`vent pas de proble
`mes d’adaptation
particuliers sur la base des e
´tudes quasi e
´pide
´miologiques
dont on sait qu’elles ne peuvent rendre compte de la re
´alite
´
psychique, le risque e
´tant de conside
´rer ha
ˆtivement que
ces pratiques ne ne
´cessitent plus de pre
´cautions particu-
lie
`res. Il s’agit, de plus, d’une simplification fonde
´e sur des
e
´carts statistiques qui conduisent a
`souvent ne
´gliger la
fre
´quence des troubles e
´motionnels dans ces populations.
Vers des conceptions bio-psychosociales
Les e
´tudes e
´pide
´miologiques se sont ave
´re
´es peu e
´clairantes
compte tenu de leur e
´chec relatif a
`affirmer l’existence de
conse
´quences e
´motionnelles face a
`ces pratiques qui,
cliniquement, sont lourdes de sens et rarement de
´nue
´es de
manifestations affectives chez le sujet consultant. Les re
´sultats
29

mole
´culaires obtenus n’expliquent qu’une faible part des
re
´actions affectives constate
´es. En effet, plus que le fait d’e
ˆtre
«a
`risque », il semblerait que ce soient les caracte
´ristiques
psychosociales de l’individu qui, directement ou indirecte-
ment, conduisent a
`des troubles psychologiques.
Certains chercheurs [10,11] se sont inte
´resse
´sa
`l’impor-
tance de l’e
´valuation subjective des risques de cancers, ce qui
ouvre la voie a
`d’autres interrogations portant spe
´cifiquement
sur les repre
´sentations des patients. Ils pointent la coexistence
de repre
´sentations objectives avec celles plus naı
¨ves, per-
sonnelles, qui tendent a
`persister malgre
´l’information
me
´dicale de
´livre
´e. Dans une me
ˆme perspective, malgre
´la
transmission d’une information objective, la plupart des
patients inscrits dans des de
´pistages ge
´ne
´tiques des cancers
mammaires ou colorectaux continuent de surestimer leur
risque de cancers au cours de la vie [26], posant ainsi la
question de l’appropriation des probabilite
´s, qui n’e
´chappe
pas a
`la subjectivite
´du sujet [6].
Ces re
´sultats tendent a
`montrer que la persistance des
croyances sous-jacentes n’est pas modifie
´e par la divulgation
d’une information objective et scientifique et qu’il convient
ainsi d’en tenir compte dans le suivi propose
´a
`ces patients.
Si les e
´tudes montrent peu d’impact des tests ge
´ne
´tiques,
certains auteurs y ont vu l’effet d’une auto-se
´lection, ces sujets
e
´tant pre
´sume
´splusendurantsetmoinsvulne
´rables. Michie
[31] a pointe
´l’importance de l’estime de soi et de l’optimisme
comme facteurs expliquant une grande partie de la variance de
l’anxie
´te
´, comme d’autres ont pu e
´voquer la force du Moi. Il
apparaı
ˆt que les individus confronte
´sa
`de telles menaces
peuvent avoir mis en place un certain nombre de strate
´gies
de
´fensives afin de « parer » a
`celles-ci et, ce, bien avant la
re
´alite
´de la de
´marche de de
´pistage ge
´ne
´tique. De plus, le motif
du de
´pistage pourrait e
´galement e
ˆtre un facteur mode
´rateur de
la re
´action e
´motionnelle a
`l’issue des re
´sultats. En effet, le de
´sir
de re
´duire l’incertitude quant au devenir est associe
´a
`une nette
diminution de l’anxie
´te
´et des pense
´es intrusives, y compris
lorsque le sujet est confronte
´a
`un re
´sultat de
´favorable [9].
D’un point de vue pragmatique cependant, ces consulta-
tions sont difficiles notamment dans la gestion des affects
qu’elles soule
`vent de part et d’autre. La pre
´sencedeces
manifestations chez les patients pourrait e
ˆtre autant d’e
´le
´ments
sur lesquels nous appuyer pour appre
´hender les effets adverses
de ces consultations. En effet, les sujets qui tendent a
`
manifester des re
´actions anxieuses a
`l’e
´vocation de l’histoire
familiale et des implications du test sont peut-e
ˆtre ceux qui
finalement anticipent le re
´sultat de celui-ci ; ce qui a pu e
ˆtre
associe
´a
`une meilleure adaptation [17]. A
`l’inverse, les sujets
qui expriment peu ou pas de re
´actions seraient plus
susceptibles de recourir a
`des me
´canismes de de
´fense de type
de
´ni ou e
´vitement, ce qui aurait pour effet de mettre a
`distance
les conse
´quences e
´motionnelles a
`court terme. La question
se pose alors des conse
´quences de ces me
ˆmes me
´canismes en
cas d’effraction due a
`l’apparition de la maladie, reposant alors
la question de l’impact de ces tests, qui finalement pourrait se
re
´ve
´ler a
`chaque examen de surveillance.
Dans la perspective d’une anticipation des re
´sultats ou de
leurs conse
´quences, les recherches en oncoge
´ne
´tique tendent a
`
montrer que la de
´tresse pre
´alable au test est un des meilleurs
pre
´dicteurs des re
´ponses e
´motionnelles a
`l’issuedecelle-ci[18],
sachant que la pre
´valence des troubles anxieux et de
´pressifs est
plus importante qu’en population ge
´ne
´rale, comme nous
l’avons e
´voque
´plus haut. Ainsi, certains chercheurs ont utilise
´
une mesure des pense
´es intrusives, entendues comme re
´ve
´la-
trices d’un e
´tat anxieux sous-jacent, en tant que pre
´dicteurs des
issues aux de
´pistages ge
´ne
´tiques. Ces variables sont lie
´es a
`la
de
´tresse e
´motionnelle et peuvent e
ˆtre pre
´ditesparlerecoursau
style de coping centre
´sur la recherche d’information ; style
implique
´dans la surestimation des risques perc¸us, connus
pour engendrer une de
´tresse e
´motionnelle plus importante
[32]. Cependant, a
`l’instar de ce que nous observons dans les
diffe
´rentes recherches d’impact, Meiser [30] ne retrouve pas
d’interaction entre le style « haut moniteur » (strate
´gie dirige
´e
vers la recherche d’information) et le fait d’e
ˆtre porteur de la
mutation sur la de
´tresse alors que les patients qui adoptent ce
style de strate
´gied’ajustementsontsouventperc¸us comme
plus vulne
´rables.
Le statut ge
´ne
´tique n’est donc pas conside
´re
´comme un
pre
´dicteur unique des re
´ponses e
´motionnelles. Plusieurs
facteurs semblent implique
´sdanslamode
´ration ou la
me
´diation de ces re
´ponses :
Certains sujets se trouvent dans un e
´tat d’alerte lie
´au
risque d’e
ˆtre porteur et anticipent un re
´sultat de
´favorable,
en tant que strate
´gie de
´fensive pre
´alable a
`l’annonce re
´elle
(fonction d’atte
´nuation).
Les strate
´gies d’ajustement ou de coping (coping
e
´vitant, e
´motionnel vs coping actif, centre
´sur le pro-
ble
`me), peu e
´tudie
´es, peuvent s’interposer pour minimiser
l’impact re
´el des re
´sultats.
Le type de protocole de de
´pistage ge
´ne
´tique va influencer
les re
´ponses affectives des sujets qui y participent.
Les motivations qui poussent l’individu a
`se soumet-
tre a
`ces tests devraient e
ˆtre plus souvent conside
´re
´es
puisque les attentes pre
´alables peuvent minorer la de
´tresse
lorsque les re
´sultats permettent de les satisfaire.
Ces diffe
´rentes e
´tudes posent ainsi la question des
consultations, de ce qui doit e
ˆtre aborde
´et comment.
En effet, l’objectif du conseil ge
´ne
´tique n’est pas de
de
´livrer une information me
´dicale stricto sensu.Ils’agit
d’apporter cette me
ˆme information dans le respect des
repre
´sentations, des de
´fenses et du ve
´cu du sujet qui
consulte. Il s’agit de s’assurer, autant que faire ce peut, que
la transmission du statut ge
´ne
´tique n’aura pas plus de
conse
´quences de
´le
´te
`resquecellesde
´ja
`augure
´es par la
perspective d’e
ˆtre malade.
Quelsprotocolesdeconsultations?
Les recherches mene
´es ces dernie
`res anne
´es dans le champ
de l’oncoge
´ne
´tique et les pratiques cliniques (clinique
30

me
´dicale et clinique psychologique) posent toujours la
question du de
´roulement des de
´pistages ge
´ne
´tiques. En
effet, les proce
´dures varient d’un centre a
`l’autre, allant du
pre
´le
`vement a
`l’issuedelarencontreinformative,a
`
l’instauration d’un de
´lai de re
´flexion, voire a
`la consulta-
tion psychologique obligatoire.
Compte tenu de la diversite
´dessituationsetdes
individus, il nous semble difficile de trancher en la faveur
d’un protocole ou d’un nombre de consultations a
`fixer
Ne
´anmoins, en ce qui concerne notre expe
´rience clinique,
il nous apparaı
ˆt indispensable de proposer un de
´lai de
re
´flexion, afin que le sujet puisse se de
´gager de l’autorite
´
me
´dicale, de la de
´sirabilite
´sociale, ou encore de son
engagement initial (cf. les travaux de Joule et Beauvois). Ce
de
´lai peut faciliter l’appropriation de la de
´marche, notamment
par le fait que le sujet est replace
´au centre de ce processus en
devenant le seul « de
´cideur » (du moins en dehors du regard
ou de la pression me
´dicale implicite
1
ou inconsciente).
Certains chercheurs ont ainsi tente
´d’e
´valuer un certain
nombre de proce
´dures que nous nous proposons de de
´crire ici.
Ge
´ne
´ralement, les mode
`les de consultation sont fonde
´s
sur ceux qui s’adressent aux de
´pistages ge
´ne
´tiques des
maladies de Huntington [17,28] et qui pre
´voient plusieurs
consultations pre
´alables, ainsi que d’autres rencontres a
`
l’issue du test avec suivi psychologique (le lecteur inte
´resse
´
par le ve
´cu d’un patient inscrit dans un de
´pistage pre
´dictif
de la maladie de Huntington peut consulter le livre de Jean
Barema, Le Test, paru en 2002).
Compte tenu des demandes qui sont importantes, Aktan-
Collan et al. [2] ont propose
´un protocole bref consistant en
une consultation informative, un de
´lai de re
´flexion de deux
semaines et une consultation de rendu de re
´sultat. Ce protocole
ae
´te
´e
´value
´sur 271 personnes consultant dans le cadre d’un
diagnostic pre
´dictif des cancers colorectaux he
´re
´ditaires non
polyposiques (HNPCC). 88 % des re
´pondants ont estime
´qu’il y
avait peu de changements a
`apporter a
`cette proce
´dure et 10 %
sugge
`rent qu’une information e
´crite serait utile. 89 % des sujets
conside
`rent que la consultation pre
´alable est tre
`s utile ou utile,
surtout les femmes ayant un bas niveau d’e
´ducation. 53 % des
sujets ont indique
´qu’ils auraient probablement utilise
´un
soutien psychologique au cours du protocole, principalement
les femmes ayant des enfants. 27 % des sujets auraient aime
´un
soutien avant la prise de de
´cision (pe
´riodedere
´flexion) et 87 %
au moment de la phase de de
´couverte des re
´sultats (52 % des
femmes et 35 % des hommes).
Les re
´sultats de cette e
´tude sugge
`rent e
´galement que la
rencontre avec un psychologue devrait e
ˆtre propose
´een
tant que partie inte
´grante des de
´pistages ge
´ne
´tiques. Les
auteurs pointent l’importance de l’e
´vocation des conse
´-
quences psychologiques possibles du re
´sultat, ce qui semble
aider a
`l’ajustement ulte
´rieur. Cette e
´vocation est suscep-
tible d’e
ˆtre facilite
´e par la non-directivite
´au cours de
l’entretien afin de permettre le libre e
´change et de de
´centrer la
consultation du discours rationnel quant au de
´pistage [15].
Ainsi, les diffe
´rents sce
´narios de re
´sultats possibles peuvent
e
ˆtre appre
´hende
´sdefac¸on a
`permettre au sujet d’envisager les
conse
´quences e
´ventuelles (autant que faire ce peut), d’aborder
les difficulte
´s qui se pre
´senteront (pas toujours en rapport
avec un re
´sultat de
´favorable comme nous avons pu
l’observer), ainsi que les croyances, l’expe
´rience personnelle,
les e
´motions et les motivations qui sont associe
´es a
`cette
de
´marche. Dans cette perspective, il nous semble e
´galement
utile d’aborder la possibilite
´de ne pas opter pour le de
´pistage.
Les consultations de ge
´ne
´tique impliquent ainsi d’aider les
familles a
`faire face aux conse
´quences e
´motionnelles, psy-
chologiques, me
´dicales, sociales et familiales et pas seulement a
`
la transmission d’une information me
´dicale complexe. A
`ce
titre, les consultations psychologiques ont toute leur place.
Ne
´anmoins, la mise a
`disposition de ces dernie
`res reste encore
souvent tributaire de la nature de la pathologie en cause. En
effet, les repre
´sentations me
´dicales des pathologies tiennent
une place pre
´ponde
´rante dans l’attribution d’une signification
psychologique douloureuse. Pourtant, du point de vue du
patient et de ses propres mode
`les, nous savons que plus que la
nature de la pathologie, ce sont les attributions, les significa-
tions et les repre
´sentations personnelles qu’il se forge qui sont
de
´terminantes [29]. Lorsque ces consultations sont inte
´gre
´es
au processus de de
´pistage, elles se dotent des objectifs
suivants :
Proposer un soutien e
´motionnel individuel
Faciliter la prise de de
´cision quant a
`la re
´alisation du test
Discuter de la communication familiale afin de
relever les difficulte
´se
´ventuelles face a
`la transmission
de l’information, les conflits
Re
´fle
´chir aux conse
´quences d’un test positif ET ne
´gatif
sur le plan psychologique, sur les relations conjugales, les
projets familiaux, la surveillance me
´dicale et sa fre
´quence
(en termes de ve
´cu possible).
Les travaux entrepris quant a
`la compre
´hension des
me
´canismes en jeu dans l’apparition d’e
´motions difficiles ont
ouvert la voie a
`des tentatives de prise en charge principale-
ment cognitive (ce qui n’exclut pas, bien su
ˆr, l’inte
´re
ˆt d’autres
approches conceptuelles). Les patientes issues de familles a
`
risque de cancers du sein, et qui ont participe
´a
`un
entraı
ˆnement a
`la re
´solution de proble
`mes, ont e
´prouve
´une
re
´duction plus importante de l’anxie
´te
´relative au cancer ;
contrairement a
`celles qui ont e
´te
´oriente
´es vers des
consultations plus ge
´ne
´ralistes. Ces re
´sultats nous semblent
inte
´ressants dans la mesure ou
`il est maintenant admis qu’une
de
´tresse e
´leve
´e interfe
`re avec la surveillance the
´rapeutique
[8,22]. En effet, cette me
ˆme population, dont l’anxie
´te
´
spe
´cifique au cancer e
´tait e
´leve
´e, a montre
´une augmentation
1
Nous ne signifions pas e
´videmment qu’il y a pression me
´dicale, mais
l’interaction, l’information, le poids du « que va-t-il penser », « je ne peux
pas diffe
´rer ou refuser le pre
´le
`vement », sont autant de facteurs implicites
qui peuvent influencer le comportement du sujet. A
`cela s’ajoutent bien
su
ˆr la pression familiale, les pactes fraternels
31
 6
6
 7
7
1
/
7
100%