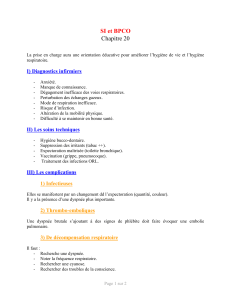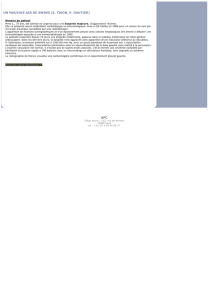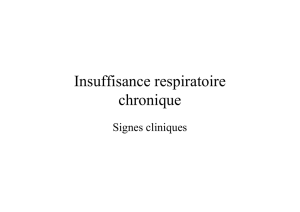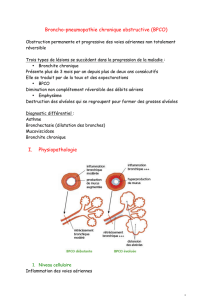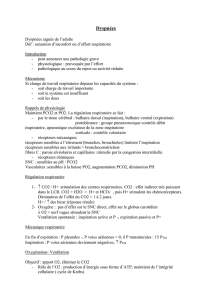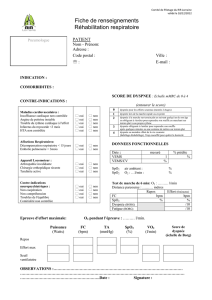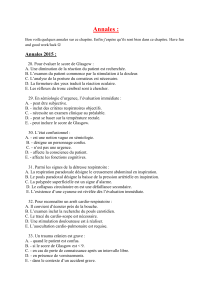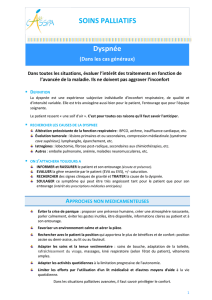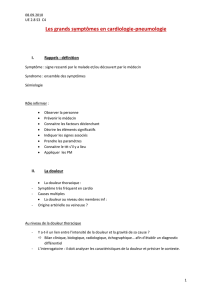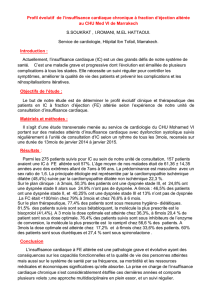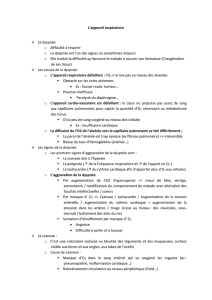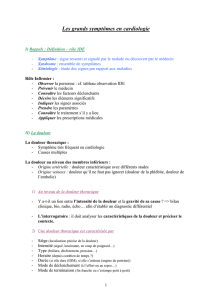Approches diagnostiques de la dyspnée chronique de l`adulte

16 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013
MISE AU POINT
Approches diagnostiques
de la dyspnée chronique
de l’adulte
Diagnosis approach of adulthood dyspnea
C. Delclaux*
* Service de physiologie – clinique de
la dyspnée, hôpital européen Georges-
Pompidou, AP-HP, Paris ; université
Paris-Descartes, Sorbonne Paris Cité,
faculté de médecine.
L
a conférence de consensus de l’American
Thoracic Society (ATS) publiée en 1999 et
reprise en 2012 définit la dyspnée comme étant
“une expérience subjective d’inconfort respiratoire
faite de plusieurs sensations élémentaires qualitati-
vement distinctes, variant en intensité. Cette expé-
rience est due à l’interaction de multiples facteurs,
physiologiques, psychologiques, sociaux et envi-
ronnementaux et peut induire des réponses secon-
daires physiologiques et comportementales” (1).
Par rapport à la plainte d’essoufflement, la dyspnée
est caractérisée par un affect ou un vécu négatif
(inconfort). Le diagnostic de dyspnée est donc un
diagnostic d’interrogatoire, le patient se présentant
pour une plainte d’essoufflement, qui est perçue
comme potentiellement pathologique. Cette plainte
a une importance pronostique puisqu’elle constitue
un facteur indépendant de mortalité des maladies
cardiorespiratoires dans la population générale, fait
bien établi mais mal expliqué.
L’approche diagnostique de la dyspnée ne fait
l’objet d’aucun consensus (1). Toutefois, du fait
de la fréquence du symptôme, il semble logique
d’essayer de rationaliser son exploration diagnos-
tique, objet d’ailleurs d’une des “conduites à tenir”
enseignées à nos étudiants en médecine pour leur
examen national classant (2).
Physiopathologie de la dyspnée
On peut distinguer, de façon réductrice, 2 grands
cadres physiopathologiques :
➤
les dyspnées en relation avec l’exercice et le
niveau de ventilation lié à l’effort respiratoire.
Exprimées par le patient comme une “difficulté”
respiratoire (charge respiratoire) augmentant avec
l’intensité de l’exercice, elles représentent la grande
majorité des dyspnées ;
➤
les dyspnées de repos, en relation avec le
stimulus hypercapnique et/ou hypoxémique, indé-
pendantes de l’effort respiratoire, et traduites par le
patient comme un manque d’air, voire une sensa-
tion asphyxique. Cette distinction est très sché-
matique sur le plan sensoriel, car bien souvent ces
sensations (effort/manque d’air) peuvent s’associer
ou se succéder, notamment à l’exercice, la sensa-
tion de difficulté inspiratoire/manque d’air étant
alors présente en fin d’exercice, lorsque l’expansion
du volume courant devient limitée, notamment
au cours de la bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO).
De façon schématique :
➤
la fonction du système respiratoire est d’assurer
une hématose normale ;
➤il existe des informations relatives aux pressions
partielles d’oxygène (O
2
)
et de gaz carbonique (CO
2
)
dans le sang artériel arrivant au système respiratoire ;
➤
des signaux partent du système de contrôle
respiratoire vers le système mécanique respiratoire,
permettant d’assurer la ventilation alvéolaire (obten-
tion d’une hématose normale). Le système mécanique
envoie des signaux au système de contrôle respiratoire
afin que ce dernier puisse “examiner” l’adéquation
entre l’ordre donné (commande respiratoire) et l’ordre
effectué (ventilation alvéolaire normale).
La dyspnée est liée à un déséquilibre entre la
commande respiratoire, elle-même liée à la demande
ventilatoire, et la réponse ventilatoire. La résultante
est une augmentation de la commande respiratoire
LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 16 28/02/13 16:22

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013 | 17
Points forts
»L’approche diagnostique de la dyspnée d’exercice peut être faite selon un schéma physiopathologique
donné par une équation décrivant la dyspnée comme résultant d’un déséquilibre entre demande et réponse
ventilatoires. La demande ventilatoire est explorée au repos en routine par la mesure de l’hématose et de
la diffusion du monoxyde de carbone (DLCO), la réponse ventilatoire par la mesure de la spirométrie, de
la pléthysmographie et des pressions maximales respiratoires.
»
La dyspnée en relation avec le niveau de ventilation est essentiellement présente à l’exercice et décrite
comme une difficulté respiratoire ou un effort respiratoire augmenté.
»
Une dyspnée de repos isolée, généralement décrite par un manque d’air, peut se voir au cours de l’asthme,
des syndromes d’hyperventilation alvéolaire et des dyspnées inexpliquées médicalement.
Mots-clés
Dyspnée
Adulte
Repos
Exercice
Diagnostic
Highlights
»
Diagnosis approach of exer-
tional dyspnea can be made
using a simple pathophysiolog-
ical schema using an equation
of ventilation determinants that
describes dyspnea as resulting
from an imbalance between
ventilatory demand and
capacity. Ventilatory demand
is assessed in routine practice
by resting blood gases and
DLCO, ventilatory capacity by
spirometry, body plethysmog-
raphy and respiratory muscle
assessment (maximal respira-
tory pressures).
»
Ventilation related dyspnea
is mainly encountered at
exercise and is described by
increased work or respiratory
effort.
»
Resting dyspnea, often
described as air hunger, is
encountered in asthma, hyper-
ventilation syndromes and
medically unexplained dyspnea.
Keywords
Dyspnea
Adult
Rest
Exercise
Diagnosis
afin de rétablir l’adéquation indispensable entre
la demande et la réponse et d’assurer l’hématose.
La dyspnée est la conséquence de l’intégration corti-
cale de cette nécessité d’augmenter la commande
ventilatoire et surtout de l’impossibilité d’assurer
la demande ventilatoire croissante à l’exercice.
La littérature récente montre que l’on peut distin-
guer 2 dimensions à cette plainte, l’une sensorielle
(décrite par des sensations respiratoires, liée à
l’état physiologique du patient), et l’autre affective
(émotionnelle, influencée par l’état psychologique
du patient) [3]. Une équation “périphérique” de la
dyspnée peut être proposée. Il s’agit bien sûr d’une
modélisation qui a des limites, mais dont l’objectif est
didactique. Cette équation a 2 termes : la demande
ventilatoire et la réponse ventilatoire. Dans cette
représentation, la dyspnée est donc avant tout liée à
la ventilation effectuée par le patient et donc à l’effort
musculaire respiratoire nécessaire (verbalisation de
type “effort respiratoire”, “difficulté respiratoire”)
puis à l’incapacité du système mécanique à assurer
la demande ventilatoire croissante lors des activités
(verbalisation de type “manque d’air”). La récente
conférence de consensus de l’ATS détaille des diffé-
rentes dimensions de la dyspnée et les échelles de
dyspnée évaluant chacune de ces dimensions (1).
La demande ventilatoire
Elle résulte de la nécessité pour le système respira-
toire d’assurer l’hématose via la ventilation alvéolaire.
Cette ventilation alvéolaire est réglée pour assurer le
maintien d’une pression artérielle en CO
2
(PaCO
2
)
constante quel que soit le niveau de production de
CO
2
par les tissus (V’CO
2
). La régulation de la PaO
2
intervient quant à elle essentiellement en situation
d’urgence (hypoxémie marquée). L’équation de la
ventilation dépend donc d’une V’CO
2
, d’un niveau
de régulation de la PaCO
2
(point de consigne) et de la
proportion de ventilation efficace (volume courant, VT
minoré de la ventilation “perdue” liée à l’espace mort
physiologique : VDph), c’est-à dire de la ventilation
alvéolaire par rapport à la ventilation totale (V’E).
L’équation de la demande ventilatoire est fournie dans
la figure 1. Elle est explorée au repos en routine par la
mesure de l’hématose et par le coefficient de diffusion
du monoxyde de carbone (kCO) [4].
Figure 1. Équation “périphérique” de la dyspnée.
En présence d’une altération de la demande ou de la réponse ventilatoire au cours des pathologies respiratoires chroniques, la restau-
ration de cette balance indispensable à l’homéostasie implique une augmentation de la commande ventilatoire permettant d’ accroître
la ventilation (demande accrue, augmentation secondaire de l’effort) ou l’effort respiratoire de façon primitive (réponse altérée). Lors
des activités, la demande ventilatoire augmente (V’CO2), un effort supplémentaire est fourni (perçu : sensation d’effort) jusqu’à ce que
l’incapacité du système mécanique face à la demande aboutisse à l’arrêt de l’effort (sensation de manque d’air).
Exercice = majoration de la demande majoration de l’effort (dyspnée d’“effort”).
Déséquilibre quand la capacité ne peut plus augmenter face à la majoration de la demande (dyspnée “manque d’air”)
Absence de plainte
Gaz du sang
kCO (DLCO)
Spirométrie
Impédance
Résistances
Volumes statiques
VA (DLCO)
Capacité altérée
Demande majorée
Demande ventilatoire
V
• E = k × V
•CO2/[PaCO2(1 – VDph/VT)]
Capacité ventilatoire
V
•E = RR × C × [ΔPm – RV
•]
Équilibre : état physiologique
Dyspnée
Cortex sensoriel
Commande
PO.1
+
+
LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 17 28/02/13 16:22

18 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013
Approches diagnostiques deladyspnée chronique del’adulte
MISE AU POINT
La réponse/capacité ventilatoire
Assurée par le système mécanique ventilatoire, elle
dépend de la capacité des muscles respiratoires à
assurer la ventilation alvéolaire face à l’impédance
du système respiratoire (contraintes mécaniques
résistives et élastiques). Ces muscles respiratoires
(inspiratoires essentiellement) vont devoir vaincre
des forces résistives (liées à la résistance du système
respiratoire [R], obstacle au débit V’ dans les voies
aériennes) et élastiques (élastance du système respi-
ratoire [E], obstacle au gain de volume courant : VT, à
une fréquence respiratoire donnée : FR) en créant des
modifications de pression (ΔPmus). L’équation de la
réponse ventilatoire est donnée dans la figure 1. Elle
est explorée au repos en routine par la spirométrie,
la pléthysmographie et les mesures de pressions
maximales à la bouche.
Étiologies des dyspnées
d’exercice en relation
avec le niveau de ventilation
Dyspnées en rapport avec
une augmentation de la demande
ventilatoire
➤
Diminution du point de consigne de la PaCO
2
:
elle est observée au cours des syndromes d’hy-
perventilation alvéolaire chronique. Toutefois,
l’augmentation de la ventilation n’explique pas à
elle seule la dyspnée de ces patients.
➤
Augmentation de l’espace mort physiolo-
gique : elle est observée dans toutes les patho-
logies s’accompagnant d’altérations vasculaires
pulmonaires (espace mort alvéolaire), comme les
hypertensions pulmonaires, l’emphysème, les
pneumopathies interstitielles et l’insuffisance
cardiaque gauche.
➤
Augmentation de la V’CO2 : c’est sans doute
l’aspect le plus discutable, mais il permet d’évoquer
les dyspnées qui seraient liées au déconditionne-
ment musculaire ou à l’anémie. En effet, dans ces
2 situations, il existe une diminution du seuil venti-
latoire avec survenue précoce de l’augmentation
de ventilation qui pourrait conduire à la dyspnée.
Globalement, en cas de déconditionnement et en
cas d’anémie, une diminution de la performance
est observée et, l’essoufflement maximal restant
constant, le sujet est trop essoufflé pour un effort
donné.
Dyspnées en rapport avec une altération
de la réponse ventilatoire
➤
Majoration de la résistance du système liée aux
pathologies bronchiques obstructives.
➤
Majoration de l’élastance du système respiratoire
(diminution de compliance) au cours des pathologies
fibrosantes pulmonaires, voire de la paroi thoracique
(obésité, spondylarthrite ankylosante).
➤
Diminution des capacités d’effort musculaire
respiratoire lors des affections musculaires de type
myopathies, mais aussi insuffisance cardiaque
gauche (myopathie de l’insuffisant cardiaque).
Stimuli liés à la chimioréception :
PaO2 et PaCO2
◆Hypoxémie
Les données de la littérature montrent que l’effet
dyspnéisant de l’hypoxémie chez le sujet sain est
surtout en relation avec l’augmentation de la venti-
lation, même si une sensation de manque d’air est
associée à l’hypoxie expérimentale. Les effets de
l’hypoxémie entrent donc globalement dans le
cadre des dyspnées liées à une augmentation de la
demande ventilatoire.
◆Hypercapnie
À l’opposé, l’hypercapnie présente bien un effet
dyspnéisant propre en l’absence de tout effort respi-
ratoire chez le sujet sain. En condition pathologique,
un effet dyspnéisant de l’hypercapnie se développant
à l’exercice a pu être montré chez certains patients
atteints de BPCO.
L’effet de l’hypercapnie semble associé de façon assez
spécifique à la sensation de manque d’air, d’asphyxie.
De façon étonnante a priori, ce type de sensation
respiratoire est celui qu’expriment bien souvent les
patients atteints de syndrome d’hyperventilation
alvéolaire chronique ou de dyspnées inexpliquées
médicalement (5). On peut supposer que le stimulus
dyspnéisant est la modification de capnie par rapport
au point de consigne plus que le niveau de capnie lui-
même. Ce type de dyspnée est exprimé bien souvent
au repos avec éventuelle majoration à l’effort.
Approche diagnostique
des dyspnées
Un logigramme est fourni dans la figure 2. Il est fondé
sur les 4 questions suivantes posées au patient et sur la
LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 18 28/02/13 16:22

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013 | 19
MISE AU POINT
réalisation d’une radiographie thoracique systématique :
1. Dans quelles circonstances êtes-vous gêné pour
respirer : au repos calme et/ou lors d’efforts, et pour
quel niveau d’effort (échelle du Medical Research
Council [MRC] : encadré) ?
2. Quelles sensations respiratoires éprouvez-vous
lors de la gêne : difficulté pour remplir ou vider les
poumons, respiration rapide, halètement, sensation
que l’on ne peut pas faire entrer tout l’air néces-
saire (manque d’air, inspiration insatisfaisante),
voire asphyxie ou encore constriction thoracique
(poumons serrés) ?
3. Y a-t-il des symptômes associés à votre gêne respi-
ratoire : douleurs thoraciques au repos et à l’effort,
toux, expectoration ?
4. Quels antécédents médicaux avez-vous (facteurs de
risque et antécédents cardiovasculaires et thrombo-
emboliques, tabagisme, antécédents respiratoires :
épisodes bronchitiques aigus, traitements pris) ?
La quantification de la dyspnée d’exercice est un
élément important, car, dans l’ensemble, plus la
plainte est sévère et plus la probabilité de trouver
une anomalie fonctionnelle est élevée. Ainsi les
dyspnées survenant pour des efforts très modérés
(marche rapide) chez un sujet d’âge moyen ou élevé
sédentaire posent souvent des problèmes diagnos-
tiques : normalité (physiologie du vieillissement
sédentaire) ou anomalie débutante ? Enfin, l’état
psychologique du patient peut bien sûr modifier la
plainte, mais les échelles de dyspnée en relation avec
les activités (de type MRC) ne semblent pas affec-
tées par cet état psychologique, car elles prennent
en compte la dimension sensorielle de la dyspnée
essentiellement (6). Des échelles spécifiques tenant
compte des dimensions sensorielle et affective de
la dyspnée sont disponibles mais actuellement non
traduites en français.
Il est évident que des antécédents du patient et des
réponses données à ces 4 questions dépendront les
stratégies des examens complémentaires ultérieurs.
Il est bien difficile d’envisager l’ensemble des arbres
diagnostiques que l’on pourrait fournir.
La plainte est présente au repos calme
Dans notre expérience, les dyspnées présentes au
repos se rencontrent essentiellement au cours de :
➤
la maladie asthmatique, le diagnostic d’inter-
rogatoire étant le plus souvent facile. Parfois, la
plainte est limitée à des épisodes de constriction
thoracique (sensation assez spécifique de la maladie
asthmatique [1]) avec sensation d’inspiration insa-
tisfaisante. Un test à la métacholine peut alors être
utile si la probabilité clinique d’asthme avant test
est intermédiaire ;
➤
les syndromes d’hyperventilation alvéolaire, qui
peuvent s’associer à la maladie asthmatique. Le
diagnostic de ces syndromes repose sur la mise en
évidence d’une hyperventilation alvéolaire (hypo-
capnie sans hypoxémie, donc inadaptée) sans
acidose métabolique associée, permanente et/
ou provoquée (test d’hyperventilation et épreuve
d’exercice avec V’O2/V’CO2). On pourra s’aider du
score clinique de Nijmegen. En l’absence de mise
en évidence d’une hyperventilation alvéolaire, il est
souhaitable de parler de dyspnée médicalement
inexpliquée (5). Le lecteur intéressé par ce sujet
pourra se référer à l’excellente revue générale faite
par W.N. Gardner (7) ;
➤le reflux gastro-œsophagien de façon indépen-
dante de l’asthme, notamment chez les obèses.
La plainte est présente uniquement
à l’exercice
➤On envisage que la dyspnée puisse être d’origine
cardiologique (antécédents, terrain, douleurs thora-
ciques associées).
Dans cette situation, un bilan cardiologique est
nécessaire : échographie cardiaque, électrocardio-
gramme (ECG) à l’effort et/ou scintigraphie myocar-
dique à l’effort. Il faut avoir à l’esprit qu’il n’existe
pas de corrélation entre le niveau de dysfonction
Elle évalue
la dimension “impact”
dela dyspnée
(1)
.
• Stade 1 : le patient est gêné
uniquement pour un effort
intense.
• Stade 2 : le patient est
essoufflé pour une marche
rapide à plat ou une légère
côte.
• Stade 3 : le patient marche
plus lentement que des
personnes du même âge ou
doit faire des pauses à cause
de sa dyspnée.
• Stade 4 : le patient doit
s’arrêter pour reprendre son
souffle après une marche
d’une centaine de mètres
ou après quelques minutes.
• Stade 5 : le patient est
trop essoufflé pour sortir de
chez lui ou est essoufflé en
s’habillant ou en se désha-
billant.
Encadré. Échelle de
dyspnée du Medical
Research Council.
Figure 2. Démarche diagnostique.
Dyspnée chronique de l’adulte
Radiographie thoracique
Interrogatoire : 4 questions
• Circonstances : repos/eort (stades MRC)
• Sémiologie de la dyspnée (descripteurs)
• Symptômes associés
• Antécédents cardiorespiratoires, métaboliques
Dyspnée de repos
Sémiologie : inspiration insatisfaisante, manque d’air
Mécanisme(s) : constriction/capnie
• Asthme
• Syndrome d’hyperventilation alvéolaire
• Dyspnée inexpliquée médicalement,
reflux gastro-œsophagien
Dyspnée d’exercice
Sémiologie : respiration dicile, avec eort
Mécanisme : déséquilibre balance demande/
capacité ventilatoires
• Origine cardiaque
• Origine respiratoire
• Acidose métabolique, anémie
LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 19 28/02/13 16:22

20 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 1 - janvier-février 2013
Approches diagnostiques deladyspnée chronique del’adulte
mise au point
cardiaque systolique ou diastolique et le niveau de
dyspnée d’exercice (en effet, le niveau de dyspnée
est essentiellement lié au niveau de ventilation à
l’exercice, lui-même en relation avec l’espace mort
physiologique) et que, au cours des cardiopathies
ischémiques, une dyspnée d’exercice isolée (sans
douleur thoracique) est présente chez environ 10 %
des patients. Le bilan fonctionnel respiratoire peut
montrer des arguments pour une cardiopathie
(trouble ventilatoire restrictif dans de rares cas,
obstruction bronchique minime, diminution des
pressions maximales à la bouche et, plus fréquem-
ment, altération du transfert du monoxyde de
carbone [DLCO]).
➤
On envisage que la dyspnée puisse être en relation
avec une BPCO (tabagisme cumulé > 15 paquets-
année, symptômes cliniques éventuels de bronchite
chronique).
Il existe une très faible corrélation entre le niveau de
dyspnée d’exercice et le degré d’obstruction bron-
chique. En revanche, il y a une meilleure corrélation
entre le niveau de dyspnée et la DLCO, retrouvée
dans la plupart des études (8). En effet, la DLCO est
le produit du kCO (sa diminution est le reflet de la
destruction vasculaire pulmonaire liée à l’emphy-
sème, augmentant la demande ventilatoire [4]) et du
volume alvéolaire (volume accessible à la ventilation,
dépendant donc de l’obstruction bronchique distale :
altération de la réponse ventilatoire). Les atteintes
obstructives et emphysémateuses consécutives au
tabagisme peuvent être dissociées. Ainsi, certains
patients ne présentent que la composante emphysé-
mateuse de la maladie responsable d’une diminution
précoce du kCO puis d’une distension. En pratique,
lorsqu’un sujet fumeur se plaint de dyspnée, il est
donc nécessaire de réaliser une spirométrie qui, si elle
est normale ou peu anormale, doit être complétée
par la mesure des volumes statiques par pléthys-
mographie et par celle de la DLCO. On complètera
l’examen, en cas de trouble ventilatoire obstructif,
par une mesure de la capacité inspiratoire après la
prise d’un bronchodilatateur d’action rapide. En effet,
l’effet bénéfique inconstant des médicaments bron-
chodilatateurs est associé à leur effet favorable sur
la distension dynamique de repos.
➤
On envisage que la dyspnée puisse être liée à une
pathologie interstitielle pulmonaire (sujet âgé, toux
associée notamment, anomalies évocatrices sur la
radiographie thoracique).
Là encore, la corrélation entre la dyspnée d’effort
et les anomalies spirométriques (diminution de la
capacité vitale) ou pléthysmographiques est faible.
Cette corrélation est meilleure avec la mesure de
la DLCO, car une augmentation de l’espace mort
physiologique est fréquente dans ce cadre.
➤
On envisage que la dyspnée puisse être liée à
une pathologie vasculaire pulmonaire (antécédents
thrombo emboliques, prise d’anorexigène, etc.).
Une scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfu-
sion, un angioscanner thoracique, une échographie
cardiaque de repos et, éventuellement, à l’effort ainsi
qu’un cathétérisme cardiaque droit constitueront le
bilan complémentaire. L’exploration fonctionnelle
respiratoire est généralement normale en dehors
d’un trouble ventilatoire obstructif minime (hyper-
tensions artérielles pulmonaires) et éventuellement
d’une diminution de la DLCO.
➤
On envisage que la dyspnée d’exercice puisse être
liée à une maladie asthmatique.
Une dyspnée d’exercice isolée (asthme induit à l’exer-
cice) est une situation exceptionnelle chez l’adulte
dans le cadre de la maladie asthmatique, en dehors
de la situation spécifique du trouble ventilatoire
obstructif fixé d’origine asthmatique (environ 20%
des asthmatiques adultes) et du bronchospasme
induit par l’exercice du sportif. Il n’est donc pas licite
de réaliser un test à la métacholine systématique si
le diagnostic d’asthme n’est pas étayé par l’inter-
rogatoire (probabilité a priori intermédiaire), car
la prévalence de l’hyperréactivité bronchique est
importante (environ 20 %) par rapport à celle de
l’asthme (environ 7 %) conduisant à un risque élevé
de surdiagnostic d’asthme.
➤
L’ensemble du bilan fonctionnel de première inten-
tion (radiographie thoracique, échographie cardiaque
de repos, spirométrie, pléthysmographie, DLCO) est
normal, la dyspnée “isolée”.
La réalisation d’une gazométrie artérielle doit être
systématique, à la recherche d’une hypoxémie isolée,
d’une anémie ou d’une acidose métabolique (rares
cas cliniques d’acidose métabolique se présentant
sous la forme d’une dyspnée isolée).
En cas de normalité de l’hématose de repos, on pourra
alors réaliser une épreuve d’exercice avec mesure de
V’O2/V’CO2 et de l’hématose au pic de l’effort. Cet
examen peut faire le diagnostic d’ischémie myocar-
dique, de syndrome d’hyperventilation alvéolaire
(chronique ou déclenché par l’effort), de pathologie
interstitielle débutante (plus sensible que la mesure
de DLCO [9]) ou de pathologie vasculaire pulmonaire
avec hypertension pulmonaire présente uniquement à
l’exercice (arguments indirects). Il peut aussi montrer
une distension dynamique à l’exercice d’une BPCO
dans une situation où le trouble ventilatoire obstructif
de repos est discret. Le diagnostic de dyspnée liée
à un “déconditionnement musculaire” (manque de
LPN1 Janv-Fev 2013-01.indd 20 28/02/13 16:22
 6
6
1
/
6
100%