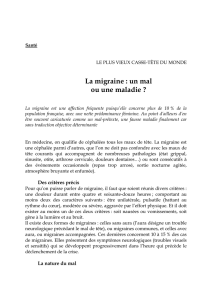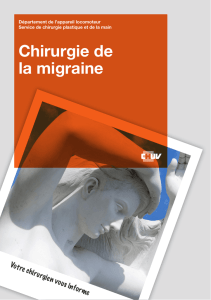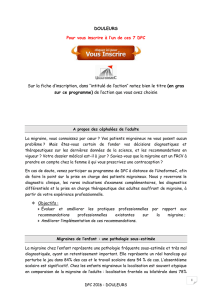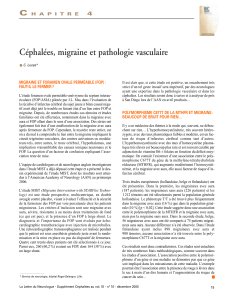Migraine

Migraine : une maladie qui se soigne • www.frm.org 1
Migraine :
une maladie qui se soigne
Propos recueillis à l'occasion d'un débat grand public organisé
par la Fondation Recherche Médicale et France Info dans le
cadre des "Rencontres santé". Vendredi 25 juin 2004, à la
Maison de la Radio (Paris). Débat animé par Marina Carrère
d’Encausse, co-présentateur du Journal et du magazine de la
santé sur France 5.
Document disponible sur le site de la Fondation Recherche
Médicale www.frm.org
Publication : août 2004.
Crédits photos : Fondation Recherche Médicale
Avec la participation de :
> Pr Gilles Géraud
Chef du service de neurologie du CHU de Toulouse-Rangueil,
président de la Société française d’étude des migraines et céphalées.
> Dr Hélène Massiou
Service de neurologie de l’Hôpital Lariboisière, Paris.
> Pr André Pradalier
Directeur du centre Migraines et céphalées de l’hôpital Louis Mourier de Colombes,
secrétaire général du Club Migraines et céphalées.
Marina Carrère d’Encausse – « Plus de six millions de Français sont concernés par la migraine. Les
femmes en sont les premières victimes, surtout les femmes jeunes puisque la migraine touche plus
25 % des femmes âgées de 30 à 39 ans.
On estime par ailleurs que 5 % à 10 % des enfants souffrent de
migraine. Quand on sait en outre à quel point la migraine peut faire
souffrir, on comprend bien que cette affection altère la qualité de
vie. Alors que des traitements existent, 8 migraineux sur 10 ne
consultent pas, et un sur deux a recours à l’automédication.
Tout ce que souhaitez savoir sur les migraines ainsi que les
réponses à vos questions sont à retrouver dans cette synthèse du
débat. »
SOMMAIRE
La prise en charge de la migraine :
manque d’information ou de formation ?…. p. 2
À chaque migraineux son traitement
………. p. 3
Vivre avec la migraine …………………….…. p. 5
À propos de la Fondation
Recherche Médicale ………………………..… p. 9
Pour en savoir + ………………………………. p. 9

Migraine : une maladie qui se soigne • www.frm.org 2
La prise en charge de la
migraine : manque
d’information ou de formation ?
Pr Gilles Géraud,
Chef du service de neurologie du CHU de Toulouse-
Rangueil, président de la Société française d’étude
des migraines et céphalées.
> Pourquoi est-on migraineux ?
La migraine part du cerveau et non des yeux,
des sinus, du cou, de la vésicule biliaire ou du
foie. En revanche, il existe beaucoup de
facteurs déclenchants qui peuvent être liés à
l’alimentation, à la vue, au cou… Pour des
raisons que l’on ne
connaît pas encore très
bien, on observe au
niveau de
l’hypothalamus une
activation d’amas
cellulaires - de
neurones - qui vont
déclencher le
processus de migraine.
D’une certaine façon,
ce dernier pourrait être
comparée à un orage. Dans un premier temps,
l’atmosphère s’alourdit : le migraineux se sent
anormalement fatigué ou a une appétence
particulière. La migraine est globalement un
conflit entre le neurone et le vaisseau. Les
éclairs de l’orage peuvent être comparés à ce
que voient 20 % des migraineux au début de
leur migraine : l’aura visuelle (flash voire figures
hallucinatoires). Ce phénomène enclenche un
processus au niveau des méninges, c’est-à-dire
l’enveloppe du cerveau. De l’hypothalamus
partent des ordres qui activent le système
trigémino-vasculaire, lequel provoque une
dilatation et même une inflammation stérile
(non bactérienne) des méninges. La
vasodilatation autour du cerveau va entraîner la
libération de toute une série de substances qui
vont entretenir le phénomène, l’étendre sur les
méninges et provoquer la douleur.
> Epidémiologie* de la migraine.
Il est difficile de définir les frontières de la
migraine. En effet, certains maux de tête sont
idiopathiques, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas
dus à une lésion, une tumeur ou à un
hématome. 30 % des Français souffrent de
céphalées idiopathiques. On estime qu’il existe
en réalité 12 % de migraineux, c’est-à-dire des
personnes répondant à l’ensemble des critères
IHS (international headache society) de la
migraine. Si l’on admet qu’il peut manquer un
de ces critères pour définir une migraine, on
atteint 20 % de migraineux.
L’enquête FRAMIG 3*, dont les résultats ont été
publiés en décembre 2003, montre que, parmi
ces personnes, seulement 40 % savent qu’elles
sont migraineuses, 30 % n’ont pas identifié
leurs maux de tête comme une migraine et
30 % pensent qu’elles ne sont pas
migraineuses. Ce sous-diagnostic de la
migraine mérite réflexion. C’est sans doute la
raison pour laquelle seulement 1 migraineux
sur 5 consulte un médecin. Parmi les autres,
certains n’ont jamais consulté tandis que
d’autres ont cessé de consulter. Vis-à-vis de
ces derniers, le corps médical a sans doute une
responsabilité. Enfin, 50 % des migraineux
pratiquent l’automédication en allant
directement chez le pharmacien pour se
procurer des produits sans ordonnance,
lesquels peuvent calmer les crises mais, bien
souvent, ne peuvent les arrêter définitivement.
Question du public – « L’origine de la migraine
est-elle d’ordre génétique ? Dépend-elle d’une
pollution atmosphérique ? »
Pr G. Géraud - Il y a, en effet, très
vraisemblablement une origine génétique à la
migraine. Elle est prouvée pour certaines
formes de migraine (migraine hémiplégique
familiale). L’activité des neurones est régulée
par des canaux laissant passer des ions
sodium / potassium. La stabilité du neurone
dépend donc de l’équilibre de ces canaux. Les
dysfonctions ou insuffisances à ce niveau sont
d’origine génétique : le neurone du migraineux
est plus « excitable » que le neurone du non-
migraineux. De fait, certaines personnes ont un
seuil migraineux extrêmement élevé : la
moindre contrariété, le moindre stress peut
provoquer une crise. On utilise actuellement
des traitements pour rendre le neurone moins «
excitable ». C’est pourquoi, certains traitements
de la migraine utilisés aujourd’hui ont en fait été
mis au point initialement pour traiter l’épilepsie.
Question du public – « Considérez-vous la
migraine comme une maladie ? »
Pr G. Géraud - Sur un plan physiopathologique,
si l’on s’appuie sur la notion de seuil
migraineux, on peut dire que les personnes
migraineuses sont plus ou moins sensibles. Et
les personnes qui vont faire quelques crises
migraineuses dans leur vie ne peuvent être

Migraine : une maladie qui se soigne • www.frm.org 3
qualifiées de « malades ». En revanche,
beaucoup de migraineux ont des crises
fréquentes et doivent être considérés comme
des malades. D’ailleurs, la migraine est jugée
comme l’une des maladies potentiellement les
plus handicapantes par l’OMS*.
Pr A. Pradalier - Il y a maladie migraineuse en
cas de répétition de crises.
Question du public – « Existe-t-il un lien entre
certains types de méningite et les migraines ? »
Pr G. Géraud - Non. Dans presque tous les
cas, la méningite est due à l’introduction dans
l’organisme d’un agent pathogène. Cela dit, par
certains aspects, on peut considérer la crise
migraineuse comme une méningite aiguë,
stérile et qui se répète. Et les signes de la
méningite, sauf la fièvre, sont très proches de la
crise migraineuse : céphalée, vomissements,
photophobie*…
Pr A. Pradalier - Par définition, la migraine
présente un caractère unilatéral : elle ne
concerne qu’un côté du crâne. Par ailleurs, si
l’on sait comment une crise se déclenche, on
ignore pourquoi elle s’arrête.
Question du public – « Je suis migraineuse
depuis l’âge de 13 ans et cette situation est
insupportable. Comment ne pas être
découragée ? »
Pr G. Géraud – Assurez-vous avant tout de
consulter un médecin vraiment spécialisé dans
le domaine de la migraine.
Pr A. Pradalier – 10 % des migraineux
« posent » d’énormes problèmes dans le sens
où leur migraine est difficile à soigner. Mais la
situation peut évoluer. De plus, il convient de
rechercher des facteurs supplémentaires - les
co-morbidités - qui aggravent l’état du
migraineux. Il s’agit de l’anxiété, des troubles
de la personnalité (parfois troubles dépressifs)
ou de l’abus médicamenteux.
M. Carrère d’Encausse – « Les médecins sont
souvent très mal formés en la matière. Cette
formation va-t-elle s’améliorer ? »
Pr G. Géraud - Un médecin suit, en moyenne,
deux heures de cours sur les céphalées au
cours de sa formation… Toutefois, cette
situation devrait évoluer. L’Agence nationale
d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes)
fait des recommandations en ce sens à
l’attention des médecins. Elle a notamment
édité un auto-questionnaire sur le traitement
usuel de la migraine.
Question du public – « J’ai longtemps souffert
de ce que l’on appelle les migraines
ophtalmiques. Je prends désormais du
Gynergene® mais sa consommation ne peut
être trop fréquente. Que faire ? »
Pr G. Géraud - Le Gynergene® empêche la
céphalée d’apparaître ou va l’interrompre en
moins de deux heures. L’auto-questionnaire sur
le traitement usuel comporte quatre questions :
• Êtes-vous soulagé en moins de deux
heures ?
• Tolérez-vous le médicament ?
• Une seule prise par crise ?
• Reprenez-vous vos activités habituelles en
moins de deux heures ?
Si vous répondez positivement à ces quatre
questions, ne changez rien à votre traitement
habituel.
À chaque migraineux
son traitement
Dr Hélène Massiou,
Service de neurologie de l’Hôpital Lariboisière, Paris.
On ne sait pas guérir la migraine. En effet, il
s’agit d’une maladie liée à une excitabilité
anormale dans le
cerveau. On peut
cependant modifier cette
excitabilité. En outre, la
migraine peut fortement
évoluer au cours de la vie,
voire disparaître d’elle-
même vers l’âge de 50 ou
60 ans.
Nous disposons d’un
arsenal thérapeutique conséquent et qui permet
de proposer deux types de traitement :
• le traitement de la crise
Il concerne tous les migraineux et vise à arrêter
la crise au plus vite.
• le traitement de fond
Il s’agit d’un médicament, ou d’une méthode
non-médicamenteuse, dont le but est d’espacer

Migraine : une maladie qui se soigne • www.frm.org 4
les crises et qui est réservé à des patients qui
ont un nombre relativement élevé de crises par
mois ou qui ont de grandes difficultés à couper
leurs crises.
Les traitements de la crise se répartissent entre
traitements non spécifiques et traitements
spécifiques.
Les premiers recouvrent les antalgiques* et les
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). La
majorité des migraineux utilisent ce type de
traitement et les achètent avec ou sans
ordonnance. Il est tout à fait légitime de
prescrire des anti-inflammatoires non
stéroïdiens voire des antalgiques de grade 2 à
un migraineux. Mais un grand nombre de
migraineux ne sont pas soulagés par ces
antalgiques et doivent passer aux traitements
spécifiques qui sont uniquement délivrés sur
ordonnance. Cela suppose donc qu’ils
consultent et que le médecin soit au fait de ces
traitements.
Les traitements spécifiques sont de deux
classes : les ergotés et les triptans qui ont fait
l’objet de nombreux développements ces
dernières années. Ces derniers peuvent être
utilisés de façon sûre mais ne peuvent être
prescrits chez des personnes qui ont des
antécédents de troubles coronariens et
d’hypertension artérielle. Les triptans ont
transformé la vie d’un grand nombre de
migraineux mais restent trop peu utilisés (9 %
d’utilisation chez les migraineux en France).
Parmi les grandes classes médicamenteuses
du traitement de fond, on trouve les
bêtabloquants et d’autres molécules
spécifiques comme les anti-épileptiques.
D’autres techniques peuvent également se
révéler efficaces : acupuncture, relaxation... Le
traitement de fond sera proposé à un
migraineux pour lequel un médicament de crise
est peu efficace et qui souffre d’un handicap
non négligeable lié à sa migraine. Ce traitement
de fond est nécessaire lorsque le migraineux
utilise plus de 8 à 10 jours par mois, un
médicament de crise.
L’une des spécificités de la migraine par rapport
aux autres douleurs tient précisément aux
risques d’abus médicamenteux. Il concerne des
migraineux qui, dans des contextes de
surcharge de travail, de stress, de dépression,
voient leurs crises migraineuses devenir plus
fréquentes. Cette situation les amènent à
multiplier les traitements de crise (spécifiques
ou non spécifiques). Se développe alors un
phénomène d’accoutumance et de rebond : la
prise du médicament, toujours plus fréquente,
est de moins en moins efficace… Le
migraineux souffre alors d’une céphalée
chronique par abus médicamenteux dont la
seule issue est le sevrage. Dans certains cas, il
est nécessaire d’hospitaliser les patients dans
le cadre de ce sevrage. Dans tous les cas, un
traitement de fond doit être institué et poursuivi
au moins six mois. Si le migraineux souffre par
ailleurs de dépression, celle-ci doit également
être prise en charge.
En résumé, il faut adapter les traitements à
chaque patient. Or beaucoup de migraineux se
découragent après la première consultation
lorsqu’ils n’obtiennent pas d’emblée un résultat
satisfaisant, ce qui ne permet pas au médecin
de trouver, pas à pas, le traitement le plus
approprié.
M. Carrère d’Encausse – « L’automédication
peut-elle être dangereuse ? »
Dr H. Massiou - L’automédication entre dans la
catégorie des traitements de crise non
spécifiques. Elle peut être utile à certains
migraineux. Elle est dangereuse en termes
d’abus médicamenteux et d’autant plus qu’elle
est, par définition, accessible à tous.
Question du public – « Je suis migraineuse
depuis l’âge de 5 ans et ai essayé une
multitude de traitements, de fond comme de
crise, qui sont devenus, petit à petit, inefficaces.
Je suis suivie depuis quatre ans à l’Hôpital
Lariboisière et ai été hospitalisée il y a deux
mois. J’ai le sentiment d’avoir tout essayé… Me
préconisez-vous de passer certains examens
spécifiques ? »
Dr H. Massiou - Il n’existe aucun moyen
d’identifier la migraine par le biais d’un examen.
L’imagerie et le laboratoire ne sont d’aucune
aide dans un cas comme le vôtre, malheureu-
sement classique.
En revanche, de nouvelles pistes médica-
menteuses sont explorées, notamment avec les
antiépileptiques. Toutefois, la réponse aux
antimigraineux relève d’une sensibilité
individuelle : les médicaments doivent être
essayés mais ne sont pas nécessairement
efficaces. Des associations de traitements de
fond peuvent être proposées en cas d’échecs
successifs de traitements pris isolément.
Pr G. Géraud - Beaucoup de migraineux ont le
sentiment d’avoir tout essayé. C’est rarement

Migraine : une maladie qui se soigne • www.frm.org 5
vrai. De plus, ces traitements n’ont pas toujours
été suivis dans les meilleures conditions.
Pr A. Pradalier - Au sein du Club Migraines et
céphalées, j’ai rencontré un certain nombre de
cas « difficiles ». Cependant, j’aimerais insister
sur le fait que, sur une vie entière, globalement,
dans au moins 80 % des cas, on parvient à des
résultats positifs. L’existence de telles
associations est aussi une façon d’encourager
la recherche.
Question du public – « Je suis kinésithérapeute.
Certains patients m’ont signalé des problèmes
de migraine. Après trois ou quatre séances de
mobilisation vertébrale, leur douleur a
disparu. »
Dr H. Massiou - L’acupuncture et la relaxation
ont fait l’objet de « grands essais contrôlés ».
La controverse sur l’ostéopathie et les
manipulations cervicales est complexe. Les
liens entre le cou et la migraine ne sont pas
clairement identifiés même si 30 % des
migraineux disent souffrir du cou pendant leurs
crises. En réalité, seules de très rares
migraines sont d’origine cervicale. La crise se
déclenche en cas de mauvaise posture ou lors
du port d’un objet lourd. À ce jour, une seule
étude a mis en évidence que, dans les très
rares migraines d’origine cervicale, on apporte
aux patients un éventuel bénéfice par la
manipulation cervicale. Mais quand on fait une
manipulation avec torsion du cou, on risque de
provoquer une dissection des artères du cou,
c’est à dire la formation d’un hématome dans
leur paroi qui peut entraîner un accident
vasculaire cérébral. Par conséquent, la
manipulation cervicale n’est pas un geste
anodin. Ce geste ne doit être indiqué que dans
des cas très particuliers, lorsque l’on a la
conviction que l’on peut apporter un bénéfice
au patient qui sera supérieur au risque qu’on lui
fait prendre. À ce titre, le patient doit être
informé des risques que cette manipulation
comporte.
L’ostéopathie, les thérapies manuelles douces
sont un peu différents. Il s’agit avant tout de
détendre le patient.
Pr A. Pradalier - Il peut exister un lien entre le
cou et le mal de tête, mais pas forcément entre
le cou et la migraine dont nous parlons.
Question du public – « Que pensez-vous des
bienfaits du yoga pour ce type de maladie ? »
Dr H. Massiou - Le yoga est intéressant dans
ce cadre s’il se présente comme une relaxation.
En revanche, plusieurs patients m’ont dit
souffrir parfois de crises migraineuses pendant
des séances de yoga au cours desquelles ils
adoptent des postures forcées ou prolongées.
D’une façon générale, nous préconisons des
techniques de relaxation des muscles
cervicaux.
Pr A. Pradalier - Ces techniques ne sont pas
forcément contre-indiquées. Nous pensons en
revanche qu’elles doivent être adaptées à
chaque patient.
Vivre avec la migraine
Professeur André Pradalier
Directeur du centre Migraines et céphalées de
l’hôpital Louis Mourier de Colombes Secrétaire
général du Club Migraines et céphalées.
J’aimerais au préalable insister sur l’utilité de la
Fondation Recherche Médicale et sur le fait que
nous devons aider cette Fondation.
La recherche est de trois ordres :
• recherche épidémiologique ;
• recherche physiopathologique ;
• recherche thérapeutique.
Cette dernière doit être
développée,
notamment sur les
traitements préventifs.
Je dirige un club de
migraineux – le club
migraines et céphalées
- depuis 1981. En
1996, ce club a réalisé
une enquête sur les
facteurs favorisant la
survenue des crises. Je rappelle que ces
facteurs ne sont pas la cause de la migraine.
Ainsi, les personnes interrogées ont cité,
comme facteur favorisant :
• le stress (68 % des personnes
interrogées) ;
• l’anxiété (43 %) ;
• la contrariété (32 %) ;
• les soucis (32 %) ;
• les grandes émotions (18 %) ;
• l’état dépressif (18 %).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%