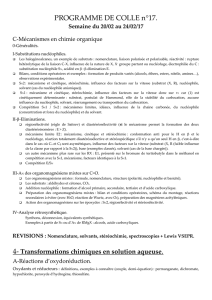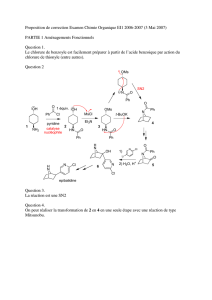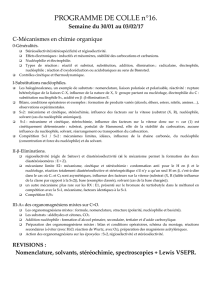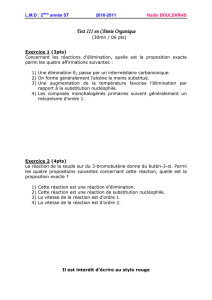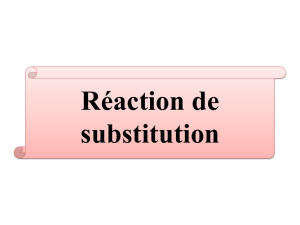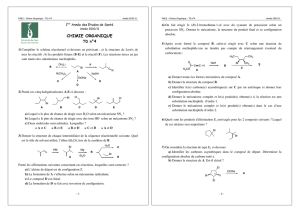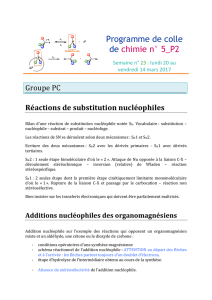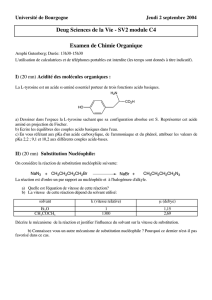R`–O - PCE76

1
GP
H
δ+
δ+
Site acide
Attaque par Base
non étudié ce jour Site électrophile
Attaque par Nucléophile
Site basique et nucléophile
Attaqué par proton
FONCTIONS MONOVALENTES
AVEC CARBONE FONCTIONNEL TÉTRAÉDRIQUE
Le carbone fonctionnel est tétraédrique et lié à un UNIQUE hétéroatome.
On distingue :
• R–X : halogénoalcane
• R–OH : alcool • R–NH
2
, RR’NH, RR’R’’N : amine
• Mais aussi R–O–R’, R–OTs, R–N
+
R’
3
R
É
ACTIVIT
É
N
OTION DE GROUPE PARTANT
Définition :
C’est une espèce stable qui part, en général une base faible. Il y a rupture
hétérolytique de la liaison C–GP.
Règle : Plus la base est faible, meilleur est le GP.
BGP : X
–
, TsO
–
, H
2
O, amine… MGP : HO
–
, RO
–
... TMGP : NH
2–
Chimie des R–X "directe" :
les S
N
(substitutions nucléophiles) et les βE (β-éliminations).
Il suffit d'ajouter le nucléophile et la réaction se déroule.
Chimie des alcools "indirecte"
il faut transformer le MGP = OH
–
en BGP avant de faire la S
N
ou la βE
Il y a deux façons de faire :
a) On protone souvent un alcool pour faire apparaître H
2
O (donc le milieu est acide !)
R–OH + H
+
⇄ R–OH
2+
Cette étape est un équilibre rapide.

2
b) On estérifie l’alcool (surtout s’il est primaire et/ou secondaire).
Pour être efficace (réaction totale et rapide), on utilise un chlorure d’acide.
Cl
O
Et-OH
N
O-Et
O
H-Cl capté par pyridine
++
Et-OH
N
H-Cl capté par pyridine
SCl
O
OSO-Et
O
O
++
Ts–Cl + Et–OH
⇄
Ts–O–Et + H–Cl capté par pyridine
Chimie des amines "indirecte" et difficile
.
On va laisser de côté pour le moment.
N
UCL
É
OPHILIE
-
R
APPELS
Définition
:
Un nucléophile est une espèce neutre (molécule) ou négative (anion) dont un atome
peut céder un doublet d'électrons.
Rq : c'est donc aussi une base de Brondsted ce qui peut poser des problèmes !
ex : H2O, HO–, ROH, RO–, R–NH2,
Propriétés :
un nucléophile est d’autant meilleur qu’il est
gros
et
chargé négativement.
H2O moins bon nucléophile que HO–
HO– moins bon nucléophile que HS– (car Rayon(O) < Rayon(S))
Conséquences
:
Rappel : R(F) < R(O) < R(N) sur la deuxième période
Les amines sont de très bons nucléophiles (alkylation des amines).
Les alcools sont des
nucléophiles assez moyens
.
Les R–X ne réagissent pas (via X).
A
CIDIT
É
DE
GP
(
AU SENS DE
B
RONDSTED
)
Il faut que GP possède un H lié à l'hétéroatome donc alcool, amine primaire et secondaire !
Couple acide-base :
R–OH / R–O– pKA # 16-18
R–NH2 / R–NH– pKA # 30-33
RR’NH / RR'N– pKA # 30-33
RH / RMgX pKA # 40
RH / RLi pKA # 40
H2 / H– pKA # 35
Formation de R–O– meilleur nucléophile que R–OH en utilisant une base très forte.

3
LES SUBSTITUTIONS NUCLÉOPHILES
B
ILAN
:
N
U
–
+
R–GP
=
N
U
–R
+
GP
–
E
XEMPLES
:
H
2
O
+
R–B
R
=
HO–R
+
HB
R
(passage d'un RX à un alcool)
HO
–
+
R–B
R
=
HO–R
+
B
R
–
(passage d'un RX à un alcool)
NH
3
+
R–B
R
=
H
2
N–R
+
"HB
R
"
(passage d'un RX à une amine primaire)
R'–NH
2
+
R–B
R
=
RR'NH
+
"HB
R
"
(passage d'un RX à une amine secondaire)
H
+
+
C
L
–
+
R–OH
=
C
L
–R
+
H
2
O
(passage d'un alcool à un RX)
X
–
+
R–OT
S
=
X–R
+
T
S
O
–
(passage d'un "alcool activé" à un RX)
R'–O
–
+
R–C
L
=
R'–O–R
+
C
L
–
(synthèse de Williamson des éthers)
S
N
2
OU
S
UBSTITUTION NUCLÉOPHILE BIMOLÉCULAIRE
Une seule étape concertée dans laquelle le nucléophile « entre » en même temps que le
groupe partant « s’en va ».
Le nucléophile est donc aussi puissant que le nucléofuge. Le solvant est polaire
aprotique.
La réaction est stéréospécifique ANTI.
Souvent SN2 prédomine.
S
N
1
OU SUBSTITUTION NUCLÉOPHILE MONOMOLÉCULAIRE
Cas limite où le nucléofuge « s’en va » avant que le nucléophile n’attaque. Il y a donc 2
étapes.
Le carbocation intermédiaire est plan donc pas de stéréosélectivité a priori.
S
N
1
OU
S
N
2 ?
S
N
1 : Si le carbocation créé lors de la S
N
1 est stable (classe III ou conjugaison)
S
N
2 : Si le carbocation créé lors de la S
N
1 n’est pas stable (classe I) ou si le milieu est
fortement basique
Cas litigieux : le C fonctionnel est de classe II ; regarder la nature du solvant et voir s’il
est très polaire auquel cas c’est S
N
1.
Seule l’expérience décide ! et souvent les deux mécanismes coexistent.

4
STRATÉGIES DE SYNTHÈSE (TS)
O
BSERVATION
:
- Quels groupes doivent réagir ?
- Faut-il les activer ?
- Y a -t-il d'autres groupes dans les molécules ?
- Si oui il faut les protéger
S
TRAT
É
GIES
:
1. Protection
DES
groupes "inutiles"
2. Activation des groupes utiles
3. Réaction
4. Déprotection
S
YNTH
È
SE D
’
UN
«
ANNEAU DE
M
ÖBIUS
»
:
L
ES REACTIONS UTILES
Sur les alcools
• un alcool est un acide faible peu nucléophile (questions 8, 9, 10, 17, 19)
pK
A
(ROH/RO
–
) = 16
RO–H + H
–
→ H
2 (gaz)
+ RO
–
avantage RO
–
est un Bon Nucléophile obtenu propre car H
2
s’en va
• un alcool primaire et secondaire s’estérifie « bien » avec un chlorure d’acide
R–OH + Ts–Cl → R–OTs + « HCl » HCl est capté par la pyridine
TsO
–
est un BGP
Mécanisme A
N
+ E (questions 14, 15, 16, 18, 20)
• protection du groupe OH (questions 2, 3, 4, 5, 6, 7)
R–OH + DHP → R–OTHP
• déprotection (questions 12, 18, 20)
R–OTHP → R–OH
Sur les RX primaires (généralisable à R–GP)
• Réaction de substitution nucléophile
Nu
–
+ R–X → R–Nu + X
–
bilan = substitution nucléophile
• Mécanisme S
N
2 : bimoléculaire et UNE étape concertée
R’O
–
+ R–X → R’O–R + X
–
synthèse d’un éther
Sur les C=C : coupure !
OsO4 catalytique suivi de NaIO4 stoechiométrique (questions 24)
R
4
R
2
R
1
R
3
O
R
1
R
3
OR
4
R
2
+
1) OsO
4
catalytique
2)NaIO
4
stoechiométrique
1
/
4
100%